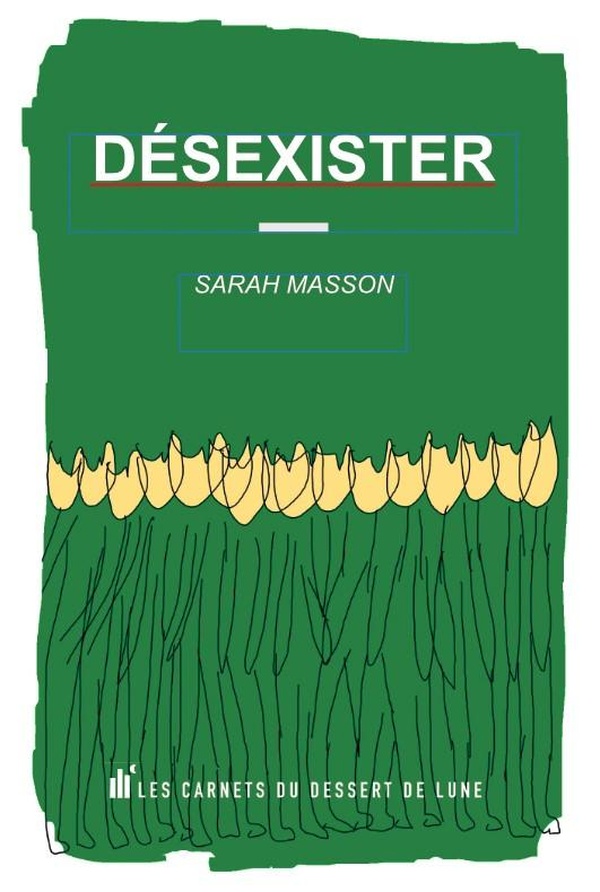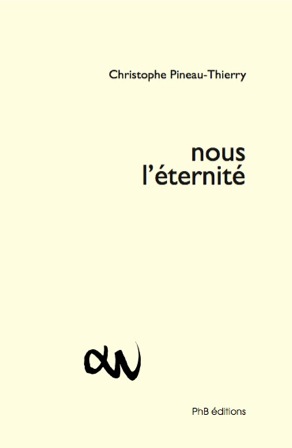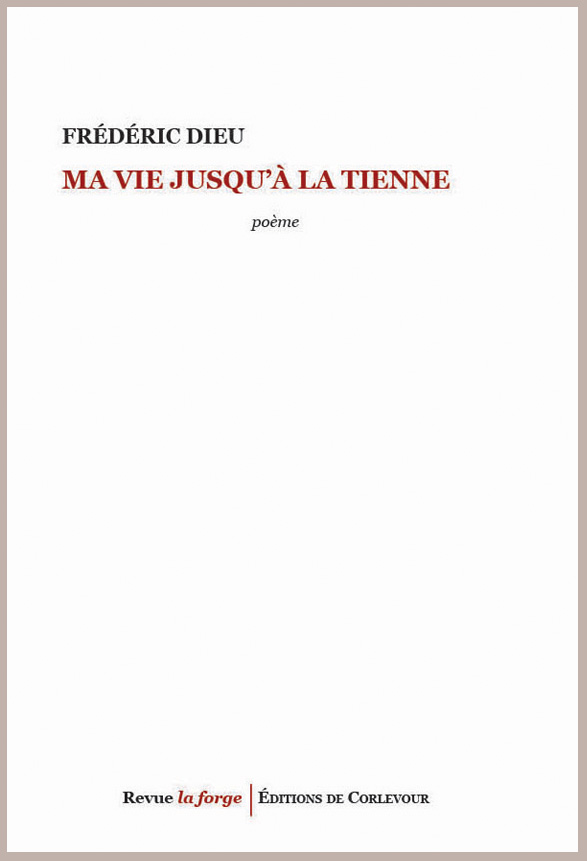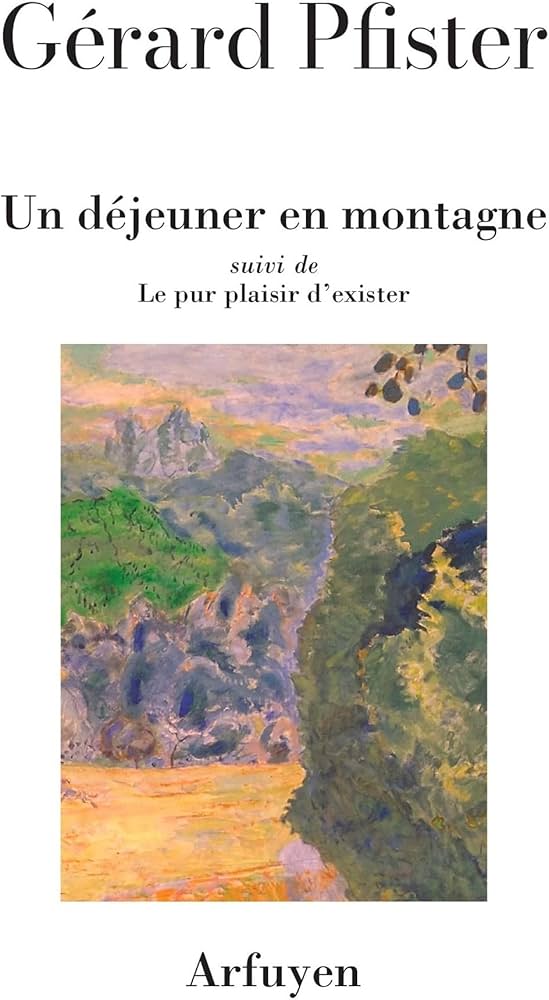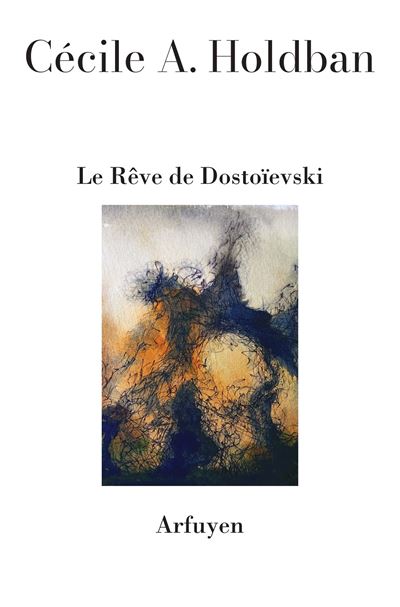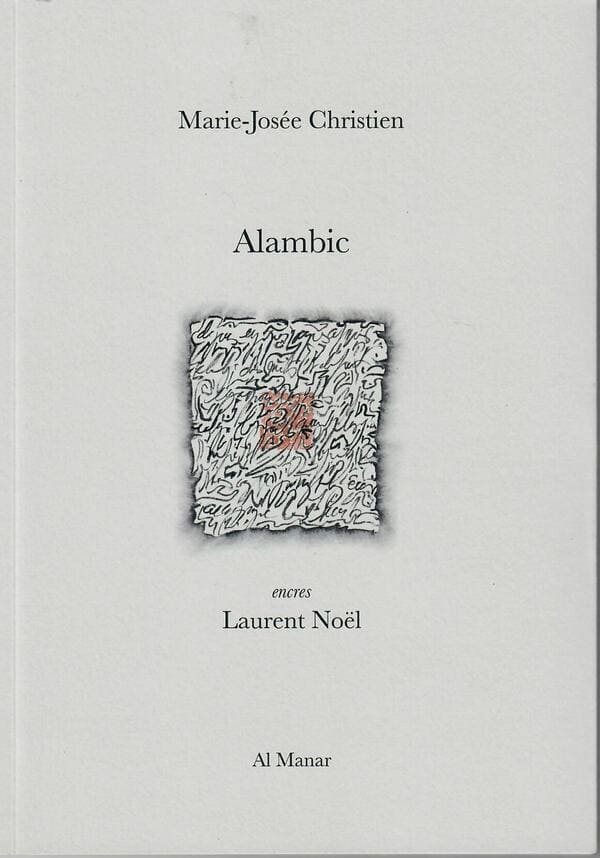Au vertige du tremblement, quel dénouement pour le deuil, se demandait son âme ?
Comme Damien Paisant qui interroge Iren Mihaylova en regard de Tirer les ombres. Cette question ne serait-elle pas la voile pour le bateau qui nous traverse à la lecture de ce recueil ? Elle évoque un moment de vacillement — « le vertige du tremblement » — où tout semble s’effondrer intérieurement, et où l’âme s’interroge sur ce qu’il lui reste après la perte : le « dénuement » du deuil, c’est-à-dire la nudité, la pauvreté fondamentale de l’être face à la disparition.
On pourrait l’entendre comme une méditation sur la limite de ce que l’on peut supporter : quand tout tremble, le deuil dépouille encore davantage, jusqu’à exposer l’âme à sa seule question, nue, essentielle. Cette phrase tient sur une tension centrale : tremblement / deuil, mouvement / retrait, excès de sensation / pauvreté de moyens. Le tremblement n’est pas seulement un choc extérieur. Il est déjà intérieur, existentiel. Le vertige dit la perte de verticalité, donc de sens, de repères, de hiérarchie. On ne sait plus où est le haut, où est le bas. L’âme n’est plus soutenue par une narration stable du monde.
Ce tremblement peut être lu comme l’annonce de la perte, l’instant juste avant ou juste après la catastrophe, ou l’état permanent de celui qui a compris que tout est précaire. Le vertige, lui, empêche toute maîtrise. Il n’y a plus de posture héroïque possible.
Le mot pour est essentiel : ce n’est pas le dénuement du deuil, mais le dénuement nécessaire au deuil, comme une condition. Cela suggère que le deuil ne se fait pas dans l’accumulation (souvenirs, objets, discours, rites), mais dans un dépouillement radical. L’âme se demande : jusqu’à quoi faut-il se défaire pour que le deuil soit vrai ?
Ce dénuement peut être affectif : renoncer même à la douleur comme identité. Langagier : accepter que les mots ne suffisent plus. Ontologique : consentir à une pauvreté d’être, à une faille durable. Le deuil n’est alors pas un travail actif, mais une exposition nue à l’absence.
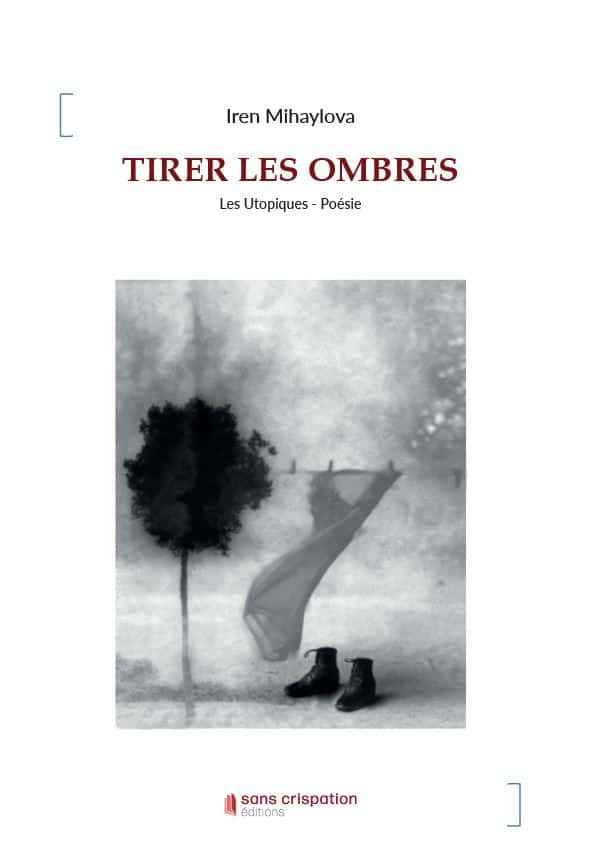
Iren Mihaylova, Tirer les ombres, Sans crispation éditions, 2023, 180 pages,16 euros.
… « se demandait son âme » place la question en retrait du mental. Ce n’est pas une pensée construite, c’est une interrogation sourde, presque pré-verbale. L’âme n’attend pas de réponse : elle habite la question. Il y a là une forme de solitude extrême : personne à qui poser la question, aucune autorité pour y répondre. Et pourtant, poser la question est déjà survivre.
La phrase peut se lire comme ceci : Au moment où tout vacille, où l’être perd ses appuis, l’âme s’interroge non pas sur comment guérir, mais sur combien perdre encore pour que le deuil soit possible. Ce n’est pas une quête de consolation. C’est une acceptation progressive de la pauvreté comme seule vérité viable après la perte. Dans le vertige du bouleversement, son âme se demandait de quel dépouillement le deuil avait besoin.
Face à l’ébranlement, son âme se demandait jusqu’à quel dépouillement le deuil exigeait d’aller. Tout s’était déplacé sans bruit, comme si le monde avait perdu son axe. Les gestes les plus simples demandaient un effort démesuré, et chaque pensée semblait menacée d’effondrement. Dans le vertige du bouleversement, son âme se demandait de quel dépouillement le deuil avait besoin. Il n’y avait plus rien à retenir, sinon cette question nue, suspendue dans le silence. Peu à peu, Iren Mahaylova comprenait qu’il ne s’agissait pas d’oublier, ni même d’apaiser la douleur, mais d’accepter de marcher sans appui, délesté des images, des récits, de ce qu’elle avait cru être une fidélité. Le manque ne se comblait pas ; il s’élargissait, devenant un espace habitable. Et dans cette pauvreté consentie, quelque chose persistait encore — non pas une présence, mais une manière de continuer à tenir debout. Et là, fut la plus grande épreuve.
∗∗∗
Ciel de ma mémoire d’Iren Mihahlova est tiré des ombres déjà convoquées dans : Tiré des ombres. Cela va de soi ! En revanche, il vient surtout de « là où le sommeil verse dans la distanciation, des barques croisent leurs chemins inversés, efforcées à se joindre désœuvrées ; p.34. » « Là où le sommeil verse dans la distanciation » installe un cadre abstrait (à tout le recueil). Le groupe « des barques croisent leurs chemins inversés » fonctionne comme une image centrale, mais reste grammaticalement ambigu : les barques sont-elles sujet autonome ou prolongement métaphorique du sommeil ?
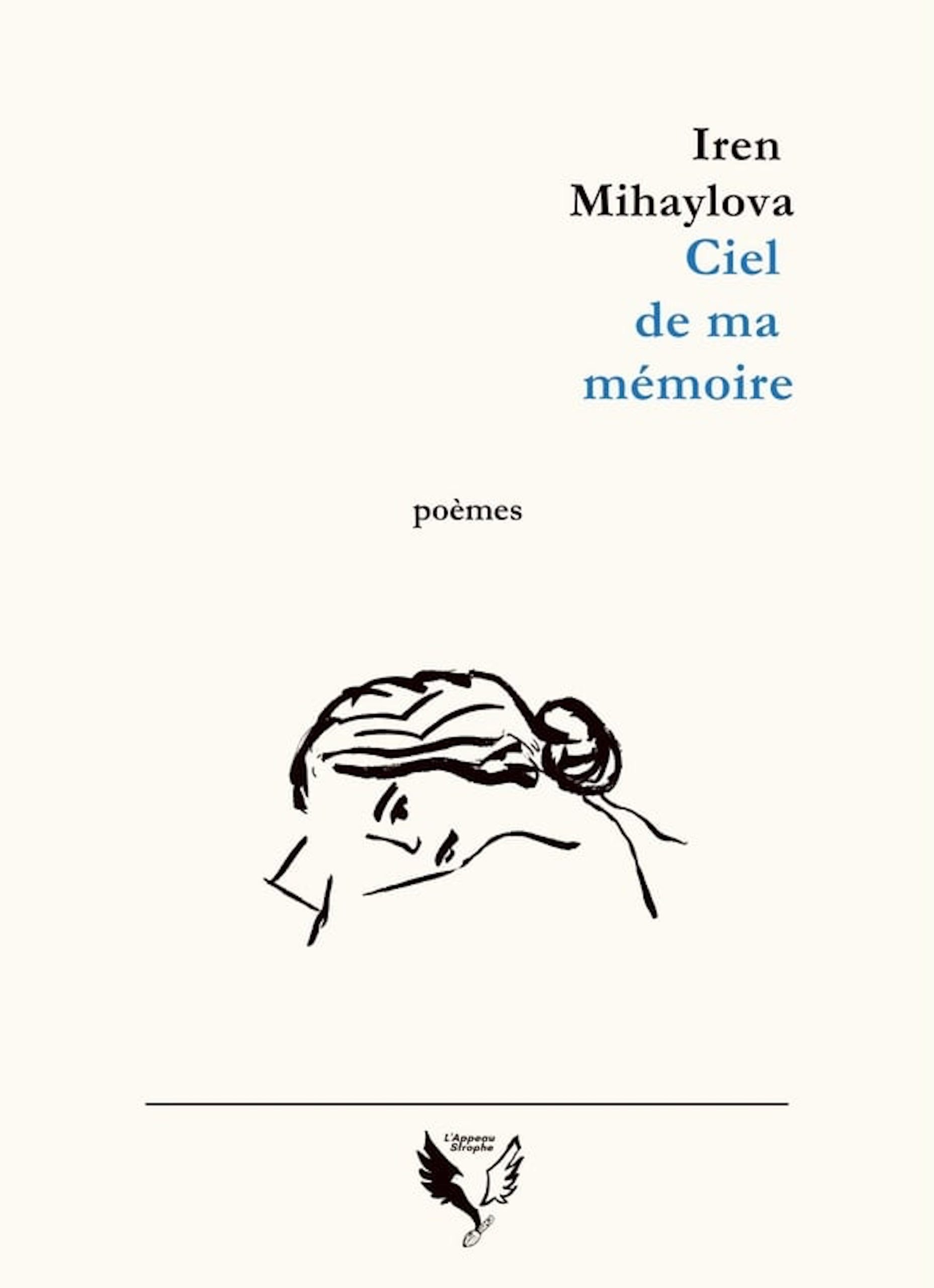
Iren Mihaylova, Ciel de ma mémoire, L’Appeau’Strophe Éditions, 2024, 77 pages, 15 euros.
Le fait qu’elles croisent des chemins inversés évoque une vision presque tragique de l’existence ; les trajectoires humaines se rencontrent par hasard, sans convergence réelle. On se croise, mais on ne coïncide pas. Le syntagme « efforcées à se joindre désœuvrées » exprime un paradoxe central de la philosophie existentielle : l’être humain tend vers l’autre, mais cette quête est souvent sans fondement stable, sans finalité assurée. Cela rappelle l’idée d’un désir d’unité toujours contredit par la finitude et la séparation. Le sommeil est traditionnellement le lieu privilégié de l’émergence du désir refoulé. « Là où le sommeil verse » peut être compris comme le moment où le sujet perd le contrôle rationnel et laisse affleurer des contenus psychiques dissociés. La distanciation renverrait alors à un mécanisme de défense ; le sujet se protège de l’affect en le tenant à distance. Les barques peuvent symboliser des objets d’investissement libidinal : des figures désirées, mais instables, flottantes. Le fait qu’elles suivent des chemins inversés évoque le désajustement du désir : le sujet veut ce qui se dérobe, et se détourne de ce qui s’offre.
C’est une configuration classique du désir pur. « Efforcées à se joindre » traduit la compulsion à la répétition, le sujet rejoue sans cesse la tentative de lien. Mais « désœuvrées » signale l’échec structurel de cette tentative, le désir s’active, mais ne se réalise pas, laissant un sentiment de vide ou d’inutilité. On pourrait y lire une scène d’attachement impossible, où le sujet reste prisonnier d’un manque fondamental. Qui sait ?
Enfin une deuxième phrase (vient et) met les points sur le i du verbe écrire : « écrire au fond du gouffre, au centre du vertige lorsque les mots manquent ; p.64. » Il s’agit moins d’un acte décrit que d’une possibilité interrogée. Les compléments circonstanciels « au fond du gouffre » et « au centre du vertige » sont parallèles, renforçant l’effet de profondeur et d’instabilité. « Lorsque les mots manquent » introduit une contradiction apparente, écrire suppose des mots, or ceux-ci font défaut. Cette structure crée un paradoxe fondateur. Le vertige renvoie non pas à la chute elle-même, mais à la conscience de la chute, au moment où le sujet perçoit l’instabilité de sa position. Être « au fond » et « au centre »suggère une immersion totale dans l’épreuve, sans point d’appui extérieur. Écrire, ici, n’est pas un geste confortable ou maîtrisé. C’est un acte de survie, accompli dans des conditions extrêmes. La phrase pose implicitement la question, l’écriture est-elle encore possible quand le langage se défait ? Cela fait écho à une conception de l’écriture comme tentative de dire l’indicible. Écrire au fond du gouffre revient à écrire depuis une expérience limite, comparable à ce que Jaspers appelait une situation extrême. Lorsque les mots manquent, le langage révèle sa finitude ; il ne peut tout dire, tout contenir. L’écriture devient alors un acte paradoxal, elle ne vise plus à transmettre un sens clair, mais à attester d’une présence, même vacillante.
Chez Blanchot, l’écriture naît précisément là où la parole échoue. Écrire, ce n’est pas maîtriser le langage, mais se tenir dans son retrait. Le gouffre correspond à ce qu’il nomme « l’espace littéraire » : un lieu sans fond, où le sujet se perd. Le manque de mots n’est pas un obstacle, mais la condition même de l’écriture. Iren comme Blanchot est dans l’idée que l’écriture commence quand le sens se dérobe, non quand il s’impose.
Beckett écrit à partir d’une injonction paradoxale célèbre : « Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer. »Le vertige évoque cette oscillation permanente entre dire et se taire. L’écriture devient minimale, presque réduite à un reste de voix. Écrire non pas parce qu’on a quelque chose à dire, mais parce qu’on ne peut pas ne pas essayer.
Chez Bataille, le gouffre est une expérience intérieure : celle de la perte, de la transgression, de l’excès. Écrire au fond du gouffre, c’est écrire au bord de la désubjectivation. Le langage est poussé jusqu’à sa limite, où il se brise. Iren rejoint Bataille dans l’idée que l’écriture est une mise en danger, une traversée du vertige plutôt qu’une explication.
Artaud, enfin, incarne le moment où les mots trahissent l’expérience vécue. Le manque de mots n’est pas abstrait : il est corporel, douloureux. Écrire devient un cri, une tentative de faire exister ce qui ne peut être symbolisé. Ainsi l’écriture est une lutte contre l’effondrement du sens, non une construction esthétique apaisante.
Iren se situe à la confluence des auteurs cités plus haut. Elle n’affirme pas que l’écriture sauve, mais qu’elle persiste — fragile, vacillante — même quand elle n’a plus de garantie. Aussi la question n’est pas : peut-on écrire quand les mots manquent ?
Mais plutôt : L’écriture n’est-elle pas précisément ce qui reste quand il ne reste plus de mots ? Magique !
Présentation de l’auteur
- Iren Mihaylova, Tirer les ombres, Ciel de ma mémoire - 21 février 2026
- Catherine Andrieu, À la marge - 21 octobre 2025