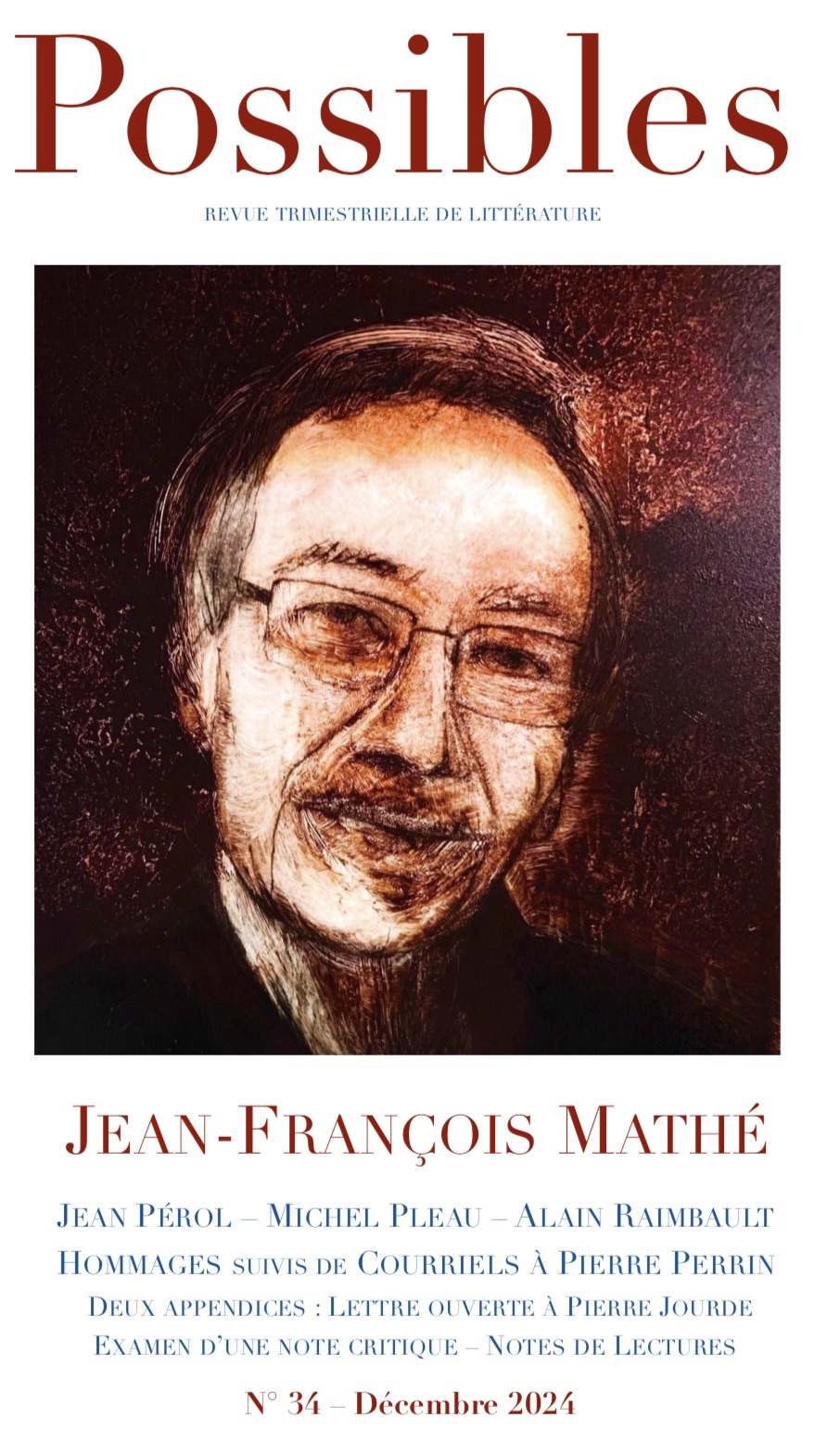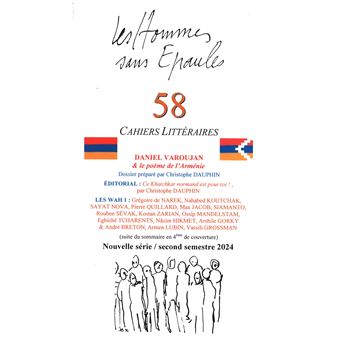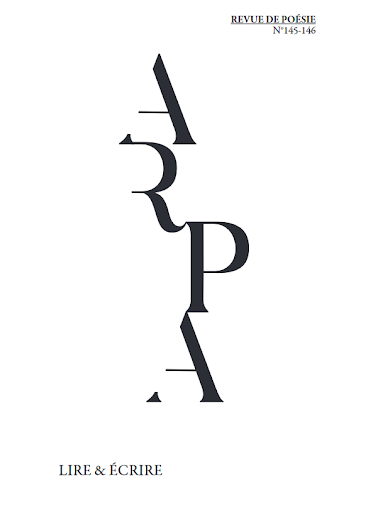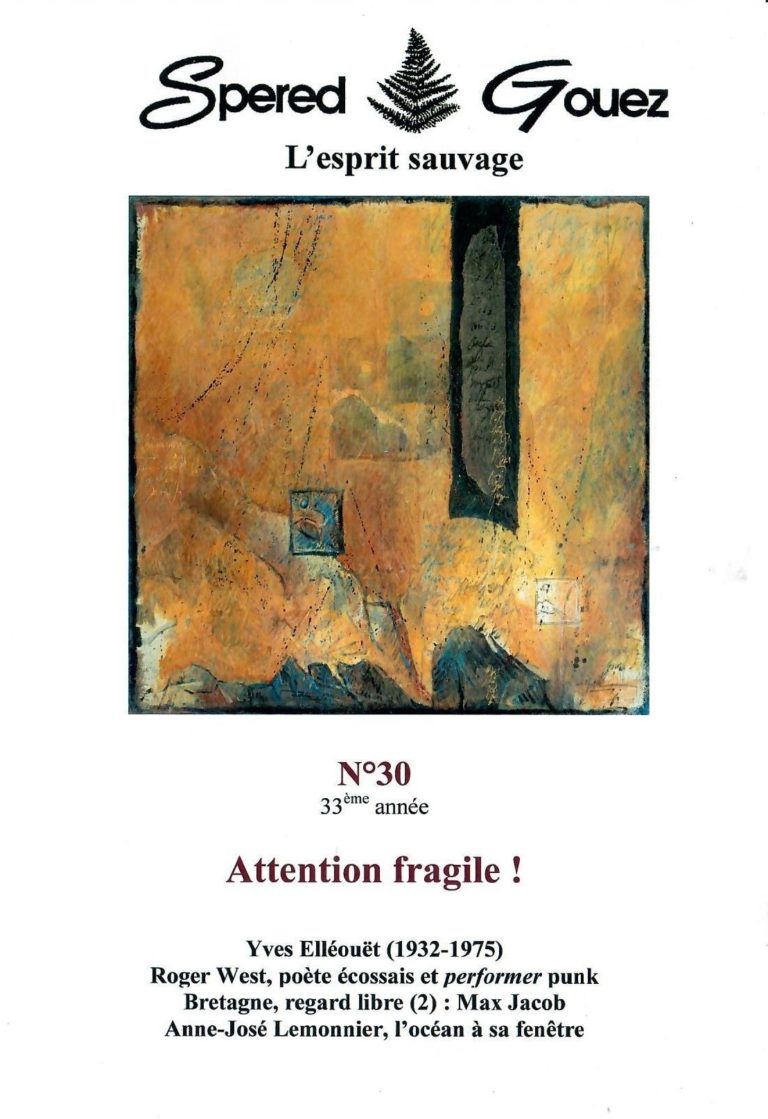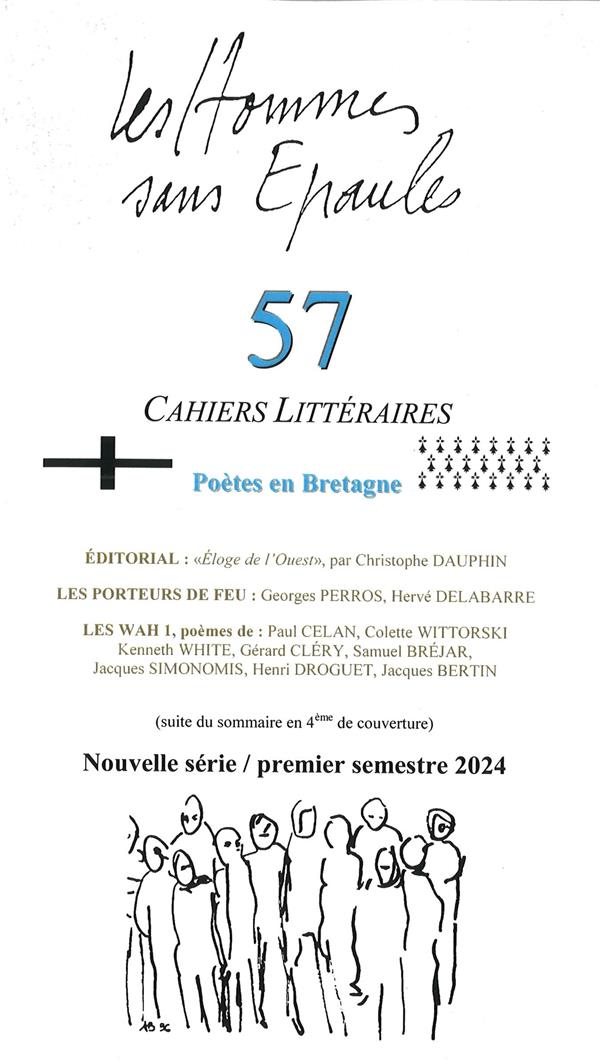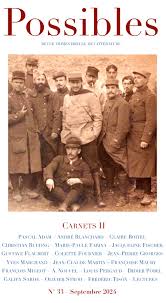Il y a une âme dans cette revue, on la croise, on la vit. On la ressent au fil des pages que l’on lit. Une âme, celle des beautés et des douleurs, de tout ce qui a fait le tragique du siècle passé. Et cette âme vit en Fario, ses pages de papier à l’ancienne, et sa belle couleur beige tout autant à l’ancienne. Elle vient d’un monde ancien, donc, cette revue, monde voilé que l’on aurait tendance à oublier afin de mieux se rassurer, de mieux survivre en pensant croquer à pleines dents un lieu contemporain que nous pensons et affirmons moderne, pour mieux ne pas le regarder. En cela, le récent numéro de Fario est un choc pour son lecteur, quand bien même ce dernier connaît l’aventure de cette exceptionnelle revue. On ne troublera personne en disant ici que les revues de cet acabit ne sont pas légions aujourd’hui. À cela, les raisons sont diverses et ce n’est pas ici notre propos. Ce monde d’avant que l’on arpente en lisant Fario est cependant monde de maintenant. Car la simple existence d’une telle revue, évoquant aussi bien l’intériorité des hommes durant les affres des folies d’hier que cette autre âme que notre modernité conteste tant, l’âme des lieux, de leur géographie, ici la Bucovine de Rose Ausländer par exemple, cette existence est un déni profond de tout ce qui pourrit actuellement l’être même de nos vies. Quelle importance que tous ces « avoirs » pense-t-on en fermant les pages de ce douzième numéro, douze, il n’est guère de hasard, de Fario ? Nous voulons être et nous ne le savons plus. Du moins, nous mimons le « bonheur » de ne plus le savoir ni le vouloir. Fario est un miroir de nos insuffisances collectives contemporaines. On peut se mentir et passer son chemin, on peut aussi plonger dans le questionnement que posent sans cesse, et avec une certaine urgence, Vincent Pélissier, le directeur de la revue, et son équipe, un questionnement répété sans le dire. Dans l’importance du silence.
Pour bien saisir ce qui est « l’engagement » de cette revue, au sens noble et non tristement dévoyé hier par des figures littéraires et idéologiques auxquels on attache sans aucun doute encore bien trop d’importance, mais cela ne durera guère, on se reportera à cette note d’intention signée Vincent Pélissier :
http://www.editionsfario.fr/spip.php?article2&site=1
Il y a beaucoup en ces quelques lignes. Comme dans les noms des écrivains publiés par les éditions du même nom, dans le sillage de la revue : Salah Stétié, Henri Droguet, Fernand Deligny, Serge Airoldi, Günther Anders, Pierre Bergounioux, Gustave Roud ou James Sacré. Les éditions Fario sont ainsi l’éditeur du tome 2 de L’obsolescence de l’homme, maître livre de Anders sans lequel Debord n’eut peut être pas été Debord, du moins ce Debord là, celui qui compte tant pour nous, et dont nous prétendons ici que la pensée vit pour maintenant. Être l’éditeur de ce livre, cela aussi est beaucoup. J’évoquais Debord. Sa silhouette plane discrètement sur Fario, revue qui crée une situation surprenante, celle du questionnement de la situation qui nous a créés. On ne sera donc pas surpris de croiser, selon les numéros, les plumes d’Anders ou Jappe.
En ce numéro 12 de Fario, on lira des textes de Jean-Paul Michel, ouvrant l’interrogation sur l’illusion de ce que furent nos utopies, nourries de celles du passé, et leur devenir terrifiant, une interrogation comme un fil « rouge » en Fario, Baudouin de Bodinat, Marcel Cohen, une belle nouvelle d’Henri Droguet, des lignes de Dominique Buisset qui réfléchissent en nous ce que sont le poème et le poète (« Et quand lui-même il vient à l’image, c’est dans un plan second, simple figure d’un être au monde »), rappelant combien est ici essentielle le jeu/je de la mesure. Viennent ensuite une nouvelle de Caroline Fourgeaud-Laville, les carnets de Jean-Luc Sarré, avec des fulgurances : Oran. Été 43. Être le fruit d’une négligence, une faute d’étourderie, une coquille, un cuir, un lapsus… C’est, au bout du compte, plutôt léger à porter. J’aurais trouvé plus contrariant qu’on ait pu « me vouloir ». Ou plus loin : Minuit. Le grossier claquement d’une paire de tongs offusque la lune. Puis un beau texte de Serge Airoldi, ponctué par un poème de Novella Cantarutti qu’il faut absolument lire, un inédit de Fernand Deligny, et le texte lu en forme de pied de nez par l’écrivain grec Thanassis Valtinos lors de sa réception à l’Académie. Une fois parvenu là, au mitan de la revue, le lecteur rencontre les ateliers croisés de Richter et de Kluge, l’artiste et le cinéaste ayant construit un dialogue en regards. Suit un entretien passionnant avec Kluge. Puis huit thèses de Günther Anders, dont la pensée ne cesse de hanter notre époque, dans le silence peureux le plus complet –ou presque.
L’heure est alors à la poésie. Un beau poème de Bill Zavatsky, autour de Bill Evans, naissance d’une amitié aussi. Et Rose Ausländer. Que dire ? Sinon les larmes qui montent aux yeux. Fario publie ici en bilingue, dans une traduction exceptionnelle signée François Mathieu, un ensemble, Pour qu’aucune lumière ne nous aime, un recueil de l’immense poète de langue allemande, poète qui résume à elle seule tout le 20e siècle, et dont la poésie dit, aussi à elle seule, l’âme de la revue Fario. Ces pages suffiraient à légitimer l’acquisition de ce volume.
Ainsi, cette Arche :
Dans la mer
une arche
d’étoiles
attend
la cendre
survivante
après
le déluge de feu
Cela n’est guère connu mais il n’y aurait pas de Recours au Poème sans la poésie de Rose Ausländer, une poésie dont l’influence irrigue, creuse un sillon qui n’apparaît pas encore clairement mais construit fortement. Dans le silence apparent, et l’illusion bruyante.
La revue poursuit ce travail, celui de donner à lire les voix de Czernowitz, depuis son origine, ou presque. Son numéro 10 comportait ainsi la quatrième partie d’une Chronique du ghetto de Czernowitz et de la déportation en Transnistrie, avec des textes traduits par François Mathieu. D’une certaine manière, la publication des poèmes de Rose Ausländer poursuit cette chronique qui, témoignant de quatre années de l’histoire d’une ville-capitale, résume celle du 20e siècle, et de ce fait… nous résume.
Pour finir, Fario demande à trois écrivains, Gilles Orlieb, Antoine Emaz et Jacques Lèbre, Où écrivez-vous. Un questionnement suivi.
Mais je dois revenir en arrière, volontairement, au texte de Marcel Cohen, lu à l’orée de ce numéro, intitulé La sphère de Magdebourg. Écrire la Catastrophe, témoignage et fiction texte qui, dans le sillage de rencontres initiées par Cécile Wajbrot en 2011, interroge le rapport entre l’écriture et la Catastrophe, la Shoah. Toute l’aventure de Fario est ici, dans la poésie de Ausländer et dans la publication d’un texte tel que celui de Marcel Cohen, lequel navigue entre écriture de sa propre mémoire et pensée sur ce qu’est écrire sa propre mémoire, autrement dit sur l’impossible qu’est cette écriture. Que nous est-il arrivé à tous dans ce qui est arrivé aux victimes des tragédies du siècle passé, semble demander Marcel Cohen, et avec lui la revue Fario, oui, que nous est-il arrivé, à nous qui prétendions, et prétendons toujours semble-t-il, être la culture. Nous, qui sommes le lieu de la mise en fonction d’usines à fabriquer la mort des êtres humains, d’abord, des êtres ensuite.
Revue Fario n° 12, hiver 2012- printemps.
Les numéros 10 et 11 sont tout aussi fondamentaux, et l’on gagnera à se les procurer.
(deux numéros par an).
26 rue Daubigny – 75017 Paris.
Site : http://www.editionsfario.fr/
Abonnement : 50 euros.
Le numéro : 28 euros. Chaque numéro, autour de 400 pages.