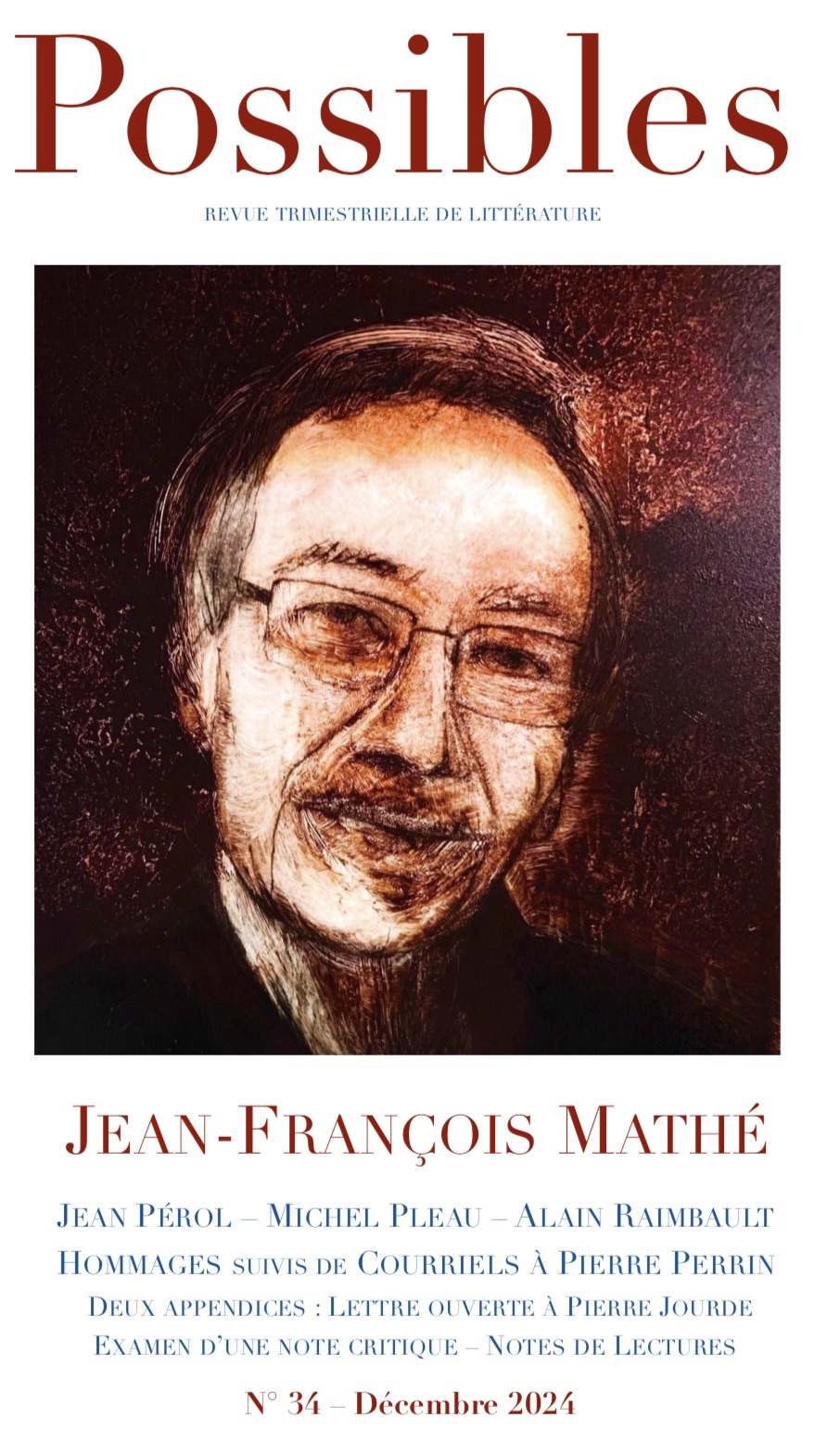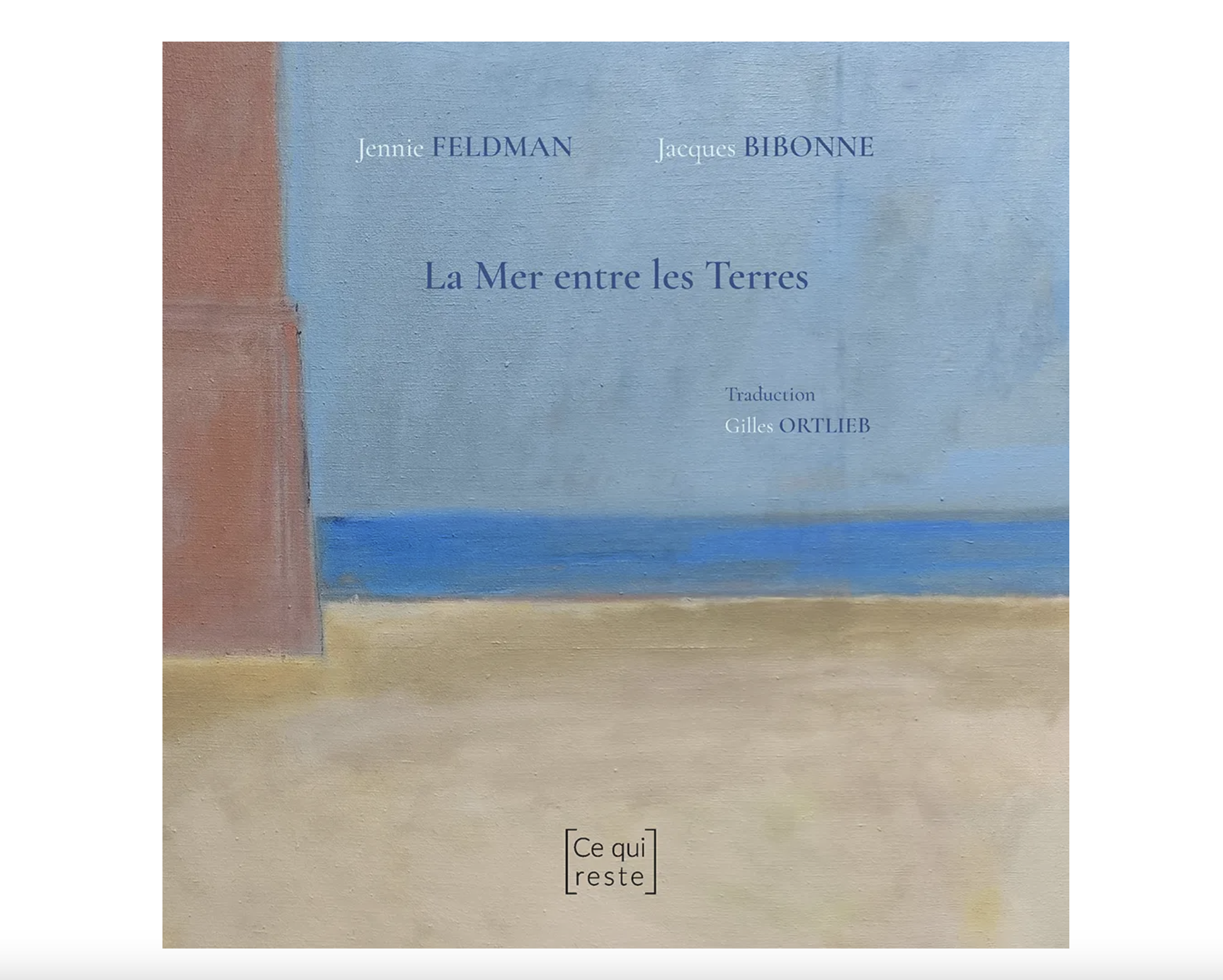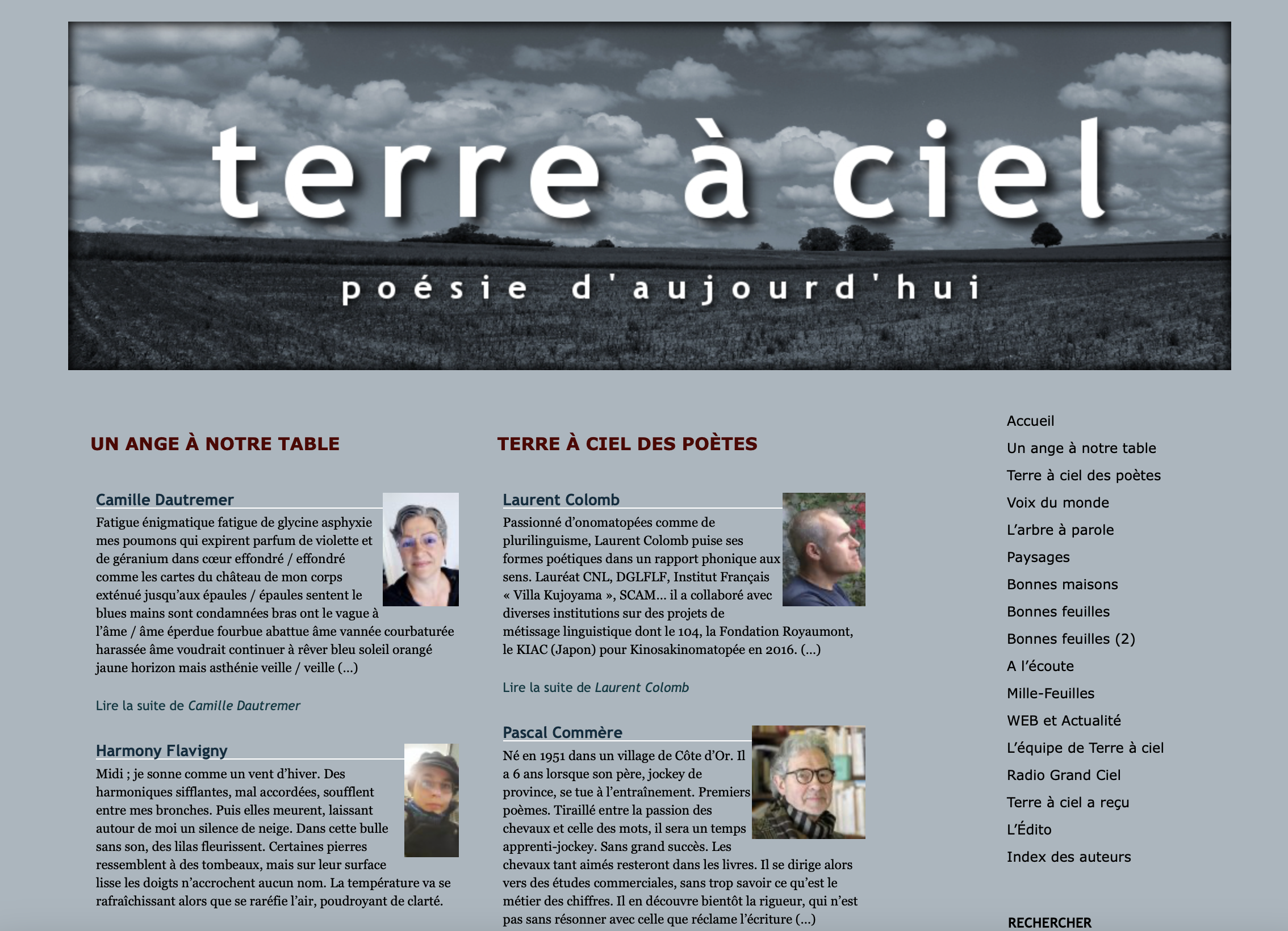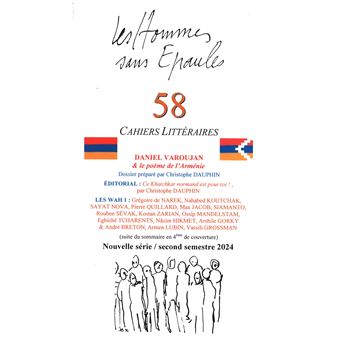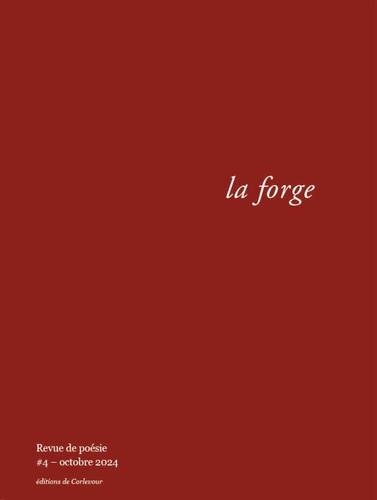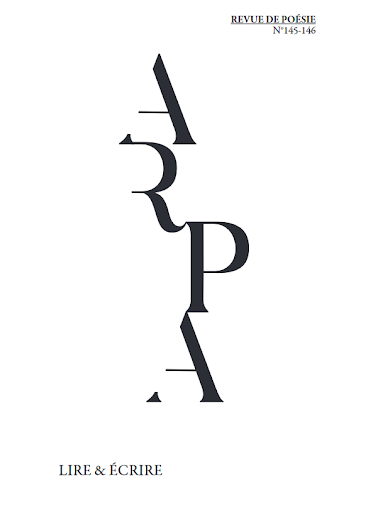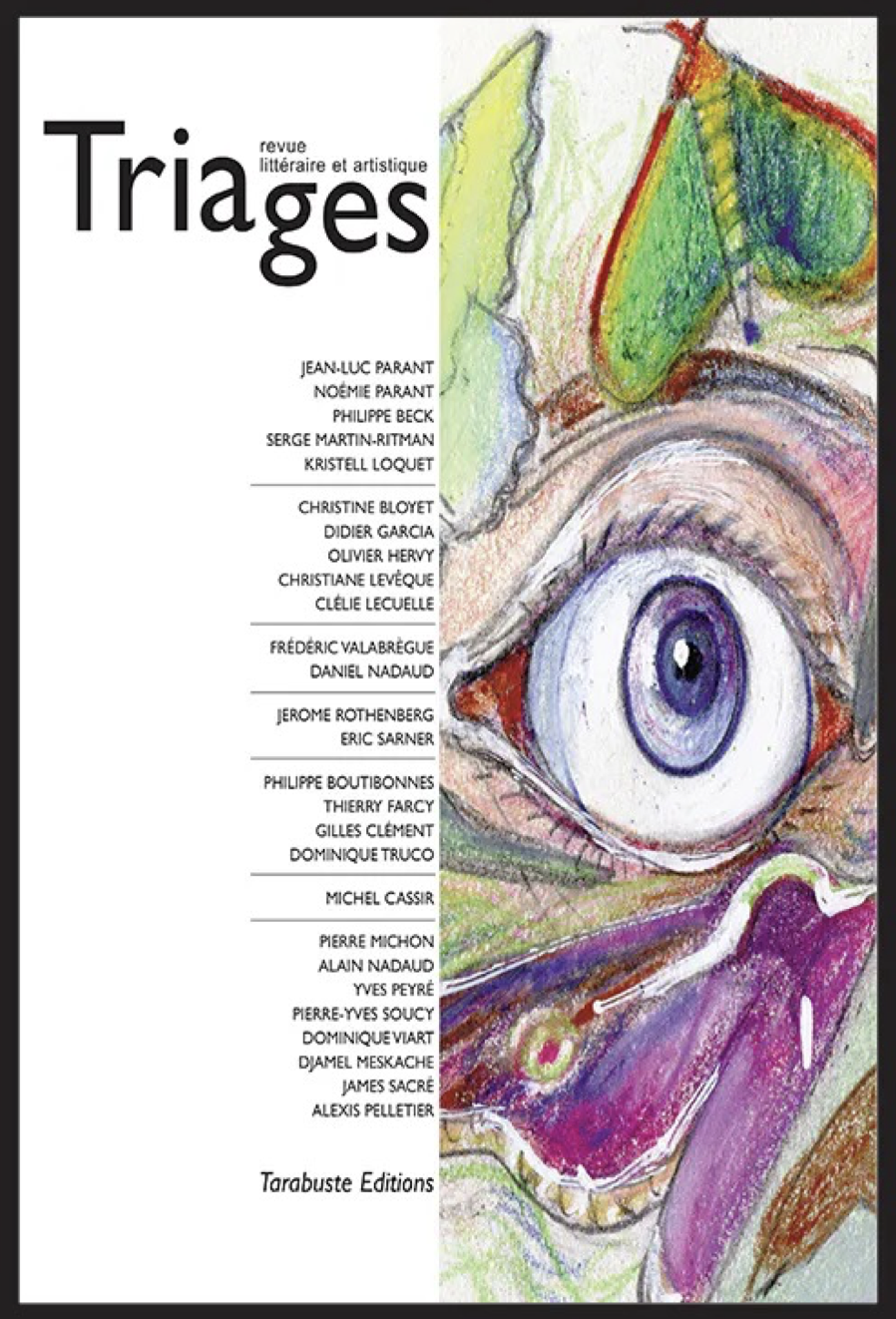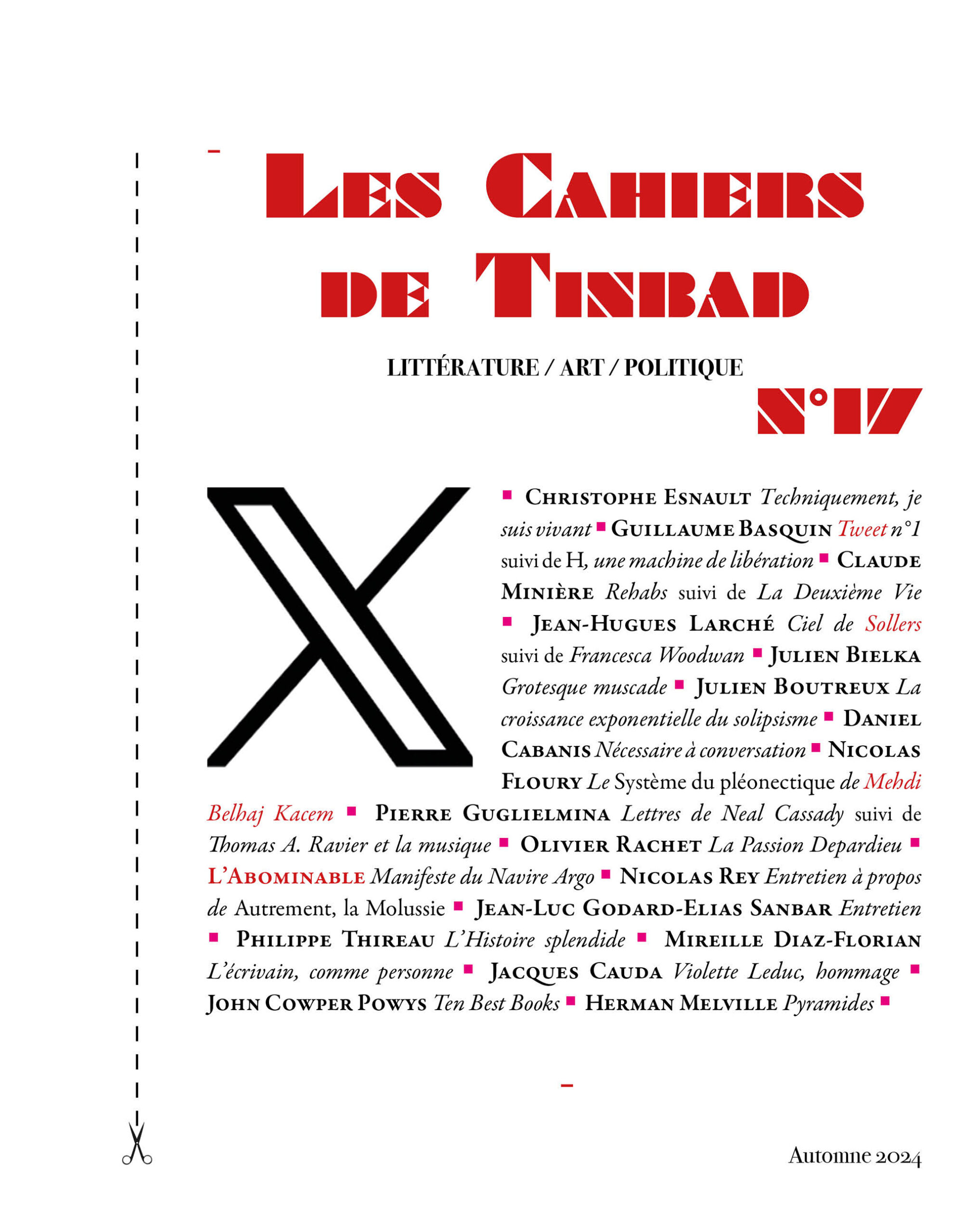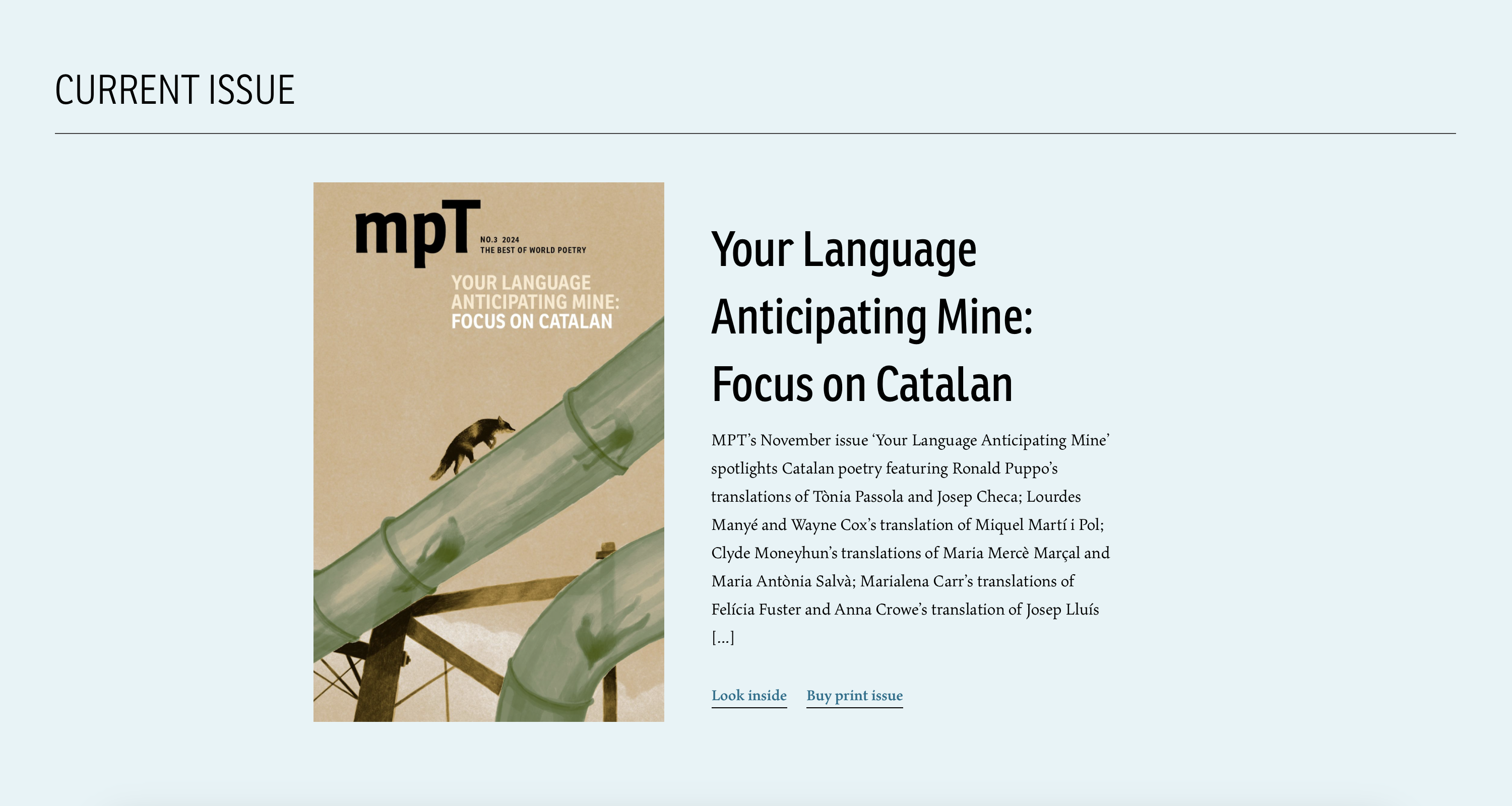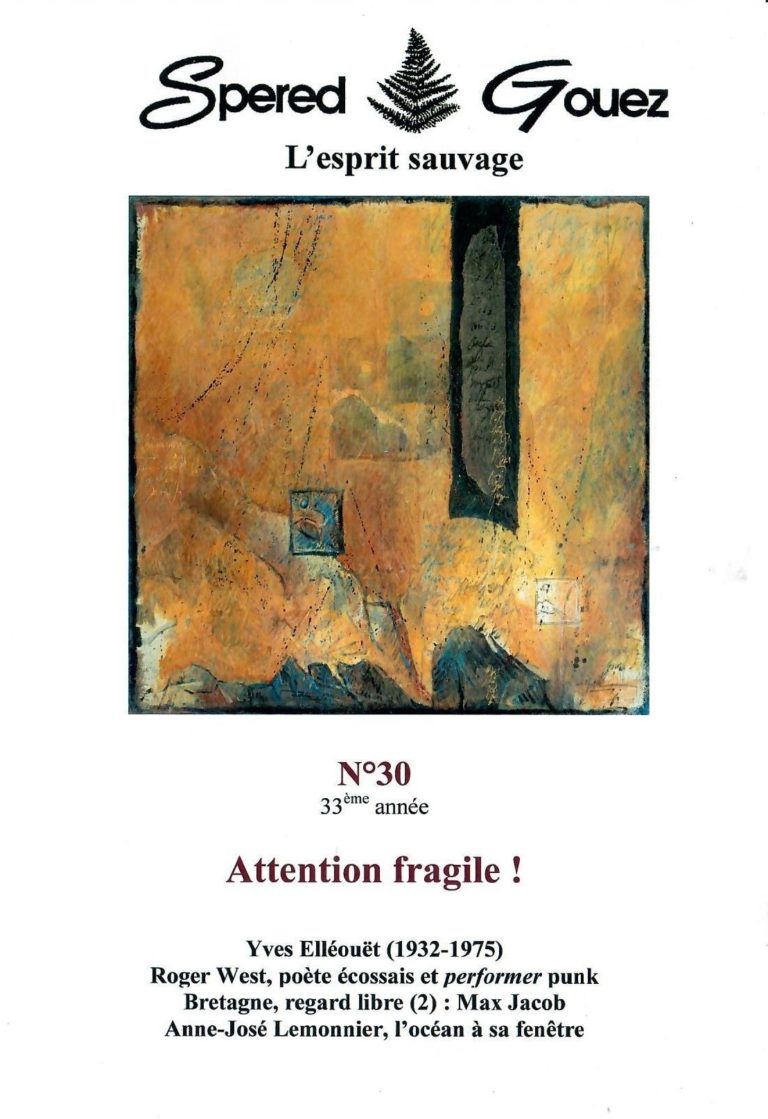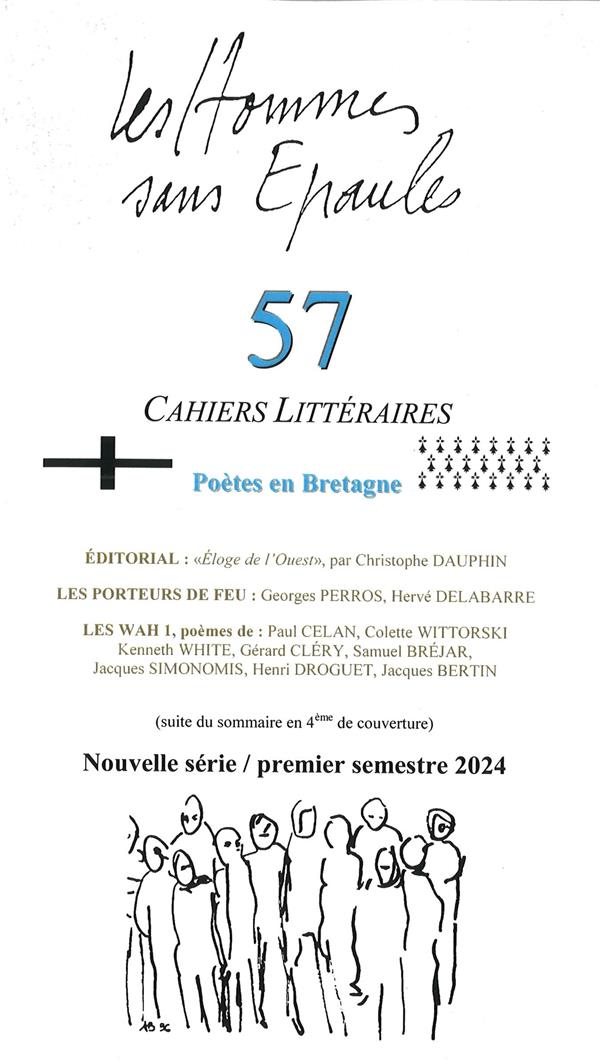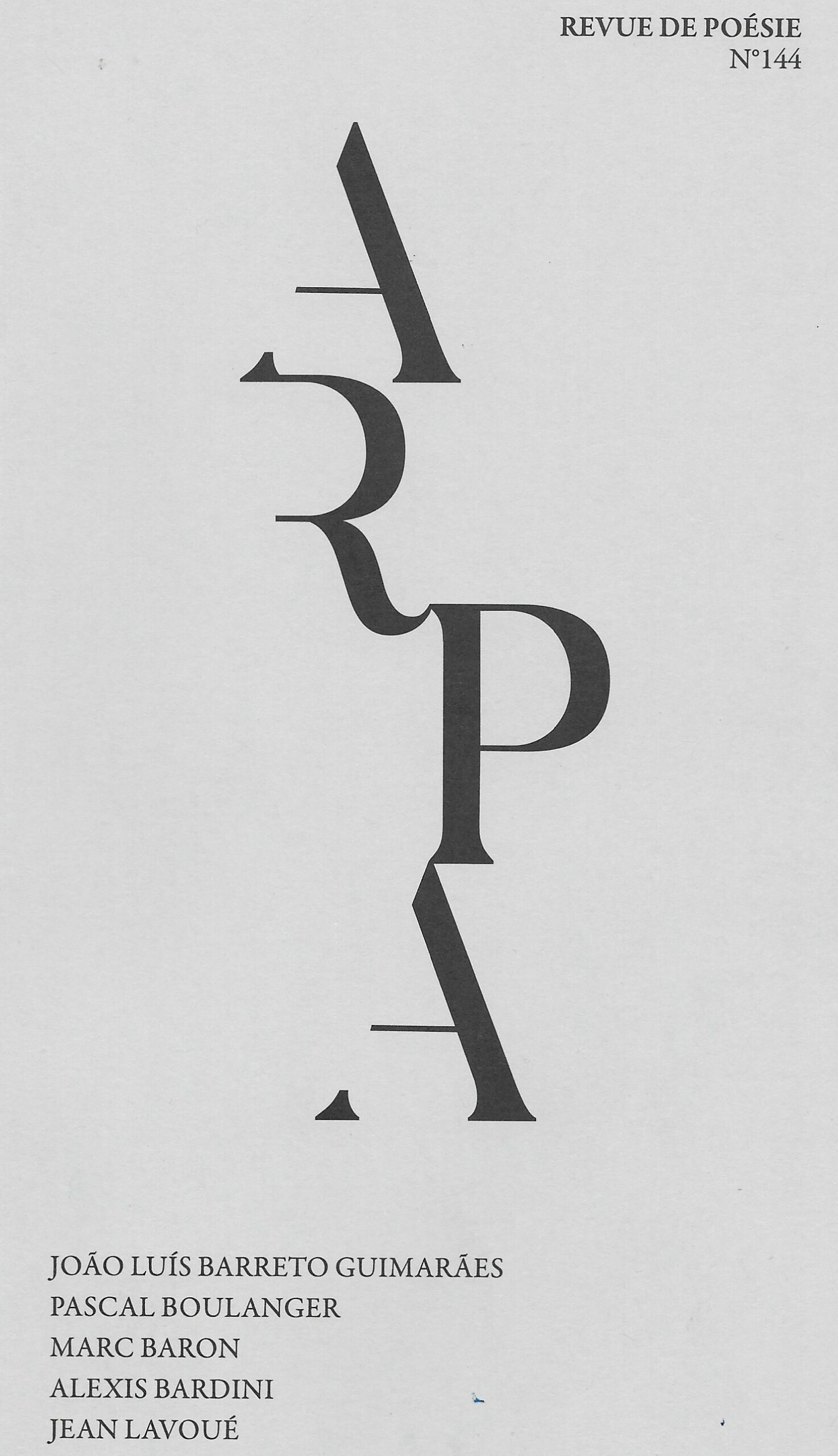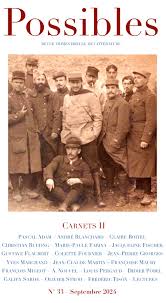La revue La Traductière, dont la grande originalité est d’être concrètement ouverte sur le monde, par l’acte de publier des textes en langue originale accompagnés de leur traduction en français et en anglais, offre son 31e numéro. Une revue dont il peut sembler inutile de vanter la grande qualité tant c’est une évidence, et même une référence du point de vue de l’aventure de Recours au Poème. Cette année, Jacques Rancourt et son équipe proposent deux dossiers intrinsèquement liés : « Poèmes que nous sommes » et « Domaine roumain ». Deux ensembles liés de par les noms qui composent les dossiers (des poètes et écrivains roumains interviennent au sujet du poème) et par le contenu des textes proposés par le dossier roumain, un dossier de très grande qualité. Et même : un dossier appelé à faire date. Les mots de présentation rédigés par Rancourt ne peuvent que résonner en nos pages : « Sommes-nous, ne sommes-nous pas, en tant qu’êtres humains, des poèmes ? Partageons-nous avec ces derniers une communauté de destin ? ». Ici, nous ne pensons pas qu’une telle question soit incongrue, bien au contraire. La poésie et le Poème ne sont pas le lieu d’un amusement ou d’un loisir, mais celui en effet d’une destinée collective. Ce questionnement est donc, de notre point de vue, une des questions fondamentales du présent, question qui conduit au-delà du poétique, au cœur de ce que notre ami Paul Vermeulen nomme le « méta-poétique » : nous sommes convaincus que la réponse à ce type d’interrogation est affirmative, et que c’est l’une des raisons pour lesquelles la poésie conserve sa charge d’acte politique (méta-poétique), sa réalité en tant que forme politique de la résistance aux conditions faites à l’humain aujourd’hui. Ou plutôt : que la poésie renaît en tant que lieu même du Politique résistant. Les barricades d’hier approchent le siècle d’âge. Le fait politique contemporain est autre que les vieux démons sans cesse agités, de conditionnements en conditionnements. Imagine-t-on, vers 1920, des intellectuels ou des poètes ressassant des événements datant de 1814 ? Agitant sans cesse, un siècle après, le « démon Napoléon » pour effrayer les âmes fragiles ? C’est un peu ce qui se passe dans l’imaginaire « résistant » contemporain, bloqué sur 1945 et 1968. Peut-être cela permet-il de se construire une bonne conduite à moindres frais (ces barricades-là sont tout de même fort peu dangereuses en 2013) mais cela ne pose aucune question essentielle sur notre contemporain. Questions essentielles ? Par exemple : quel est cet humain qui continue de naître sous nos yeux au cœur de l’arraisonnement subit par ce même humain en territoires de techno-science débridée ? Que devient le monde, et par ricochets successifs, que deviennent l’homme et la poésie quand l’espace devient virtuel ? Des questions parmi d’autres, par souci de saine provocation. Et pour insister à ce propos : face à de telles questions, essentielles pour comprendre et saisir ce que nous sommes en ce monde, en lequel nous sommes maintenant, la poésie est, de notre point de vue, une des sources de la résistance réelle, un des vecteurs du combat en cours, et sans doute, pensons-nous, le vecteur principal, c’est-à-dire l’acte qui s’oppose le plus en profondeur aux transformations produites par la situation mise en œuvre sous couvert de techno-science et de virtualisation du réel au cœur même de l’âme humaine. Quoi de plus politique ? Cette perspective induit aussi un lien de concordance entre la poésie et, par exemple, la philosophie, le théâtre ou la danse, et l’immense travail chorégraphique en cours sur les souffrances imposées aux corps par le monde contemporain. Ce n’est pas le lieu de développer ce point (les liens intrinsèques entre poésie et danse contemporaine par exemple) mais Recours au Poème travaillera cette matière. Il reste, et on le comprendra aisément, que, face à de telles perspectives, les petites chapelles des « milieux poétiques » et les petits débats pétitionnaires qui semblent parfois les agiter nous paraissent pour le moins insignifiants. À la question posée par Jacques Rancourt, Recours au Poème répond par l’affirmative. De par sa simple existence.
Ainsi, par le prisme du poème, La Traductière ne pose pas, en sa dernière livraison, de question anodine. « Poèmes que nous sommes » réunit une cinquantaine de poètes, parmi lesquels quelques poètes et traducteurs amis et qui collaborent souvent à notre aventure (Elizabeth Brunazzi, Max Alhau, Jean-Luc Wauthier, Marilyne Bertoncini), et propose une série de textes de poètes réfléchissant de diverses manières sur cette question. Ainsi, Shizue Ogawa : « Le moment d’inconscience arrive et j’incarne une masse physique. Cette expérience s’appellerait dans un langage bouddhiste « kuu », le vide. De l’aboutissement de ce courant naturel naît le poème ». On peut le regretter ou refuser de le sentir, reste que l’acte poétique en lien avec le Poème, principe universel de vie, est acte relié au tout d’une vie s’exprimant sous le vocable de sacré. La poésie construit le temple de l’Homme au cœur même du Poème. Et tout le reste est amusements provisoires, sans prétentions ni guère d’incidences. Poésie et Poème sont un au-delà du littéraire, une voie initiatique exprimée dans la diversité des voix. Tout poète est-il conscient de cela ? Non, bien entendu. Cependant, l’absence de conscience que j’ai d’une réalité ne signifie pas que cette réalité n’existe pas. Ce point est particulièrement délicat à saisir en un moment du contemporain où tout un chacun pense que ce qui existe dépend de son unique perception. Les temps sont à l’auto-centrage sur des egos illusoires. Chacun refuse dieu en s’auto proclamant petit dieu. Ce n’est pas grave : quand quelque chose est à ce point visible et exacerbé, c’est qu’il est déjà mort. Ainsi, oui, ce dieu-là (ou ce dieu démultiplié) est mort. Nietzsche est un prophète. Tous les poèmes présentés ici ne défendent évidemment pas ce point de vue, que nous exposons en conscience de son statut de simple « point de vue ». Au contraire, la grande qualité de ce dossier est de mettre le fait « d’être poème » en débat, et des textes s’opposent entièrement à ce possible.
Le dossier intitulé « Domaine roumain » est une vraie respiration. Proposés par Linda Maria Baros et traduits par ses soins, les poèmes du dossier offrent un panorama de la poésie roumaine contemporaine, incomplet sans aucun doute, c’est la règle du jeu. Un dossier n’a pas besoin d’être « complet ». On termine ces pages frappé par la puissance en acte des poésies présentées. Je pense ainsi aux textes de Stanescu (« La poésie, c’est l’œil qui pleure…), Grete Tartler, Cassian Maria Spiridon, Gabriel Chifu ou Dan Mircea Cipariu. On aimerait maintenant lire une partie de ces poètes en France, sous forme de recueils. En attendant, on se procurera ce volume, riche et fort.