« Poésie Ô lapsus », Robert Desnos
Le Scalp en feu est une chronique irrégulière et intermittente dont le seul sujet, en raison du manque et de l’urgence, est la poésie. Elle ouvre un nombre indéterminé de fenêtres de tir sur le poète et son poème. Selon le temps, l’humeur, les nécessités de l’instant ou du jour, ces fenêtres changeront de forme et de format, mais leur auteur, un cynique sans scrupules, s’engage à ne pas dépasser les dix à douze pages, ou à peine plus, pour l’ensemble de l’édifice.
Le SCALP est publié, simultanément ou non, par les magazines en ligne : LA CAUSE LITTERAIRE / RECOURS AU POEME.
Lecteur, ne sois sûr de rien, sinon de ce que le petit bonhomme, là-haut, ne lèvera jamais son chapeau à ton passage car, fraîchement scalpé, il craint les courants d’air. (M.H)
Sommaire
I — La poésie en soi (Quête 1) – p.2
II — Renaissance d’une maison de poésie :
̶ de L’Atlantique à Alcyone ̶ p.6
III – Les Recueils - p.7
À l’ordre de l’oubli de Jean-Louis Bernard – Alcyone – 68 pp.-18 € — p.7
De l’acide citronnier de la lune d’Anna Jouy – Alcyone – 51 pp. – 16 € — p.8
Ruralités de Marcel Migozzi — Alcyone – 52 pp. — 16 € — p.10
Les 3 recueils édités en 2016, dans la collection « Surya »
IV – Notes biobibliographiques - p.12
I — La poésie-en-soi (Quête 1)
C’est, avec une assertion mêlée comme les eaux des rivières à leur confluence, que m’a été posée cette simple question audacieuse et risquée, et j’ignore si quelqu’un est parvenu à lui donner une réponse satisfaisante : celle-ci, de Louis Aragon :
« J’appelle poésie un conflit de la bouche et du vent la confusion du dire et du taire une consternation du temps la déroute absolue » — Grenade, Le Fou d’Elsa.[1]
Cette pensée étonnante m’a semblé une flèche touchant sa cible au cœur : ma pensée floue de la matière poétique ̶ pourquoi ceci m’est à moi « poésie » et ne l’est pas pour mon voisin, ma voisine ? ̶ Je fus étonné, au sens le plus étymologique de l’étonnement, frappé par l’ampleur et la complétude de cette réponse du poète, et cela en dépit de ses couleurs négatives : « conflit, confusion, consternation, déroute… »
M’est apparue l’insuffisance de ma propre réponse : « Poésie est mutation, traduction dans la langue maternelle, selon des cadences très intimes, de la langue sourcière mal connue, celle des émotions et des intuitions. » Je liais cela à l’autobiographie, par défaut, dirait-on aujourd’hui. J’adhère toujours à cet avis de Frédérick Tristan : « La poésie n’est jamais fictive. »
L’explosive définition de la poésie par Aragon m’en a bouché un coin (si j’ose dire), tout en me permettant de comprendre que sa positivité, son élan, sa force… ne résident pas dans un ordre particulier, fût-il celui des vers réguliers et rimés dans des strophes bien ordonnées, (tout cela d’ailleurs ne lui nuisant pas automatiquement), mais précisément dans un désordre inouï qui mettra aux prises le dire et le taire, la bouche (la voix ?) et le vent (qui l’interrompt ou la couvre,), la « déroute absolue », qui telle une armée anéantie, meurt comme meurt seul un homme blessé sur le champ de bataille du poème. Il y aura donc silence et consternation (épouvante) qui supposera encore la résurrection du poète-soldat, car le poème, voire l’œuvre, attendent encore et toujours.
Mon mouvement a été d’interroger des poètes de divers horizons, familiers parfois, notamment à travers ces SCALPS. Ils m’ont apporté des réponses personnelles, souvent fort incitatives, mais aucun(e) d’entre elles n’a fixé l’axe de la poésie dans le grand charivari du lexique et de la syntaxe, leur bousculement, leur renversement jusqu’à un plus rien à ajouter sinon ma défaite, celle du texte poétique. Cette défaite éprouvante doit sans doute s’appeler victoire.
Reste à déterminer ce qui fait, ne serait-ce que pour moi lecteur ou auditeur, que « ce » poème relève sans aucun doute de la poésie, et tel autre non. On ne peut ici que parler en son propre nom. Si l’impression poétique[2] est absente, non perceptible, on s’adressera en général aux professeurs, dès le lycée, à l’université… Ailleurs non, cela n’intéresse pas. Spécialistes et critiques entrent dans le jeu ; j’entre rarement dans leur jeu. Ma seule ambition est de traquer la poésie-en-soi. La même bataille, en somme, mais sans obligation de définitions.
Pour cela, la (ma) méthode précédente n’ayant produit que d’intéressantes approximations, je m’en vais ̶ sans crainte de me contredire ̶ tenter d’interroger ceux qui, poètes et hommes de réflexion ont abordé aux mêmes rives, tenté de donner leurs avis, leurs analyses de la poésie, et cela le plus simplement possible, car je me noie aisément dans l’abstraction et la complication des grandes théories. J’approcherai, commenterai ainsi les entretiens, déclarations spontanées (enfin on les supposera telles) généralement énoncées par des poètes dans le souci de la compréhension de tous.
Michel Deguy, armé comme il se doit de diverses qualifications et fonctions qui créent d’emblée la distance du sérieux : « Créateur de la revue Po&sie, éditeur, philosophe et poète », il vient d’accorder au Monde du 28 octobre 2016, un intéressant entretien. Entre autres choses, il y fait ces déclarations :
« [Je suis] L’héritier d’une tradition, d’une transmission qui fait voisiner depuis 2500 ans ce qu’on appelle philosophie et poésie. […] Je me situe dans cette médiation entre les deux que j’appelle la poétique. »
Il va de soi que tradition et transmission sont d’indispensables clés à la mise en œuvre de la poésie, à chaque époque de l’histoire humaine. On note que Michel Deguy fait « voisiner » philosophie et poésie. Il ne les fait pas fusionner et il a raison. Elles sont de natures différentes bien que l’une puisse instiller dans l’autre, par moments, ses poisons, ses drogues, ses élixirs de vie[3]. On est un peu déçu de ce que la mediatio, qui est quelque chose comme une conciliation, quelque chose comme l’ouvrage d’une force intermédiaire, produise non la poésie, mais le poétique, qui sonne à son tour comme un concept, une théorie, voire une science. Manie contemporaine de vouloir du scientifique dans la littérature : la vacuité, la stérilité du structuralisme ont illustré puis discrédité cette manie.
À la question, que transmet-on dans l’écrire », et à quoi et à qui ? ̶ Michel Deguy répond : « … un attachement à la langue, à la beauté de la langue. Un faire voir par le dire. […] … c’est transmettre un attachement au terrestre, à ce que les philosophes appellent l’ouverture au monde. »
Manifester un attachement à la langue et à sa beauté est, certes, l’une des fonctions de la poésie. Sans doute pas la seule. « Un faire voir… » suggère l’entreprise didactique. Sans doute pas la première exigence. Mais je dirais alors musiques de la langue, ses combinatoires multiples du son et du sens[4]. Quant à « l’ouverture au monde », c’est un petite affiche-bateau, une carte postale de la pensée qui pense comme il faut que l’on pense.
« La chose est en effet menacée par son devenir image, ce qui est une affaire sans précédent… la screenisation, c’est-à-dire ce qui se passe à l’écran sous l’injonction de vivre en direct. »
Michel Deguy a mille fois raison. L’image donne à voir en surface, et quoiqu’elle n’empêche pas absolument d’écrire, son sens est brouillé soit par le commentaire qu’on lui accole (« on lui fait dire n’importe quoi » — M.D.B[5]), soit par l’émotion brutale qu’elle engage. Il m’est arrivé d’écrire que « l’image est ce qui empêche de voir ». Pour la poésie, elle l’anéantit dans un faux réel ou, pire, dans un réel présenté comme poétique.
Ensuite, pour Michel Deguy, viennent le reliques du passé (dans la langue, bien sûr) qu’il tend à concevoir comme « pertes » ou « rebuts » à ne pas conserver, mais à « transformer » (traduire ?) dans notre langue présente, sans superstition ni idolâtrie. On peut n’être pas d’accord : gardons le passé comme notre socle, notre trésor premier, vivant et non pas survivant, regrettant que, sauf exception, nos écoliers ne puissent plus comprendre ni s’intéresser à quatre vers de Racine. Soyons certains qu’un vers de Charles d’Orléans parlera toujours à notre âme : « Je meurs de soëf emprès de la fontaine… » et que Rimbaud, Verlaine, peut-être Michel Deguy lui succèderont sans encombre.
À la question adjacente « Pensez-vous beaucoup à vos lecteurs ? », Michel Deguy répond « Bien sûr !… », et de développer le sujet de l’enseignant, de celui qui parle à l’autre, aux autres… « L’acte d’écrire implique le destinataire, c’est-à-dire la publication. » C’est un langage d’employé des postes : « le destinataire ! » La publication est un tout autre problème. Certes, le poème gagne à être lu, porté par la voix et publié si possible. Mais s’il ne l’est pas, outre l’espoir de l’être plus tard, il n’en demeure pas moins poème. L’écrivant, le poète est d’abord en soi, dans le flux intérieur de la vie qui le possède et l’anime.
La postérité ? « Je ne pense pas que vous trouviez un auteur qui dise espérer être lu dans 200 ans. Le rapport à la gloire, à l’immortalité, a complètement changé. C’est le contemporain qui m’intéresse. Le présent. » Ici encore, n’être pas d’accord est le bon sens même. Qu’en est-il des bons écrivains que le présent refuse, qui n’ont que la postérité en point de mire. « Auteurs » ? Il en est de toute sorte : la postérité a même retenu les recettes d’un Apicius. Si la bibliothèque d’Alexandrie n’avait pas brûlé, la postérité nous eût légué, en compagnie d’une foule d’écrivains mineurs, voire médiocres, un nombre conséquent d’écrivains de haute volée. Pour « l’immortalité » elle relève de la foi ou de la superstition, mais il est curieux que Michel Deguy ne s’arrête pas sur la fugacité du présent, le bruit bavard de sacristie qui nous assourdit dans « le contemporain », fût-il laïque et national. Du vent, le présent ! Je finis avec Héraclite, cité par le poète Jean-Louis Bernard :
« Il faut aussi se souvenir de celui
Qui oublie où mène le chemin. »
M.H.
*
II — Renaissance d’une maison de poésie
De L’Atlantique à Alcyone.
Je célébrai en ces termes, dans mes Carnets d’un Fou XLIII (au 8 août 2016)[6], le retour d’une maison de poésie de grand large sous une apparence nouvelle : « On peut se réjouir encore aujourd’hui. Nous apprenons que la maison d’édition de l’Atlantique, qui avait été contrainte de déposer son bilan il y a une bonne année de cela, « ressuscite » sous le nom d’ALCYONE. L’impôt avait dévoré son modeste patrimoine éditorial. ALCYONE reprend le départ avec un autre type de contrat avec l’État et son administration fiscale. Nous savons que nous sommes, quant à l’imposition, le deuxième État européen le plus exigeant. Nous n’ignorons pas non plus que notre système de protection médico-social, quoique en voie de l’être, n’est pas encore entièrement ruiné, et que de le maintenir a un prix. » « Trois recueils poétiques inaugurent cette reprise d’activité. Ils sont signés d’Anna Jouy (De l’acide citronnier de la lune), de Marcel Migozzi (Ruralités) et Jean-Louis Bernard (À l’ordre de l’oubli). J’aurai le plaisir et l’honneur de célébrer à l’automne cette remise sur orbite de la poésie qui est, avec l’attention que l’on doit aux enfants, l’activité humaine primordiale témoignant de la pensée, du cœur et des îles des essences sensibles au milieu de l’océan pollué des vulgarités dans lesquelles nous baignons. » Voici. L’automne est venu.
Alcyoné (‘Αλκυóνη) est fille d’Éole, roi des vents. Zeus et Héra la changèrent en l’oiseau Alcyon, lui laissant, après le solstice d’hiver, jouir de jours sans tempêtes afin qu’il puisse couver ses œufs (les poèmes ?). Le moins que nous puissions faire est le souhaiter bon vent aux nouvelles éditions.
Éditions Alcyone — B.P. 70041 — 17 102 Saintes Cedex
Courriel : editionsalcyone@yahoo.fr
*
III — Les Recueils
§ — À L’ORDRE DE L’OUBLI, de Jean-Louis Bernard
« à cloche-mot / nous entrons / dans le vide taciturne / d’une attente sans voix » J.-L.Bernard
Ce beau recueil témoigne tout au long de l’attente d’un retour de mémoire, de celle de l’enfance à celle de temps qui nous ont précédés, de la préhistoire, m’a‑t-il semblé, à celle de temps moins lointains que des livres, des images ont offerts à nos rêveries. « La mémoire est silex / la mémoire est glycine ». Jusqu’à l’instant qui s’échappe. Jusqu’à l’anxiété à contempler l’abyme du temps (« le lieu d’avant le monde ») : « se souviendra-t-on d’avoir oublié ». Voilà l’enjeu initial et profond, une affaire de vie et d’effacement du vivant, sans doute.
Le mouvement est donc lancé. Il faut demeurer attentif à tout, aux êtres qui nous entourent, au végétal, au minéral d’abord, puis à notre monde lustré par les vents si présents et actifs dans ces vers qui pour être tirés à bout portant n’en sont pas moins de belle amplitude : « souffle dispersé / sur la paille / en infinie coulée : pérennité de l’éphémère » … Monde sensible obligatoirement lié, presque à la manière d’un pari, à la trace, à l’écriture : « mais déchiffre inlassable / l’écriture du vent / palimpseste sur la paroi / du taire. » Cruelle évocation de fille : « certaines gouttes / chancellent / d’autres se lovent / languides sulfureuses / au creux de nos / désirs. » Notre vie, notre temps limité, qui nous tire et nous entraîne, l’être vivant voudrait au moins agrandir sa cage, l’extraire du temps, la rouvrir… Mais quoi, c’est impossible : « le vent / seul abri pour nos traces / les porte sur son aile / ou bien en son reflet ». Traces incertaines, donc, si fuligineuses, qui s’égareront dans les nuées. Mais pas le temps, non pas le temps de faire halte, et moins encore de s’accrocher au terrain, non, il faut marcher, marcher… Il n’y a aucune possibilité d’évasion, aucun subterfuge : « j’ai conjugué le cru / et le sacré // sous l’archet de parole / vibrait la / solitude. » La parole, le poème ont-ils quelque pouvoir ? , « le chasseur obstiné / attend un signe / de l’ailleurs. » Faire halte, c’est pour attendre, rien d’autre, et « Peut-être / juste après le passage / manquerons-nous / aux heures. » Le plus, le mieux que nous puissions espérer… Mais rien à faire, nous devrons « marcher… marcher / dans la jungle du jour : par plaintes et collines / à travers ombres / et décombres » (p.59) C’est destinée, fatalité. Nous aurons donc marché. Traversé nos espaces et notre temps pour, à la fin, tirer « un chèque à l’ordre de l’oubli » Grande poésie de la pensée, du retour sur soi, sur l’être mince et vulnérable et néanmoins endurant que nous sommes. Pas de métaphysique, les dieux sont des images ou des absences. De la physique pure, de l’inéluctable, mais sans désespoir ni afflictions, nous-mêmes en somme, notre partage sur terre et nulle part ailleurs. C’est ainsi que j’ai lu, certes en lui rognant quelques plumes, ce poème magnifique. ̶ M.H.
§ — DE L’ACIDE CITRONNIER DE LA LUNE, d’Anna JOUY
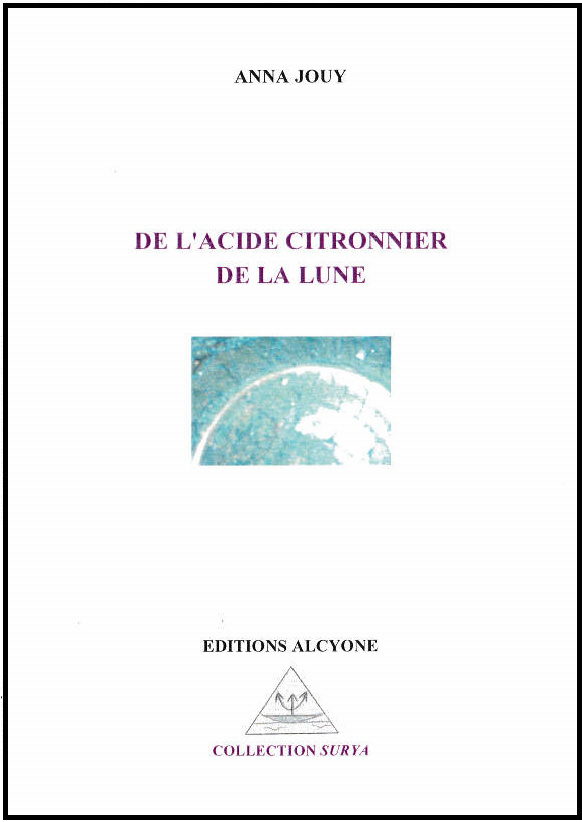
« L’éclosion des poudres noires, l’incognito du poème dans les deuils de la nuit. » ̶ A. Jouy
Vers libres alternent dans ce recueil avec distiques, proses brèves et, ici ou là, éclats dans l’œil et l’oreille, des pierres lancées contre les vitres sourdes de nos maisons d’esprit, des aphorismes ou presque… C’est cela la forme D’Anna Jouy, poète née en Suisse romande, non un continuum rigoureux mais une rigoureuse et kaléidoscopique liberté d’allures, comme d’une cavale. D’emblée, des inversions logiques, des visions : « les poissons du ciel perdent leurs lisses écailles […] Et au collet le lasso de la bise / Qui serre son écharpe sur ma voix ». Le « la » est donné. Rien ne sera comme d’habitude. Quelle parole laissera vivre le lasso-écharpe étrangleur ? L’aube est à chaque page, construite sur « un vide salutaire » réservé pour elle dans la mémoire… et pourtant Anna Jouy établit son lecteur / auditeur (on oublie trop que les poèmes peuvent aussi être lus et entendus) dans « l’inconstructible glacis de l’aube ».
Le monde physique paraît aporétique, ambigu, plongé dans ses indécisions comme dans ses certitudes paysagères. La poétesse rejoint l’espace antérieur où se parle « cette langue étrangère [qu’elle] ne connaît pas » mais dont elle éprouve les caresses liquides, « Langue de la praticité des choses, là où vivre est encore simple et de l’enfant. »
Il faut maintenant se lancer, défier les objets du monde, l’ombre, les vases et le vin… La vigneronne boira son vin de l’année, a‑t-elle un autre choix ? « Mon vase penché et la main qui tremble, un peu millésime chargé de lies. » On l’entend bien : ici, le langage de l’existence concrète est autre car le « rien » nous envahit par cent ouvertures, il donne l’assaut : « … il ne vous arrive de fait plus rien non plus. Sinon ce qu’on doit s’inventer, ce qu’on doit recréer de toutes pièces… » Pour ne pas s’estomper dans le poème absent, brouillé, et ne pas devoir s’établir dans le vide intégral, il faut tout recréer, soi-même, le décor alentour (le mot est mien)… Dès lors une méditation profonde engage le Poème, la voix, dans un creusement incessant et presque une chasse. La page, la partition sont blanches ̶ « La neige est mon enfance. ̶ et rude pourtant la tâche.
Des éléments viennent l’aide ou l’obstacle. Le vent invite à apprendre toutes les langues étrangères, et nullement au sens scolaire habituel. « La harpe du vent » creuse mon espace de vie : « J’essaie alors de savoir quelle matière me forme pour n’avoir aucune douceur, aucune légèreté, aucune transparence. » La parole peut s’instaurer : « … les vibrisses de la parole se mettent en mouvement et dansent. » Notre monde, tout le monde, « ce monde maillé de renvois […]… Saurons-nous l’écrire ? » La grande, la belle et signifiante poésie nous invite parfois à deux mouvements contraires : la reprendre à notre compte, donc la redire autrement, ou la mettre à bonne distance pour une travail d’observation et de dissection. Il faut aller au moyen terme. Je tente l’effort, assis entre deux chaises, dans une commode incommodité. J’ai cru, j’ai pensé, goûtant à « l’acide citronnier de la lune » ̶ car la lune est aussi un citron, n’est-ce pas ? Fière astronome, la poétesse ! ̶, nous sommes sous-tendus de nature, éternelle parturiente de nous-mêmes aussi. J’ai cru être plongé dans une lente et constante interrogation, ou, plus authentiquent, le mitraillage des questions : « Mettre l’accent sur ce ton diaphane de l’aube, la presser de me reconnaître, qu’elle me sorte de la nuit, qu’elle pèle mon obscurité, qu’elle me redéfinisse des humains et des vivants. »
À l’amoureux, à l’autre… : « M’as-tu aimée dis ? »
L’espoir du jour suivant, peut-être : « Mais aube, y es-tu ? »
Il n’y a pas de désespoir, ici, dans ces attentes et ces reprises de conscience ; de l’inquiétude, oui ; une colère discrète, une révolte tenue en laisse… L’appel au seul possible, je jour suivant, m’émeut au plus profond ̶ « Mais aube, y es-tu ? » ̶ . Nous n’avons qu’elle et sa lumière variable, puisque ni dieux ni Dieu ne sont là. Cette certitude négative et heureuse malgré tout m’est du moins apparue. Le doute fécond engendre poésie et musique avant toute chose, ensuite philosophie, pensée, tendresse, pour ce que j’ai cru comprendre, à la fin. Puis l’inéluctable qu’Ana Jouy dit ainsi, avec élégance mais sans rien dissimuler : « Il n’y a ici que de féroces langages, avec la mort dessus. » « Ici on brise grève dans le semis des granits, on jardine les abords de sa tombe, songeurs. » Parfois, l’aube elle-même n’est pas drôle : « J’ai mis ma danse dans une horloge molle. »
À la fin des fins : « Mettre un trait noir au corral des couleurs, contenir les lumières à leur séjour ̶ tout ce soleil dissipé qui veut remonter sa rivière ̶ frayer dans la nuit de sa naissance. […] À quoi se raccrocher ? » Quelques pas encore :
« Tandis que l’aube dévisse des couloirs de la nuit
Tenir son échelle et se faire la belle.’
« Genio y figura », comme disaient les Espagnols. Le loup meurt dans sa peau. Allure et caractère. On va puis on s’en va. Reste la trace, offerte au promeneur des bois, des temps et de l’espace impartis aux humains. Méditation mouvementée. Tel le poème. ̶ M. H.
*
§ — RURALITÉS, de Marcel Migozzi
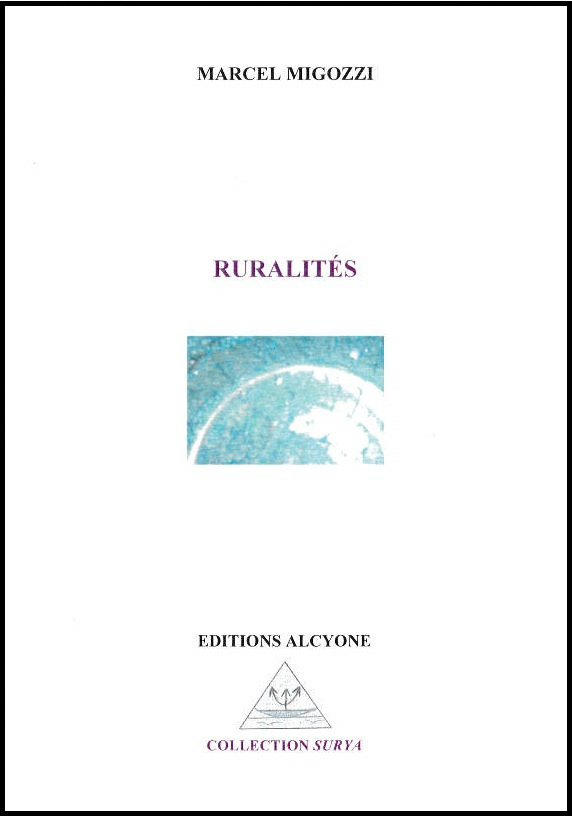
« Sous les cyprès / Mistral flapi et au tapis / Le chat du voisin passe en noir / Plusieurs bruits meurent plusieurs fois / Pas de questions ?» ̶ M. Migozzi
Ruralités libère les poèmes brefs, coups d’œil attentifs arrêtés sur les objets de la nature au sens le plus quotidien qui se puisse imaginer. Ce n’est pas reposant pour autant, car le fauteuil, au jardin, tourne lui aussi dans le cosmos.
Regard à distance, d’abord : les labours, les mottes, les corneilles « Avec un ciel pervenche / En miettes. » Entrée en matière dans le registre du constat, soit d’une supposée acceptance des faits, des choses, à la façon de Lucrèce ! Cela se met en mouvement : « Une étable puis l’abreuvoir / L’allégé bleu // Puis le soudain / Espace la / Montagne danse. » La tranquillité de l’inéluctable comme dans une peinture de Corot : « Le soir viendra / À vaches lentes. » De natura rerum.
Est-ce un monde nié par la réalité mondialisante en marche ̶ soit la F.N.S.E.A. et les « grands groupes », comme ils disent ? De ce monde qui s’enfonce, celui de nos enfances et pour quelques années encore de notre bel âge, Marcel Migozzi retient les beautés, les coloris patinés, visibles entre les branches du jardin qui semble d’abord, chez lui, ne devoir pas mourir. Un témoignage pour l’après et le maintenant, un témoignage maintenu ?
« Passons // L’olivier a offert du vert / À ses rejets une mésange / De l’écume / À ses dessous ». Cette délicatesse printanière émeut et touche l’âme. J’y songe (qu’on me pardonne de songer au même pas que M. Migozzi), dans mon jardin, cet été, les mésanges ne sont pas venues ? Toujours je m’inquiète. Où ont — elles passé l’été ? Dois-je me fier à l’intuition du poète : « Vers la beauté déjà / Poussière / Le papillon se hâte va… » Il prend note, lui aussi. Comment ne pas voir ce qu’on ne voit pas : « Dans le cyprès aucun oiseau. » ?
La giration du monde est ininterrompue : « Yeux de sommeil on perd conscience / Chat-chaise de jardin-olivier-ciel mélange »… Qui penserait à l’interrompre ? Qui le voudrait ? MM. Galilée, Newton, Copernic, Einstein & Cie se sont penchés sur le problème. Même constat. C’est impossible. Soyons obstinément patients : « En vieillissant il faut / Recommencer l’appel des présences discrètes ». C’est là toute l’entreprise de Marcel Migozzi. Et puis quoi… Sous le prunier mort « Ce poème n’est pas en bois / Et change lui aussi /// Mais quoi ».
Prise en considération de cette évolution, il faut aller vers l’ailleurs, vers la suite, les mois « en bre… l’automne » par exemple, vers l’ «adieu » de ses feuilles ratissées, revenir à L’invisible passé des morts ? » « Entre passé et non passé. » L’interrogation dit la difficulté. Il semble bien que le poète se faufile dans les interstices du temps et qu’il n’y aura sans doute « Pas de place pour le dernier vivant », ajoutant ce « Déjà ? » qui sonne comme un glas.
Un apparent détachement semble être l’attitude voulue dans cette excursion aux paysages anciens, déjà. C’est l’empire du Déjà. « L’enfant y demande à son cœur / Pourquoi il a déjà vieilli ». Déjà, déjà… « Comme le temps passe » ̶ entend-on sur les places de villes et des villages, dans les escaliers des immeubles… Alors, pour reprendre de ce poil de la bête qui nous meut, nous rend l’énergie, le poète s’adresse à l’enfant (je pense pouvoir dire « à toute enfance ») lui signalant ce qu’il y a encore à voir et à honorer parmi les beautés du jardin exténué, les oiseaux d’abord, ceux de François d’Assise et du paradis premier ̶ rouge-gorge, mésange bleue, charbonnière, oui, si familières, si audacieuses !, rossignols, chardonnerets, dont un seul nous interroge encore : « Qui es-tu ? ». Les enfants des villes ont parfois la chance de les (re)connaître car des pédagogues de bonne volonté les entraînent dans les bois, les parcs, pour les y rencontrer. Puis viennent les fleurs, « l’écume / éclaboussée d’abeilles », neige sur l’amandier, « la fleur (ou la chair) est si nue / qu’elle n’a rien sous elles / à elle », les fleurs qui finiront par se faner, réduites à ce « … pétale isolé / délà marbre // déjà ».
L’hiver peut-il contrevenir à la loi ? On le croirait, on le désirerait : « neige fille / de nuque pure ou de /// poitrine nue / laiteuse /// neige mère / désirable ». Nostalgie des désirs et des anciennes amours, à quoi répondent d’autres souvenirs, atroces, qui rendent inutile (selon moi) le sursaut : «neige l’étoile / au revers jaune /// là-bas les corps / brûlés du siècle /// neige restante / à la mémoire / il neige encore ». C’est comme le coup de grâce. Ces belles et dures Ruralités ne s’achèvent pas en apothéose, ni en célébration, ni même en tristesses avouées. Les faits sont là. Ils s’enfoncent, nous enfoncent. Regardons la vérité en face. La mort est grimaçante dans ses instrumentalisations les plus répugnantes : le poème du temps humain reste tragique. Tirez-en vos leçons, car je n’en ai pas à vous donner affirme le poète dans un constant et vigoureux implicite. Cela étreint, est superbe. ̶ M.H.
*
IV – Notes biobibliographiques
Jean-Louis BERNARD Poète et critique, Jean-Louis Bernard, né en 1947 à Biarritz, vit à Grenoble depuis 1975. La montagne, le sud, le temps nourrissent son écriture poétique. Il a écrit et publié plus de trente recueils et obtenu le prix de la Découverte poétique en 2001. Dernières publications : Au juste amont du songe (La Licorne), 2oo8 En lisière d’absence (L’Atlantique), 2010 Calligraphie de l’ombre (Jacques Brémond), 2011 Entre trace et obscur (Sac à Mots), 2011 Dans la tanière obscure du soleil (Encres Vives), 2012 Côté ubac (Le Petit Pavé), 2012 Et la parole s’est faite nuit (L’Atlantique), 2013 Savoir le lieu (Editinter), 2013 A l’heure grise (L’Ecritoire d’Estieugues), 2014 Dans l’inédit du gouffre (Encres Vives).
Anna JOUY, est née en Suisse romande, y vit et y travaille, notamment dans un Centre de formation pour femmes en grandes difficultés. Elle élabore des spectacles musicaux et poétiques, des mises en scène. Elle a aussi écrit des romans policiers… Ses recueils poétiques publiés : Ciseaux à puits, 2008, Polder-Décharge ; La mort est plus futée qu’une souris, 2008, Le Pas de la Colombe ; Au crible de la folie, 2011, L’Atlantique ; Agrès acrobates, 2013, Ed. P.I. Sage Intérieur.
Marcel MIGOZZI, poète français, est né à Toulon, en 1936, d’une famille ouvrière d’origine corse. Il vit dans le Var. Il a obtenu les prix Jean-Malrieu (1985), Antonin-Artaud (1995) et Des Charmettes-Jean-Jacques Rousseau (2007). Il a publié dans de nombreuses revues, collaboré à des ouvrages collectifs, anthologies, livres d’artistes… « Il aime une poésie lisible, incarnée, en souci du monde quotidien. » (Ed. Alcyone). Parmi ses trente et quelque recueils de poésie, les derniers : Un pied toujours dans mon quartier, La Porte (2014) ; Pommeraie Paradis, Tipaza, (2014) ; Des heures froides, L’Amourier, (2014) ; L’heure qui chasse, Gros textes (2014) ; Temps morts, Encres Vives (2015).
[1] Louis Aragon, Œuvres poétiques complètes, Pléiade, vol.II
[2] Je ne prétends pas éclairer « le poétique », et reviendrai sur cette substantivation du qualificatif.
[3] On pensera à Héraclite, Nietzsche, Rilke…
[4] Dans ce sens, l’oubli, le mépris, voire l’hostilité dans lesquels sont tenues aujourd’hui les Fables de La Fontaine, fondatrices (avec peu d’autres œuvres) de la langue moderne et contemporaine, est un malheur doublé d’un déni de justice. Les esprits étroits et courts n’y voient que de « la morale », dont ils ne savent rien tout en la détestant.
[5] M.D.B. Ma Conseillère en titre.
[6] On retrouve aisément ces Carnets sur le site : LA CAUSE LITTERAIRE — http://www.lacauselitteraire.fr/carnets-d-un-fou-xlv-par-michel-host
















