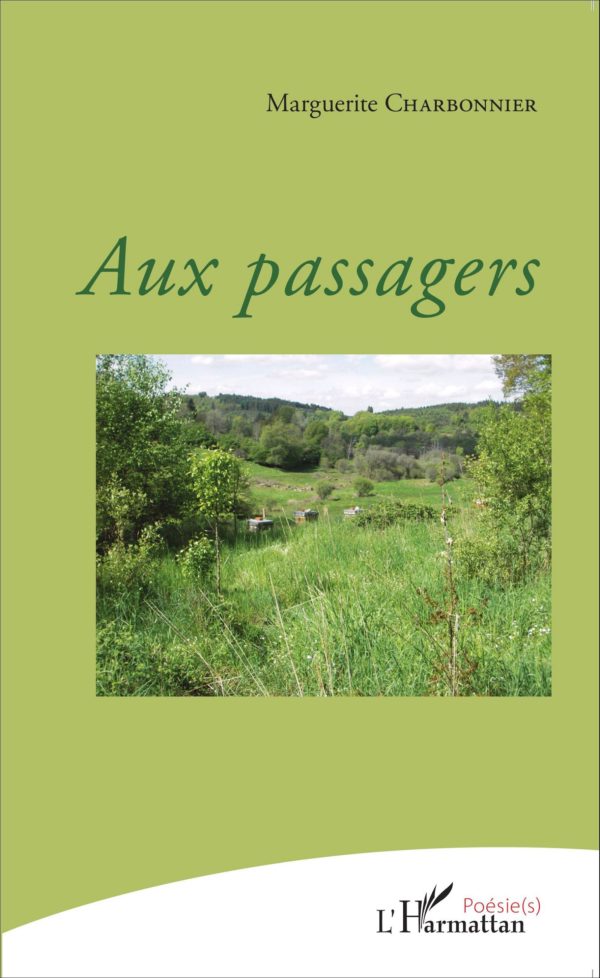Aux passagers de Marguerite Charbonnier est un titre1 Marguerite Charbonnier, Aux passagers, coll. « Poésie(s), L’Harmattan, 2015. sous forme de dédicace à ses lecteurs. Il semble que la poétesse ait puisé son inspiration dans les voyages de Paris vers ces « régions de grande province humide » (14) qu’elle affectionne tant2 Les chiffres entre parenthèses correspondent à la pagination du recueil.. Les lecteurs sont donc les passagers d’un train qui met en mouvance l’écriture poétique :
êtes-vous
avec moi
prêt pour ce grand voyage
qui brûle
en nous déjà
et qui nous fait lever
chaque aube
pour demain (49)
Le poème est une invitation au voyage.
Dans le train, le bruit est parfois si régulier qu’il équivaut au silence, le mouvement si continu que l’esprit le prend pour l’immobilité. C’est du silence de ce lieu que jaillit l’inspiration du poème de Marguerite Charbonnier.
Cette poésie, proche de la sensibilité et de la forme brève des haïkus est imprégnée par la notion des saisons :
le déversement du temps
sur nous
sur notre vie
et nos saisons (22)
La fulgurance de l’instant est captée par un distique : une prairie aveuglante / de chants d’insectes (20) ; un tercet : l’aube / son regard froid jeté / de son front blanc dégagé (16) ; ou, encore, ce neuvain : « tasses remuées / les soirs d’été / bruit / choqué / des vaisselles / des cafés / des tables / des villes /de promenade (66).
L’instant est un don de ce mouvement qu’il est possible de vivre dans d’autres véhicules que le train :
il arrive un instant où le car d’où
qu’il vienne
même chargé des monts des rivières
des alpes glorieuses
des villes et d’horizons splendides
des orients
passe le tournant familier
l’angle de rue où l’on va au pain (71)
Être en partance ne se conçoit que s’il y a, quelque part, un autre être qui vous attend : « et comment font tous ceux / qui n’ont pas / quelque part quelqu’un / qui les attend pour ce projet / et qui plonge avec eux / dans la vague / ou le ciel / ou l’infini des forêts » (27). Ce sera un des seuls questionnements d’un recueil dont la tonalité est surtout sérénité, certitude, joie et espoir :
Tout fleuve est passage à l’espère (44)
La nature, elle aussi pour exister est en attente du regard poétique : « narcisses des patiences innées / attendez que nos yeux éblouis / dans l’herbe verte / vous regardent (11)
Le seul antagonisme réside entre la nature que l’œil découvre à travers la vitre du train en mouvement et la ville figée aux tours de verre. Vitre de la transparence : « l’ardeur immense / la froide emprise / la belle glace / o vitre franche » (22). Verre de l’apparence : « verre glissant des apparences / monde de verre / glissent nos mains / conversations / factices / conseillers de loin / téléconseillers (51).
Dans le monde de la transparence, les choses sont vues dans la réelle présence de leur beauté, mais dans le monde de l’apparence, le regard se voile de mélancolie.
Alors que tous les vers du recueil commencent par des minuscules, les majuscules n’apparaissent qu’en trois endroits qui sont autant de stations poétiques. D’abord dans deux strophes contiguës, de quinze et cinq vers, au milieu du livre, qui décrivent la désolation du gigantisme urbain :
Tours de l’humain
Sœurs inhumaines
Absentes vides aux yeux de verre
Sans le voir
Au bord du fleuve debout sans fin
Attendez-vous que l’onde s’use
Ou le ciment
S’effrite
Pour revenir
Aux berges tendres
D’argile autrefois
Habitées alors
De prairies de vie
De versants boisés
D’osiers pâles et saules vertsSœurs d’enfantine ardeur
Patientes sans savoir
Construites par folie
Dressées par déraison
Et pauvres d’abandon (53)
Les majuscules marquent l’orgueil inhumain qui a saisi l’homme moderne mais elles peuvent aussi désigner la négation du voyage, l’absurde tourner-en-rond, la crainte du retour vers le point de départ de la Capitale, que symbolisent les ronds-points, comme le montre la deuxième occurrence des majuscules, dans ce tercet : « Que de ronds-points / Universels accidentels / Semés dictés au long des routes » (86). Enfin, l’étrange troisième occurrence des majuscules, dans ce quatrain qui sonne la fin de l’automne et l’entrée dans la saison de l’hiver parisien : « Odeur de la feuille / D’automne / De la terre / Du dernier oiseau » (92). Sensation mélancolique, rêvée au milieu des hautes tours de la ville, dans les cours citadines aux barreaux majuscules :
cours d’anciens immeubles à Paris
où l’on peut faire des rêves
si longtemps
des années d’ennui
de silence
de vie de sauvage enfance
des prisons d’espoir (89)
Si les majuscules des villes engendrent la mélancolie, c’est que leur centre en est occulté : « villes qui ont l’allure / d’éternelles / banlieues / étalées en ruban le long des voies rapides / de centre commercial en zone /industrielle / parc de loisir / d’activité / zone / résidentielle / panneaux indécis mentionnant / le centre / caché / où des traces / de vie normale rappellent qu’un jour / des villes furent bâties / pour des hommes (69). Le rythme des saisons est donné par le centre, autant géographique que spirituel :
centre
des sources et des plateaux
cœur de France (62)
Quel est le projet de ce livre ? La poétesse le révèle : il s’agit de « descendre le trajet / de notre destinée » (27), de retrouver notre centre qui se trouve sur la route de notre Midi :
Paris Vierzon Limoges Brive Toulouse Agen
le grand air frais qui court
dans le train du pays
les retours et les arrivées
du sud
places campagnes et villes
habillées du midi
danses et parlers légers
noblesses héritées de race souveraine (55–56)
Le mouvement qui engendre l’inspiration poétique est porteur d’un rythme qui donne la clef du secret de l’écriture :
pour l’amour de vous
et de moi
appelons-nous d’un nom nouveau
d’un nom qui sonne et qui chante
au grand air
qui nous réveille
et nous révèle
un nom d’espace
un nom de langue
secrète
et douce
de langue
ancienne et neuve
comme un grand fleuve
passe
sage et usé sous les ponts de l’Histoire
et comme
bouillant aux bancs des galets ronds
dans les montagnes sans témoins
sa source
petite et vive glacée
jaillit (65)
Cette langue secrète du cœur, le lecteur la découvrira dans un sizain, caché dans un tout petit compartiment, au fin fond de ce train poétique conduit par la main écrivante de Marguerite Charbonnier ; c’est la langue d’Oc des troubadours et des poètes du Félibrige qui, intérieure à la langue poétique de l’auteur, invisible à l’œil lisant, impulse le rythme des sonorités d’une poésie qui se présente comme un « défi de vivre / en amants / et en enfants / la liberté » (11)
- Marguerite Charbonnier, Aux passagers - 10 juillet 2016
Notes