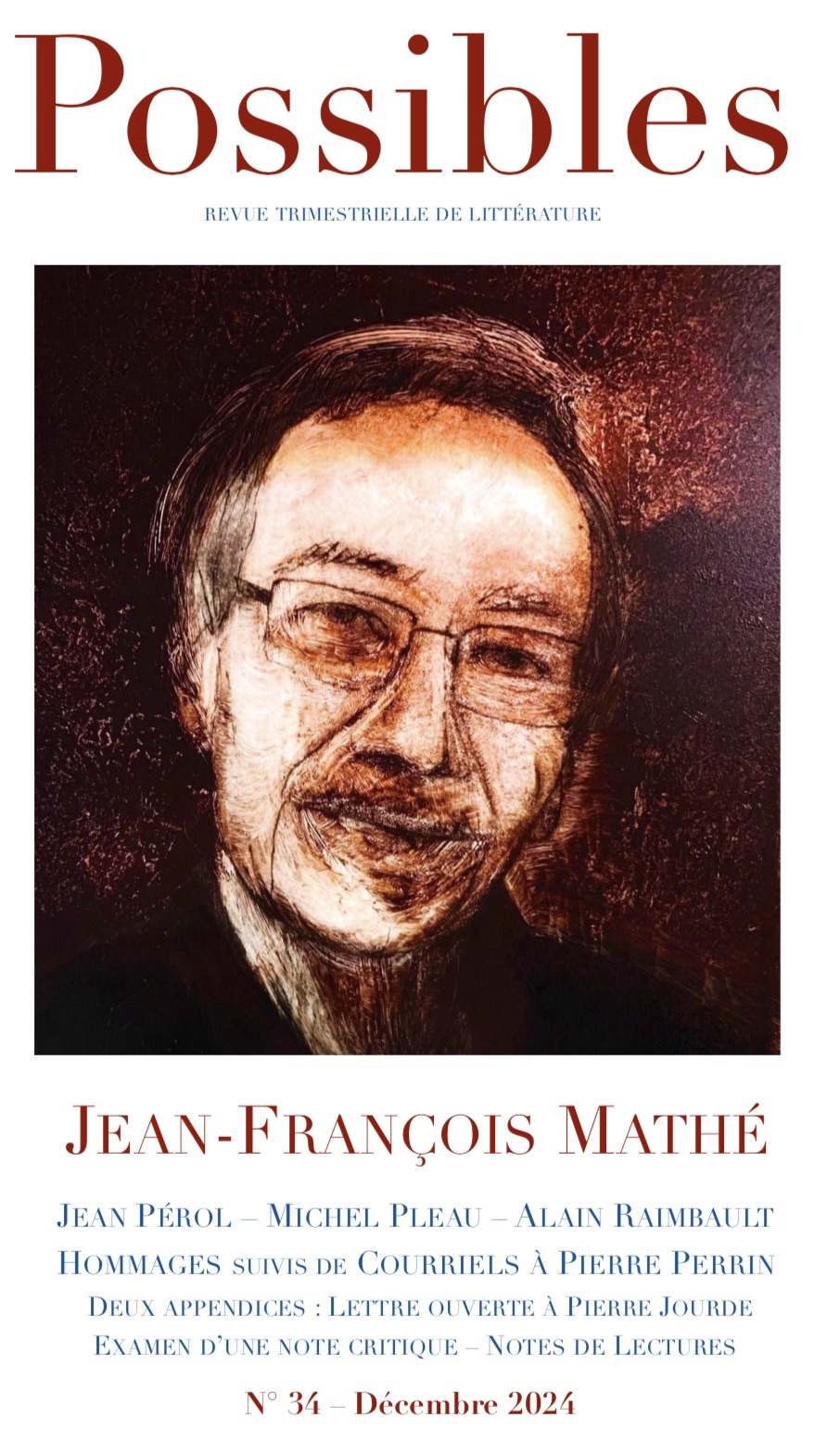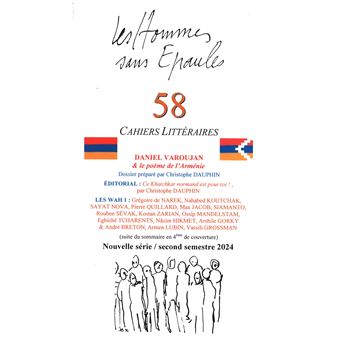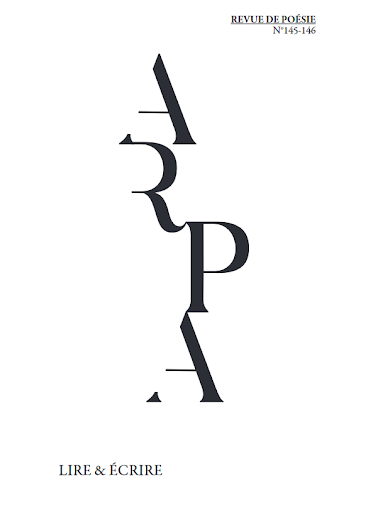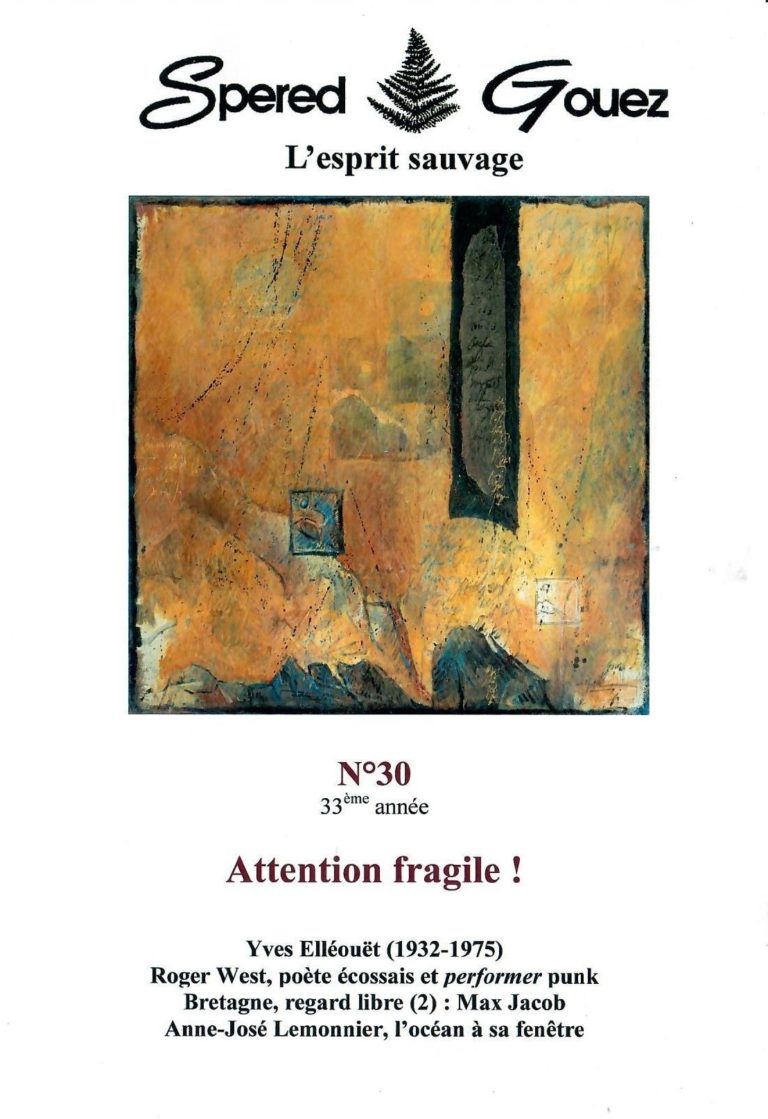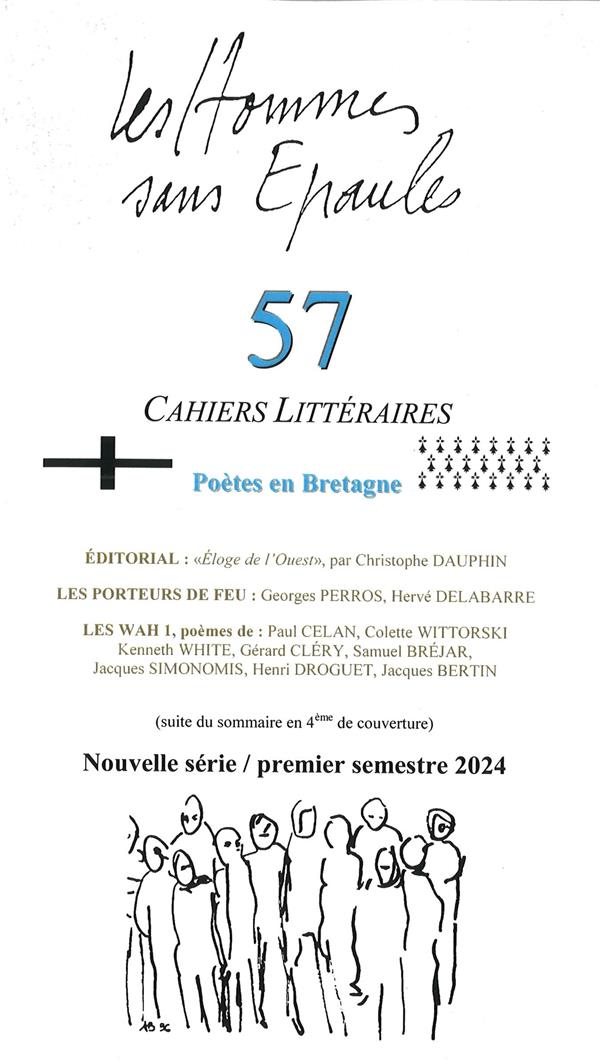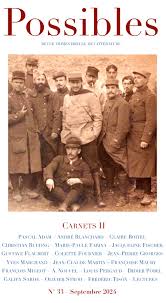À l’image de son rédacteur en chef, Richard Millet, La revue littéraire propose des articles d’une grande tenue. 276 pages, rien à jeter, cela commence par quatre auteurs italiens vivants à Paris qui abordent les questions de la précarité des écrivains et de l’asservissement de l’intelligence.
« Plus on cherche la qualité, moins on est payé »… Francesco Forlani offre une stimulante réflexion sur nos représentations du « travail culturel », sachant que tout travail mérite en général salaire. L’article, pour vif et même drôle, ne laisse de mettre mal à l’aise tant la situation de bénévolat forcé dans lequel se trouvent les auteurs est un fait collectif auquel tous participent. Loin d’énoncer des solutions (exercice à la mode en ces mois préprésidentiels), loin même d’imposer ce qui serait un problème à résoudre, il nous tend (à nous tous, travailleurs culturels travaillant pour la gloire ou le sens du service) un miroir qui fait le tour de la tête.
De la république des lettres, Andrea Inglese donne l’image d’une autopromotion permanente où il n’y a que des « égoïstes lancés les uns contre les autres ». Où l’on voit que l’art de la formule peut aider l’intelligence. L’humour aussi : en réfléchissant à ce qu’il nomme les « écrivains pré-posthumes », Giacomo Sartori met le doigt sur un problème littéraire qui est aussi un problème de civilisation :
Moi-même, le soir le plus souvent, ou quand il pleut, ou quand mon compte en banque entre dans le rouge, ou quand le frigo est vide, je penche vers cette autre possibilité. Je me dis que je ne suis pas un écrivain pré-posthume, mais un écrivain raté : mon échec réitéré et cristallin est exactement ce que je mérite. Le matin suivant je me lève, et je recommence à lutter pour trouver un peu de temps pour écrire (…) indifférent à ce qu’assènent les pages culturelles des journaux, ces havres de l’entre-soi où les critiques parlent des romans écrits par les critiques des autres journaux ou par les éditeurs des maisons d’éditions où ils publient eux-mêmes (…) rêvant peut-être que ma belle et riche éditrice m’invite à déjeuner, comme cela arrive dans tant de films français.
Jérôme Michel donne un remarquable article sur Cristina Campo, une « insulaire de l’esprit » :
Chez les insulaires de l’esprit (…) nulle nostalgie d’un âge d’or, d’un autrefois fastueux en contrepoint de la détresse du présent. Ceux-là savent qu’on ne peut rien contre le temps, que toute insurrection s’achève dans les fosses communes de l’oubli. Non, pas de contre révolution à opposer à la révolution des mondes. Les civilisations meurent, c’est tout. L’insulaire de l’esprit se tiendra droit dans le désastre, et calme, et silencieux.
Avec subtilité, il fait vivre cet auteur dans son époque.
Après une citation de Joyce poète (Chamber Music) Clara Lukowska donne de très forts poèmes :
Pourquoi me dire que tu m’aimes
si c’est pour me laisser au bord des mots
comme le hérisson retourné (…)
Une longue contribution de Bruno Chaouat s’interroge sur la possibilité de la littérature à l’ère du transhumanisme. Qu’est l’acte d’échanger la parole face à ce projet d’améliorer et d’augmenter l’homme ? Où la littérature apparaît consubstantiellement liée à cet homme ontologiquement défectueux dont le narrateur des Particules élémentaires finissait par se débarasser.
(…) la mort serait vaincue ici-bas et non plus au-delà (…) la littérature en tant qu’elle s’élève, comme la foi, contre la mort, a‑t-elle un avenir ?
Face aux avancées en apparence libératrices de la Silicon Valley, cet article documenté réunit des considérations anthropologiques, scientifiques et morales : notamment sur le cerveau, cet organe esthétique « affecté par l’ouverture au monde ». Au delà de l’article, peut-on y voir une réponse à « l’onanisme » littéraire traité par le quatrième auteur italien, Giuseppe Schillaci ? Le Je t’aime du robot fait quant à lui penser aux poèmes de Clara Lukowska. Ce qui montre la cohérence éditoriale, qui est aussi une cohérence d’ouverture, comme en témoigne encore l’entretien de Régis Debray avec Richard Millet et les pages diaristes de ce dernier, deux auteurs moins unis par les idées que la rigueur d’écriture et l’art de ne jamais être en repos.
Je terminerai ce tour incomplet par un long article de Guillaume Basquin sur Carrousels de Jacques Henric. Une republication à laquelle il a participé et dont il constate amèrement le maigre écho dans la presse papier. Nous épargnant les réflexions désabusées sur la fin des avant-gardes, Basquin fait de cette irritation un départ pour un questionnement sur la littérature aujourd’hui. Immense vertige que de constater que le grand public et la presse semblent dépassés par l’ampleur du réel (et de sa folie institutionnelle ?) au point de ne plus oser parler de telles œuvres « insuffisantes » par principe. In-suffisance qui requiert un lecteur actif. Mais il semble que chacun cherche, à travers l’expérience littéraire, une sorte d’assurance tout risque parfaitement adaptée à la singularité (fantasmée) de sa vie. Et là l’industrie éditoriale assure l’approvisionnement. L’article est riche, précis et lyrique. On peut ne pas suivre Henric et Basquin (d’ailleurs, le plus jeune des deux, Basquin, n’a lui-même pas une âme de disciple) dans toutes leurs assertions, mais s’enchanter que le comptoir des lettres serve encore ce genre d’alcools forts.
°°°°°°°
Aux commandes des Cahiers de Tinbad, le même Guillaume Basquin demarre le numéro 2 sur une rencontre inadvenue : il voulait y faire dialoguer Schuhl et Nabe, les deux l’ont éconduit. Ils ont même, depuis leur frenhoférienne retraite, refusé tout net l’autorisation de republier certains textes de jeunesse. Pas le moins du monde plaintif, il signe un édito qui, au lieu d’être vengeur, est une réflexion sur cette génération de maîtres qui ne veulent pas transmettre. Réflexion qui pose la question morale (il est question d’égoïsme et du « jouissez sans descendance ») en même temps que celle de la survie de l’institution littéraire… On voit que les préoccupations des Italiens de La revue littéraire ne sont pas très loin.
Dans le corps d’un sommaire à cheval sur le texte et l’image animée, Basquin analyse entre autres les Huit salopards de Tarentino. :
[…] l’écran extra large est très propice à bien représenter l’indifférente nature, sa violence intrinsèque. Ici, cette sauvagerie est très bien représentée […] ce blizzard qui n’en finit pas et qui emprisonne les personnages, soulevant les passions, et rendant enfin possible le bain de sang final. Oh le beau rouge ! Et ce bleu du ciel dans les premières minutes [quand la diligence] nous mène vers le lieu du drame/crime ! Ah ce blanc moiré (à cause du noir entre les images du projecteur-Lumière à obturateur rythmique) […] Je sais qu’en projection numérique, c’est perdu… Foutu !
Son style de critique ressemble à son style poétique. Le lecteur doit engager la première phrase dans son cerveau à la manière d’une pellicule dans les griffes du projecteur. Après, ça se lit très bien. C’est un peu ce qu’on fait avec les vers classiques. C’est une éthique de la lecture présupposée par la façon d’écrire. Cette remarque stylistique me semble résumer ce que l’auteur prétend apporter dans les usages littéraires de maintenant, une implication et un style qui ne se limitent pas à des enjeux esthétiques.
Toujours le cinéma, Mark Rappaport vient parler du goût d’Hitchcock pour la performance. Les explications sont accompagnées de photogrammes, on a l’impression d’être avec l’auteur dans une salle obscure.
Côté poésie — mais n’y étions-nous pas dès le début ? —, c’est Christophe Esnault, lequel nous permet de trouver made in french une rude alacrité que nous avons pris l’habitude d’importer d’outre-Atlantique (Swensen, Rankine, etc.) :
Aplanir la sensation jusqu’à ce qu’elle crache son jus.
Je reviendrai sur cet auteur avant le printemps.
Côté vivacité, Tristan Félix, dont Guillaume Basquin fera prochainement une présentation dans nos colonnes, nous livre des poèmes sur des images de « malformations » animales ou humaines à la limite du montrable. Lignée Batailienne ?
Je n’suis pas bien joli joli
dis-tu
dois-je l’être ?
Peut-on rire, pleurer, fuir ? Êtes-vous une chose ? Voilà le sens d’écrire sur « l’anormal », la question irrigue le normal et son déficit d’humanité. La référence à Freaks…
« On lit pour perdre du temps ». Dans ce cas, je ne pense pas.
°°°°°°°°
La même Tristan Felix est au sommaire de Dissonances avec une réflexion sur le clown (de mes deux), qu’il ne faut pas confondre avec le bouffon qui est aimé du Pouvoir (d’après vous Groland, entrecoupé de pub pour 4x4, se plaçait dans quelle catégorie ?) Ce texte a donc passé le comité de lecture sous forme anonymée comme toutes les contributions. Un choix qui fait voisiner des débutants et des confirmés au nom du seul intérêt de leur écrit. On pourrait objecter que cela risque de tout subordonner au goût de l’équipe de rédaction autour de Jean-Marc Flapp, mais la palette des collaborateurs des 30 numéros précédents, de Valérie Rouzeau à Hubert Haddad, prouve une bonne ouverture d’esprit.
Le thème du numéro : désordres.
Jean-Christophe Belleveaux donne un journal du trouble qui ressemble à un glossaire sur un air de blues, mots triste et sourire goguenard : j’accueille le soir, la poignée de la porte, les voix, ce qui serait une réalité vraisemblable (qui ne m’inclut pas tout à fait)…
Luna Beretta fait un récit avec X et Y en plus du narrateur, dont le ton prolonge maintenant l’aboulique désinvolture d’un certain Plume ; dans Asphodèles, Cédric Bonfils raconte une perte d’identité par petits bouts où la seconde personne paraît à chaque fois un peu plus effacée de la phrase, jusqu’à être à la fin affublée du nom floral qui fait le titre : cette fleur presque verte… On aimerait parler de tous ces bons et très bons textes.
Sinon, c’est une vraie revue avec un portfolio de photos — cette fois d’Isthmaël Baudry, où les reflets servent moins à superposer des lieux qu’à faire trébucher l’un l’autre, comme deux marcheurs chercheraient en vain à accorder leurs pas — et des critiques de livres, ça ne coûte que 5€ et on a envie d’en acheter pour donner à la volée aux amis de passage.