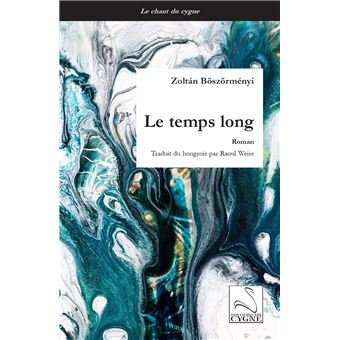Mais cette dernière ne pouvait pas et ne voulait pas parler honnêtement de cette histoire, elle m’a envoyé auprès de la directrice. J’ai également contacté le maire de la petite ville, qui a répondu à mes questions ouvertement et honnêtement, et m’a donné le nom et le numéro de téléphone de l’assistante sociale en charge des enfants. J’ai appris que l’école n’avait pas de psychologue pour enfants, que l’assistante sociale n’avait pas reçu la formation nécessaire pour aider la fillette et que cette dernière avait été transportée à l’hôpital alors que son état était tellement détérioré qu’elle pouvait à peine marcher. J’ai rassemblé beaucoup d’informations et il ne me restait plus qu’à commencer à écrire le roman. Mais je n’y arrivais pas. J’ai travaillé sur le texte pendant des semaines, mais je n’arrivais à rien. Je suis resté assis devant l’écran de mon ordinateur, abasourdi, et aucune pensée ne me venait. Plus d’un mois s’est écoulé, jusqu’à ce qu’un matin, je me rende compte que j’avais moi-même grandi sans mère. Pendant des années, j’avais cherché l’amour de ma mère, sa présence, ses caresses, la chaleur de son âme m’avaient manqué. À l’âge de soixante-sept ans, je suis entré dans le rôle de cette fillette et j’ai écrit ce livre en à peine un mois.
Que vous évoque l’anorexie ?
Il existe deux types d’anorexia nervosa. Tous deux sont dus à une perte d’appétit. Le premier type est appelé boulimie. Elle se manifeste surtout chez les adolescents qui se se font vomir ou refusent de manger par peur de devenir obèses. L’autre type, également un trouble nerveux, est le résultat d’une sorte de rébellion. En l’occurrence, la jeune fille refuse de manger pour attirer l’attention de sa mère, dont elle a besoin de l’amour. Il existe une phase de la maladie, décrite pour la première fois par le Français Ernest-Charles Lasègue et le Britannique William Gull en 1873, où la dégradation totale du corps est inarrêtable et aboutit à la mort. Il n’existe pas de traitement pour cette maladie, c’est pourquoi elle est si fatale. Moi aussi, j’aspirais à l’amour de ma mère, mais je me rebellais autrement, je tombais dans la mélancolie, je vivais dans une mélancolie douloureuse et j’étais envahi par une léthargie constante.
Comment définiriez-vous le personnage de la mère dans votre roman ?
Le comportement de la mère et son mode de vie sont un fil rouge qui traverse le roman. Elle n’a pas fait beaucoup d’études, elle est peu cultivée. Bien qu’elle aime sa fille de manière abstraite, elle est incapable de comprendre ce dont son enfant a besoin. Elle n’a aucun sens de l’attachement parce qu’elle n’a jamais été attaché à personne. Sa vie affective est morne. Elle change beaucoup de partenaires. Elle part travailler à l’étranger parce qu’elle veut gagner sa vie plus facilement, si possible pour trouver dans son travail de la détente et du plaisir physique. Quelque part, elle est consciente de sa responsabilité envers son enfant, mais ses instincts maternels sont mêlés d’insouciance et d’ignorance. Elle ne comprend pas pourquoi sa fille aspire à son amour, parce qu’elle-même n’a jamais vraiment aimé personne. J’ai éprouvé des difficultés à présenter le comportement contradictoire de la mère, à dépeindre son personnage. Quant à sa présence, sa relation avec sa fille, j’ai essayé de rester objectif et laconique. Moi-même, je ne pouvais pas m’identifier à elle, elle était si repoussante, si cruelle.
Avez-vous songé à une fin différente ?
J’ai plusieurs fois pensé à sauver la vie de la jeune fille, une fin heureuse m’est venue à l’esprit. Mais à chaque fois, je devais me rappeler que cette forme d’anorexie mentale est fatale. Au-delà d’une certaine limite, on ne peut pas y survivre. Bien sûr, je voulais que la jeune fille se rétablisse, qu’elle quitte l’hôpital et que, plus tard, lorsqu’elle aurait éventuellement un enfant, elle l’aime comme personne d’autre. Son amour pour son enfant aurait été la catharsis de sa vie. Mais dans ce cas, cela aurait été un autre roman, un autre type de fiction.
Est-ce que l’écriture de ce livre vous a soulagé d’un poids dans votre vie personnelle ?
Non. Ma propre expérience de vie, l’absence de ma mère, n’a fait qu’intensifier la douleur due à cette détresse émotionnelle. Je ne voulais pas revivre les événements de mon enfance, mais plutôt souligner la tragédie et le manque d’expression de cet état émotionnel, qui n’est comparable à rien d’autre. Quand j’ai écrit sur le destin de cette jeune fille, j’y ai aussi inclus mon propre destin, avec toutes les angoisses qui déchirent la chair et les douleurs au plus profond de l’âme. Le Momo dans le roman La vie devant soi de Romain Gary (Emil Ajar) verse de l’eau de Cologne sur le cadavre en décomposition de Mama Rosa en insistant avec dévotion sur le fait qu’elle ne peut pas accepter sa perte. Il ne peut accepter sa mort parce qu’il l’aime farouchement, de manière indiscible, à la folie. Si vous aimez quelqu’un, si vous l’aimez de tout votre être, de toute votre âme, vous ne pouvez pas vous en séparer.
Dans ce roman, vous avez choisi de mettre à l’écart la figure paternelle. Pourquoi ?
Ce n’était pas une question de choix. Mon père a toujours été présent dans ma vie, mais pas comme un symbole d’amour, d’affection, de loyauté. Beaucoup d’hommes sont incapables de se sacrifier pour leurs enfants. Je pourrais citer d’innombrables exemples parmi mes proches et mes connaissances. Les hommes se comportent différemment. Pour eux, la paternité n’est pas une épreuve, une expérience écrasante dotée d’une force indomptable. Ils ne portent pas l’enfant dans leur ventre pendant neuf mois, ils n’accouchent pas, ils n’ont pas leur corps lié par un cordon ombilical, ils n’ont pas leur bébé suspendu à leur poitrine pour allaiter. La maternité est un don de Dieu, et Dieu ne l’a donné qu’aux femmes. C’est pourquoi elles sont privilégiées, différentes de nous, les hommes.
Avez-vous dû vous-même « fermer les yeux » sur certaines choses quand vous étiez enfant ?
J’ai été le témoin oculaire et auditif des disputes de mes parents à plusieurs reprises. Ils étaient très méchants l’un envers l’autre. Je me disais que s’ils répétaient sans cesse qu’ils s’aimaient, pourquoi se comportaient-ils de manière aussi hypocrite ? Pourquoi se lançaient-ils des mots au vitriol ? Pourquoi criaient-ils ? L’âme de l’enfant est une chose très sensible, elle peut être facilement endommagée. Non, je n’ai pas fermé les yeux quand mes parents se disputaient, jouaient au chat et à la souris, je me suis simplement caché. Parfois sous la table, parfois derrière la bibliothèque. Chacune de leurs disputes me causait une douleur physique. La petite fille du roman ferme les yeux parce qu’elle veut se cacher de la réalité - elle ne peut plus bouger, c’est vrai — mais cela lui permet aussi de se souvenir plus facilement des moments de sa courte et douloureuse vie.