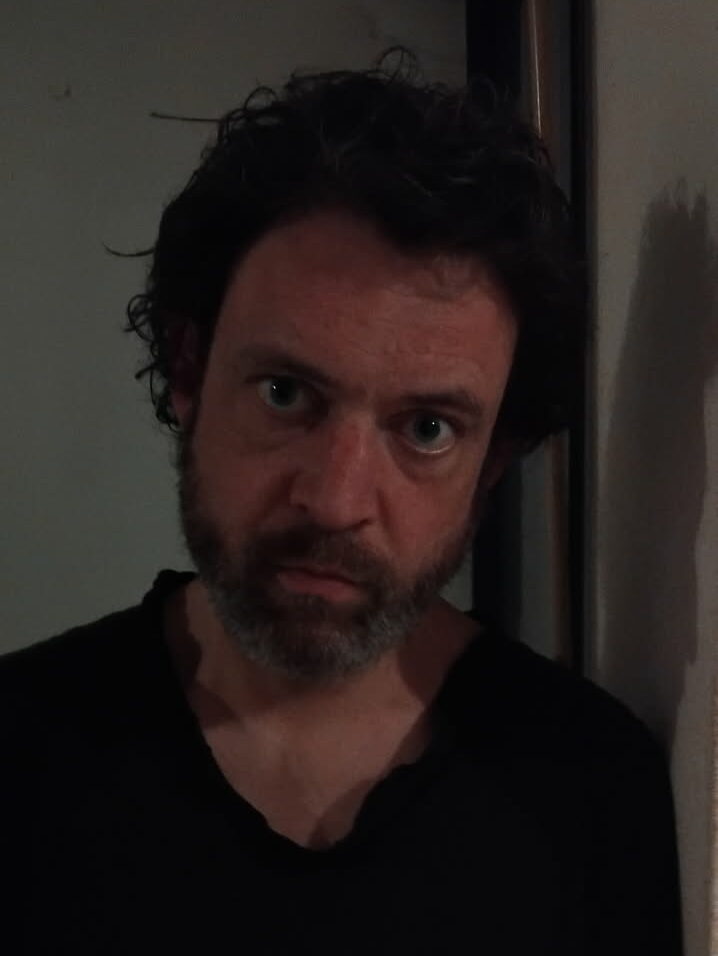autrefois les rives étaient si proches…
maintenant
dans le gué de mes larmes,
le chagrin transi,
les mots las,
la queue qui ne bande plus
et le triste assistanat des griefs, et la pension,
et aussi
les sédatifs,
les comprimés
et tout ça,
la mort travaille plus la matière
que le silence n’use l’esprit. dans ma main,
je lis mille sillons
plus profonds qu’une douve,
et j’y lis un écartèlement
que je ne peux franchir.
tous mes potes malades sont morts
et je suis le dernier sur le banc de touche.
la mort nous garde en réserve
et les joueurs comme des secondes
ne cessent de s’envoyer la balle.
nous nous sommes peut-être trompés.
peut-être n’étions-nous faits que pour tisser
le suaire d’un monde
qui ne devait que cacher la lumière
d’un faussaire.
peut-être devions-nous simplement nous taire
et attendre.
maintenant,
je regarde ces rides dans le coin de mes yeux, j’y lis des frontières qui ont croisé le fer
avec l’éternité
et qui sont restées closes à jamais.
des barbelés tristes sur un visage de honte.
et dans le noir,
parfois, j’entends un bruit venir de très loin,
de vieilles musiques jouent encore pour moi.
nous ne pouvions qu’apprendre à oublier
et disparaître
pour ne jamais nous souvenir.
les doigts, eux, tissent une autre honte.
vos corps sont sans prénoms, vos larmes sont sans merveilles, le conte du clodo fou pleure.
il suffit de regarder
dans l’œil du cobra,
il suffit de regarder dans l’œil d’un mort,
ou dans le pixel qui hurle dans le téléviseur.
ou encore dans l’œil de bœuf de la terreur,
ou dans l’iris pâle d’un clodo fou,
ou d’un épileptique maniaque
hurlant pour plus de mort.
il suffit de regarder à la lueur d’une ampoule qui pâlit
l’inconstant plafond
d’une larme qui s’effondre
sur le parquet plat d’un ciel mouvant.
il suffit de compter le glas d’une montre,
d’une trotteuse lasse de courir
pour entendre tous les cadavres que la vie amorce
d’une seule détente
courant sans faux pas.
il suffit de mourir dans le noir et de regarder dans un asile
ces vitres de verre teintes,
il suffit de regarder la peau crispée
d’un dépressif sauvage
pour sentir la bouilloire hurler
d’un crissement sans nom.
mort et sans bruit,
préalable sans frontière.
évangiles tonitruants d’un chagrin
éternel, d’un enfer insomniaque,
d’une pute borgne,
d’un terroriste amnésique de son amour,
d’un paralysé n’arrivant à se sucer la queue
pendant que rien ne répondra à son nom,
à ces mains lasses cherchant dans l’air
de quoi nourrir l’immobilisme du monde.
la pauvreté de notre désir est sans limites.
et on nous apprend qu’un homme en bonne santé
est plus puissant qu’un homme malade.
et notre système éducatif nous apprend
qu’il faut comprendre pour ne pas hurler,
mais qui a entendu la larme de ciguë qu’un homme
nourrit jour après jour, dans le noir
sans un bruit,
jusqu’à s’étouffer sous le grincement de larmes
plus agiles que ses doigts…
qui a entendu un bipolaire cinglé hurler
pour sentir son prénom palpiter
plus que son amour,
plus que son cœur,
plus que sa honte.
qui entend dans le noir
la clameur d’âmes évanouies
qui ne ressortiront jamais des ténèbres
de la noirceur ?
d’un vide si abyssal
qu’il devient transparent
au simple pas
dans un couloir ;
si noir, que l’on se noie
dedans et qu’on n’en ressort jamais
que trop tard
quand la lumière a abattu toutes ses
cartes
et le ciel tous ses rêves.
mort
et sans épitaphe
dans une guerre du silence.
mort sans parafe,
signant en lettres de sang
l’anonymat de l’air,
la constante du soupir,
la terreur de la honte
et l’horreur de tout vivant.
nous mourrons dans le noir agitant des bras
comme des draps brisés
aux plis échancrés comme des lèvres hurlantes.
nous hurlons dans le noir
d’un silence si profond
que nous n’entendons même pas hurler
la sirène du monde.
nous brûlons le quart de mégot
en existentiels karmas,
nous fumons à la racine l’os
qui nous tient d’égo,
un égo plus maigre qu’un rouleau de cuisine,
un égo plus plat qu’une assiette brisée,
un égo si triste
que si les larmes pouvaient couler,
un rideau de sel entarterait toutes les fenêtres
du monde d’un gris terrible.
non,
nous ne sommes pas heureux.
nous crions de ne pouvoir satisfaire
ce que l’esprit demande
à proportion de ce que la chair désire.
nous hurlons de satisfaire le bas branlant
de la tour de Pise,
nous hurlons de nous esclaffer dans le noir
en scarifiant des bras ridés
ne serait-ce que pour sentir la monstruosité
de notre horreur
voiler le consensus
même du monde.
nous pleurons,
nous pissons,
nous chions,
nous saignons,
le bas des immeubles s’effrite sous un battement de paupière,
les dunes s’abattent comme des automnes sur des vies
plus pauvres qu’un sablier de verre bâti dans une bouteille
en plastique tranchée.
et on ne nous apprend pas
la terreur d’un homme seul entretenant une plante séchée
dans la condamnation éternelle
d’une honte privatisée.
non,
nous ne sommes pas heureux.
nous pleurons,
nous pissons,
nous chions,
nous saignons.
et dans le respectable réquisit d’une société qui tue
sans signer de chèques
qu’au bas d’une mort à crédit pourvue à seule
mention de drame,
nous abattons les rideaux,
nous sortons les couteaux,
nous entaillons la chair,
nous travaillons à l’esprit
ce que le monde ne peut user
jusqu’à la moelle.
nous secondons le tonnerre,
nous travaillons la pluie,
nous fanons sous le bruit des pas de nos maîtres,
nous sommes des mainates secouées par le tonnerre,
nous sommes des singes jouant sur un bidon,
cogitant pour l’élémentaire
dans la comédie politique de nos égos,
travaillant le vide de l’air
et le plat du verre
dans un regard plus triste
que n’importe quelle nuit d’hiver.
SEUL.
SANS PRENOM.
ANONYME
ET MORT,
NOUS NOUS LEVONS.
et dans le noir
nous épelons le sommeil
comme nous éplucherions
un rêve
d’un baiser
plus mortel
que n’importe quelle femme
aimant
n’importe quel schizophrène fou.
nous nous taisons
et mourrons.
il n’y a pas de réponses.
/poème à une vieille dame.
j’ai lu mon magazine
d’acupuncture
ils disent
qu’on peut guérir le cancer
en travaillant sur
ses émotions.
tu savais qu’on pouvait guérir
de la schizophrénie en mangeant
du chou-fleur ?
respirer,
cela permet de délivrer l’âme
de ses terreurs.
ah ouais, je dis.
oh oui,
et il faut boire du jus
de coquilles d’œufs
pour hydrater tout le corps
de potassium
pour nourrir la beauté de Dieu.
j’ai guéri mon genou
en priant,
même les médecins
ne savaient le guérir,
tu vois que je ne suis pas si folle.
et la vérité,
c’est la solitude enfermée dans une huître
avec des murs qui ne rendent pas de perle.
et la vérité,
c’est l’existence comme un compacteur d’ordure
qui fait d’un cœur une bobine fripée
constipé de son rêve,
prête à chier son désir affamé.
je lui offre
des fleurs
(parfois)
et j’essaie de la faire rire,
mais elle est perdue
et seule
et dingue d’une folie banale
qui tue tous les dingues
cathos
et toutes les pauvres petites
vieilles solitaires
de la vie qui meurt et qui pense.
un jour peut-être
les corps qui furent poussière
redeviendront des roses,
et les cœurs
des chardons pleins d’épines
que rongeront les ânes.
pas ce soir.
les jours comme des graviers
se jettent sur les tombes
pour épeler les prières.
les désirs comme des tournevis
ne s’agencent pas dans le bon trou,
et la croix d’un mot
peut faire vivre un homme
jusqu’à ce que son existence s’assèche
comme les neiges bleues au sommet de la chance.
nous sommes tous voués
à une paralysie complète,
à un inceste de l’esprit
pour n’avoir pas à mourir trop tôt.
nous avons peur,
nous sommes effrayés sous les parvis de vos sourires,
nous sommes terrorisés sous les abat-jours de vos visages,
sous les frontons de vos esprits,
sous les abattements de vos dettes,
nous sommes constipés d’un manque de vie
et d’un désespoir plus prolifique que l’esprit
d’un génie alimenté de homards jusqu’à la fin du monde.
nous sommes des grains de raisins que mastique la mort
en ricanant du manque à gagner à propos du crédit premier.
les mots s’usent,
les vieux pensent,
les vieux élident leur peur avec la plume d’un rêve effrayé.
les morts cherchent,
les vers trouvent.
les sommiers comme des corps s’affaissent
ils finissent jaunis comme nos esprits
et on les jette
pourvu que la déchetterie passe
et que nous mourrions tous,
ma pauvre et vieille Titi.