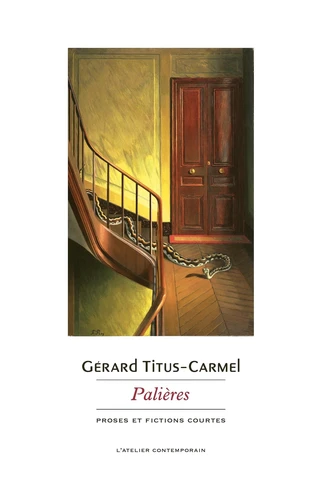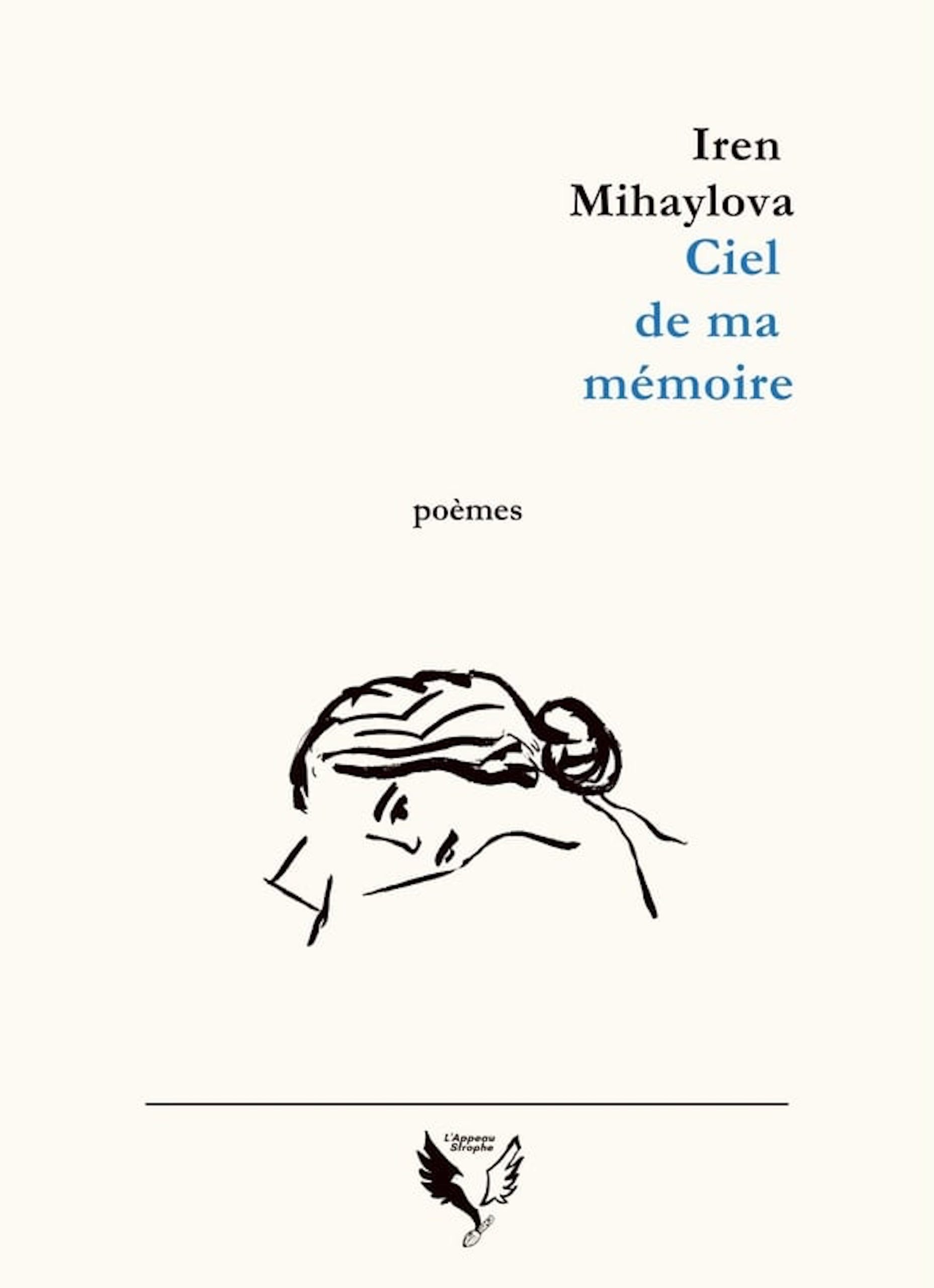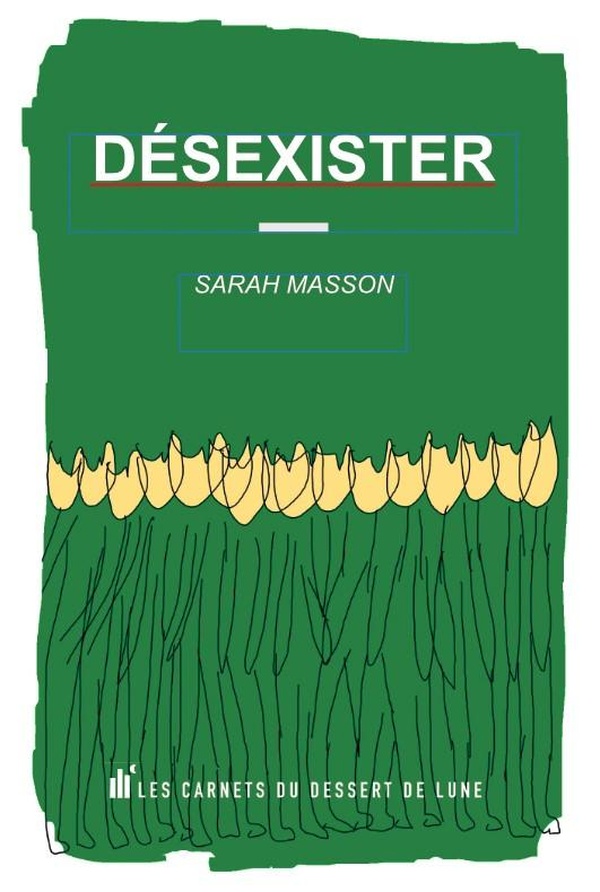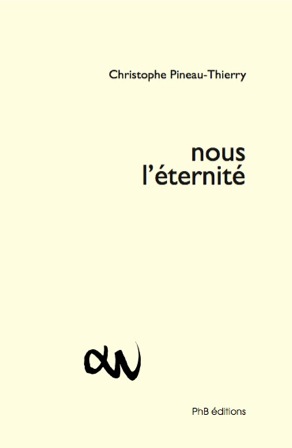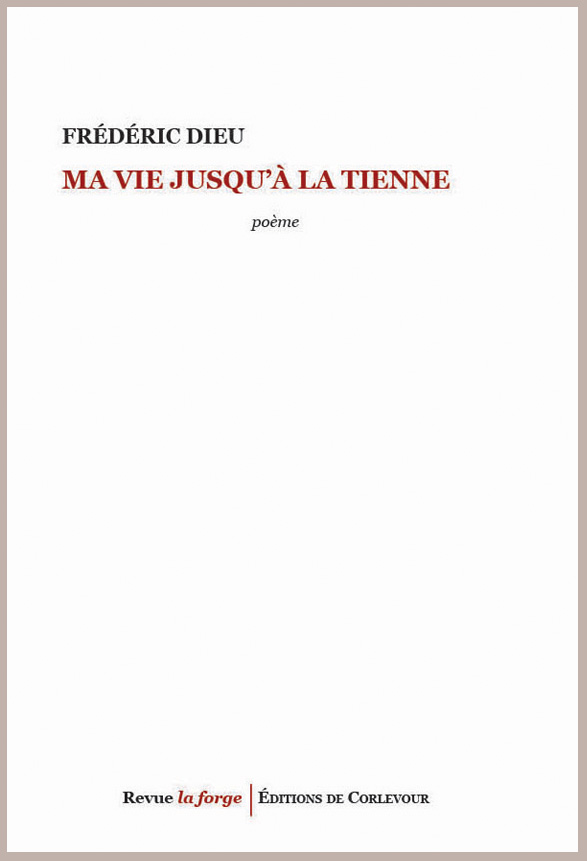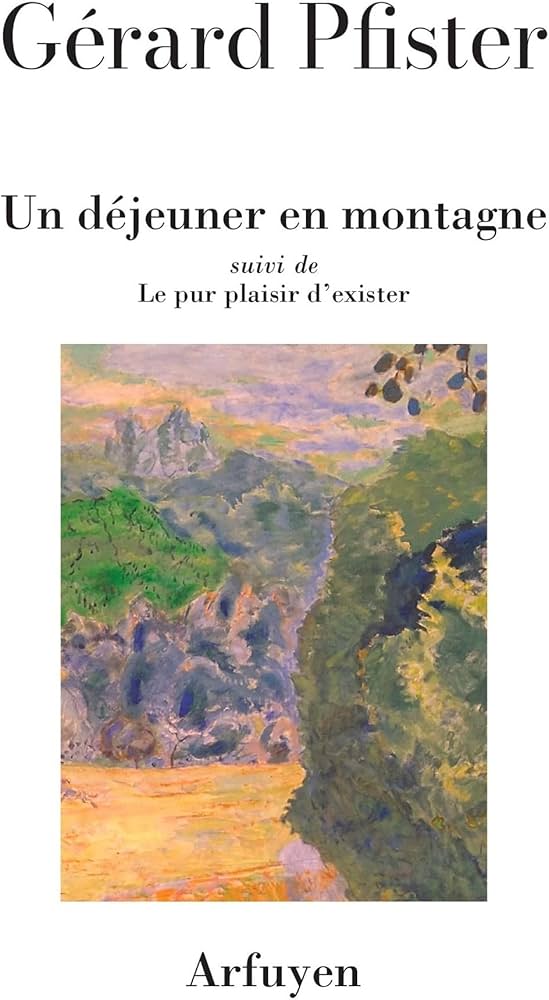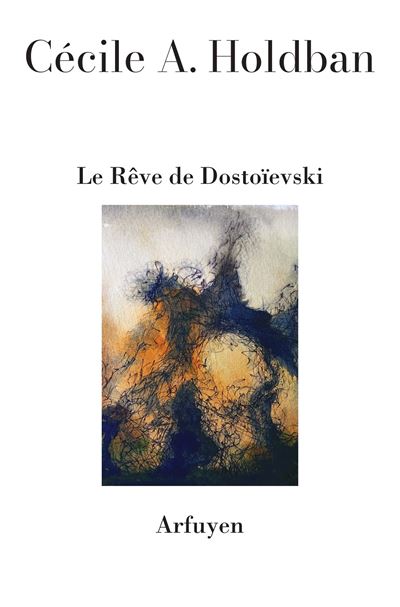Entre 1819 et 1823, Francisco de Goya peint sur les murs de sa propriété, surnommée la Quinta del Sordo (la ferme du Sourd), les Pinturas negras, quatorze à quinze fresques ou “peintures noires”, transférées depuis sur toiles et désormais exposées dans la salle du même nom au Musée du Prado (Madrid). Si ces peintures font résonner l’absurde de notre condition humaine, vouée à la souffrance et à l’atrocité de nos pulsions les plus violentes, “Duel au gourdin” qui se trouve parmi elles, a inspiré à Béatrice Bonhomme le titre de son recueil Les Boxeurs de l’absurde, paru en 2019, aux éditions L’Étoile des limites.
Ce tableau représente la rixe de deux lutteurs, dont la poète écrit qu’ils sont “Ces immobiles tueurs-troncs”, aux “Pieds enlisés dans le sabot du sable”, “Au mouvement inouï réfugié dans le bras / Aux visages tuméfiés” (p.23), et qui s’affrontent à coups de massues, sur l’infini d’un ciel crépusculaire. Allégories d’un monde en plein chaos, de nos angoisses les plus profondes, ces boxeurs archaïques, tels des demi-dieux païens, semblent incarner aussi notre malheur contemporain.
Ils s’appelaient les boxeurs de l’absurde
La neige de leur cœur avait noirci
Les bords des yeux cerclés de noir.Ils restaient fardés par la souffrance
Aucun horizon, aucun bleu
Ne levaient leurs ciels.Leurs yeux étaient cernés de pourpre
Ils se frappaient sans se reconnaître
Leurs yeux fermés à toute lumière.Ils frappaient leur propre cœur sans relâche
Dans le martèlement de leurs poings dérisoires.Ils lançaient leurs poings dans les ténèbres. (p. 28)
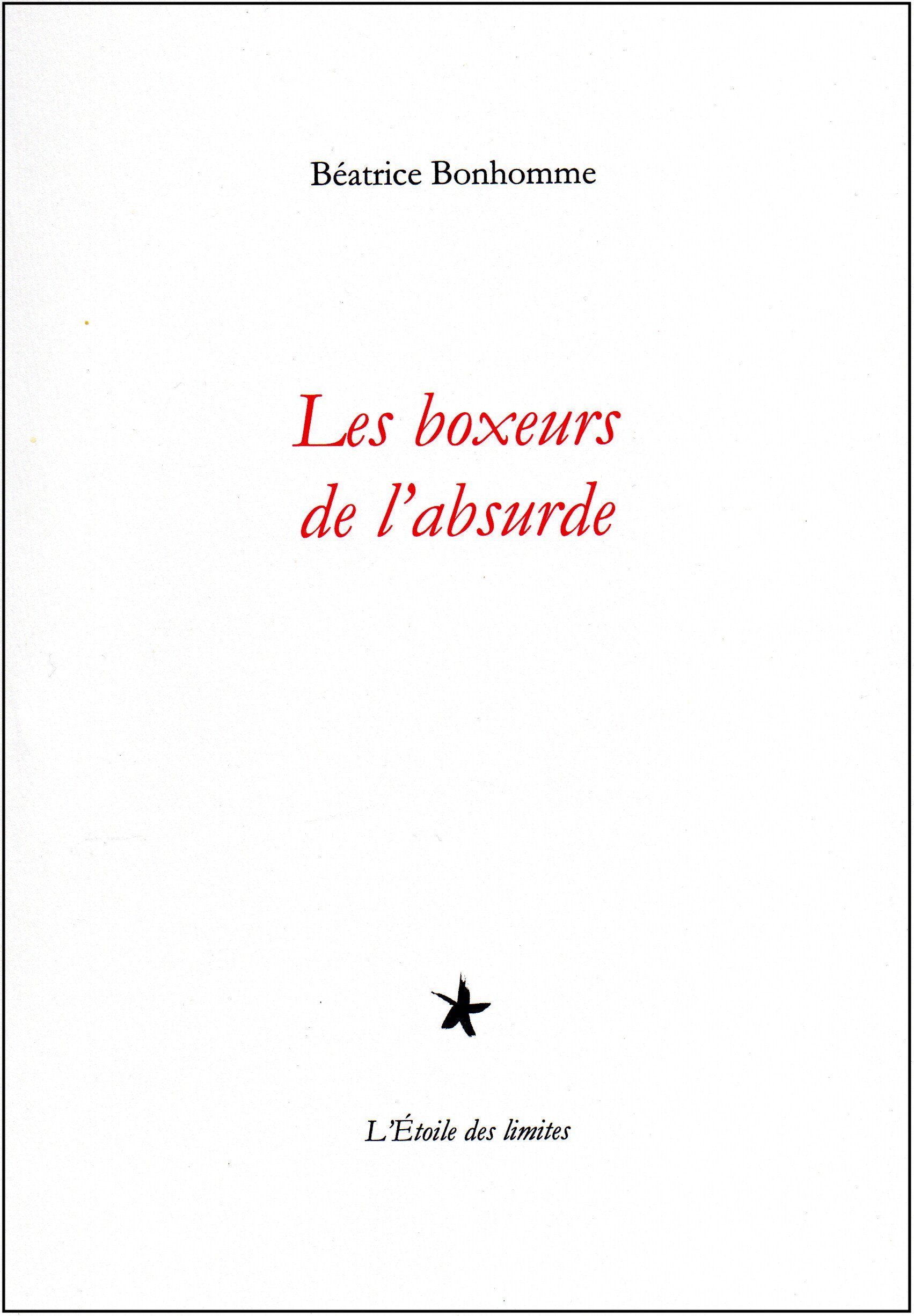
Béatrice Bonhomme, Les Boxeurs de l’absurde, éd. L’Étoile des limites, 2019, 192p.
Ces damnés de la terre, Béatrice Bonhomme, les rapproche des anciens mineurs de charbon de Sardaigne, sous Mussolini (“Le regard aveugle d’une absence de lumière”, “Ils charbonnaient la vie”, pp.31–32). Mais ils convoquent aussi les ombres de tous les déportés, les esclaves, les exilés, voués à se débattre dans le démon des dictatures. Le désespoir y est tangible (“On décryptait l’absence de signe”, p.33), le destin anonyme (“Mémorial de carte d’identité / De morts désormais au service / De la terre / De la dictature / Une radio de poumon / Exposée avec ses taches blanches et ses ombres / Un voile posé sur la vie”, p.37). La silicose des mineurs semble faire écho à une maladie respiratoire généralisée, qui engage le malheur de toute l’humanité.
“Les Boxeurs de l’absurde”, dédié à Claude Lanzmann qui lui-même a écrit sur “Duel au gourdin”, constitue le second texte du recueil auquel il donne son titre. “Cette boxe de l’absurde, c’est celle que nous vivons tous, dans le quotidien, dans nos amours, dans nos deuils…”, explique Béatrice Bonhomme dans un entretien avec Gabriel Grossi. “Le poète reçoit le monde de façon intense, violente. Il le reçoit comme un coup de poing dans la figure […]”. Dans “Les chiens ont mangé la boue” comme dans “Ecorchés vif”, respectivement quatrième et onzième suite du recueil, les traumatismes du destin, la terreur infligée, prennent la forme tragique de chiens infernaux : “Les chiens ont mordu la boue de ton cœur / Ce cœur de quinze ans coupé dans le temps” (p. 62), “Les chiens étaient lâchés / mangeant la boue du monde” (p. 162). Le cri est ‘silencié’ et le souffle asphyxié : “Ils avaient la bouche ouverte / Tragiques sous les masques du destin” (p.64). La chair est déchirée, les viscères enflammés : “C’était en écorchés rouges qu’on affrontait l’amour / Avec cette brûlure au centre des corps et du monde” (p.164). Souffrance et défiguration y convoquent les ombres de Beckett et d’Artaud.
Dans “Harponnant un dieu” comme dans “Cartes à jouer” cinquième et huitième suites du recueil, ce sont gestes violents que les dieux, le hasard, soudainement imposent, depuis les origines et les jeux de l’enfance : “La douleur de ce corps traversé par l’impact” (p. 69), “Le cœur empalé de souffrir” (p.70), “Il y a le nain jaune / Qui trahit sans savoir / Et la dame de pique […] Et mine de rien / L’air de glisser de main en main / L’air d’un petit tour de passe-passe / Ils portent l’estocade fatale” (p. 110).
Toute illusion soldée, sous les coups de stupeur et de lucidité, ne restent que le chant, la poésie qui réinspirent quelque chose d’un espoir, d’un horizon vers la beauté immanente du monde : “respiration à venir” au cœur de la maison rouge et blessée de l’enfance, Vita nuova continuée, réinsufflée jusqu’à l’absence en creux de nos présences. On pense à Yves Bonnefoy dans Les Planches courbes : “La vie alors ; et ce fut à nouveau / Une maison natale.” La référence au peintre iranien Farhad Ostavani, dans la première suite du recueil de Béatrice Bonhomme, “Le signe horizontal de l’infini”, inscrit une réouverture sur la “soustraction d’un paysage” : “Oui, atteindre le blanc / Sans visage et sans nom, / Sans paupières et sans yeux. // Sans. (p. 19)”
“Du blanc pour respirer” (entretien avec G. Grossi), pour retrouver l’intensité de la lumière de Tipaza en Algérie, ou de Tharros en Sardaigne. Les noces avec la Méditerranée, avec le souvenir vivant des disparus, redonnent une naissance à l’être “de ciel et de mer” (p. 95), par-delà toute mort (voir les poèmes “Tharros”, “Chef d’œuvre”, “Un jour de pierre blanche”, “Stèles pour un scribe”). Que la tombe soit pierre blanche, ou les colonnes doriques, ou les nuages “cubes de neige”, de nouveau de la vie palpite et engendre le nom dans la respiration (voir le poème “Le carré d’une marelle”) : par-delà ruines et souffrance, l’écriture accomplit une “liturgie verticale” (p. 47), trachée-artère de la vie.
Respire !
Respire dans le temps qui est quotidien
Respire on n’en meurt pas
Respire dans le temps concret du monde
Respire on ne meurt pas d’amour(“Les chiens ont mangé la boue”, p.65)
Présentation de l’auteur
- Béatrice Bonhomme, Les Boxeurs de l’absurde - 21 février 2026