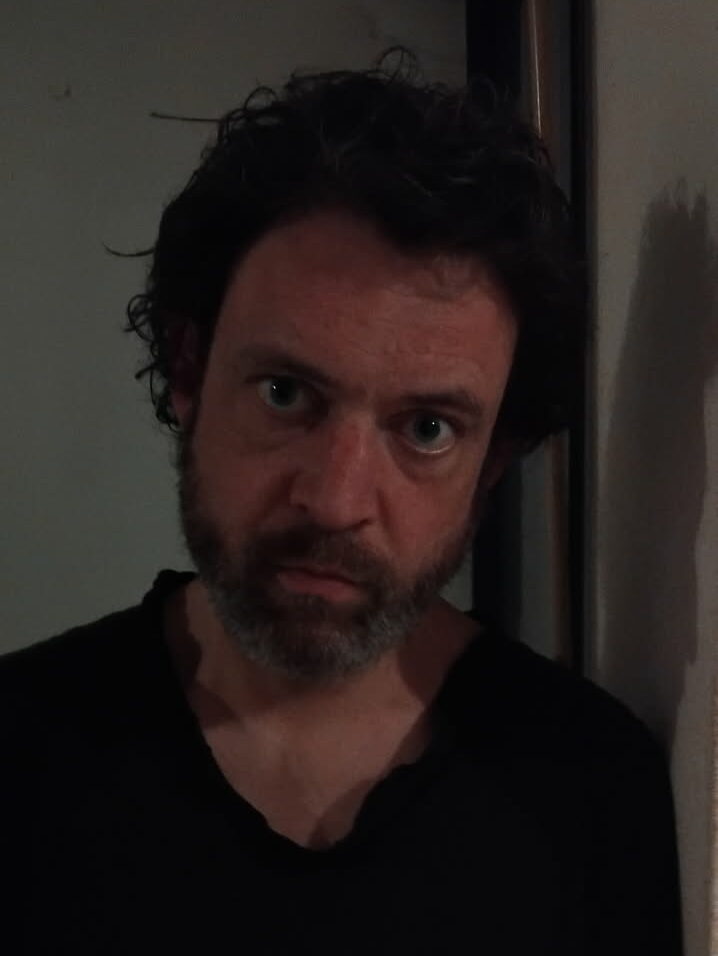Écrire le monde
Cela ressemble à une flamme peu sûre
Parmi le vent, la nuit, les rires.
On ne sait pas trop où l’on va,
Berger que les ronces enserrent jusqu’à presque le sang
Quand, à la lisière du champ
La brume se mêle âpre aux rêves,
Le froid fait plisser le front.
Peut-être est-ce inutile
Voire impudent, cette manière de retrait
Quand les hommes s’ébrèchent, se courbent.
Quand les hommes jouent,
Les questions écartées, avec la force
De s’inventer un destin friable,
Le fil et les ciseaux, et le visage des vieilles sorcières,
Moires captives derrière un écran sans lendemain,
Ou dans un livre si vite perdu.
Et puis
Il faudrait, à la rigueur,
S’intéresser à l’amour fou, qui enlace, tranchant,
Parce que le désir efface les souvenirs,
Disperse les heures.
Mais dire
Dire le monde, qui ne fait qu’envelopper,
Qu’être évident…
Qui n’a rien de tranchant comme l’amour,
‑On dirait une respiration lente,
Un sommeil lointain
Infranchissable comme serait la mort.
Ou même rien,
Seulement un mirage que la pluie suffit à changer,
Que la chaleur trouble ou presque.
Presque : c’est ainsi que l’on s’élance et c’est ainsi que l’on trébuche
Au seuil de la maison d’enfance, ensoleillée.
*
On pourrait certes tenter de dire la pointe mystérieuse
Du regard, quand empli de désir,
On l’entend vibrer comme une mer impatiente.
Une espèce de Gabin, qu’étreignent la peine et la résolution,
Devant les verres vides et le cendrier,
Les yeux cernés par le rouge des baisers absents,
Chante la distance d’Amour :
“Et quand elle disait mon nom,
Mon beau nom Salomon,
C’était t’sais comme l’aveu d’une tendresse
Où je vivais en paix.
Nous nous aimions moi comme le lis de la vallée,
Elle
Comme une gazelle, un jeune faon.
” Oh pis tiens j’sais pas dire l’amour ;
Elle s’est débinée pis les mots moi j’sais pas !
Depuis où que j’aille…”
*
On pourrait dire l’enfant qui,
Devant les mille et une couleur de la féerie,
Les monstres, les forêts dessinées,
Les gestes qui racontent mieux la vie que la vie elle-même,
A les yeux grand ouverts, ronds à se briser dans une nuée d’images,
— Étoiles animées, violence simple, facile à apprivoiser…
Il regarde la télé
Où se meut le monde avec le sens
Jusqu’à ce que le corps s’affaisse, se creuse comme
On râcle, à la pelle, les graviers de l’âge.
Et les membres cessent d’obéïr aux rêves,
Les méchants et les bons se mêlent et le jour
A la nuit ; le savoir
Se disperse
Si lentement, lentement,
Qu’on finit par se demander où puiser la force
De mettre, à tout ça,
De l’ordre, rien qu’un peu…
C’est comme si
A vingt ans déjà, le regard s’écartelait
Entre désir et mort,
Au milieu d’un vent muet, de rires
Que briserait n’importe quelle ombre,
N’importe quel caprice (les jouets cassés,
L’étouffement, les portes qu’on secoue presque en vain…)
*
On pourrait dire comment, d’âge en âge,
De plaines en royaumes,
De brigants et de loups en supermarché…
Comment les pas ont creusé le sol ;
Des chemins s’y sont tracés ; puis
Les roues de tracteurs les ont pétris
Jusqu’aux microbes, pressés dans les ronces, les flaques !
Tracées, les autoroutes ; montés, les bâtiments ;
Tendus, les câbles ; diffus, d’oreille en oreille ce qui était bruit
Qui est devenu volume sonore ;
Morcellement, dispersion, absence
Faite de son envers : oh ce monde-Arlequin où
Je veux n’être qu’un Pierrot, dans la lune !
*
On pourrait dire…
Cette matière est vieille comme le monde moderne,
Qui accuse non pas la douleur mais, moins dicible au fond,
Ce qu’un poète, un jour, entrevit sous la fumée d’un houka,
Une destinée où les yeux s’exilent
En même temps que les mots, vidés, fragiles,
- Mince cloison d’indifférence,
Voix d’exil endormie…
*
L’exil est la terre des hommes.
Ce n’est pas grave, bien sûr !
Nous ne sommes pas comme les arbres, qui croissent
Tel que les branches et la lumière
S’élèvent en brindilles d’air, en feu bleu-ciel, ajouré.
Non les hommes
Poussent en se consumant dans l’espace
Comme une branche que lèche la flamme,
Un arbre tombé
Que le temps étreint jusqu’à la cendre.
Les hommes : un feu de branches mortes,
Un feu d’exil, qui troue la terre.
C’est un peu Ulysse quand il sort de la mer,
Ivre de vent, il brille d’une eau salée, tumultueuse,
Se couche et s’endort dans les ronces.
Les voitures fourmillent droites, brillantes,
Parmi les arbres du boulevard, le brouillard…
C’est un peu comme se retourner sans cesse, éperdu,
Les yeux creusés et leur lourde hâte
Dans les reflets des vitrines, puis en l’air !
Recoudre, tisser contre l’exil, faire marche arrière ;
C’est là la distance du marcheur,
Là le chemin où les orties, l’herbe haute,
Balancent entre les pierres silencieuses.
Là, aussi, où fuient les rues entre les toits et les fleurs ;
On y plonge un regard rapide, on passe
Comme le long de portes entrouvertes.
Il y luit de douces ombres,
Un chien dont le museau pointe plus loin que notre élan peut-être…
On s’immisce dans les trous d’oiseaux,
Le tranchant de l’air nous guide
Jusqu’à ramper avec les insectes, dans les coins d’araignées,
Sous les draps et les rêves reptiliens.
On ouvre les livres, les aventures,
On aime les histoires, les contes ;
On marche, on suit la transhumance en mots,
La trace laissée par le pas des héros.
On aura cherché, dans la poussière proche,
Comment se glisser, serpents, dans l’embrasure des choses mortes.
Des pas, des mots en herbe
Les bergers
Comme une flûte dressée, le matin étincelle, calme.
Etre un berger qu’accompagne le vent dans les roseaux rustiques,
Le vent de Pan enroulant comme une flamme la cire de l’instrument,
On pourrait penser que c’est être à l’écoute d’un éveil sonore
Parmi les chênes prophétiques, la tombée de leurs feuilles brûlées d’air.
Un pré d’hiver ensommeille les troupeaux blancs…
Et tandis que la fumée traverse l’air
Le froid se mêle aux épines et les ronces n’ont, dirait-on, pas de sens.
Et rien d’ailleurs,
Et c’est cela qui fait taire les hommes quand, avec les mots
Sombrent au midi de l’obscur les mondes, les étoiles qui brillent toujours pareil,
Même à la surface de l’eau noire, la nuit.
Quand disparaît le sens
Ce n’est ni la peur ni le malheur qui montre sa gueule,
Mais comme une marée invisible dans l’étendue des jours qui se suivent,
L’ombre étrangement familière de tout ce dont on s’est lassé
Et tout au bout de quoi se tapirait comme en une brume épaisse,
La brûlure soudaine des fleurs sauvages, ou
Des insectes, des serpents…
Et moi je veux, quitte à ne faire que des images sans consistance,
Trouver des mots qui iraient en deça d’eux-mêmes, creusant
Ou presque dans le temps et cueillant une rose non l’absente ;
La rose sauvage, secrète comme Diane !
Forcer somme toute les pas d’un berger presque éteint
Pour ne pas perdre ces points chétifs qui semblent coudre l’espace :
L’herbe aux cimes les cimes au ciel, et le feu qui les love !
Peut-être est-ce beau ces mots ainsi jetés
Mais je dois admettre que ce ne sont certes pas ceux-là
Qui feraient plier les arbres, danser les bêtes et les pierres, qui descendraient
Jusqu’au fond des enfers en passant par le fronton ultime,
Perdu dans la forêt obscure : ah des mots
Qui auraient une puissance de feu, à résonner
Dans les lointains des hommes…
Etre un berger, avec un bâton de noisetier,
A l’appel de tout un monde proche…
Echapper au reste, à la science et aux certitudes ;
La vérité dans les astres, plus loin qu’eux même, et pourquoi
Ne serait-elle pas le nœud des métamorphoses, se dénouant au moment où
Dans la bouche avide, éclate, glisse enfin
Le sang des mûres, celui des arbres…
Beauté et vérité dans un même soleil,
Une lumière d’eau brève qui peut être
Simplement
Les bruits fragiles et les jolies couleurs
Comme une rue qui tourne et descend, l’alerte fauve d’un chevreuil ;
Remuent la boue de la mémoire et celle qui recouvre le bois mort
Et j’ai la sensation d’être un enfant dont les rires atteignent la cime des peupliers.
La Vérité, sur une urne de marbre,
Des astres à moi,
J’aimerais la dire comme si elle jaillissait en espérance brusque
Juste au devant du regard : telle
Vénus sculptée par les vagues du désir,
Qui tend la main, qui appelle !
Mais le berger sous le feuillage noir, le regard appesanti vers les ombres, le toit des fermes qui fument,
Déjà cesse de chanter le nom d’Amaryllis :
Des ailes rasent la terre comme une faux, et les oiseaux des ténèbres,
La chouette et l’orfraie,
Rappellent en leur vol déployé toute la pourriture, le sang versé après le passage des loups,
La mort qui assèche les membres et fait des trous par où passent les fourmis.
Etre un berger,
Ce serait ce regard dans l’énigme des jours
Au moment où la flûte se heurte, discrète,
A la brume et aux bêlements du monde.
Pas à pas
Un nuage de branches, cet écheveau vert que, la porte ouverte
On s’obstine à tirer en nous, sur les chemins, le pas pressé.
Un fil dont on attend les épines en feu, et qui nous tient en équilibre,
Nous recentre, nous et l’espace avec, ses oiseaux, leur ciel, son silence inouï !
La flûte s’épointe en descendant, pierre à pierre, fleur à fleur,
Et les pas semblent pénétrer en une eau calme,
Nappes vertes, lampes d’ombre où se détache lentement,
Comme une écorce usée, le fantôme qui nous suit dans les jours sans consistance.
En nous, c’est comme une sorte de craquement inaudible, léger,
Au rythme des pas qui tournent vers leur centre ;
La rivière et les fougères résonnent contre, creusent un chemin
Où l’horizon s’ouvre pour de bon, montre ses lointains.
Les pas semblent descendre vers le haut, où le bruit des peupliers
Fait du ciel un ruisseau, de la terre une fumée tendre ; où
D’un arbre à l’autre, les cris d’oiseaux retendent le ciel,
Jusqu’à en tracer les déchirures invisibles, qui sont des lumières d’air…
Et les pas suivent un fil d’air qui nous tire, écarte les membres
Pour glisser, entre les fibres, une série d’évidences retrouvées ;
La première, bien sûr, est cette distance d’avec l’immense toile tendue
Après avoir franchi les barrières noires, où s’arrêtent les rêveries inutiles, les idées aux remparts de sable…
Je marche autour de l’étang ; personne qui puisse venir ici et
Par-delà les questions inutiles, c’est au milieu de moi-même que je m’enfonce ;
Le sang, comme dans les secousses d’une mâchoire canine, se purge pas à pas :
Pas à pas affolés, blessés, vers un point de lumière chétif…
Ils me mènent au gré des chemins, une fois parcourues les routes du vide,
Les chemins verts que le vent et les feuilles font résonner toujours plus bas ;
Un fil d’eau troue les barbelés ; en moi, il écarte les leurres,
Et les pas serpentent, comme cette eau des jours clairs, au travers des ombres.
Pas d’eau calme, parmi les feuilles de lumière, dans l’invisible…
Autour voltigent des papillons, comme de l’air qui prend feu ; ici
On dirait que l’ombre jaune des tournesols cache l’univers, d’où s’échappe
Vers les chemins d’air, un oiseau dont, sous la pluie, les ailes ont l’odeur du temps…
Ces pas d’été, c’est comme s’ils réveillaient en moi un vieux désir
Que le temps étiole peu à peu, mais qui demeure malgré tout ;
Comme si, pour quelques heures, un cocon d’air les protégeait,
Empêchait, de distance en distance, qu’ils ne trébuchent trop bas, trop haut !