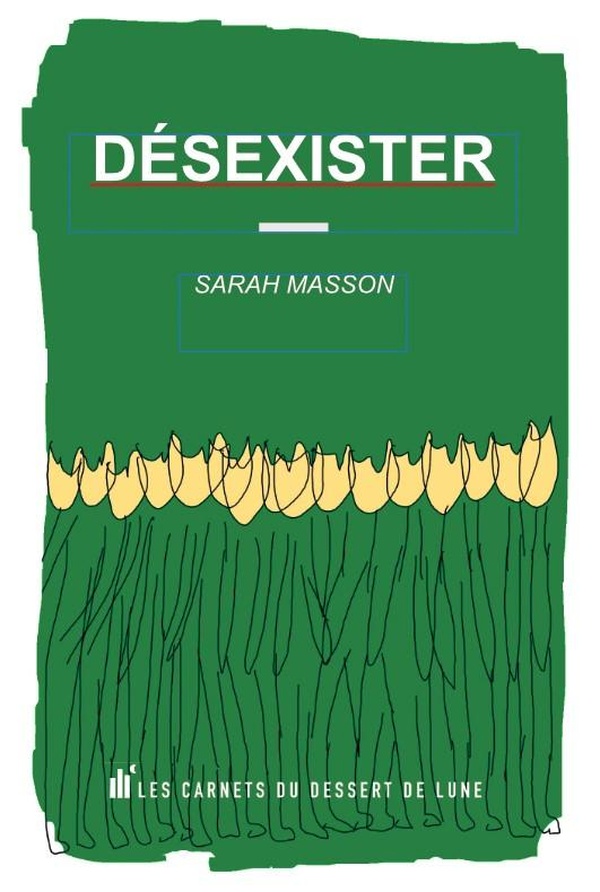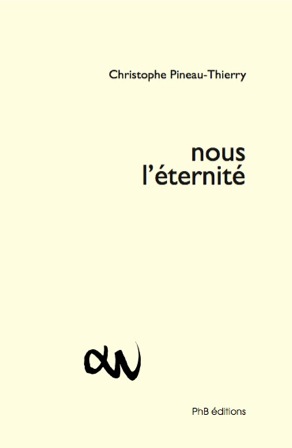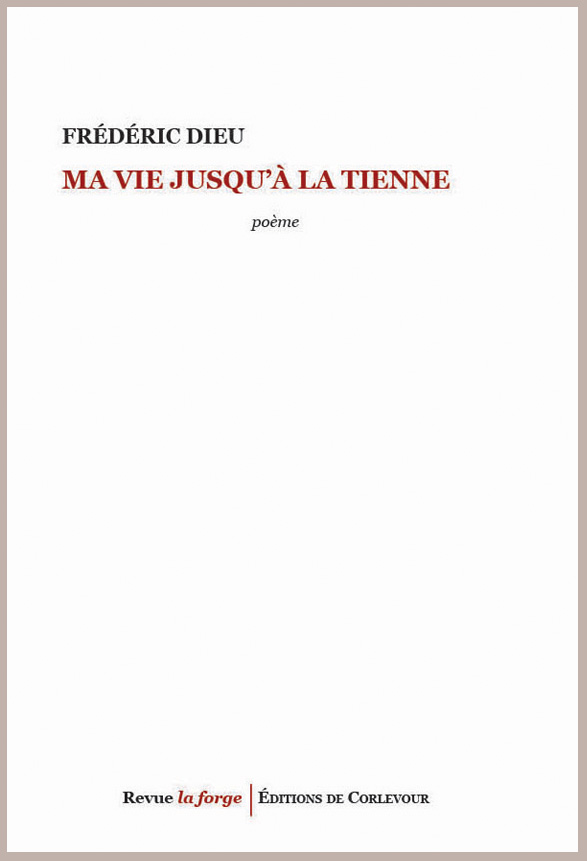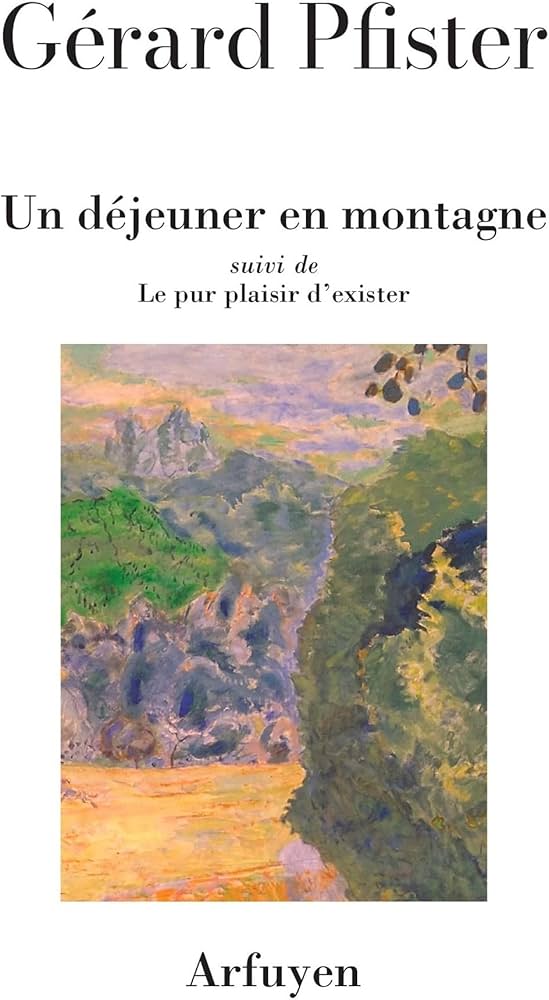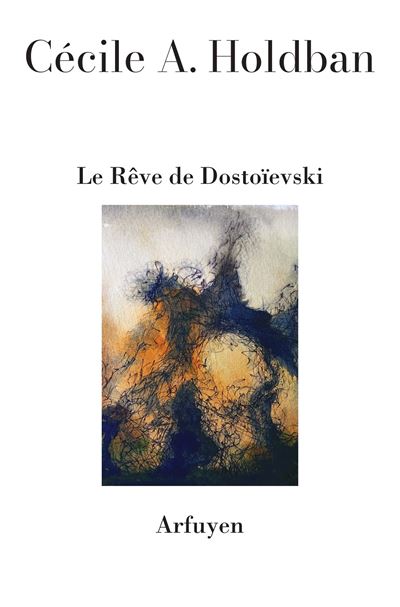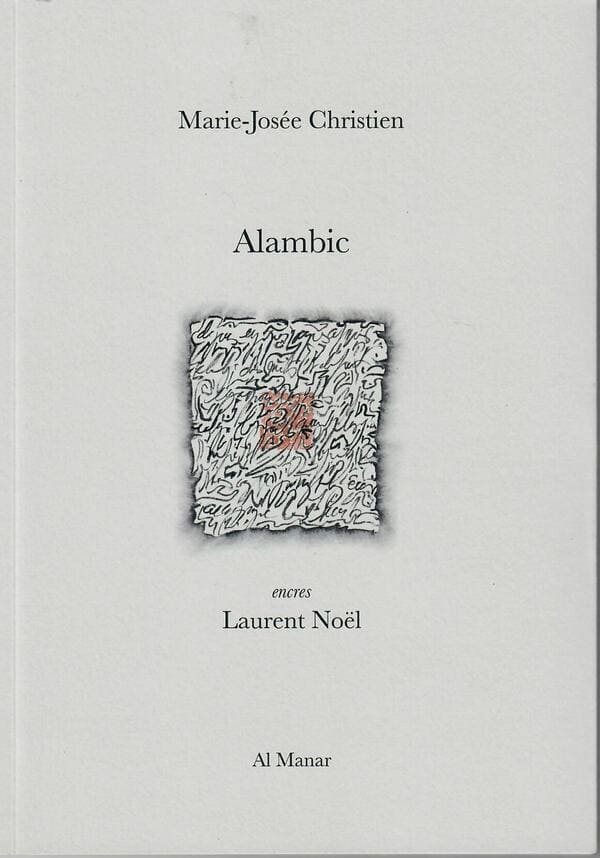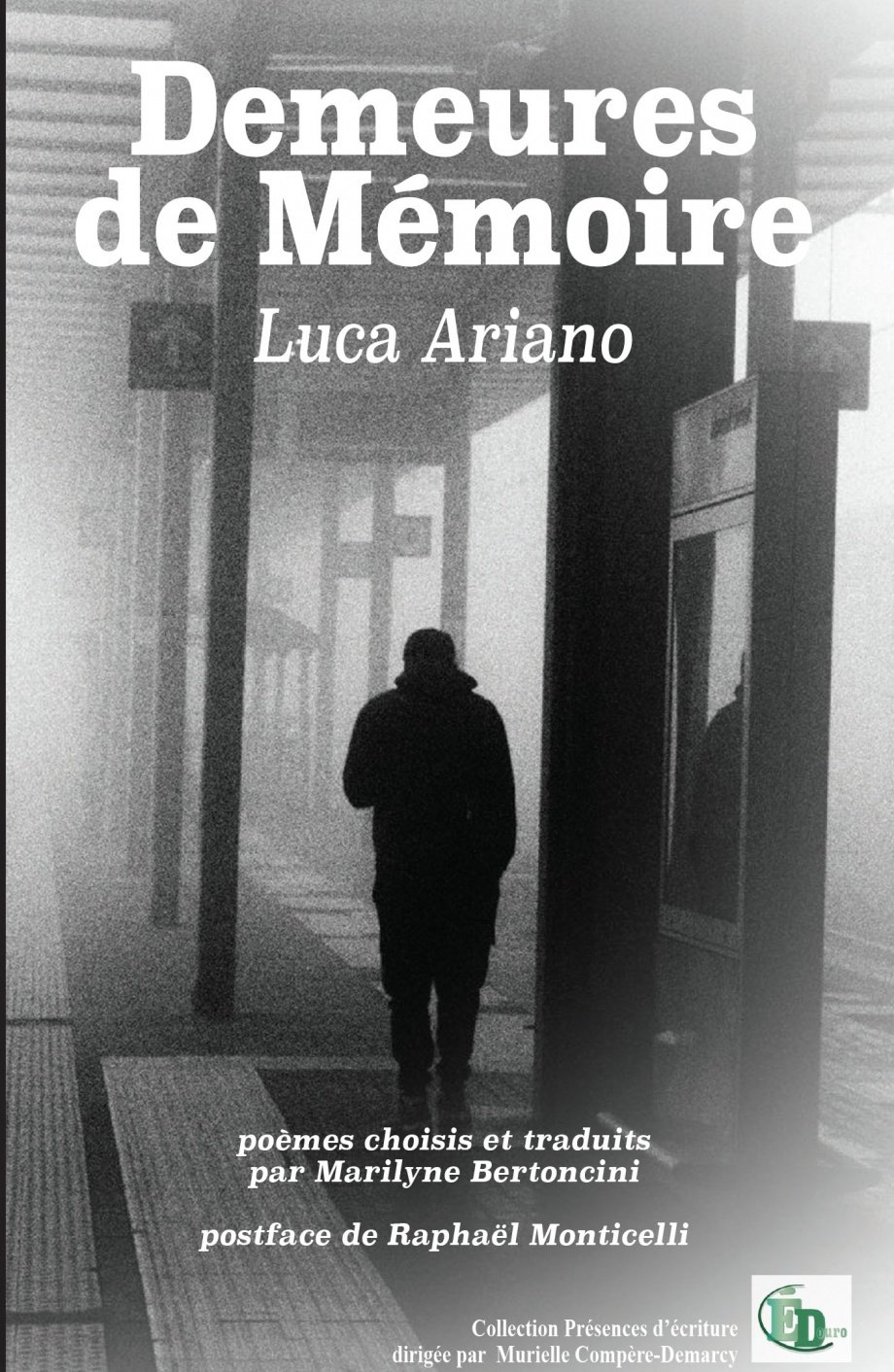C’est un monde nouveau que vous allez découvrir en ouvrant Les Fenêtres de Sara Balbi di Bernardo, un monde où tout est familier, mais vu autrement. Vous n’aurez plus de repères, c’est normal, vous allez voir avec les yeux de celle qui a creusé le corps, l’attente, le chemin, ainsi que nous y invitent les trois citations sous les auspices desquelles l’autrice a placé son recueil et qui sont autant de consignes de lecture, des lanternes dans cette traversée.
« Dans chaque corps, il y a un vide. / Le corps est-il un refuge du néant / ou seulement un malentendu entre ses cavités ? » : l’interrogation de Roberto Juarroz ouvre une fente. Et tout le recueil va s’y glisser, l’exploration du corps et du monde étant les deux versants d’une même foulée. Kafka nous le dit d’emblée : « Il n’est pas nécessaire que tu sortes de chez toi […] sois pleinement calme et seul. Le monde va s’offrir à toi pour que tu le démasques, il ne peut rien faire d’autre, il va se tordre extasié devant toi ». Il s’agit de fermer les yeux et de se laisser guider par la « dame du chemin qui ne mène nulle part », jusqu’à « reconnaître l’instant sacré » comme nous y appelle la citation d’Alejandra Pizarnik.
À partir de cette béance originelle, l’autrice déploie une poésie du symptôme et de la frontière. Dans Les Fenêtres, chaque texte a la pureté d’un objet posé sur la table. Les titres eux-mêmes (Trace, Liste, Boucle, Plinthe, Ombre, Soleil, Blanc) ont la sobriété d’étiquettes : on dirait des mots de rangement, mais ce rangement est une ruse pour mieux nous dé-ranger
Les fenêtres ne sont pas ici de simples ouvertures sur l’extérieur, mais des membranes poreuses où le dehors et le dedans se percutent, un lieu de transfert entre l’intime et le monde. « L’ombre glisse le rideau entre / en moi le vent / balaie dehors dedans dehors dedans de/ main est hier / d’un autre monde / la frontière est un leurre / le temps est un leurre ». On y entend l’écho de La chambre seule d’Alejandra Pizarnik, mais une chambre dont les murs seraient devenus organiques comme une continuation de son précédent recueil (Chambre 12, éditions de La Crypte, prix APPF 2025), bouleversant de nudité.

Sara Balbi di Bernardo, Les Fenêtres suivi de Quoi, éditions de Corlevour, janvier 2026, 128 pages, 19 €.
Sara Balbi di Bernardo noue la trivialité du geste à une inquiétude métaphysique, qui se donne dès le premier poème :
le chiffon suit à la trace
le silence des chagrins ronds
par-delà la vitre
le bleu d’avant le bleu
résiste
le tonnerre peste quelque part
son écho discordant
tarde
je m’accroche aux saisons
j’avale des gélules de patience
En écho à son premier recueil, Biens essentiels, elle fait des listes et tourne en boucle, comme on conjure un sort en récitant des phrases rituelles, en marchant sur les lignes du trottoir, en contemplant l’espacement hypnotique des rais de lumière entre chaque lame de volet ; pour tenir debout par réassurance, dans la verticalité des mots avant que « des nuages traversent mes yeux / en dedans / m’échouent ».
Ce qui frappe c’est l’extrême nouveauté de la perception. Tout passe par le corps : le monde est goûté, touché, dépecé, sucé, ouvert. Les poèmes sont ceux d’une enfant qui met tout à la bouche pour en éprouver la consistance, mais une enfant qui aurait déjà toute l’étendue du langage pour en rendre compte et une sensualité de femme (« le soleil sur les lèvres / l’été plein la bouche / et les yeux et les mains et le sexe et le cœur et la langue / se perd / sur ta peau interminable »).
Ce faisant, elle nous emporte dans un monde en surimpressions et synesthésies fabuleuses en quelques vers seulement : « pomme / contre mes lèvres / bleu piscine ». Un monde où l’on peut « couvrir les miroirs / de silence propre », où elle voudrait « allumer les pierres / seulement avec [ses] mains ».
Comme l’enfant, elle tourbillonne entre l’infiniment petit et l’infiniment grand (« je frissonne / des visions galactiques / à dos de fourmi rouge ») et superpose les rituels quotidiens et les questions existentielles : « dans la maison des poupées / mort et poésie / goûtent / ensemble / dînent ensemble / couchent ensemble / et ensemble / ne dorment pas ».
La poésie se fait à même le corps (et ses « peaux-pages »), mais un corps distordu, broyé, fracturé. Le motif des « mains trouées » dit l’impuissance et la recherche, le désir de saisir ce qui toujours échappe. Mais ce corps est aussi, paradoxalement, ce qui enferme et noie : « des amours comme des rasades / gonflent leurs eaux délirantes / dans l’air / e de la bouche de la tête du sexe et du cœur / dans un corps sans porte de sortie ». Dès lors, la fêlure est érigée en condition de l’impulsion créatrice « le bruit de la fracture est / peut-être / le premier son du poème ».
Sara Balbi di Bernardo a digéré Éluard, le surréalisme et réinvente à sa manière le réalisme magique par irruption de l’onirique dans le réel : « quand tu pleures une poignée de mikados / tombent sur la table de la cuisine / dans un verre on peut boire / leur saveur multifruit ».
Elle travaille la langue par association (« lien existant entre deux ampoules ou autres états mentaux / il existe de nombreux types / d’associations / celles qui se manifestent chez un individu dépendent de son antiquité / de sa presbytie de l’orange / de sa connaissance de sa confiture »), en jouant sur les polysémies et les glissements de sens et de sons : « l’oreille du chat aiguille / les promeneurs immobiles ». Elle « mâche / pieds nus » dans une traversée hallucinée propulsée dans un film de Wim Wenders :
les ailes dépassent de ton manteau
quand tu enlaces la statue
qui confond pluie et larmesles pensées des passant·e·s
s’écrivent à même
le gaz carboniquesans son imperméable
un homme mange
un chien chaud incompréhensibledans le cercle clos
une danseuse voletu l’aimes
est-ce que parfois tu doutes ?
On s’aperçoit vite que l’association qu’elle pousse à bout est le revers de la dissociation dont elle fait le moteur de sa création, en se laissant guider par cette « voix qui ne dort pas » : « je me tourne vers un autre soleil / entre mes côtes / bat le cœur d’une autre » ou encore « une voix habite / en moi / comme dans une chambre / elle possède toutes les clés / tour à tour / elle déverrouille / une voix / qui me traverse / nue ». Jusqu’à effleurer le trauma originel : « je repense au silence noir / des tirets de Dickinson / aux dents de lait dans le cercueil ».
Arrive alors la deuxième partie du recueil : Quoi. Radicalement différente dans sa forme. On quitte l’épure pour une forme plus expansive, plus orale. Ce deuxième volet est une séquence de questions numérotées à rebours (de 18 à 1), où chaque poème commence par « pourquoi… » comme des litanies enfantines, auxquelles répondent les scansions du « quoi ».
On change de régime : ici la parole déborde, s’emballe, fait entrer dans le poème des définitions, des listes, des aphorismes, des parodies de dictionnaire, des bribes de discours social et philosophique, de la psychanalyse.
Une trouvaille décisive est le remplacement obstiné de « chose » par « chaise ». La chaise devient l’unité de sens (ou plutôt de non-sens) du monde contemporain : elle permet le burlesque, mais un burlesque tranchant. Dire « quelque chaise » au lieu de « quelque chose » n’est pas une coquetterie : c’est nous renvoyer à notre immobilité. C’est aussi montrer que le langage lui-même se détraque, qu’il se met à boiter et que ce boitement dit une vérité du temps.
Car Quoi est aussi un texte politique, mais sans discours. Il suffit d’un détail, d’une phrase, pour que le politique s’immisce. La mention des « sans-dents » surgit au détour d’un poème sur le rire et la violence sociale prend corps immédiatement.
Plus loin, l’obsession des chaussures, la statistique, la mode, la mer transformée en piège, composent une sorte de dystopie du quotidien industriel : « l’enfer est pavé de semelles de fast fashion ».
Ce qui est neuf, aussi, c’est la manière dont l’autrice tresse serrés la souffrance psychique, le symptôme et le travail de la langue avec un humour féroce qui évite toute complaisance et sauve du pathos. Le texte parodie Céline (« l’amour c’est l’infini mis dans une portée de chatons »), convoque Freud et Lacan, mais en les dérangeant, en les tordant à la manière d’un Bacon, en les mettant au contact d’une parole qui ne cherche pas à expliquer, mais à montrer comment ça s’associe, comment ça se déplace, jusqu’au délire : « certaines épluchent des pommes de terre / certaines font les cent pas dans la cuisine / entre l’hypersomnie du frigo et le hoquet / du robinet / certaines épluchent la peau des murs creusent / sous l’escalope / le creux du plâtre saigne / du sucre sur la main sur la langue dans les yeux / la phrase aveugle / défait l’écho ».
Ce délire, nous indique la note de l’éditeur, « y est pensé comme une manière de dé-lire le réel » (littéralement sortir du sillon, lira en latin). Ce « dé-lire » n’est pas une posture, mais une méthode de survie : faire un pas de côté et de l’incompréhension une matière, la travailler sur un tour de potier, en faire une colonne d’argile sur laquelle s’appuyer pour conjurer le non-sens, l’angoisse et les extrémités auxquelles ils peuvent mener : « certaines mangent du sucre à même le paquet / certaines allument le gaz à même le four / certaines regardent à l’intérieur à même la tête / assez longtemps pour / bien vérifier que / rien n’a de sens ».
Le corps n’est plus un abri, un habitacle, c’est un « mécanisme qui dysfonctionne ». Elle interroge plus fort : « pourquoi ton corps est un mécanisme / pourquoi ton crâne n’est pas au milieu de ton corps / pourquoi ta tête ne sent pas ton crâne ». Ces vers, par leur simplicité presque enfantine et leur cruauté anatomique, rappellent les fulgurances d’Antonin Artaud s’acharnant sur son propre corps-supplicié.
Chaque strophe est une lutte contre l’effacement qu’elle ne parvient à dire, qu’elle ne peut qu’épeler pour mieux accoucher du verdict : effacé.
Le recueil accélère, le vélo s’emballe, les sensations défilent. Le lapsus défie la fin possible : « je sais / que c’est dangereux de freiner entre deux voitures je sais / que je pourrais fleurir d’un coup / en roulant en sens / inverse ». Jusqu’aux lettres éparses, la dislocation finale.
On pourrait relier Quoi à toute une lignée qui va de TXT à certaines formes de poésie-action, de poésie sonore, de prose à haute tension verbale : Prigent, bien sûr, mais aussi, par endroits, Novarina, Tarkos, ou encore ces écritures qui aiment la scansion, l’acharnement, la logique de la litanie comme moteur de pensée. Ce texte pourtant ne se laisse enfermer dans aucune filiation. Il joue à la frontière entre le lyrisme et la crise du discours, entre la confession et la langue publique dans une réinvention permanente au tamis du corps.
Enfin, ce recueil n’est jamais seulement expérimental. Il est tenu par des images d’une netteté bouleversante et cette évidence poétique née de l’accouchement du dé-lire : « déraille tu trouveras / le chemin / qui te traverse ».
Présentation de l’auteur
- Sara Balbi di Bernardo, Les Fenêtres suivi de Quoi - 6 février 2026