Les éditions, Le miel des anges, s’attellent à la tâche de faire connaître en France l’un des plus grands poètes grecs du 20e siècle, Yorgòs Markòpoulos dans une traduction de Michel Volkovitch. Pour certains d’entre eux, déjà présentés dans l’Anthologie de la poésie grecque contemporaine chez Poésie/Gallimard, de Yorgòs Markòpoulos nous sont ici également proposées beaucoup d’inédits, auxquels s’ajoutent des versions de poèmes déjà connues en français, mais parfois revues par l’auteur ou bénéficiant d’une nouvelle traduction.
Le recueil donne également le dernier opus du poète grec, Chasseur caché, dans son intégralité. Pourquoi faut-il donc lire Chasseur caché, au Miel des anges ?
Si les textes choisis ici proposent un voyage dans l’histoire tourmentée de la Grèce au 20e siècle, ce n’est que de loin et la manière presque effacée. Le lecteur ne trouvera ici ni la peinture des années de la dictature, ni la souffrance des intellectuels, ni la misère politique, morale, ou aujourd’hui économique, d’une Grèce décidément parente bien maltraitée de l’Europe. Yorgòs Markòpoulos se poste comme “un chasseur caché”, un observateur attentif de ses concitoyens, de sa ville. On découvre dans ce recueil un poète qui arpente, un poète de la rue, un poète qui enregistre à la manière d’un appareil photographique, des scènes de la vie ordinaire. Le premier poème du recueil Les Artificiers (1979), nous le présente dans une scénographie qui privilégie le pas de côté, la distance :
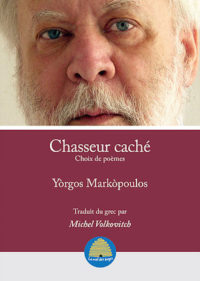
Yòrgos Markòpoulos, Chasseur caché, Traduit
par Michel Volkovitch, 2016, 136 pages, 12 €.
Les passants le soir pour couper
traversent le parc.
Nous autres les voyons.
Ou plutôt, nous voyons le point rouge de leur cigarette. (les Poètes)
Le poème résume la démarche de l’auteur; il en donne à voir la posture. On les retrouvera toutes deux dans l’ensemble du recueil. La modestie de Markòpoulos tient dans ce “nous” qui semble effacer la silhouette trop identifiable de celui qui regarde et qui parle. Le poète est ce fantôme qui se fond dans les ombres, regarde de loin. Oh, non, plus de prétention à parler au nom de… à étreindre le drapeau, à guider le peuple dans la rue. Pas de prophète. Un homme pauvre, le poète, qui ne prétend qu’à cette fidélité étroite au réel. Notons le détail de l’effort de correction du dernier vers. Cette exigence terre à terre de vérité qui fait préférer à un énoncé trop lyrique ou faussement juste, une vérité, même triviale. Les hommes, ses contemporains? Le poète ne prétend les connaître ni comme sociologue, ni comme politique. Moins encore comme un intellectuel. Non, il ne les saisit que dans leurs mouvements, leurs habitudes animales, fatigués et éreintés qu’ils sont ces hommes, d’une vie maussade, sans horizon. La vérité du poète? La pointe rougeoyante d’une cigarette grillée dans la nuit. Et le doux sourire de Markòpoulos ferme le poème. Tout se joue là: cette tendresse humaine, cette douceur qui ne juge pas. Ce refus d’assimiler la fatigue, la platitude ou l’amertume à une défaite.
C’est donc bien, la postface du recueil le signale, comme un photographe, un photographe ambulant qu’il aime à se présenter et à écrire. Avec lui nous fréquentons les foires, les marchés, les rues étroites, les chambres des célibataires, le bord des fleuves, secs, souvent abandonnés aux détritus, ces espaces interlopes de vie, de cris. De solitude et de silence aussi. Des paysages urbains donc, qui ne sont pas paysages mentaux, mais bien ce pays qui est le sien, qu’il aime, qu’il chante, qu’il célèbre dans sa pauvreté ordinaire, son insuffisance, jusqu’à son absence de rêve. Filous, mendiants, prostituées, trafiquants, camés, marins au chômage, travailleurs pakistanais, c’est tout un peuple qui se presse sur les quais, dans les rues, dans les échoppes. “Voilà ta vie Pirée, voilà mon bien”, psalmodie le poème. On ne lira donc pas ce recueil pour retrouver l’ampleur marine, le bleu d’un azur brûlant, l’aridité minéral qui forment la scène grandiose de la célébration lyrique d’un Elytis ou d’un Ritsos. On ne retrouvera rien du décor mental, partagé par les lecteurs émerveillés de l’Iliade et de l’Odyssée que nous fûmes dans nos études au collège ou plus tard. La Grèce de Markòpoulos, ce n’est pas la Grèce des touristes, pas plus que celle des livres. Et c’est bien là ce qui donne à la lecture de ce recueil sa force douce-amère qui nous rejoint, à notre tour, dans nos vies d’ici, dans nos cœurs de cendre :
Une voix cette nuit criait dans mon sommeil :
viens voir les lieux où tu courais, disait la voix, enfant
je ne peux les voir, ces lieux, répondais-je,
mon cœur est en cendre.
(“Ma terrible patrie” in Ne recouvre pas la rivière, 1998)
Le choix de poèmes qui est offert ici, couvre un demi-siècle de création. Le premier recueil dont sont soumis des extraits, date en effet de 1968, le dernier de 2010. C’est là aussi ce qui fait l’intérêt de la lecture. On parcourt à la fois une vie, celle de Markòpoulos, la maison jamais finie de son père, le souvenir de la mère, des images fugitives d’une enfance, l’installation dans une petite ville de province, et une œuvre, dont la variété formelle, au regard de sa relative modestie, dit le souci scrupuleux de la forme et du style. Lauréat par deux fois, consécration magistrale, du plus prestigieux prix littéraire grec, Markòpoulos est un auteur majeur. Le choix établi par Michel Volkovitch rend compte de la complexité et de la variété des explorations formelles de l’auteur. On y croise des textes très courts, lapidaires comme cette “chanson des hommes solitaires” :
Le soir tu ramasses du bois pour la cheminée.
Et le matin, ah le matin,
comme la vie est amère, avec toutes ces cendres.
d’autres plus amples, animés d’un souffle visionnaire, presque halluciné, comme les trois belles “lettres au poète Papadìtsas” où l’on retrouve les grands accents d’un Garcia Lorca :
L’hiver, un tambourin qui lit la brume
et l’enfant de l’image devant, près du cornouiller
tandis que dans son livre d’images
la marche silencieuse, entre les branches, du tigre,
comme le feu qui dans les brindilles se propage
et une nuée de boucliers de bronze un peu plus loin.
La chanson donc, la lettre, le récit en prose, l’interview pastichée, ou encore l’ode, (il faut lire, pour l’admirer, “l’ode au joueur de l’AEK et de l’équipe nationale Chrìstos Ardìzoglou”), d’autres formes plus difficiles à définir comme ce très long poème en prose séquencé en grands mouvements, “passage piétons” où l’écriture prend la forme, dans le dernier extrait proposé, d’un script cinématographique en quatre plans.
Le lien qui unit tous ces textes, c’est l’homme. Rien de ce qui est dit ici ne vient d’ailleurs que de sa vie, de son expérience. Son travail d’ingénieur, la maladie, le deuil des parents, ses lectures aussi. On trouvera avec émotion un très beau poème intitulé sobrement Sylvia Plath :
Voix de lionne mais plainte de femme
qui se déshabille dans l’autre pièce
après l’annulation d’une sortie très désirée.
Le monde de Markòpoulos est un monde dont on ne peut sortir que par le bas. L’hôpital, le cimetière sont les lieux de solitude qui reviennent régulièrement dans l’anthologie. L’alternance sans fin des saisons, résumée dans le vers “brouillard de cimetière, novembre, soleil, décembre, d’asile” rythme le recueil qui observe le temps qui passe et efface: guère d’illusions ou de consolations faciles chez notre poète. Mais c’est que la poésie n’a pas à consoler d’être vivant et en vérité si peu dans la vie. Sensible à la fuite du temps, à la disparition des visages, à la fugacité des rares moments d’amour, de plénitude, Markòpoulos ne fait de la poésie ni un salut, ni une prière. Une voix, simplement, qui essaie de dire avec justesse que la douceur et la tendresse d’un regard humain peuvent aider à supporter l’amertume et la désolation du réel :
Jusque là homme du peuple au marché, dans ses affaires,
lorsqu’il a découvert soudain la poésie.
Dès lors il a pris l’eau par tous les bouts.
Sa femme l’a quitté un soir.
Regardez-le maintenant dormir.
Au dessus de sa tombe volent des oiseaux.
∗∗∗∗∗∗
Ce jour d’hui comme hier et demain, Andrèas Embirìkos, Le miel des anges, 2016
Poèmes traduits par Myrto Gondicas et Michel Volkovitch
Sous un cerisier un poète aveugle chante la gloire du désir
Ce vers tiré du poème intitulé « vision des heures matinales » rend compte de manière assez exacte du contenu et de la démarche de ce recueil Ce jour d’hui comme hier et demain, d’Andrèas Embirìkos . Dans ce vers chacun des mots en effet fait sens et pourrait proposer à un lecteur qui découvre cette œuvre, une porte d’entrée finalement assez juste.
Sous…
La préposition sous d’abord, témoigne de la manière dont cette poésie est une poésie du jaillissement, du débordement. Ce qui vient vient de loin, des profondeurs, celles de l’inconscient, du rêve, des fantasmes, du désir. C’est cela, en continu, dans les images surréalistes, la violence d’un lyrisme parfois cru, le chant exalté du corps et des sèves, c’est bien cela qui jaillit et déborde. Oui, dessous, derrière ce qui masque, cache, ou étouffe, c’est là que la parole du poème se glisse, dénude, déshabille, pénètre. Sous les vêtements, sous les contraintes sociales, sous les interdits, Embirìkos va chercher la force vitale, l’énergie primitive qui le fascinent. La violence radicale et légendaire qui nous lie à la beauté du monde et à celle plus singulièrement de la femme, voici ce qu’il chante, cherche, capte, les yeux grand ouverts devant la beauté sensuelle, sexuelle, érotique du réel. Le recueil rappelle ainsi à la page 90 que la poésie
sera spermatique / absolument érotique / ou ne sera pas.
On aura reconnu au passage l’influence des surréalistes français… Ce poème par ailleurs est suivi presque immédiatement d’un très court texte, intitulé « Les Trois du triumvirat, » qui rend hommage aux trois maîtres de notre poète, j’ai nommé, Léon Tolstoï, Sigmund Freud et André Breton. L’horizon s’éclaire pour le lecteur français qui ignorait, comme moi ce poète que Michel Volkovitch nous présente comme une figure essentielle de la poésie grecque contemporaine.
Triple lumière, celle du retour à une morale naturelle, celle de l’acquiescement aux forces profondes et informulées de notre être, celle enfin de la folie et de la violence des images et des associations d’idées : triple lumière pour un seul recueil, un regard, une voix très singulière.
…sous un cerisier…
Le cerisier, un arbre qui revient plusieurs fois et occupe une place centrale dans la flore et la faune de cet Eden rêvé par l’auteur. Le cerisier est l’arbre dont l’ombre cache mal la lumière éclatante du soleil et de la beauté; il porte sur ses branches les fruits rouges couplés, gonflés de sève et de sucre dans lesquels le poète célèbre et chante la sensualité de son rapport au monde.
Le cerisier encore, c’est l’arbre dans ce jardin derrière la barrière, caché aux yeux du passant, au pied duquel il fera la rencontre, enfant, d’une jeune beauté nue et occupée à son plaisir à l’abri, croit-elle fallacieusement, des regards. La scène est chantée dans un lyrisme échevelé, violent et cru, sans précaution oratoire. Véritable scène primordiale, primitive dont on ne sait si elle est réelle ou simplement rêvée, elle exprime ce que le poète voit dans le plaisir et la sexualité: l’extase matérielle, l’union avec le végétal, la création, la force dyonisiaque qui porte à la Joie. On comprend donc que le poème ici ne fait pas de la nature, de l’arbre un simple symbole destiné à exprimer pudiquement la radicalité du désir humain. Non. Ce désir, la nature l’accompagne et le permet, l’autorise, l’appelle.
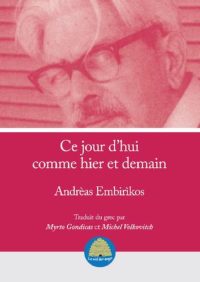
Andrèas Embirìkos, Ce jour d’hui comme hier
et demain, traduit du grec par Myrto Gondicas
& Michel Volkovitch, Le Miel des anges, 2016.
…un poète aveugle…
La poésie pour Embirìkos est un chant de libération. Ce recueil écrit à la fin des années 60, alors que les militaires avaient pris le pouvoir en Grèce, croit à l’affirmation de la liberté et de la joie d’être, dont la rencontre amoureuse est aux yeux du poète l’achèvement et le point culminant. Les mères les prêtres, les bourgeois, les soldats qui défilent dans la rue, les colonels, toute la violence grise et sale d’un monde semblent interdire, de poèmes en poèmes, la conquête du plaisir d’exister, aux enfants, au femmes, aux hommes portés naturellement les uns vers les autres, désireux pourtant de s’aimer de s’admirer, gonflés tous, femmes, hommes et enfants du désir brûlant de parachever leur humanité. Ce monde réel d’entraves, de règles et de soumissions n’est pas occulté dans le recueil. Il est bien présent,à la page 104 par exemple, derrière la fenêtre ouverte, dans la rue où passent les chars bruyamment, accompagnés de la fanfare militaire. Mais ce que le poème chante, c’est précisément la chambre, où sur les draps blancs, dans la lumière du matin, un couple fait l’amour.
Aveugle donc le poète, mais aveugle volontairement, fort de vouloir ignorer le laid du monde actuel pour chanter un monde nouveau à venir. Embirìkos s’attache malgré tout, malgré tous (il choisira de ne pas publier son recueil) à contre-courant, à chanter sa foi dans la grandeur de ce que les autres considèrent comme bas et vil. C’est bien à un renversement des valeurs que nous invite le recueil; mais le lecteur français aurait tort de me voir que des poèmes complaisamment érotiques. Il s’agit de bien d’autres choses encore.
…un poète aveugle chante…
«Un poète aveugle chante», écrit-il. Ce chant est dionysiaque, incandescent, brûlant, on l’aura compris. Il anime tout un monde. Une Création, où la faune et la flore la plus ordinaire accueillent Archanges, Nymphes, Centaures. Le réel, oui, mais enchanté, habité de présences et de puissances. Mieux encore: Ce jour d’hui comme hier et demain réalise la promesse de son titre. Il s’ouvre à des temps, à des époques et à des espaces qui dépassent très largement la Grèce de la moitié du 20e siècle. Le monde aztèque de Montezuma, les bords du Jourdain, Paris, la Russie éternelle de Tolstoï, c’est tout un univers à la fois livresque, légendaire, mental, rêvé que projette le recueil, pour atteindre à l’universel. De grandes processions primitives d’hommes et de femmes joyeux « couronnés de lierre et solennel » avancent vers ce que l’auteur appelle de ses voeux, “ le Nouvel Âge”. De grandes processions syncrétiques dans lesquelles la vision du poète associe les différents âges de l’humanité :
Du Christ-Adonis érotique et humain
Sève de la terre Ranga-Paranga
Antidote à toute mélancolie
Battement blanc velouté d’aile d’ange
atterrissant devant nous qui apporte
Non pas l’épée de l’Eden mais pour les affamés
Du lait sucré Nestlé en boîte avec la manne céleste
Ranga- Paranga-Ranga!
Le rêve porté lyriquement par Embirìkos ? Voir l’homme s’ouvrir « pour le cœur et les sens/à ce monde-ci/de trésor plus vivifiant plus riche”.
Quelle langue alors pourrait dire l’extase d’être que vise les poèmes? La langue d’Embirìkos chante en empruntant sans vergogne aux grands genres littéraires anciens, mais aussi à la prose la plus plate et triviale d’aujourd’hui, aux prières et formules rituelles consacrées du christianisme enfin :
Sur terre aussi Gloire tout de suite
Et en même temps pour eux le mot Ourmahal veut dire
nous nous accomplissons dans le plaisir
comme dans les cieux sur terre maintenant et toujours
À tout moment disant au lieu d’insultes
« Ourmahal ! » ― un « Ourmahal ! » pour tous les siècles.…la gloire du Désir
Sans doute voilà la formule qui explique le sens du titre de ce recueil publié à titre posthume, que pourtant l’auteur avait achevé avant de disparaître. Il y a, le mot « gloire » nous le rappelle régulièrement, une religion du désir chez Embirìkos. Il faut entendre par là, d’abord un sens renouvelé du sacré : les yeux qui dévorent la beauté du monde, s’extasient de celle de la femme, comme le désir et le plaisir sexuel, tous sont sacrés. Ils relèvent tous trois de ce que l’homme a de plus grand, au regard du poète. Mais le mot « religion », entendons-le aussi dans son sens de lien, de relation. Ce qui fait le fil directeur du recueil d’Andrèas Embirìkos c’est la manière dont lorsqu’il est libre, accepté, vécu sans honte, en réciprocité, le désir lie l’homme et la femme, mais aussi l’homme et l’animal, l’homme et la création tout entière. Il est un langage enfin vrai et transparent :
Quel dommage que si souvent les paroles soient conventionnelles
Et ne disent pas toujours la vérité des choses
Ni celle des sensations ni celle des sentiments
Et tout comme les vêtements de tant de modes risibles
Cachent elles aussi la grâce des âmes et des corps.
- Deux grand poètes grecs : Yòrgos Markòpoulos, Andrèas Embirìkos - 6 juillet 2019
- Roger Gonet : La Voie Haute - 7 janvier 2016
















