Juillet 1978. J’avais vingt-deux ans. Contrairement à Paul Nizan, je laisserai sans doute dire que c’est le plus bel âge de la vie. J’étais étudiant en lettres modernes à la Sorbonne. Je n’affirmerai pas que ma vie a changé cette année-là mais j’ai appris ce que le mot « rencontre » signifie. J’étais en vacances en Martinique pendant deux mois. Un privilège certes. Une chance également pour qui veut la saisir. Je logeais dans la famille d’un ami martiniquais de mon âge. Que connaissais-je de la Martinique? Rien. Enfin si, des livres : André Breton et surtout Aimé Césaire…
Etait-ce suffisant pour découvrir ce département d’outre- mer qui devint français en 1635 soit plus d’un siècle avant la Corse ? Je l’ignore. J’avais lu Césaire avec l’enthousiasme et la candeur d’un jeune homme épris de littérature et d’absolu. Le beau-père de mon ami travaillait à la mairie de Fort — de ‑France. A l’époque, dans tous les foyers martiniquais, il y avait une photo du maire de Fort- de –France dont j’admirais l’écriture, le lyrisme, la révolte… Que sais-je encore ? Sans hésiter, j’ai demandé à mon hôte s’il pouvait m’obtenir un rendez-vous avec Aimé Césaire. Charles n’a pas paru étonné. « Je vais voir ce que je peux faire » m’a‑t-il répondu et ce fut tout.

Au cours de mes promenades, je voyais parfois le maire de Fort- de- France et son chauffeur dans une DS noire. Les gens le saluaient de loin ; il répondait toujours amicalement à leurs signes.
Un jour, Charles est venu à ma rencontre avec un sourire entendu : « Tu as rendez-vous avec l’homme que tu voulais voir, demain à quatorze heures, à la mairie ». J’ai tout de suite apprécié la périphrase. Ainsi, Ilm’attendait. Je ne savais quoi penser. J’avais emporté Les armes miraculeuses en vacances, un de mes livres préférés. Je décidai de le prendre avec moi. Que pouvais-je faire de plus ?
A 14 heures précises, j’entrai dans la mairie. « Vous êtes attendu » me dit-on avant même que je me présente. On m’introduisit dans un bureau. Césaire se leva et me tendit la main en souriant. Ce qui me frappa tout d’abord, ce fut son amabilité et cette manière spontanée de mettre son interlocuteur à l’aise. Je n’éprouvai aucune timidité. Je me sentais de plain-pied avec lui. De quoi avons-nous parlé ? A ma grande confusion, je ne m’en rappelle plus exactement. Je n’ai pas pris de notes, je ne peux donc restituer notre dialogue avec précision. Il m’écoutait parler de littérature, de Paris et de son œuvre avec attention. Je me souviens d’une phrase qu’il a prononcée en souriant : « Je ne suis pas le roi Christophe ». Je pensai fugitivement à une autre affirmation de Césaire (je cite de mémoire) : « L’indépendance conquise, commence la tragédie ». Ce fut vrai pour Haïti, pour l’Algérie et pour bien d’autres pays. Pensait-il alors à la Martinique ? Je ne lui ai pas demandé.
Parfois, on frappait à la porte. Lorsque la personne entrait, il faisait signe qu’il ne voulait pas être dérangé et notre conversation reprenait.
Et maintenant, plus de trente ans après ?… C’est trop tard, me dira-t-on. Curieusement, je n’ai pas cette impression même si je suis bien incapable de restituer le contenu de cet entretien. L’avouerai-je ? Je n’en éprouve aucun regret La page est tournée.
C’était en juillet 1978. J’avais vingt-deux ans. Et tout le reste est littérature.
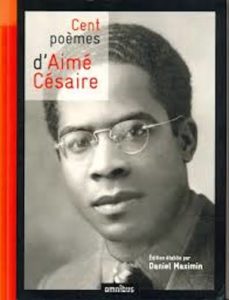
Ils sont revenus les visages en exil
Je les ai vus se refléter sur les chemins
Détrempés de sang
Ils me rappellent sans cesse
Que j’ai raison de voir la mort en filigrane
De ma vie.
Je les ai vus se profiler sur les ombres
Des déportés du monde
Sur la douleur d’une femme que je n’ai pas su abolir
Ils marchent tous dans la même direction
Avant de se rassembler au cœur du monde
Pour se réchauffer
Autour d’un brasier fantôme.
Personne ne voit les visages en exil du monde
Et je détourne aussi les yeux
Pour vivre encore un peu.
La nuit
Leurs yeux rouges mettent le feu à mon sommeil
Ils sont revenus des carrefours de la douleur
Les visages en exil.
Ils s’appellent Abraham ou Boris
Et portent d’autres noms que le monde
A oubliés
Ou grattés furieusement sur les stèles de la mémoire
Ils se rassemblent toujours au carrefour du monde
A Delphine Haslé
La nuit se penche vers nous
Par-dessus votre épaule
En nous tendant la main.
Les mots que vous prononcez s’ accrochent à vos cheveux.
J’ aimerais en cueillir quelques-uns avant qu’ils disparaissent
A jamais
Mais je n’oserais pas les dissimuler dans ma paume
Ce serait vous faire offense
Le temps ne le permettrait pas.
La nuit avale doucement nos pensées
Au rythme de nos pas.
Je voudrais inscrire notre rencontre dans
Les battements de mon cœur.
La nuit se penchait vers nous.
Grâce à vous
J’oubliais la face tuméfiée
Du monde
Denis EMORINE, Auteur de « Teatru » ( Editura Ars Longa http://www.arslonga.ro/ , français/roumain, 2013)
- Et tout le reste… - 6 juillet 2018
- La poésie iranienne d’aujourd’hui - 19 octobre 2014
















