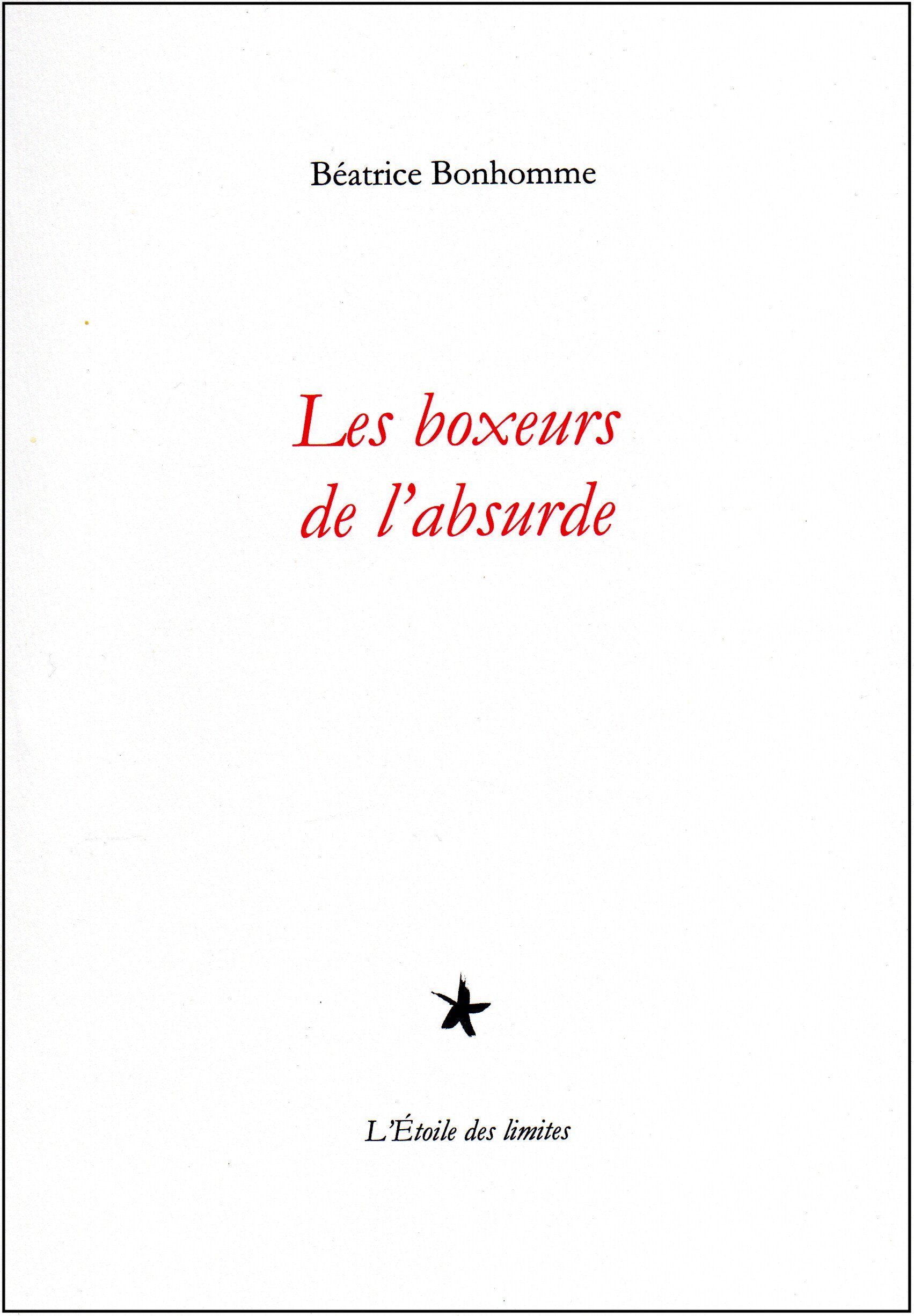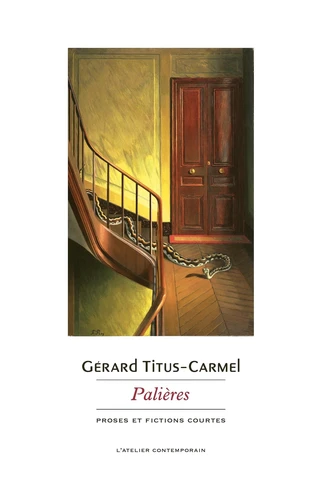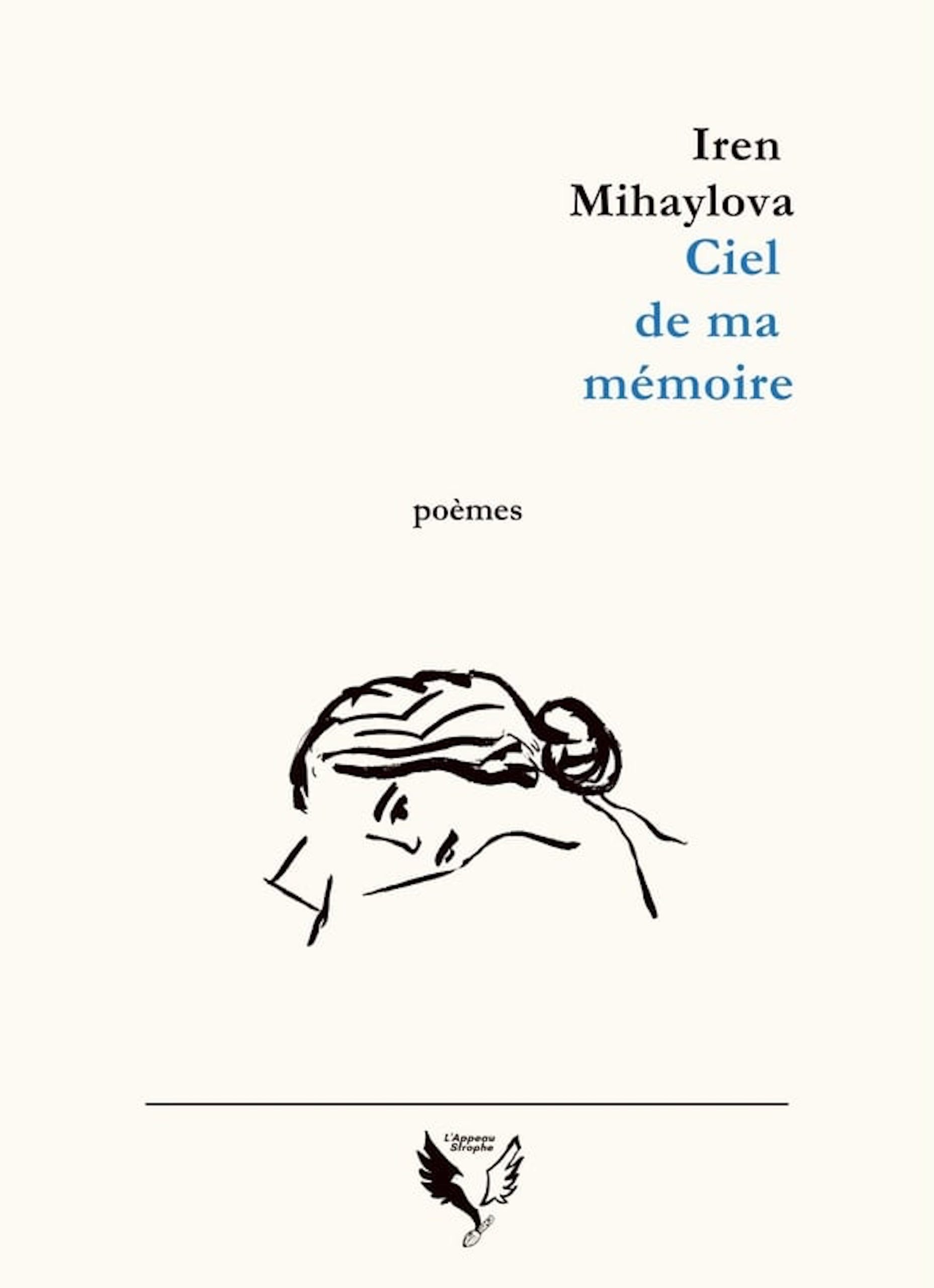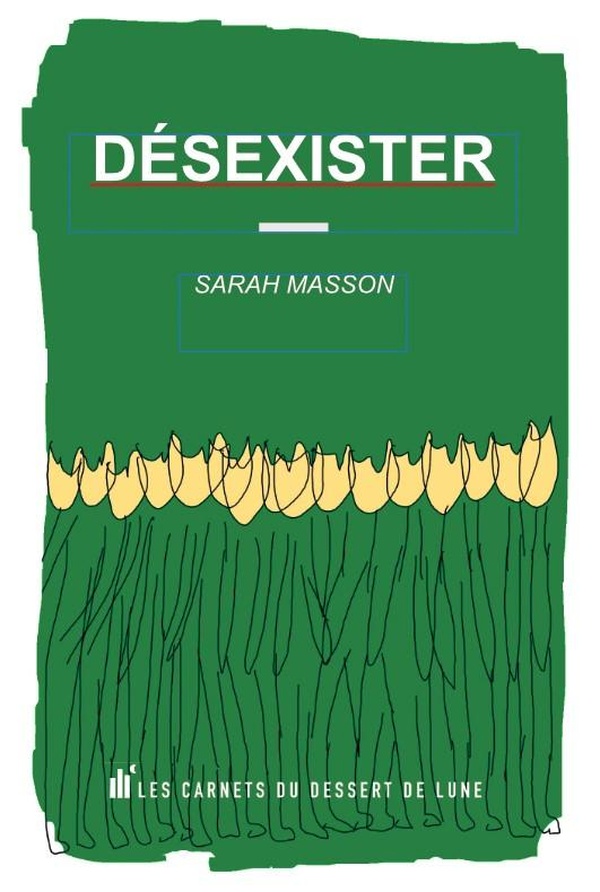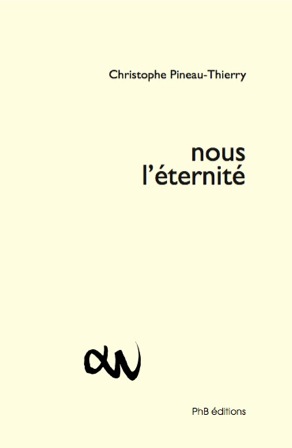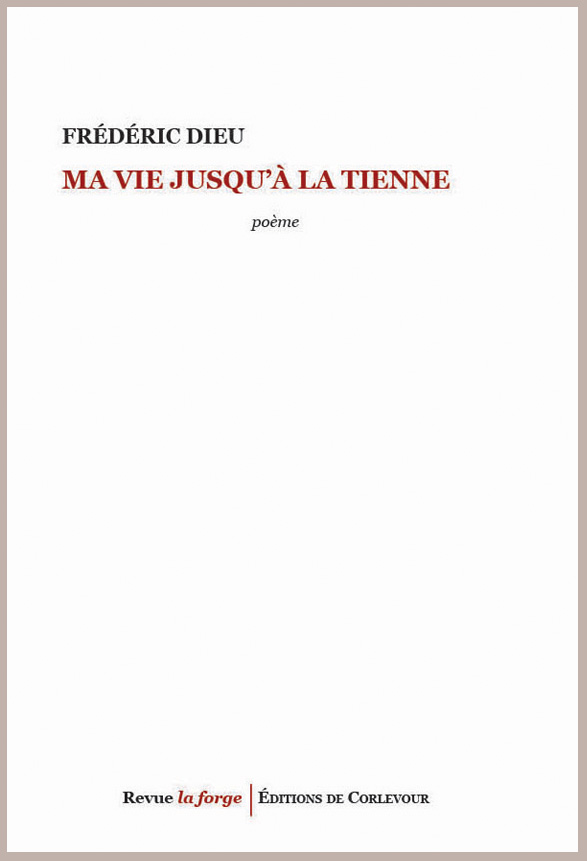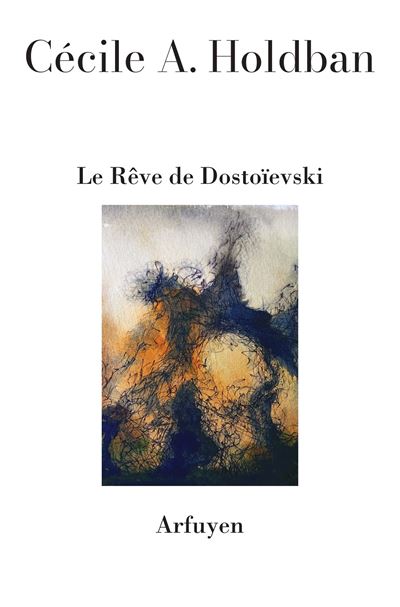« Au festin de la vie », banquet de l’immanence
Peu d’œuvres contemporaines possèdent la densité méditative et la simplicité apparente d’Un déjeuner en montagne suivi de Le pur plaisir d’exister. En cent soixante-huit fragments, si l’on cumule les deux textes, Gérard Pfister met en scène une communauté d’amis qui marchent vers une clairière, partagent un repas frugal, et en reviennent transformés, transformation qui conduit à une méditation sur « le plus vrai de nos vies ».
Un déjeuner en montagne condense en une scénographie spirituelle (la montagne reste matrice symbolique, cf. Hautes Huttes1, mais l’élévation devient partage, et après les hauteurs surgit la clairière) un parcours d’initiation. L’ouvrage réactive une mémoire antique sans didactisme, et propose une liturgie de l’immanence aux convives de ce banquet – ainsi qu’aux lecteurs.
Avec ce recueil, où s’énonce en toute simplicité une philosophie de la présence et de la gratitude, Pfister poursuit, dans la langue dépouillée qui est celle de la sagesse, la continuité d’une œuvre tout entière fondée sur l’expérience, et non sur la doctrine. Comme l’affirmait d’emblée Le Livre2, « Ce n’est pas du livre / qu’il faut parler / mais de l’expérience. » Un déjeuner en montagne est précisément un récit de cette expérience et des enseignements à en tirer. Et tel est bien le rôle de l’ami, central, celui que l’on vient célébrer mais qui s’efface, discret dans sa vie comme dans sa mort. Sa présence-absence est en effet l’occasion d’une révélation pour chaque convive. L’ami n’a‑t-il pas le désir de ne « vouloir en rien s’interposer dans notre propre expérience » (p. 55) et ainsi de laisser advenir, pour chacun, cette apocalypse (au sens étymologique de « dévoilement » sans eschatologie) ou, si l’on préfère, cette révélation ?
Le cheminement vers la table : scénographie d’une sagesse
Le livre s’ouvre sur l’évocation d’un ami anonyme, célébré chaque année par une assemblée fraternelle. L’auteur, tout aussi effacé, se dessine sous les traits du marcheur. L’ex-cursion sera questionnante, initiatique, inspirée par le modèle du ζητητής, marcheur apparenté au pèlerin de l’intériorité du Cherubinischer Wandersmann d’Angelus Silesius, plutôt qu’aux figures romantiques en quête d’infini.
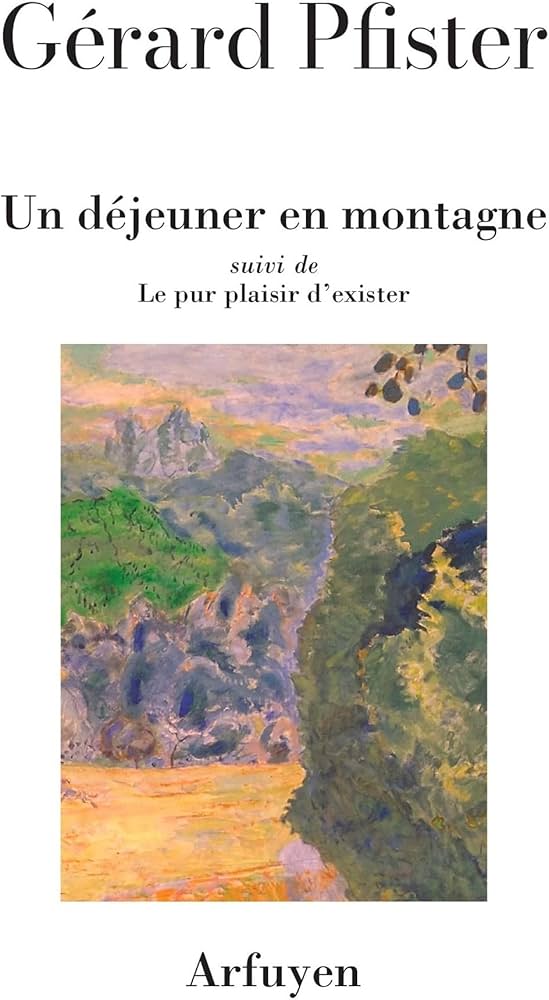
Gérard Pfister, Un déjeuner en montagne suivi de Le pur plaisir d’exister, Arfuyen, 2025, 128 pages, 15 €.
Ce voyageur mystique n’avance pas vers un ailleurs lointain, mais s’ouvre, pas à pas, à la clairière intérieure. Il suit un itinéraire spirituel à la manière des marcheurs dépouillés et réceptifs, lancés in die weite Welt comme le Taugenichts d’Eichendorff. L’intention liminaire inscrit ainsi le texte dans la tradition des pérégrinations spirituelles, où l’espace extérieur reflète un cheminement de l’âme. Cette marche vers le banquet est dépouillement, libération des vanités, du savoir figé et stérile. Il y va d’une ascèse, où ne manquent ni la fatigue, ni la présence de la mort (la buse). Le cheminement progressif vers un repas communautaire passe par des étapes préparatoires : l’approche (les bosquets, les rondins, les mûriers, la clairière), le seuil (le tapis déployé, l’accueil par les convives, les tentes installées), la préparation (on délasse les sandales, on enduit d’onguents, on pare de châles, autant de gestes immémorialement sacrés), l’entrée dans le cercle (les noms appelés, les retrouvailles, les guirlandes de fleurs), et enfin le repas proprement dit. Les tentes de toile blanche, dressées sur la hauteur, rappellent les abris bibliques du désert ou de la Transfiguration. Mais, chez Pfister, elles n’abritent plus la gloire d’un dieu. Elles deviennent le signe d’un sacré sans transcendance, d’une lumière fraternelle partagée. Ce mouvement est lent, cérémonial, comme un franchissement de seuil vers une communion grammaticalement traduite en un « nous » dissolvant l’individu dans une communauté idéale.
Les guides, dans cette montée vers le partage des nourritures, ne sont pas les dieux mais les enfants. « À chaque détour du chemin, les dieux nous apparaissent, et nous sommes leurs hôtes. Nous n’en avons plus peur, ils n’ont plus de révélations à nous faire » (p. 104). La transcendance a été abolie. Les dieux sont familiers, ils mangent à la même table que les humains. Pfister reprend ainsi la leçon de Lucrèce : les dieux ne sont pas inatteignables, omnipotents, résidents de palais célestes (De rerum natura, V). « La piété, ce n’est pas se montrer à tout instant la tête voilée devant une pierre, ce n’est pas s’approcher de tous les autels, […] c’est bien plutôt regarder toutes choses de ce monde avec sérénité ». (V, 1196–1200) Le sage épicurien est capable de tueri omnia, « contempler toutes choses » depuis la hauteur tranquille d’une montagne spirituelle, en somme. Et d’un esprit apaisé (mente pacata). Pieux programme réalisé chez Pfister, quand l’éternité se confond avec l’instant du partage.
Si les dieux ne sont pas guides, mais convives, c’est aux enfants, en revanche, que Pfister confie cette mission d’accompagnement et d’accueil : « Les jeunes guides tenaient de la main gauche un fin bâton tressé de rubans bleus, verts et jaunes, à la manière d’un caducée. » (p. 67) Les enfants sont souvent les acteurs principaux de la hiérophanie du quotidien, dans l’œuvre de Pfister. Ici ils sont les médiateurs, comme le Psychopompe, entre visible et invisible. Le caducée d’Hermès, emblème du passage et de la médiation, confère aux enfants le rôle de messagers d’un rite. Leur rôle renverse toute hiérarchie, faisant de l’enfant le véritable initié, lui conférant un rôle majeur que condamnent les « exégètes » (p. 68). Ceux-ci, ridiculisés pour leur lourdeur interprétative (puissions-nous ne point leur ressembler !) et pour leur morgue, s’opposent aux enfants incarnant la sophia innocente, proche du jeu. La vérité de Pfister n’est pas dans les traités, mais dans la capacité d’émerveillement. L’ami se caractérise par son rire (p. 31), qui rend inutile et vaine la pompe des discours, « grand rire bienheureux » (p. 95) qui secoue tout le livre. Dans la troisième partie du livre (« De l’amitié »), les enfants apparaissent encore comme des figures de légèreté et de rire : « À nouveau, les enfants se moquent de nous avec leurs crécelles » (p. 106). Pfister fait des enfants les prêtres involontaires de l’immanence, célébrant, à leur insu sans doute, la liturgie du réel.
La « crécelle », comme d’autres realia qui jalonnent le parcours, signale un lexique délibérément désarrimé des repères contemporains. Ni objet antique exhibé comme citation érudite, ni accessoire moderne, elle résonne dans son intemporalité. Même économie pour les « châles », les « guirlandes de fleurs », les « sandales » qu’on délace, les « onguents » dont on enduit la peau, les « vasques de terre » où roulent les olives, etc. : ce vocabulaire domestique, pastoral et artisanal ne verse ni dans la reconstitution archéologique ni dans la notation réaliste d’aujourd’hui. L’achronie permet à la langue de dire les choses dans leur évidence première, comme une manière d’être-au-monde.
Le banquet, co-présence, nourritures
Le fragment inaugural d’Un déjeuner en montagne établit d’emblée le cadre symbolique de tout le livre : « Aujourd’hui est le jour anniversaire de sa naissance. Nous nous réunissons ainsi depuis des siècles, comme il l’a voulu, autour d’un repas. Bien peu de lui nous est connu, mais son amitié nous rassemble. » Ce passage, par sa simplicité liturgique, possède un écho double. Dès l’exergue (« Toujours nous est doux le souvenir d’un ami disparu », p. 7), Pfister inscrit son livre dans la filiation directe d’Épicure. Diogène Laërce rapporte en effet que le philosophe prescrivit à ses disciples de célébrer son anniversaire par un repas simple, « le vingtième de chaque mois » (Vies et doctrines des philosophes illustres, X, 18–19). Le livre de Pfister transpose ce rite en un « déjeuner en montagne » qui n’est ni un festin somptueux ni un symposium intellectuel, plutôt la sensation du partage des mets et des mots, une synousia, présence partagée, co-existence sous le signe de la joie tranquille. Autre écho, plus sourd, celui du Christ à la veille de sa Passion, invitant au partage du pain et du vin « en mémoire de moi » (Luc 22, 19). Anniversaire célébré, repas rituel, communauté fidèle, injonction de mémoire : les convergences sont frappantes. Mais Pfister opère un renversement eucharistique. Le repas n’est plus commémoration d’une mort rédemptrice, mais reconnaissance d’une présence silencieuse, et partage non du Corps du Maître, mais de l’expérience d’exister ensemble. Le pain et le vin demeurent pain et vin, sans transsubstantiation, juste une « secrète alchimie » (p. 71, p. 83) organique. Mais c’est ce caractère organique même, comme la matérialité des choses, qui devient sacré. « Depuis des siècles » joue alors comme un écho à la longue mémoire chrétienne, mais la continuité du rite n’est plus instrument de salut. Au « depuis des siècles » liminaire fait écho « la tradition depuis des siècles » (p. 67). Cette reprise, apparemment anodine, agit comme un véritable sceau rythmique, scandant la fidélité d’un rite détaché de toute institution, résonance de la formule doxologique in saecula saeculorum. Pfister en reprend la cadence, mais en la désacralisant. Le saeculum n’est plus ici le temps opposé à l’éternité divine, mais la temporalité immanente où se manifeste la permanence du lien. Autrement dit, l’expression conserve la musique du sacré tout en la transposant dans le plan de l’expérience, cette « expérience » décidément fondamentale… Ainsi, à la transcendance du salut succède la continuité du geste, maintenu « depuis des siècles » dans le sensible. Ce « depuis des siècles », qui peut paraître hyperbolique, marque la survivance du sacré dans le profane.
La scène du banquet prend, de plus, une valeur anthropologique. Elle réactive la fonction primordiale de la table qui est de relier tout autant que de nourrir. D’ailleurs, les nourritures terrestres y sont frugales, donnant lieu au plaisir du mot autant que du goût. Le passage des olives, outre qu’il rappelle Martial et ses « olives, soustraites aux pressoirs du Picénum [qui], commencent le repas et le terminent » (XIII, 36) en est l’exemple parfait. Cet inventaire reconduit une tradition littéraire ancienne : celle des catalogues savants de Théophraste (Sur les plantes) et de Pline l’Ancien (Histoire naturelle, XV). Mais la rhétorique du catalogue culinaire n’a rien d’ornemental. Dans la ligne d’Athénée de Naucratis et de ses Deipnosophistes, cette immense compilation de propos de table où chaque aliment devient matière à savoir, Pfister reprend le motif encyclopédique pour le renverser. Si Athénée accumulait les citations et les anecdotes, Pfister pratique, lui, l’art de la soustraction. Cette sobriété rappelle les enseignements d’Épicure. Le plaisir ne naît pas de la profusion, mais de la mesure et le repas pfistérien obéit à cette économie du peu : vaisselle sans apprêt, aliments simples, etc.
L’amitié et l’ami, présence d’une absence
Ce déjeuner communautaire réalise l’idéal de l’amitié, que Cicéron définissait comme « accord sur toutes choses humaines et divines, accompagné de bienveillance et de charité » (De amicitia, 21 : « amicitia autem est nihil aliud nisi summa consensio omnium rerum divinarum humanarumque cum benevolentia et caritate. ») La philia est rempart contre la tristesse, « seule inexorable malédiction » (p.64) et elle relie les vivants et les morts, à commencer par le premier d’entre eux, l’ami que l’on célèbre. L’amitié n’engage à rien, est sans objet, « Elle ne demande ni ne donne, mais partage ce que nul ne possède ni ne connaît. » (p. 94) Elle relie les vivants et les morts, et s’éprouve comme dépossession de soi. La philia aristotélicienne et l’amitié selon le modèle de Montaigne prennent ici la forme d’une Abgeschiedenheit, qui est aussi une Gelassenheit, cet abandon paisible de soi, « extase », « pur plaisir d’exister » (p. 95).
La figure de cet ami n’est pas dogmatique, bien au contraire. Son enseignement passe par des images (p. 29) et par l’observation du vivant comme autant d’apologues (l’enfant, les raisins, la fourmi (p. 36)). Il fuit comme la peste les cuistres et les doctes qui encombrent les bibliothèques. On ne connaît ni son nom, ni ses traits, au point que le lecteur finit par douter de la réalité objective de cet ami irreprésentable, innommable. On n’ose pourtant le doter d’une majuscule d’abstraction, tant il est incarné. Et puis, ce serait trop simple…
Cet ami n’a « ni chaire ni estrade » ; par son refus du jugement et de l’autorité, il s’oppose à toute figure magistrale ; et pourtant il a l’autorité d’un Maître. Sa présence subtile habite chaque page, comme un vide rayonnant. Pfister écrit : « À peine si nous parlons de lui quand nous sommes ensemble. S’il s’est tellement effacé, on dirait que c’est pour nous laisser toute place pour vivre. » (p. 55) Ce paradoxe, la présence d’une absence, forme suprême de présence, prolonge une longue tradition spirituelle, la sagesse de se retirer pour laisser être. Mais l’ami accomplit également une mission, la transmission d’une parole de sagesse.
« Regarde ce que disent les choses »
En effet, au centre d’Un déjeuner en montagne, cette injonction, « Regarde ce que disent les choses », résume la manière de l’ami disparu et, plus largement, la philosophie de l’immanence qui traverse tout le livre. Cet impératif condense la conversion du regard qu’exige Pfister. Il ne s’agit pas de gloser sur le monde mais de le regarder et de l’écouter. Car le monde est déjà langage. Regarder ce que disent les choses, c’est entendre ce logos discret que la pensée abstraite recouvre d’ordinaire de son verbiage. Mais Pfister n’en fait pas une métaphysique, il reste dans la phénoménologie. Le visible suffit. « Regarder » le monde se manifester exige plus une forme de disponibilité et de présence que d’action. Semblable attitude s’oppose frontalement au discours des « cuistres » et des « doctes », figés dans l’érudition stérile et le bavardage interprétatif. Cette injonction de l’ami n’est donc pas une exhortation morale, mais une proposition ontologique. Elle agit comme un contrepoint tout au long du recueil, qui n’est, finalement, qu’illustration de cette invitation. La marche, le banquet, le partage, tout est regard.
À ce titre, parmi les fragments les plus révélateurs d’Un déjeuner en montagne, quelques passages énumératifs scandent le texte comme des litanies de la présence. Chacun de ces inventaires participe d’une même écriture de l’immanence. La nomination y remplace la méditation abstraite et le nom devient acte de reconnaissance (le motif du nom, de l’innommable, de l’innommé, est essentiel dans l’œuvre de Gérard Pfister, et central dans Ce qui n’a pas de nom, 2019).
Premier micro-poème de cet ordre, le fragment botanique (p. 17) : « La grande luzule côtoie la callune et la bruyère, la bétoine se mélange aux campanules, les digitales aux verges d’or. La potentille et la pensée sauvage composent des bouquets, l’achillée fait touffe avec l’épervière, le mélampyre avec la stellaire ». Bien au-delà du propos naturaliste, cette prose catalogique, héritière des traditions botaniques antiques, évoque une société végétale sans hiérarchie. L’accumulation, paratactique, restitue la syntaxe d’un monde qui s’organiserait (« côtoie », « se mélange », « fait touffe avec »), en une sorte de fraternité botanique. Déjà, dans l’ordre des végétaux, se dessine une autre forme de communauté, de convives, eux aussi, du banquet de la vie. L’inventaire des plantes, tout comme la liste des olives, est aux antipodes de toute velléité savante. Les noms ne sont pas donnés pour décrire, mais pour faire advenir. Nommer, ici, c’est faire exister.
Le même principe régit le fragment des coquillages : « Buccins, murex, nautiles, mitres, bucardes, cauris… ». Les noms latins, sonores, rappellent la tradition des litanies poétiques. Ce passage est typique de la prose incantatoire pfistérienne. L’énumération y permet une célébration sensorielle mais aussi une évocation presque visionnaire des âges du monde à travers la primitivité des espèces. Par la seule profusion lexicale, le texte évoque à la fois la mer antique et la pré-histoire du temps. De la litanie des nomenclatures antiques, donc, Pfister ne retient que le chant, débarrassé de toute visée érudite. Ces noms rares sont de purs signifiants sonores, coquilles vides mais pleines de la mémoire du monde.
L’énumération devient ainsi miroir de la pluralité terrestre et de la continuité des règnes minéral, végétal, animal. D’autres passages en témoignent, « olives, picodons, oranges et miches » ; ou encore « fruits des vergers, pains d’orge et de seigle, miel de bruyère, vin léger des collines », etc. De tels fragments constituent une poétique de la nomination, comme une bénédiction des choses, nommées une à une. La litanie des noms a tout d’un exercice spirituel. Mais il s’agit de regarder simplement, c’est-à-dire d’écouter, ce que disent les choses, sans interprétation.
Au bout du chemin, satiété spirituelle et affective
Le recueil s’achève sur une vision d’accueil et de transmission : les convives, vêtus de châles colorés, rencontrent d’autres voyageurs auxquels ils offrent ces châles comme don gracieux (p.107), dans la logique du présent simple qui n’attend pas de contrepartie. On songe encore à Martial qui, dans ses Xenia et Apophoreta, fit du don, notamment alimentaire (figues, olives, fromages) un poème en miniature, rappelant que la poésie se nourrit littéralement du partage.
L’après-banquet est formulation de gratitude et de joie. « Ce qu’un tel jour nous a donné, rien ne peut nous l’enlever » (p. 98). La joie reçue en partage est transfiguration. Elle se marque par une métamorphose et par une transformation de la marche même. « Au retour, notre pas n’est plus le même. Il nous semble que c’est nous, à présent, qui sommes portés » (p. 103). Ce renversement du poids, de la pesanteur à la grâce, si l’on veut, clôt le cycle initiatique.
La gratitude définit un nouveau rapport au temps, symbolisé par la couronne de lierre (p. 99) perpétuant le souvenir d’un banquet comme dans l’antiquité. Désormais nous entrons dans une ubiquité d’existence, où le monde cesse d’être étranger et où la chronologie s’abolit. L’expérience d’une journée est initiation. Mais était-ce une journée, vraiment ? : « Nous avons vécu mille existences en un jour. »
Le mot de la fin est proprement lyrique, orphique : « La gratitude nous porte. Nos forces sont intactes. Un chant merveilleux rythme nos pas » (p. 108). Le poème peut naître, avec le chant.
Le plus vrai de nos vies
L’accomplissement du livre, « le pur plaisir d’exister », scandé par l’anaphore « Le plus vrai de nos vies… », résume cette philosophie. « Le plus vrai de nos vies n’est pas » ; « Le plus vrai de nos vies est dans » : ces affirmations, au présent gnomique et sous la forme de la sentence, ne composent pourtant pas une doctrine, mais se veulent précisément l’enseignement de l’expérience. Pfister ne définit pas un concept de « plus vrai » ; il nous le « montre » dans le visible (ce pain, cette eau, ce lait, cette olive », comme la lumière qui seule « mange à la table » (p.114). D’où la justesse du « Final », et la continuité avec Le pur plaisir d’exister : la pensée n’ajoute rien au repas, elle en prolonge la lumière. « Le poète n’a rien à dire, le philosophe n’a rien à annoncer. » (p. 114)
On y revient toujours, « Ce n’est pas du livre qu’il faut parler, mais de l’expérience. » Les fragments déclinent ici l’expérience de vérité sous ses multiples visages en un flux de conscience bergsonien (ou stream of consciousness de William James, comme on voudra) où les instants se relient, « de l’étoile à l’amibe », en un ruissellement d’énergie cosmique « que rien n’arrête, pas même la mort » (p. 112).
***
Ainsi, Un déjeuner en montagne apparaît comme l’approfondissement d’une œuvre d’une grande cohérence. Après les vertiges et les gouffres vient le temps de l’accomplissement. L’élévation se reconnaît désormais dans la simplicité d’un pain partagé et dans une forme d’apaisement. Ce livre est l’un des plus accomplis de Gérard Pfister, qui y accomplit le vœu d’Épicure : vivre sans peur, dans la joie de l’instant. Il n’y a pas d’au-delà à chercher, l’éternité se goûte ici-bas, et sans jugement (si l’Ami devait juger, nous serions à jamais indignes…). À la transcendance verticale (de la communion mystique), Pfister substitue l’horizontalité du partage. Ni traité ni allégorie, Un déjeuner en montagne est une célébration de l’immanence, de la joie et de la reconnaissance. En cela, il convoque Épicure, Lucrèce, Montaigne, bien sûr, mais aussi La Fontaine, dont la fable « La Mort et le Mourant » résumait déjà l’éthique du départ : « Je voudrais qu’on sortît de la vie ainsi que d’un banquet, remerciant son hôte… ». La fin du repas, la fin du livre, est un écho au Nunc dimittis : « Il fait grand jour encore, nous marcherons jusqu’à la nuit » (p. 108). Partir, oui, mais riche de ce repas où l’on a appris que la vie, fragile et passagère, trouve tout son sens dans l’évidence d’une présence partagée. Quitter la table en ami, plein de gratitude envers l’hôte…
Notes
- Gérard Pfister, Hautes Huttes, Arfuyen, 2021.
2. Gérard Pfister, Le Livre, suivi de L’expérience des mots, Arfuyen, 2023.
Présentation de l’auteur
- Gérard Pfister, Un déjeuner en montagne suivi de Le pur plaisir d’exister - 6 janvier 2026
- Gérard Pfister, A livre ouvert - 6 avril 2023
- Gérard Pfister, Vertiges de hautes huttes - 28 décembre 2021
- Ce qui n’a pas de nom : la chance des mots - 14 octobre 2019