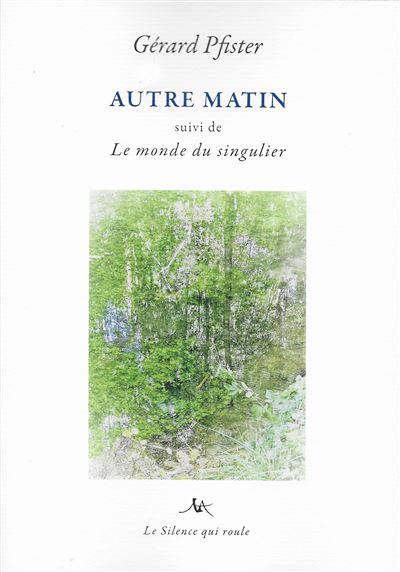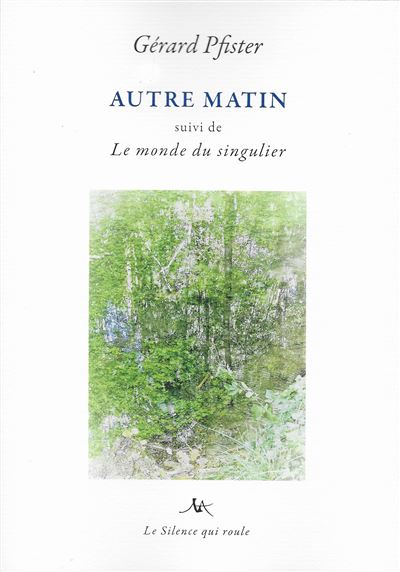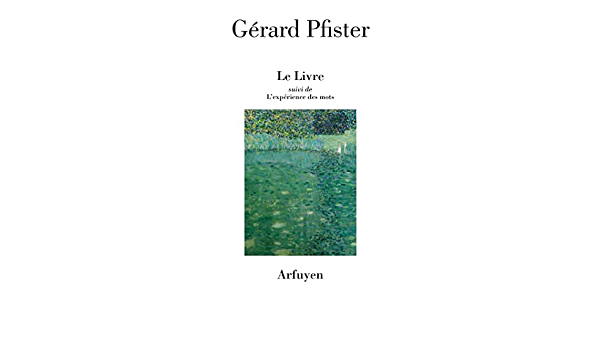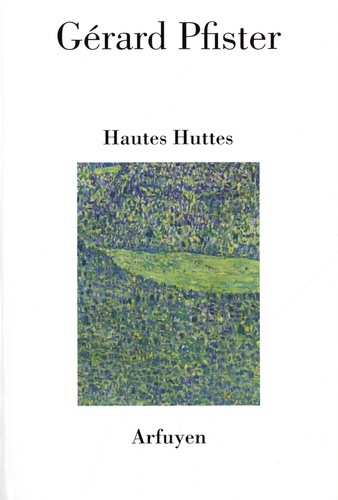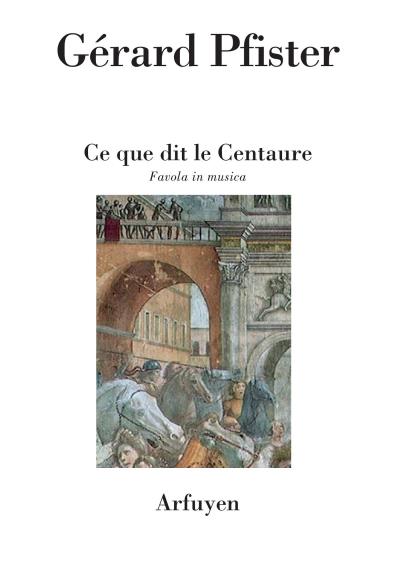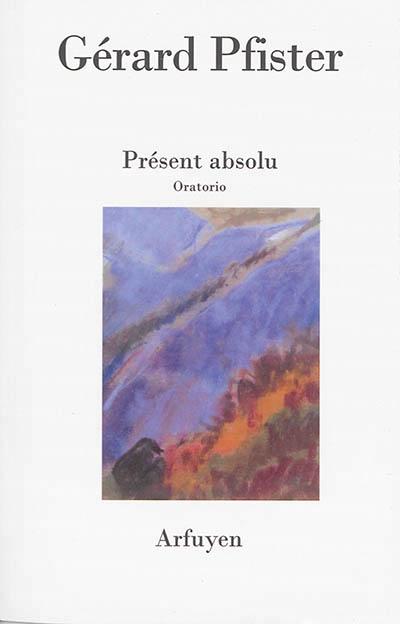Quel poète
enfin libre du poèmemarcherait
dans les pas de l’Éléen
Gérard Pfister s’inscrirait-il à la suite de Zénon et de Pyrrhon, moins pour les paradoxes du premier (quoique d’une certaine façon la flèche immobile traverse les poèmes de Ce qui n’a pas de nom) que pour le refus de définir propre au second ?
Le paradoxe est redoublé par l’idée d’une aphasie de mille poèmes, et pourtant, la liberté se dessine au terme du chemin. Si le recueil s’ouvre sur une invitation décourageante :
Ce qui est sans nom
n’essaie pas de le nommerCe qui est sans forme
N’essaie pas de le voir

Gérard Pfister, Ce qui n’a pas de nom, Arfuyen.
il s’achève sur la possibilité du signe, donc du sens du sans-nom, même si ce signe est… indéchiffrable.
Il s’agit donc de suivre un parcours qui s’ouvre sur de sombres auspices, sur une impossibilité à dire, à voir, ou plutôt sur le constat que les invocations litaniques qui tournent autour de l’In-nommable ne peuvent se dire qu’en creux. A l’origine était l’a‑privatif, et les poèmes poursuivent le nom de ce qui n’en a pas, courent dans l’avant et l’après des formes. C’est dans cet indicible en mille éclats que tout se joue. Les flammes, l’esprit, soufflent régulièrement sur l’informe et les ascensions se produisent tout au long de ce parcours. Rouge et or servent de toile de fond comme dans l’Assomption du Titien le rouge s’élève des hommes à Ce-qui‑n’a‑pas-de-nom en passant par la robe de Celle qui a trop de noms. A ces flèches ascensionnelles répondent des images de submersion et consomption totales (135–136) au fascinant vertige, et ce jusqu’au plongeon final, qui est aussi Assomption. Et nous voilà renvoyés au tableau dans lequel le bleu est cette zone intermédiaire entre l’humanité levant les bras et le sans-Nom auquel elle aspire. Sauf que l’ordre peut s’inverser, les couleurs se mêler, les formes et les teintes se fondre et l’apothéose finale se résumer au blanc d’une (demi-) ombrelle sur un autre tableau. Blanc dans lequel tout se résout, silence dans lequel s’éteignent les cris des hommes tout en bas. Mais ils ont, nous avons, toujours les bras tendus vers le haut. Tout s’est figé dans une « assomption immobile » (958). C’est peut-être le moment de bascule final, le point immobile des mystiques, le « still point of the turning world » de T.S. Eliot.
Nommer
Ce parcours entre mer et terre, bas et haut, plein et vide, est aussi réflexion sur le sens et son absence. Il y a le sans-nom qui est plus que le nom et qui est peut-être le mystère suprême, mais aussi le mot qui n’a rien du nom. Le mot, les mots, quelle nécessité et quel fléau aussi ! Les mots fatiguent, paraissent souvent usants (peut-être trop usés), et c’est un pari audacieux que d’utiliser les mots pour dire la beauté du « sans-mot ». Le poème rappelle que le mot blesse à l’occasion (168–170), qu’il revient comme une infection (392), que la fascination pour noms et formes à satiété a quelque chose de mortifère (129–130). Les noms sont un bazar/hasard, les mots quittent, leur charpente est vermoulue et nous étouffe.
La question essentielle, cratylienne, est posée tout au long du recueil : faut-il nommer, « dire » les choses et les formes ? Exemplairement : faut-il donner un nom au papillon ? Faut-il tenter d’en faire un mémorial (389 / 545 /905) par le nom ? Mais oui, si c’est le myrtil, car son nom rappelle un autre nom, celui du fruit dont il est fait bouquet. Au passage, ce sont justement ces échos, ces clins d’œil, qui invitent à faire une lecture suivie de l’ensemble avant la relecture en morceaux de choix, car le myrtil, que serait-il sans la myrtille ? Il en fait mémoire. Et un nom n’est pas un mot comme un autre.
Vide au miroir
L’absence, le vide, l’envers des choses, l’avers de l’apparence, le jeu sur la disparition et la mémoire sont au centre de tous ces mots. Le vide est central, et au cœur physique du livre, avec un apogée en son milieu même.
Au cœur de l’espace
au cœur du temps
il y a ce vide
que le vide seul contemple (555)
Et ce vide spéculaire, ce vide que le vide contemple, c’est comme une quintessence du livre, un concentré, un élixir. C’est aussi un moment de suspension au cœur du recueil, même si la fin apporte une résolution, une forme de plénitude qui répond harmonieusement au vide sans pour autant chercher à le combler (au contraire). Ce vide est vertigineux aussi, il nous maintient dans l’entre-deux, suspendus. Il rejoint les images de seuil, de bascule (181–183). Les mots restent sur le seuil, aussi (342). C’est d’ailleurs la même image d’entre-deux ou de basculement entre mort et vie qu’on retrouve dans les très beaux vers sur l’eau qui lave mais noie aussi, le feu qui réchauffe mais brûle aussi.
Les mots figent le temps, empêchent d’accéder à l’éternel présent qui ne cesse pourtant de jaillir. Ils renouvellent le supplice de Tantale, et nous mourons de soif près des fontaines (224, 416). L’Éternité est maintenant, constate Gérard Pfister en formulations lapidaires et condensées qui rappellent le « It is eternity now. » de Richard Jefferies. Le présent est saisi comme fulgurance, éclair, contre la durée : apparaître et disparaître ne sont qu’un, il n’y a ni commencement ni fin. Le temps est aussi l’infini de la vibration (67–531, bel écho), la respiration et le battement au cœur du vide.
Ce vide qui se contemple est donc quelque chose, comme l’absence est aussi présence. Et Gérard Pfister dit et écrit admirablement cette présence de l’absence, en dehors des truismes d’usage. Le recueil peut se lire comme un jeu sur l’apparence, à la fois présence et reflet, illusion d’être. L’apparence prend aussi la forme de l’image, en mots ou en couleurs. Images de nature, peinte ou réelle, mais c’est la même chose, jardin dans le tableau ou jardin devant la page en train de s’écrire, qui est tableau à sa façon. Un bouquet de myrtilles est « au centre de tout », mais l’image n’est pas fixe, car le bouquet vit et meurt, et le lecteur se pose la question : « mais qu’est-ce donc qui l’a fait croître et dessécher ? » Rien de plus concret et sensuel, mais rien de plus métaphysique que ce bouquet-là (ou l’absente de tout bouquet).
Mots creux, noms en creux, et chemin du silence
L’éloge de l’art au détriment des mots invite le poème à ne plus être l’esclave du discours et de l’illusion. Les mots détachés du sans-nom sont vains, autant de livrées chamarrées et de bicornes galonnés (339), insignes et signes de vanité comme de préciosité stylistique. Les jolies apostilles et cavatines (613–614) sonnent bien, mais ne sont que chatoyances baroques, écriture chantournée, mots-pierreries. Métaphysiquement parlant, ces mots perdus signifient apophasie et apostasie.
Le poème s’écrit sans cesse contre la vanité du langage. Pourtant nourris de références, mythologiques par exemple, les vers ne les délivrent qu’en creux, ils les concèdent. Tout au plus quelques indices culturels parmi d’autres sont-ils donnés à la fin. Cette discrète « solution des énigmes », clin d’œil ludique, est apportée par les « résonances » ultimes, occasion pour le poète de glisser quelques pistes interprétatives. Mais on devine que par discrétion il en tait bien d’autres, dont la présence se ressent. On ne saisit pas forcément mais on devine ces noms en creux, cachés par modestie. On en surimpose d’autres, ceux qui vous viennent subjectivement à l’esprit. Mes propres échos, par exemple, voix que cette voix m’évoque : Parménide, Héraclite, Mallarmé, T.S. Eliot donc, Valéry, Hölderlin, mais aussi le Hofmannsthal de La Lettre de Lord Chandoset le Beer-Hofmann de La Mort de Georges.
En somme, le « pèlerin aphasique » (696) serait la définition idéale du poète, qui « fabrique » à partir du vide. Mais on apprécie, dans la poésie de Gérard Pfister, l’absence de pose, la noble humilité. On évitera donc à notre tour de broder sur le « poiein », ce lieu commun de l’exégèse, même si en l’occurrence il s’agit bien d’une fabrique, d’une création à partir d’une matière qui se dérobe, insaisissable comme le souffle, la matière de Ce qui n’a pas de nom. De dénégation en dénégation, la poésie se constitue de ce qu’elle n’est pas. On a beau se sentir fleurir, se sentir voler : « une rose non », « un oiseau non » (701). Leçon de faire poétique ? : deux vers, puis deux autres, et ce vide, et le silence. C’est tout le contraire de « l’illusionnisme du discours » (591), des mots de théâtre (608) revisitant la métaphore baroque de la vie. Il faut que le mot tombe, et on peut comprendre de deux manières ce constat, comme dépouillement des feuilles ou « chance » étymologique, la chance du mot juste, le seul. Mots (noms ?) comme feuilles et pétales tombés (201), la chance des noms en somme. C’est cela, ces mille poèmes : la chance des mots, les mots qui tombent bien, le pari gagné.
Devant le silence les mots s’inclinent, eux qui ne sont là que pour l’écouter. Et le dit du silence est particulièrement frappant, un silence qui est bien plus que le fait de se taire (210), un silence qui a de l’épaisseur et de la consistance. C’est là le secret de la liberté de l’Éléen, qui est aussi la transmutation du mot en chant, grâce au vide, y compris au cœur des versets.
Quand le mot est chant : montrer l’apparition
Dans le liminaire une fin est donnée au projet poétique : faire voir, sentir, entendre une parole rivalisant avec les éléments, mais au risque ou au prix du mirage, du vacillement des apparences. Il s’agit de faire sentir l’apparition, le chatoiement, ce qui « semble ici » et qui se définit par la négation du nom. Le but est atteint au terme de la lecture, mais il est même dépassé, car au-delà du tremblement, du reflet sur la lagune, se devine la terre ferme. Le lecteur bercé par le tangage et menacé d’engloutissement trouve des amarres, mais le voyage ne saurait s’oublier, et l’on est durablement chaviré par cette navigation sur des entre-deux, à nos risques et périls.
Les sections IX et X constituent une éblouissante variation sur l’apparence, ce qui n’est pas étonnant, dans la foulée de l’Éléen et des raisonnements pyrrhoniens sur les conséquences incertaines des illusions ! Mais cette plongée dans les fonds bourbeux de la lagune, et cette assomption qui va bien plus loin que la simple ekphrasis, conduit le lecteur à être sauvé des eaux de manière subtile et particulièrement bouleversante. Anabase et catabase, descente dans l’obscurité et le vacarme pour réveiller les vivants et les morts, puis… le miracle du chatoiement, du miroitement, du sourire aux mille nuances, d’un apaisement enfin trouvé. La fin et le commencement s’inversent comme l’eau et l’air, pour une plongée à rebours. Résolution de l’incandescence de la robe sans-nom, la flamme blanche de la robe de la jeune fille de Monet, à la fin du livre, nous emporte vers le ciel. Visage tourné, « happé » dit le poème, vers le ciel et pieds ancrés dans le sol d’un jardin, le lecteur se retrouve dans la position de l’ « os homini sublime » des Métamorphoses d’Ovide, cette face tournée vers le ciel étant peut-être le signe d’une dimension sacrée au sein même de l’humanité.
Le sourire innombrable n’a plus rien du sourire moqueur devant l’illusion de toute chose, et l’on se « réancre » en ce jardin bien concret, même si ses marais sont souvenirs de lagune et ses prés souvenirs de la candide jeune fille à l’ombrelle. La lumière sur les tiges est réelle, elle fixe l’instant dans un paysage bien terrestre quoiqu’aérien, les éléments se mêlent et sortent du cadre strictement pictural. Les ondulations des plis de la robe Virginale, au début, ne sont plus désespérantes comme autant de parures de noms et de formes qui n’en purent saisir que le contour. Le regard peut désormais se reposer sur ces ondes sans chercher à les traverser pour saisir une présence derrière l’apparence, puisque l’apparence, finalement, est déjà en soi le signe de la Présence. Que le signe soit indéchiffrable est reposant ; le pèlerin aphasique peut retourner au silence en ayant donné du sens à toutes les privations et négations initiales. Toutefois l’ouvrage est subtil, et ne propose pas une interprétation restrictivement dialectique. On ne résout pas les contradictions du haut et du bas, du creux et du plein, de l’alpha privatif et de l’oméga de la résolution. De toute façon en haut il n’y a rien, c’est tout en bas qu’est la colombe (466–467).
« The way upward and the way downward are the same », « le chemin qui monte et celui qui descend est un seul et même » : ce fragment d’Héraclite était placé en tête des Quatre quatuors de T.S. Eliot. Et eux aussi font écho à Ce qui n’a pas de nom, même si l’éblouissement final du recueil, point fixe où beauté et sagesse irradient, ressemble bien à une assomption de pure lumière sans la menace d’une chute.
- Gérard Pfister, A livre ouvert - 6 avril 2023
- Gérard Pfister, Vertiges de hautes huttes - 28 décembre 2021
- Ce qui n’a pas de nom : la chance des mots - 14 octobre 2019