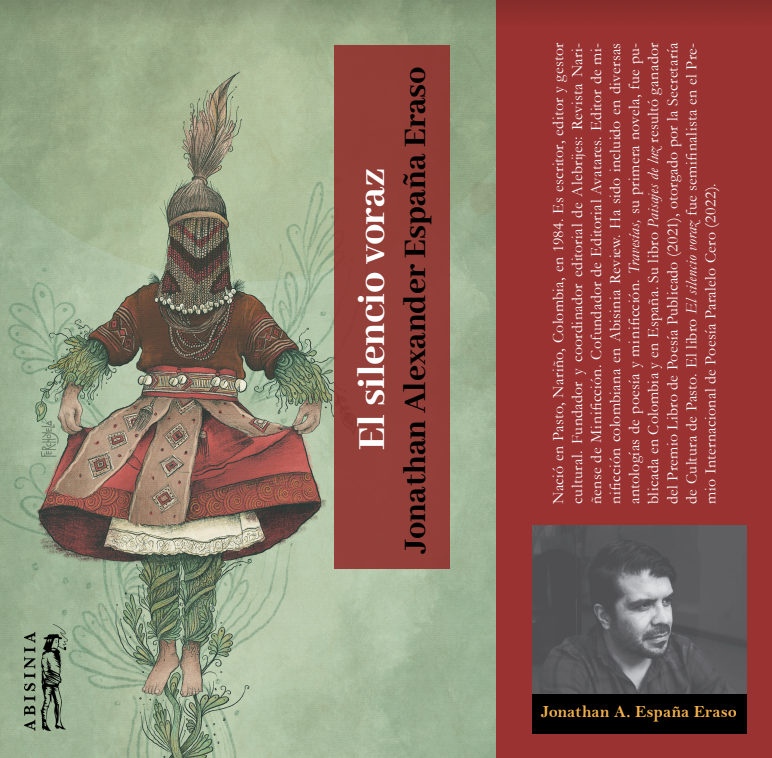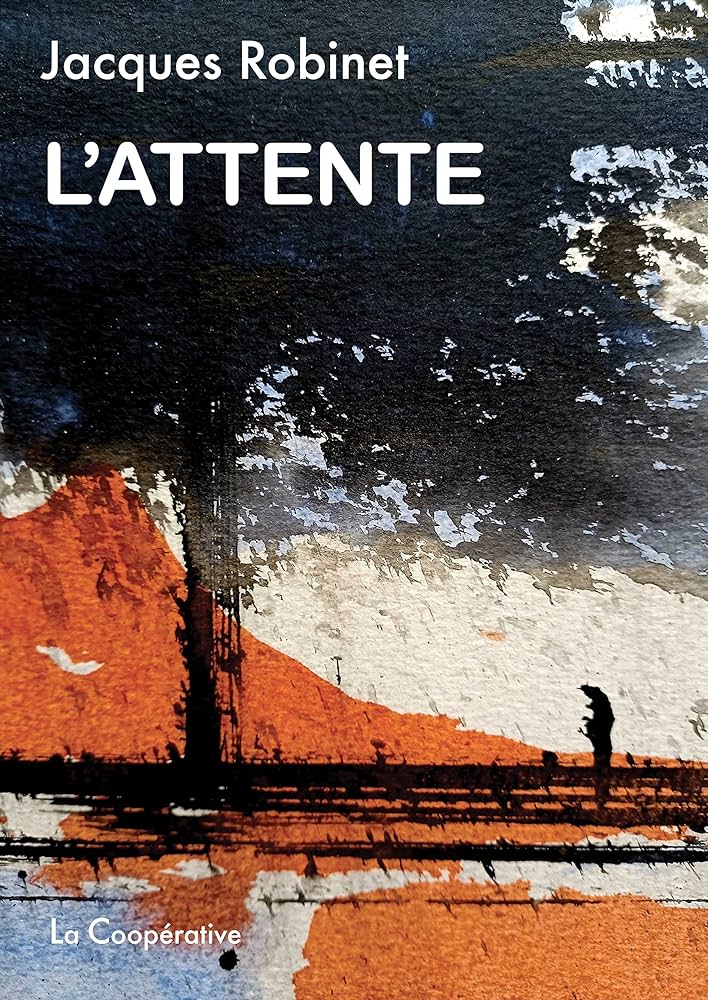À cette période de l’existence que René Char, en 1967, appelait «L’âge cassant» Jacques Ancet fait écho en 2016 par «L’âge du fragment». La chronique paraît en même temps que «Huit fois le jour», comme son autre face. Ce dernier recueil de poèmes organise une semaine sous le signe du huit au carré, de huit sections de huit poèmes, pour ainsi dire de l’infini «redressé par un fou de philosophe» (Apollinaire), et de l’éternité du langage, alors que la chronique répartit sur un certain nombre de «fragments» des éléments dont le souci n’est pas immédiatement l’organisation du chaos, toutefois pensées par la même conscience écrivante, bien sûr.
L’âge du fragment présente une succession de proses simples, d’une belle force poétique, qui donnent à méditer, me semble-t-il, sur ce moment où le regard bascule d’une vision du futur conçu comme plus vaste et prometteur que la portion de vie déjà passée, à une vision du futur assagie par son rétrécissement même et la conscience que la probabilité concernant les ans qui restent à vivre n’est pas considérable. Qu’en somme, avec le recul lié à l’âge, l’expérience d’une vie passée « la tête dans le guidon » peut se voir par fragments ressaisie et méditée, conduite jusqu’à des considérations abstraites, voire métaphysiques. Le livre est superbe en sa qualité matérielle, avec de très belles compositions « fragmentaires », en couleurs mais aussi en noir et blanc du peintre Jean Murat. Sur cette affaire du « fragment » il faudrait décidément s’appesantir… Ce qui « fragmente », à mon sens, ce sont avant tout les interrogations. Comment circonscrire, dans les souvenirs qu’il nous reste de ce que, depuis hier ou depuis cinquante ans, nous venons de vivre, ces éclats de « présent », dignes d’être dits – pour être maintenus présents justement -, ou ne méritant au contraire que l’oubli ? Comment « ne pas se perdre », « Comment dire ? Comment ne pas dire », énonce un des derniers textes.
Ce sont bien là des interrogations émouvantes que seul un poète entré dans, au mieux, disons le dernier tiers d’une vie, est amené à se poser. Ce qui est un phénomène spécifique de notre époque, car peu d’œuvres de poètes témoignent d’une phase de la vie relativement tardive : soit parce que la durée de vie pour beaucoup était tronquée de ce « grand âge », comme disait Saint-John Perse, soit parce que la « vis poetica » s’était éteinte avant même que d’y parvenir… La poésie moderne accède donc à la possibilité de témoigner de l’expérience d’une période fort peu thématisée, excepté par quelques rares « durs à cuire », comme Victor Hugo. Or, ce qu’on découvre, c’est une sorte de retour réfléchi et analytique à une vision voisine de celle de l’enfance, mais sans la naïveté et l’inconscience. En gros, j’entends que la vision de l’enfant est celle d’un être jeté dans le chaos de l’existence, et qui avec ses sens et son intelligence va travailler à l’organiser en un cosmos sensé, en mettant de côté sous la pression de l’urgence à vivre, ce qui s’opposerait à cette construction mentale, les questions vitales et déconcertantes de la philosophie, concernant la mort, l’essence de la vie, le réel et le fictif, la valeur de l’action, et ainsi de suite. Avec le seuil du « tiers âge », ces questions reviennent comme des torpilles dans le cosmos confortable, unifié, sensé, qu’on s’était bâti au prix de les éviter, à force de travail urgent, de soucis familiaux, de distractions diverses, sport, cinéma, etc. C’était une période où l’adjuvant « poésie » pour un poète se donnait volontiers, liant les jours la voix était là en permanence, et ne s’interrogeait pas sur sa nature, sa source ou sa présence.
Or à l’âge du fragment cette belle continuité vole en éclats, la coulée poétique devient spasmodique car elle se retourne sur elle-même : pourquoi écrire des poèmes, de quelle nature est la voix qui les prenait en charge. Bref, une quantité de questions existentielles ressurgissent, mises de côté depuis l’enfance, qui concernent le « sens » : « Qui te fait signe – une aile passe – et pour dire quoi ? ». C’est le temps où à la fois « tout s’approche et tout se retire », en un mouvement accéléré : « Le jour, la nuit, la vie. Vite. Vite. » Il y a un je-ne-sais-quoi de désemparé dans cette chronique émouvante, dont je citerai le dernier texte, parfaitement représentatif : « Tout près est à présent. On cherche une main. On croit l’avoir vue, mais où ? Et maintenant comment savoir ? Et la voix, que peut-elle dire encore ? Montagne ? Lumière ? Camion ? Visage ? Quelque chose d’autre ? Rien ? On ne sait pas. La voix n’est plus la voix. » Moment pathétique, auquel le poète a répondu par anticipation, quelques pages plus tôt : « Continue, répète la voix, mais si loin maintenant que tu l’entends à peine. »
Et comme pour affirmer, on pourrait dire avec un certain héroïsme, qu’il continue, le poète Ancet organise concomitamment et publie une image cubique et inépuisable de son cosmos, sous le titre « Huit fois le jour ». Quelque chose d’unifié, d’infini, une durée close sur elle-même comme un « cosmos privé » que rien ne pourrait atteindre, et qui est la quintessence de tout ce que Jacques Ancet a su être et voulu léguer. Il y a là une haute voix de la poésie lyrique. Je suis honoré de pouvoir ici la saluer.