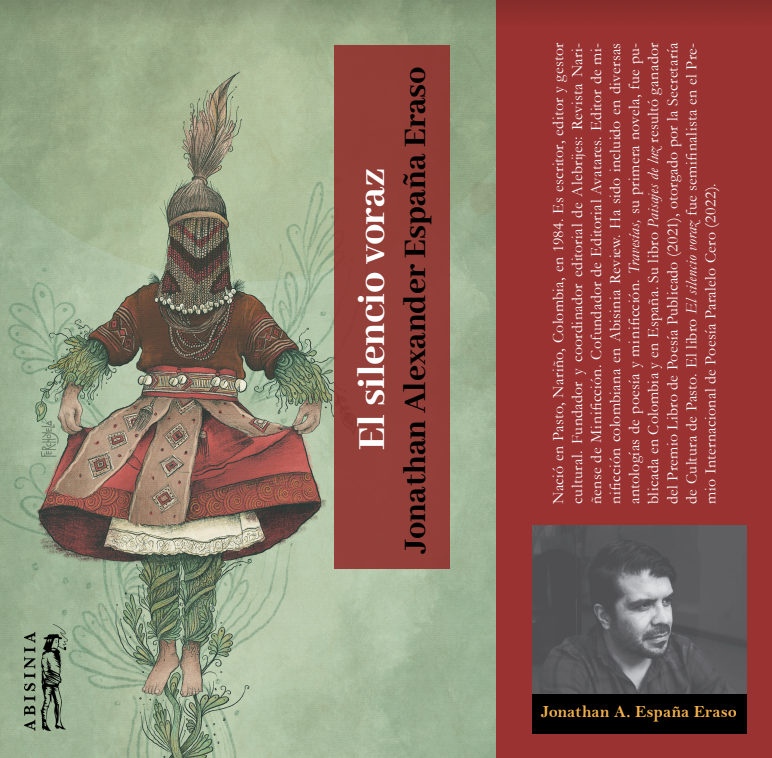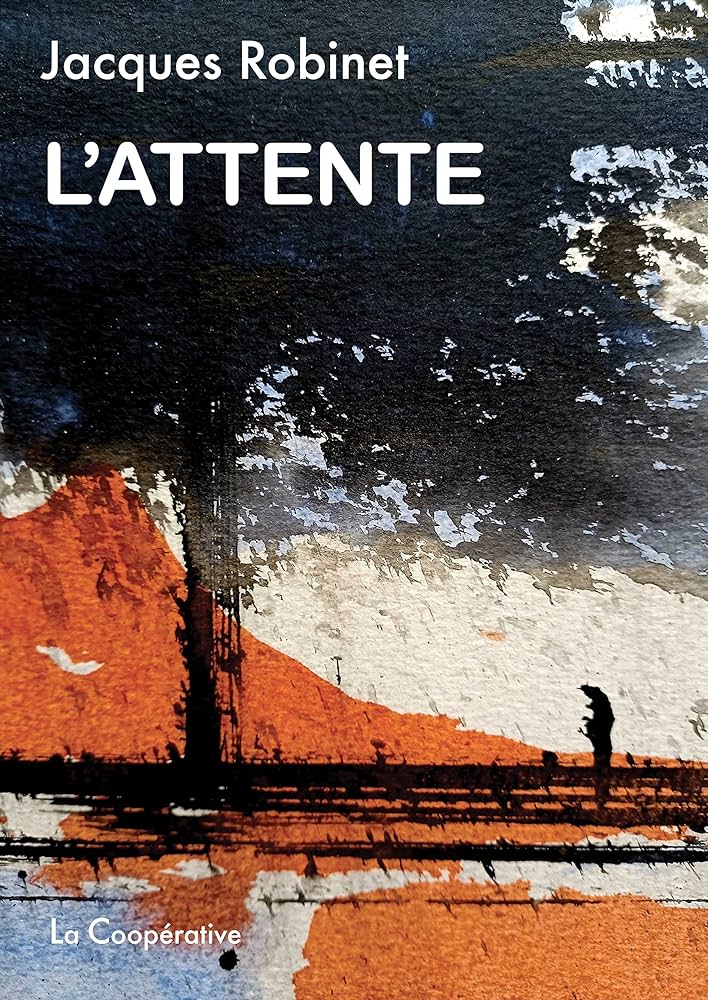Canto rodado veut dire « galet ». Un canto c’est un chant, et aussi un caillou. Rodado : il a été roulé, charrié dans les eaux vives et ne doit sa douceur qu’à des chocs répétés que le tumulte et l’écume ont maintenu invisibles et inaudibles.
Elle a l’air douce la poésie de José Bergamín, ses aspérités ne se voient pas :
Tengo miedo al silencio
y temo las palabras
que al decirlo lo esconden
como si lo callaran.
Me da miedo esa hora
silenciosa del alma
en que todo se hunde
porque todo se calla.
José Bergamín, La claridad desierta, p.67
Ce qui donne en français : J’ai peur du silence, et je crains les phrases qui pour le dire l’étouffent comme si elles le taisaient. Cette heure me fait peur, cette heure silencieuse de l’âme dans quoi tout s’abîme parce que tout se tait.
Les essais de José Bergamín sont déjà familiers au public français grâce aux traductions de Florence Delay et d’Yves Roullière. La personnalité littéraire, politique et religieuse de cet auteur est excellemment évoquée dans les actes du colloque tenu à Nanterre en 2008, volume qui contient en outre les entretiens qu’André Camp avait menés avec Bergamín pour France culture en 1965.
Mais l’œuvre poétique, dont Turner a publié les sept volumes, n’a pas fait à ce jour l’objet de publications substantielles dans notre langue. Yves Roullière, que j’avais contacté en commençant à travailler sur ce dossier, restait d’ailleurs très dubitatif sur la possibilité de bien la rendre en français. Il s’en dégage pourtant une impression de facilité : le vocabulaire et la syntaxe sont d’une rare simplicité. Quant aux sujets, aux motifs : du début à la fin, il semble que ce soient les mêmes. Cette sorte d’ascèse verbale le distingue des autres poètes de la génération de 27. Pas de références d’histoire ni de variété de paysages, seulement des détails, des instants… N’allons pas pour autant croire à une dilatation des petits riens. Pour la forme on serait proche de Guillevic et pour l’esprit dans la posture de Ponge. Mais en disant cela je ne dis rien, je pose des panneaux indicateurs.
Les mêmes mots reviennent d’un vers à l’autre et d’un poème à l’autre comme des échos. Bien qu’ils soient banals : âme, flamme, cœur, main, vie, taire, répondre… il faut y voir la première difficulté qui s’oppose à la traduction du fait de leur forte extension sémantique dans les deux langues, extensions qui ne coïncident pas souvent.
Pour autant, Jeanne Marie n’a pas été découragée, elle assure avoir traduit en toute modestie. Je sens une justesse dans ses choix, je voudrais que l’on soit sensible à la générosité de sa démarche.
Dans ses essais, comme l’écrit Yves Roullière, Bergamín procède « par de perpétuels coq à l’âne, idéations, calembours, contrepieds, cela même qu’il théorisa (…) sous le terme de disparates ». Sa poésie, par contre, avance d’un pas court, revient un peu en arrière, va de côté mais sans perdre son chemin initial. C’est rassurant, musical et, si l’on tient compte des répétitions dont je parlais plus haut, très vite vertigineux.
Chemin discret. Peut-être une parole qui craint de faire fuir quelque chose, de voiler par une trop forte affirmation le véritable propos. Et en même temps l’énoncé, net, sans hésitation, a la simplicité tranchante du proverbe. Ce sont des poèmes qui n’occupent pas beaucoup de place sur une page, mais en même temps le blanc qui les entoure n’a rien d’orgueilleux. Au bord du silence, mais — le paradoxe de la première strophe du poème en exergue, sans doute — on n’est jamais certain qu’il s’agisse d’une disparition ou d’une apparition.
Elle se tient là, la poésie de Jose Bergamín. Moins soucieuse de déclarer que de placer la parole au plus juste. Une justesse mobile, ductile, qui requiert une grande économie de moyens rhétoriques, une poétique sobre qui se frotte au soleil, à l’abîme, comme dans ses meilleures après-midi l’art de combattre les taureaux. Ah ! le « toreo » ! auquel il a consacré des écrits capitaux : « … le torero trouve son rythme, sa pause et sa mesure de façon magique, comme le poète et le prosateur lorsqu’ils écrivent » (in « Le toreo, question palpitante », traduit par Yves Roullière, Les fondeurs de briques, 2012, p.154) .
Bergamín parle quelque part de la similitude des passes de la tauromachie. Leur côté répétitif ne le gênait pas. On pourrait, sans en dire du mal, qualifier ses poèmes de rengaines. J’ai fait lire à mon ami Xavier Garcia-Larrache un poème que je ne connaissais qu’en lecture silencieuse ; il a tout de suite placé les accents, les syncopes, les reprises de souffle, les a incarnés puis a dit naturellement reconnaître l’inspiration populaire des coplas, ces airs andalous qui ont forgé la langue de Bergamín. Sans partition, ses vers en apparence si peu expressifs chantent dès qu’un naturel les déclame. C’est ce qui fait que leur côté répétitif n’est jamais lassant.
Ce retour du même est moins obsessionnel qu’excavateur. Le retour et le retournement des mêmes expressions, leur remise sur le métier, loin de finir en épure, ont su, comme c’est le cas pour les saintes Écritures, conserver dans ces vers d’apparence très calmes toute la tension de la vie humaine, de sa raison et de ses passions. Chez Bergamín, la langue est taillée facette après facette comme elle l’a été par ces siècles d’exégèse et de répétition qui ont conduit à la perfection lyrique de la liturgie catholique.
Bergamín ne construit pas un style personnel, son écriture est comme une œuvre collective (mais tendue) que le mot de tradition résumerait un peu vite. Il a commencé à publier de la poésie alors que ses essais lui assuraient déjà beaucoup de reconnaissance (et d’ennuis), à l’âge où on se fiche d’être singulier et où le dire se veut simple célébration… je n’aurais pas le culot de (faire) croire que je sais de quoi !