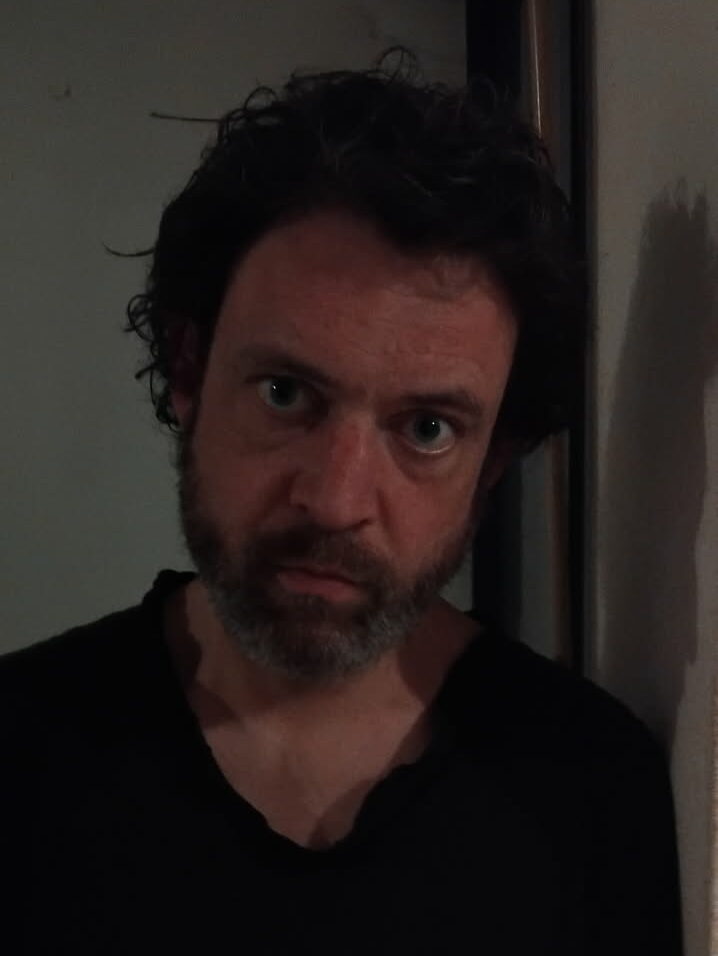Poèmes traduits par Jean Migrenne
Huit heures du matin.
La vieille au bout du couloir
passe du Fairouz.
Il pleut en gris sur nos toits en pente.
Beyrouth est sous les tempêtes de sable.
L’ivrogne supplie
la jolie fille de sa voisine
de ne pas l’oublier
dans les paroles de la vieille vedette.
Dans le couloir, le chant se dévide.
*
Couloir aux portes fermées
à clef sur des possibles,
miroirs déformants,
face à grotesque face.
Retour à des frontières
closes de barbelés.
À la langue de mon grand-père et
celle que j’écoute,
à leurs invectives, leur mutuelle
incompréhension. Glaces, portes.
*
La glace au matin
donne sur la pluie —
début octobre
comme en hiver dans cette ville.
À écrire, en pyjama,
désolée devant toi-même,
dictionnaire ouvert
sur de vains désirs,
tu poses un mot, fermes les yeux,
entends des pas, de moins en moins.
*
De moins en moins de jour —
encore nuit à six heures, à la demie,
derrière les rideaux de tulle beige.
Le café est éclairé
comme cinq heures plus tôt.
Demi-heure de lecture
au lit, ou prendre un pull,
se faire un bain moussant,
avant le café, les journaux qui voient
les jours en noir, de plus en plus.
*
Des femmes de plus en plus vieilles,
toutes, c’est ce que voit mon ami chauve,
qu’elles aient son âge ou plus,
qu’elles écrivent, enseignent : ses collègues.
« Elle a au moins quatre-vingts ans. »
« Non, soixante-huit,
ça change quelque chose ? »
« Non, pas soixante,
cinquante-quatre, comme toi. »
(Il vit avec une de vingt-deux.)
*
Deux sous-titres sur l’écran,
anglais et français. Les acteurs
jouent en arabe
le sac d’Ur : scribes, tablettes,
martyre du savant
qui les déchiffrait, les traduisait.
Rasha connaît la moitié d’entre eux,
revient à la réalité, à la vie
de gongs, de lamentations,
de résurrection d’un verbe assassiné.
*
Résurrection du jour —
fins d’après-midi de juillet
en promenades à reconsidérer
l’inachevé, le non commencé,
aller jusqu’au canal.
Encore trois heures de jour :
de quoi commencer ; de quoi terminer…
C’était avant ; maintenant il fait nuit
avant sept heures et les après-
midi fondent au noir.
*
Après-midi d’automne,
pour descendre à la Mairie porter
un sac de serviettes,
de T‑shirts, trois sacs à dos,
à la collecte des réfugiés.
Des cachemires de deux ans, on
n’offre pas ça à des amis.
Au café, ils ne veulent pas
que tu paies l’addition, que tu leur dises :
«On se voit l’année prochaine, à Damas… »
*
À ce moment-ci de l’année,
c’est la rentrée, nouveaux
étudiants, nouveaux profs, épreuves
à relire pour les parutions de printemps,
numéro d’automne tout frais à poster.
Moi, émigrée,
je pointe les saisons sans
permis de travail. Me revoici
étudiante, à traduire en triangle,
toujours nouvelle.
*
Nouvelle un jour,
absente aujourd’hui.
Je me ferai à la quinzaine d’années
de repas partagés, à son esprit
éteint à quatre-vingt-dix ans ;
amours de ma vie qui
ont changé d’avis, différentes
maintenant, amours mortes…
yeux noisette ou verts d’hier,
avenir d’hier aujourd’hui passé.
*
Aujourd’hui figues en salade
en émincé, figues au labneh,
figues vertes d’Italie,
et figues de Provence bleu-foncé
achetées à l’étal des trois frères.
Souvenir de branches
de figuier par-dessus des murs
de pierre, ou du temps
où par l’échelle on grimpait sur le toit
cueillir les figues tardives de Vence.
*
Septembre à Vence :
sur la terrasse avec Marie
à écouter le torrent
murmurer son prélude et fugue
à nos lapidaires petits déjeuners —
café, pain, confiture.
Elle avait cinquante-neuf ans.
J’en avais trente-sept.
Quasiment le même âge pour
passer à notre journée de travail.
*
Le sonnet passe
de l’affirmation à l’interrogation,
du panorama au gros plan,
La consultation chez le médecin,
passe de la corvée au verdict.
Le bébé passe sa première semaine
protégé par son berceau de bois,
sur un tapis kurde tissé
d’une plume de cigogne qui lui dévide
sa lointaine berceuse tout le matin.