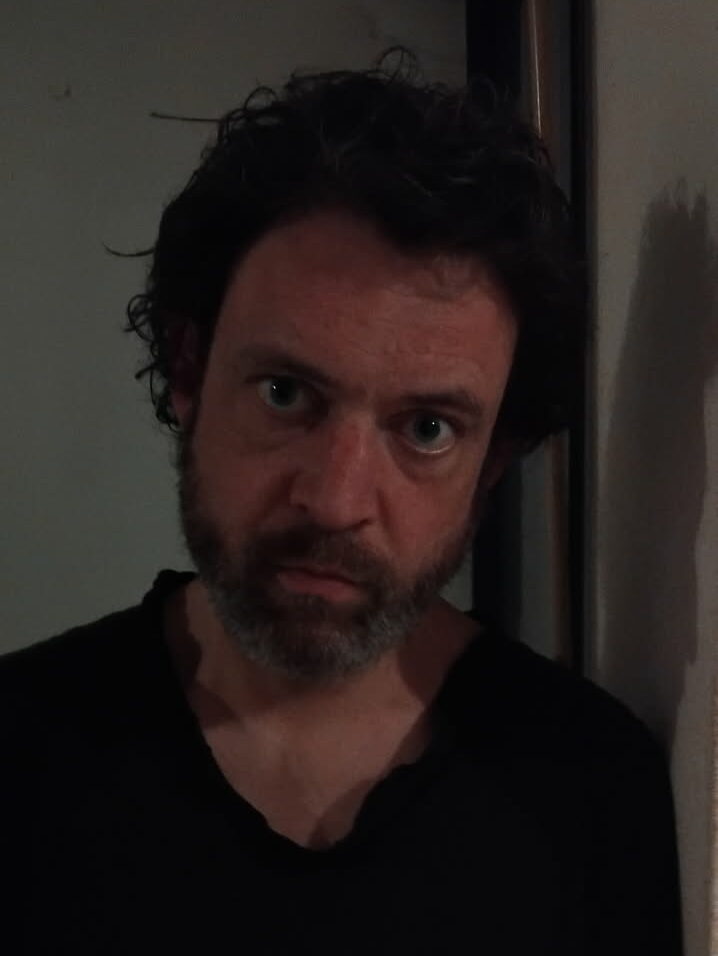Traduction de Stéphane Lambion
Canto I
Il y aura des hommes et ils pousseront le monde plus loin.
Aujourd’hui, il est déjà tard, on construit un commissariat de police en Lego
et on regarde Cars.
Aujourd’hui, le monde ne mérite pas qu’on le pousse plus loin que ça.
Aujourd’hui, je n’ai pas vu le soleil se débattre, tétanisé,
dans le ciel. On dirait presque qu’il n’a pas existé.
Aujourd’hui, Dieu n’a plus été le concept à l’aune duquel
nous mesurons notre douleur, comme le chante John.
Peut-être qu’il avait mesuré les convulsions et la torture du soleil,
je ne sais pas. Pour nous, seule a existé
la lente construction du commissariat de police
et, au-dessus, aucun soleil qui nous empêche d’en venir
à bout.
Nous avons besoin d’un soleil Lego qui brille sans alternative
au-dessus d’un néant Lego. De jeunes paysans Lego
d’une Galilée Lego
prenant sur eux tous les péchés et les déjections Lego.
Nous avons besoin d’enfants Lego qui chanteraient :
« à l’ombre de la croix Lego nous étions assis et nous pleurions ».
D’un John Lennon Lego qui chanterait sur
des dieux, des concepts et des douleurs Lego.
Alors seulement, le soleil se débattra dans
d’heureuses convulsions. Alors seulement, le monde méritera
qu’on le pousse plus loin.
Aujourd’hui, il est déjà tard, on construit un commissariat de police en Lego
et on regarde Cars. Le lait
se réchauffe lentement dans la tasse blanche en métal.
Rien, et c’est le moins qu’on puisse dire – vraiment rien
ne peut nous pousser plus loin.
Canto XXVI
Papa, tu m’as trop parlé,
ça suffit, à partir de maintenant c’est moi qui vais te parler.
Pas en rêve, mais pour de vrai.
Et je te le dis franchement, d’entrée de jeu :
peu importe combien j’aime ton suicide,
je ne me suiciderai pas.
Peu importe combien la mort est technicolore,
peu importe comme nous serions beaux tous les deux
dans le film de nos suicides, réalisé
par le diable en personne, peu importe combien
de poésie à l’état pur on trouve dans les manuels de suicidologie –
je ne me suiciderai pas.
Moi aussi, avec une lame, je me suis entaillé les bras,
j’y ai plus de cicatrices
que de photos avec nous deux, ou juste avec toi.
J’ai bu de l’alcool méthylique à la bouteille,
dans l’espoir, terrifié, de mourir pour de bon,
de ne pas me réveiller aveugle le lendemain.
Tu penses que je ne sais pas avec quelle douceur
la lame s’enfonce dans la chair
de l’avant-bras, descendant toujours plus profond
dans les rainures juteuses de sang
par lesquelles passera, éclaboussant tout autour de lui,
le char de Dieu aux roues dorées ?
Tu crois que je ne vois pas comme les cicatrices deviennent
lumineuses telles des enfants gâtés
lorsque je pense à toi ?
J’ai été jaloux – je suis encore jaloux à en crever –
des morts si profondément enfoncés dans leur tranquillité,
car ils sont des roses se humant elles-mêmes.
Mais, papa, les roses sont sans pourquoi,
elles fleurissent comme les hommes se suicident.
Elles n’ont pas le choix. Tout comme moi :
Après avoir tranché le fil qui t’entourait le cou,
tu n’avais pas d’autre regard à soutenir que le mien.
Moi je dois soutenir le regard de Sebastian.
Et maintenant, seul au milieu de tes roses,
tu n’as pas d’autre regard à soutenir que celui de Dieu.
Tandis que moi je dois soutenir le regard de Sebastian.
Alors, comprends et pardonne, papa –
je ne me suiciderai pas.
(Et en fait, c’est ça le suicide.)
Canto XXXVIII
Cette nuit d’il y a sept-huit ans
quand tu te promenais dans Cisnădie,
après deux ou trois jours de beuverie
suicidaire – zapoi, comme disent les Russes –
et que, sur la place centrale, en face de la mairie,
tu t’es approché du chien qui te regardait
avec les yeux de papa, que tu t’es agenouillé près de lui,
que tu as pris sa tête dans le creux de tes mains et que tu l’as embrassé sur les yeux,
lui, il est resté figé, d’effroi ou de surprise
ou parce qu’il savait, et vous êtes restés comme ça un temps indéfini
sous la pluie qui tombait comme tombent toutes les pluies
sur les hommes et les chiens qui fraternisent –
c’est-à-dire imbibée jusque dans chaque goutte
d’une insolence typiquement et profondément humaine.
Canto XL
Je l’avais oubliée, celle-là, pour de bon : je vois
la photo de Cisnădie avec le mûrier en noir et blanc
derrière la maison de grand-mère et mon ventre
se colle à ma colonne vertébrale –
là-bas, on avait notre maison en haut du
mûrier, construite par le cousin Claudia,
de qui j’étais très amoureux.
J’avais l’impression qu’on restait là-bas des
semaines entières, à regarder les rats grouil-
lant sur le bitume du toit
et à nous remplir l’espace entre le ventre,
la colonne vertébrale et l’âme avec des mûres noires.
En dessous de nous il y avait le jardin, à des kilomètres
de nos âmes pleines de
mûres noires. On y descendait de temps en temps
comme Dieu descend quelquefois
sur le monde, cléments et
impitoyables. On enflammait tout
avec nos épiphanies
jusqu’à ce que, comme des bulles d’eau minérale,
se lèvent des halos au-dessus des rangées
de persil, de céleri et de carottes.
Puis s’élevaient sous les halos les anges
du persil, les anges du céleri et les anges
de la carotte
et ils nous chantaient des hymnes de gloire jusqu’à ce
que le sol fasse ploc-ploc de plaisir sous
nos pas.
Ils chantaient jusqu’à ce que le monde devienne
paradisiaque et instrumental,
comme un objet dont Dieu
se servirait en permanence.
On officiait sous le cocon de buissons de mûres américaines
et l’air était fait d’immenses blocs d’amour
qui se renversaient toujours et écrasaient toujours
quelque chose sous eux et
riaient toujours.
Nous grimpions à nouveau dans la maison
en haut du mûrier, étincelants et avec nos globules
aussi gros que des reins de porc. Grand-père mourrait
depuis plusieurs années dans la maison en dessous de nous,
le cerveau broyé. Et nous, on écrabouillait,
heureux, les mûres, tout comme la lumière
écrabouillait, heureuse, nos cerveaux. Plusieurs années plus
tard, les blocs d’amour devaient se
renverser sur moi et sur papa et nous
écraser et rire de nos cerveaux
broyés comme celui de grand-père.
Cela, je pense que je le savais déjà. Les taches
noires des mûres partent très difficilement
au lavage.
- Plantations – Constant Tonegaru - 1 mars 2022
- Gérard Bayo, Et si mal regardée - 4 mai 2019
- Radu Vancu, Poèmes - 5 octobre 2018