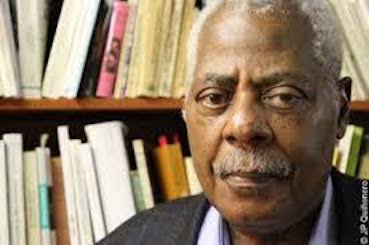Certes, je savais qu’il était un des premiers poètes et romanciers de langue française en Haïti : l’ultime lecture enthousiaste de Malraux, sur son lit de mort, avait été « Au piripite chantant », son premier recueil dont l’ample parole bousculait une poésie hexagonale asphyxiée à l’époque par ses prétentieux laboratoires. Certes, depuis 2005, il assistait aux déjeuners parisiens du Journal des Poètes.
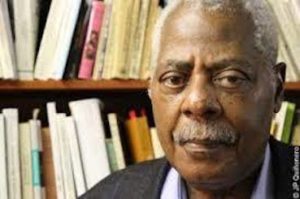
Malgré tout cela, Jean Metellus restait une figure respectée mais lointaine. Jusqu’au moment où, en 2009, au Comité des Biennales de poésie, nous pensâmes à une double présidence symbolique : un poète qui aurait représenté le pays le plus riche du monde et un autre qui aurait été l’emblème du plus pauvre de la planète. D’un côté, Jimmy Carter ; de l’autre, Jean Metellus. On aurait ainsi montré que la poésie appartenait à tous, qu’elle était à la fois la force et la fragilité de l’homme. Souffrant à l’époque et éloigné dans l’espace, Carter, très gentiment, renonça à nous rejoindre. Jean, qui vivait depuis longtemps à Paris, accepta tout de suite.
Ce qui, durant sa présidence, frappa chacun fut une double et rare qualité : une humilité discrète confinant à la timidité et une extraordinaire attention à tous, pénétrée de la conscience du rôle à jouer. Metellus assistait à toutes les manifestations. Quasi vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Sa haute silhouette de grand mammifère farouche, son regard ultra-attentif, sa bienveillance, la sûreté et l’économie de ses propos, tout cela en fit un président idéal, humble devant la poésie. Homme de contact mais d’une grande réserve pudique et dont même les silences parlaient.
A partir de là, nous partageâmes une amitié solide et fidèle. Il m’envoya ses travaux, jusqu’à son dernier livre, « Empreintes » dans lequel cet homme de la terre et des éléments chante l’ivresse vitale, faisant une dernière nique à une mort que, sans doute, il sentait venir. Tel Néruda, le poète vieillissant évoquait dans la jubilation ces « Odes élémentaires » qui, toujours, dans un langage bien à lui, le nourrissaient de leur sève.
Fin juin 2013, il fit l’effort de participer avec la fidèle Anne-Marie au déjeuner parisien du Journal des Poètes. Ses yeux fiévreux, son amaigrissement inquiétant en faisaient une manière de long papillon de nuit qu’on aurait surpris en allumant brutalement une ampoule dans le grenier où il rêvait .

Mémorial, par Josué Azor.
Jean n’est plus. A son propos, on pourrait évoquer ce qu’Andrée Chédid, autre grande et belle figure des Biennales, disait de Guillevic : « Chez lui, on aime et admire autant l’homme que l’œuvre ».
Il n’est pas fréquent, dans un monde poétique qui se refroidit, de croiser un tel porteur de feu. Et le chagrin de l’avoir perdu ne sera pas mince, car tout, chez ce grand poète, était intense et vrai.
- UNE RENCONTRE TARDIVE ET INTENSE - 5 juillet 2018