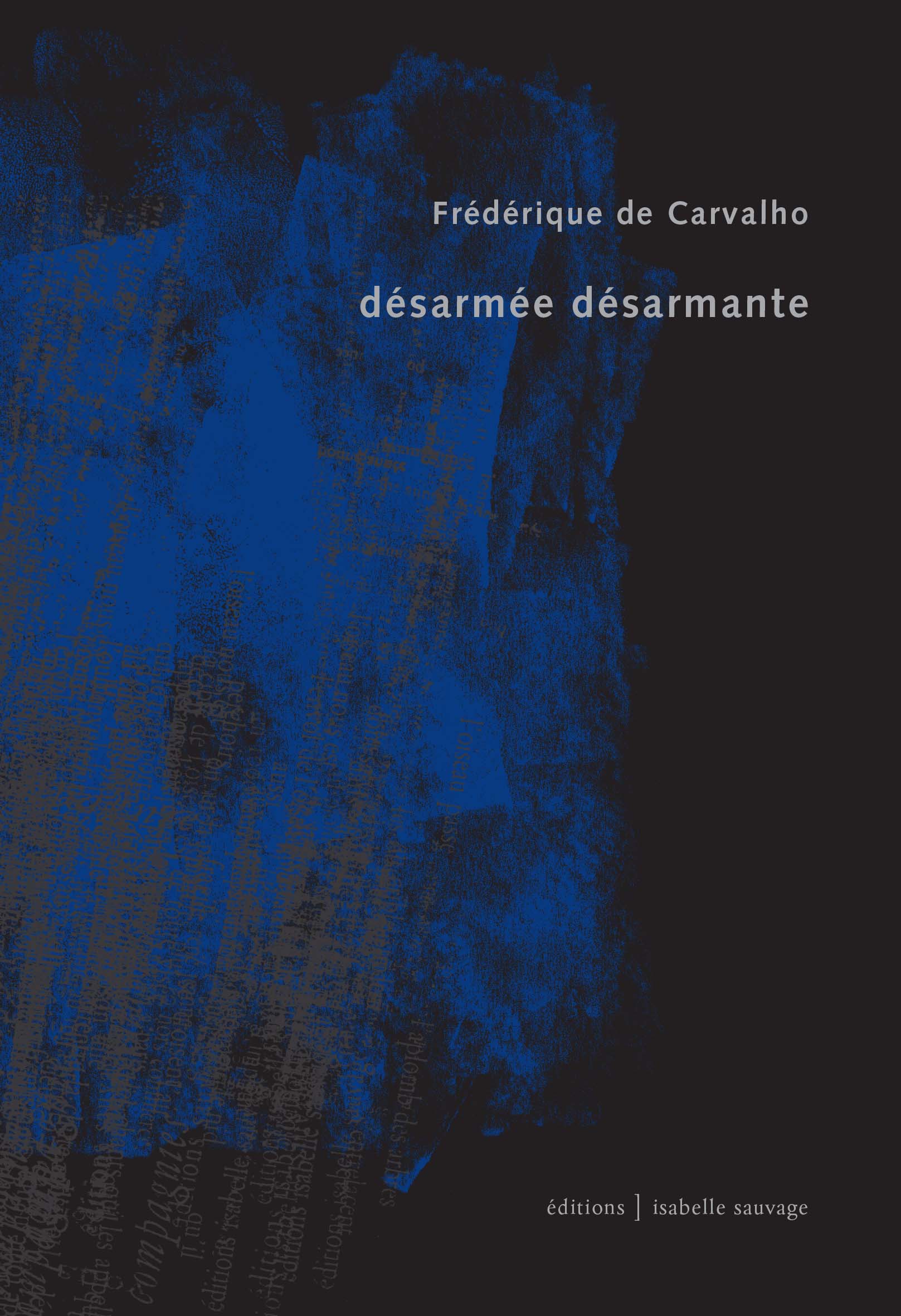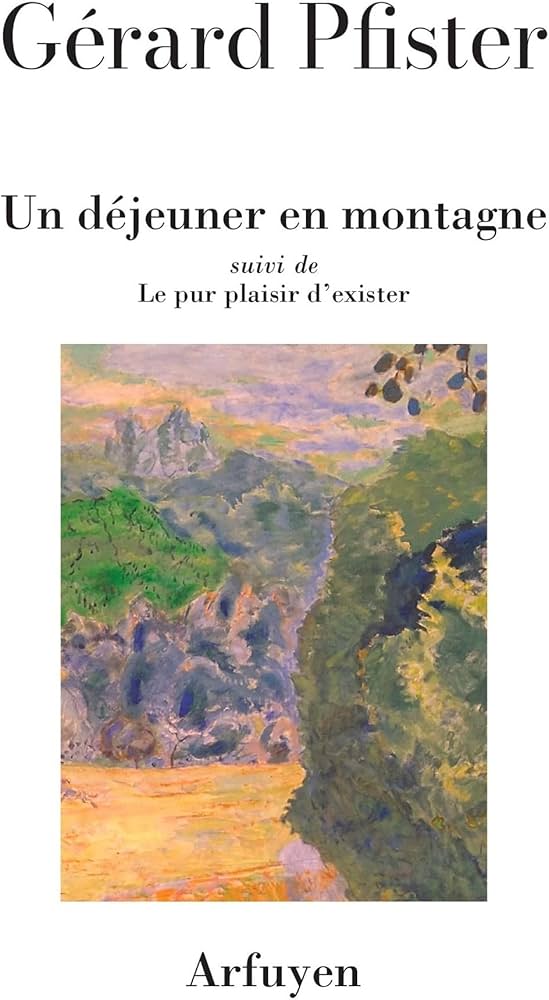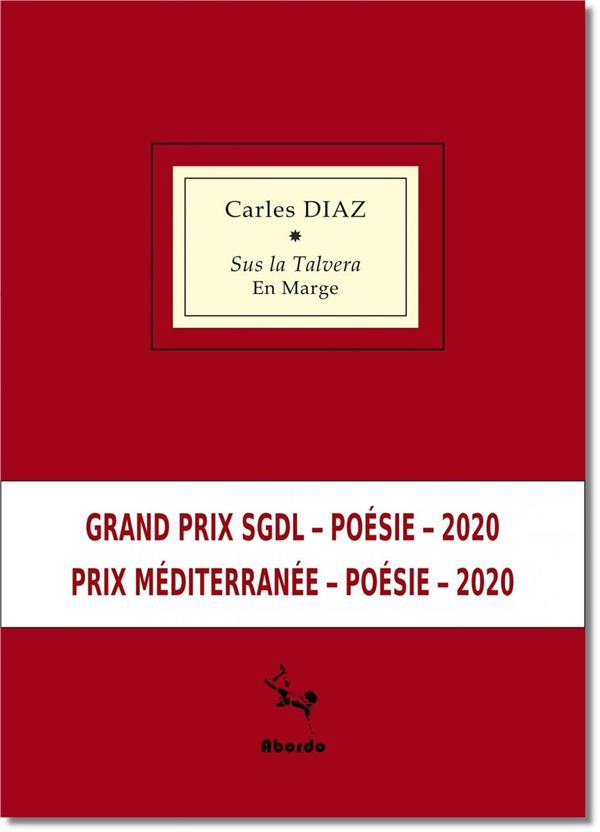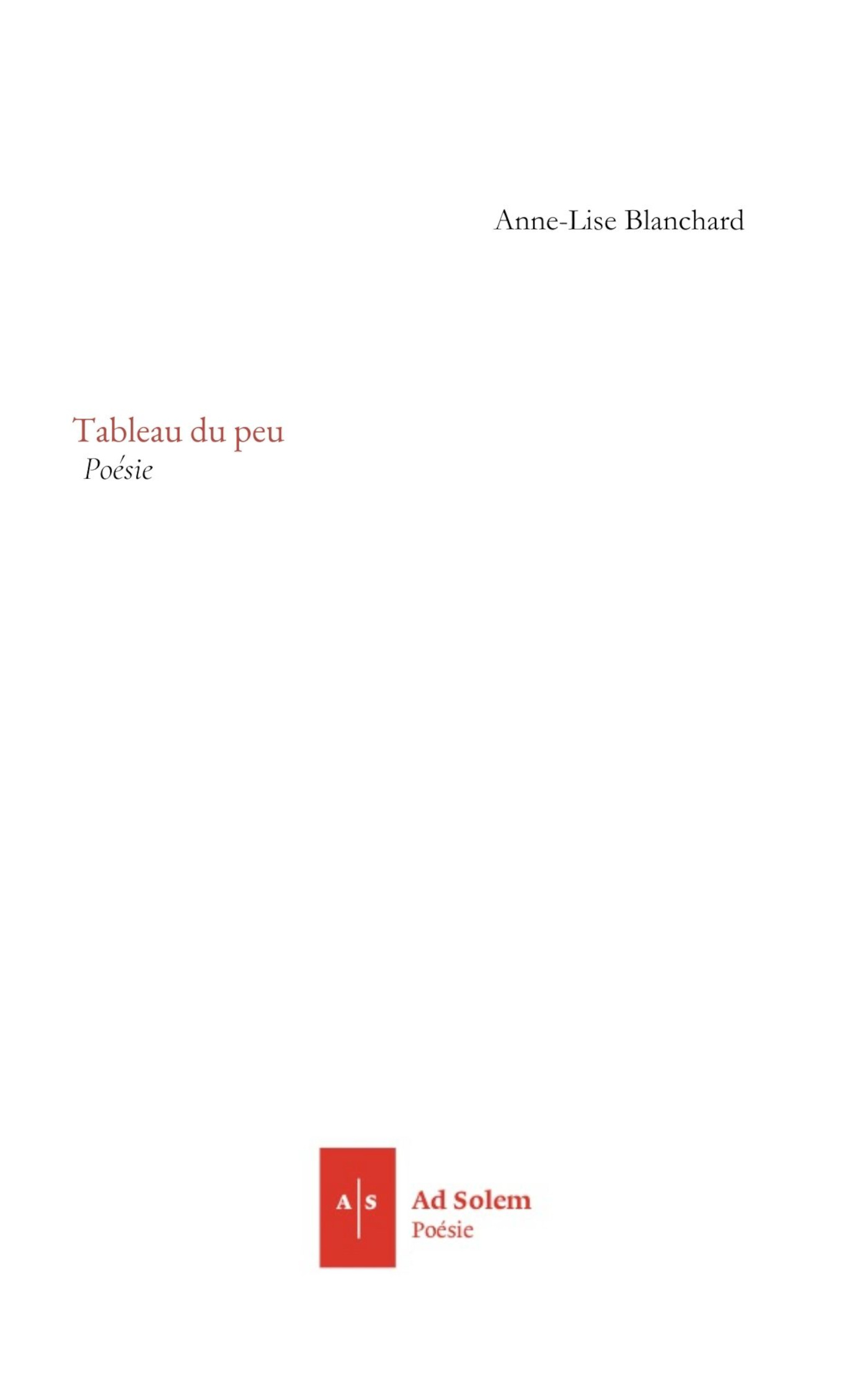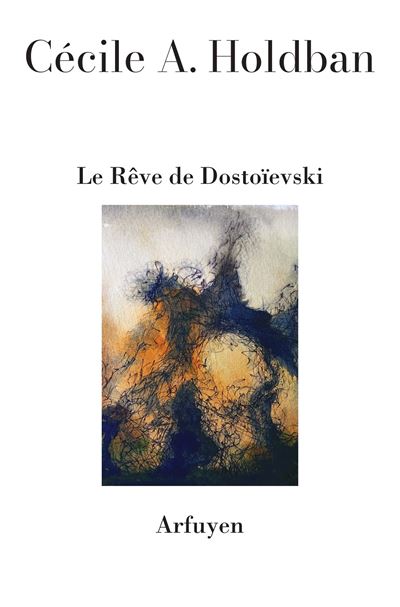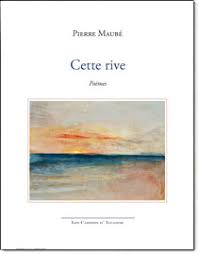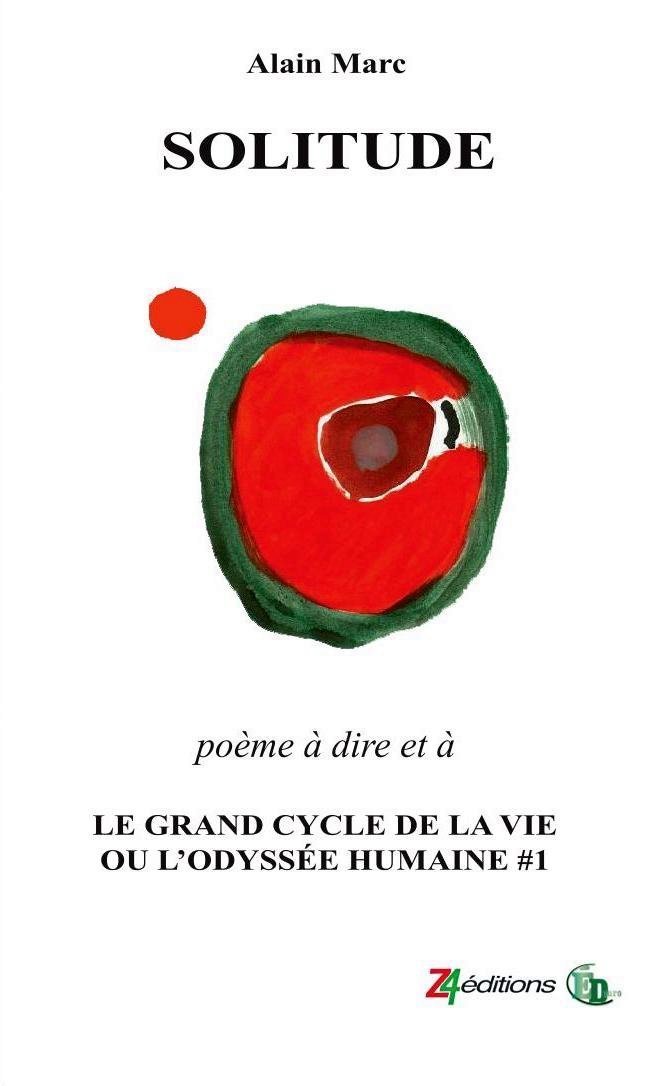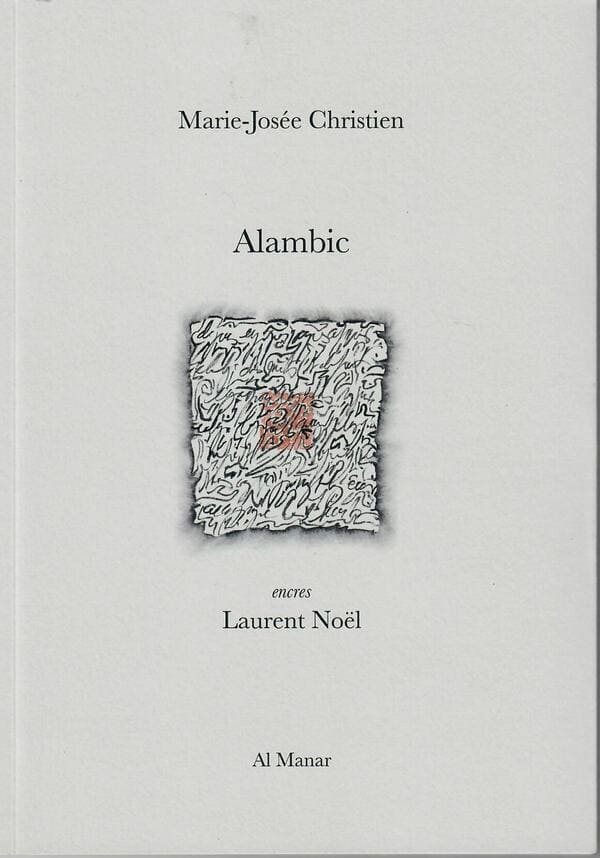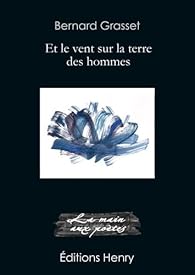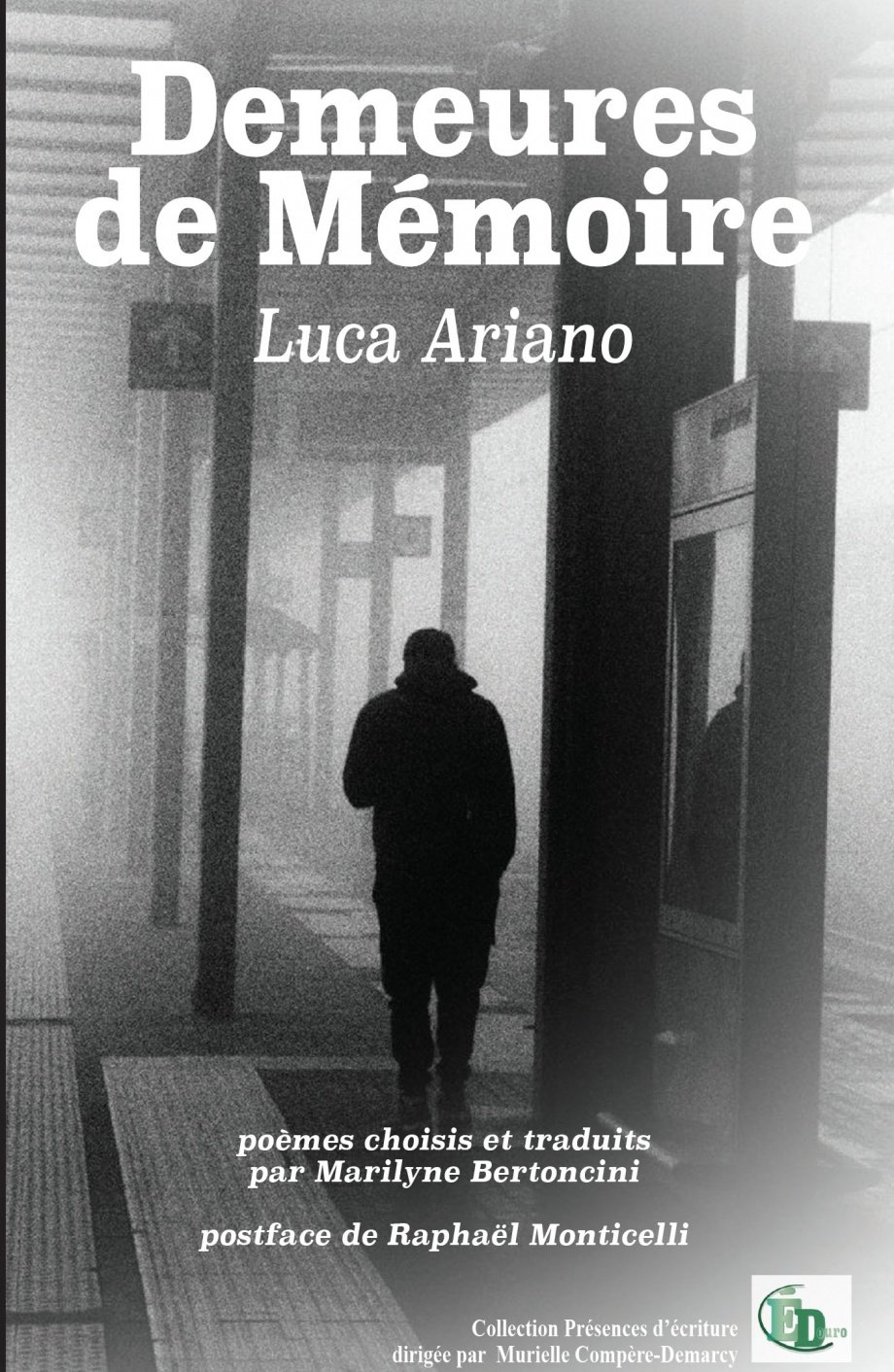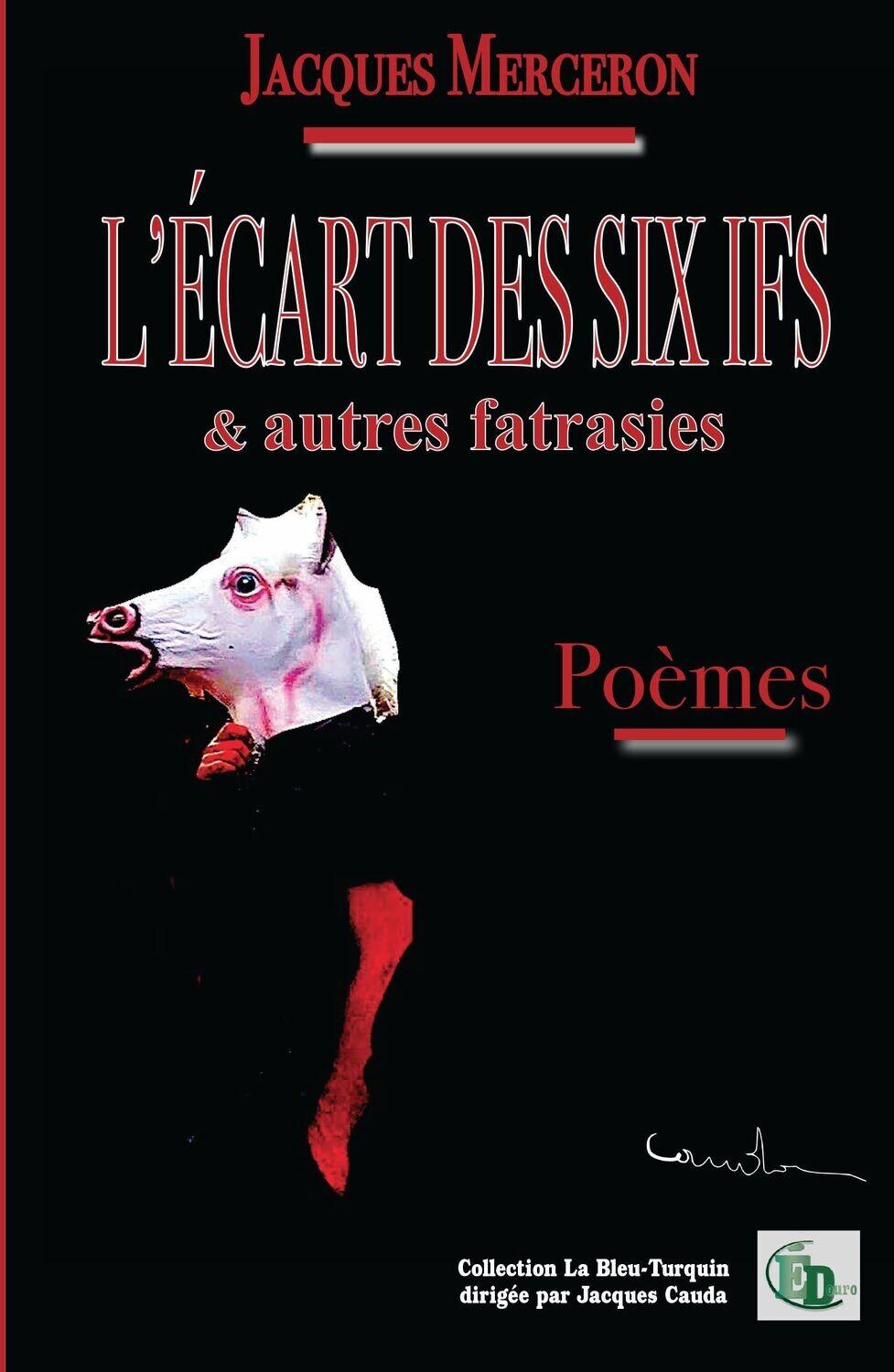Avec ses deux dédicaces, sa petite préface et les quelques notes qui suivent cette longue suite de poèmes, déjà on pénètre dans l’énergie qui propulse toute l’œuvre de Valéry Rouzeau : une générosité, une bonté, une gratitude qui vont dans tous les sens, et ceci malgré fatigue, perte, anxiété, doute.
Il s’agit d’une force résiduelle, résolue et déterminante qui excède tous les critères strictement esthétiques comme tous les jugements ou théories socio-politiques ou philosophiques. Si elle peut parler d’un ‘esprit d’enfance’ où puiser, se régénérer, si elle rêve d’un ‘roman en vers’ à la Queneau, mais, ajoute-t-elle, ‘façon puzzle’ (12) et si elle parle d’une dette au ‘nonsense’ de Lear et Carroll et d’autres encore (12), ce serait, me semble-t-il, et toujours, la force de ‘l’amour et [d’un] humour’ (12) portant la signature très particulière de Rouzeau qui dominerait, et ceci sans présomption, sans dérision, sans ce soubassement de haute mais prétentieuse ambition littéraire qui peut pervertir, miner l’essentiel d’une vie humaine. Partout, une espèce de minimum suffit pour parer les insuffisances de nos catégorisations, nos scisssions, nos mathématisations. Partout un refus de tout chronologiser, situer historiquement. Une petite trace anecdotique ou fantaisie remplace le grand événement, en assume la pertinence, fait basculer nos façons de mesurer, juger le poids des choses qui sont, des instants qui constituent une existence. La forme poétique ne choisit pas non plus le grandiose, la fioriture, l’effet visuel, se contentant d’inversions, de petits liens qui étonnent, de sautillements, de délicats jonglages, de compactages, de brefs rassemblements de quelques flashes, quelques éclats d’esprit qui exigent qu’on prenne garde au ‘vide / Entre le quai et le marchepied please mind the gap’ – celui qui surgit entre signe A et signe B.
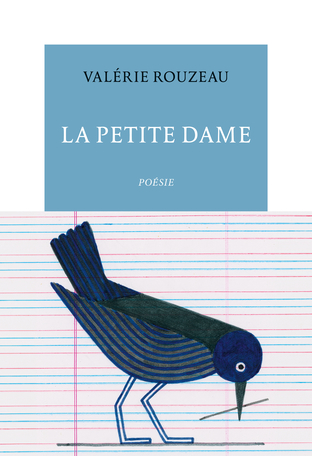
Valérie Rouzeau. La Petite dame, La Table Ronde, 2025. 101 pages. 15 euros.
Le poème rouzaldien s’inspire spontanément de presque n’importe quoi, des banalités du quotidien, banalités qui inexistent, bien sûr, des instants-phénomènes qui ne font qu’attendre un geste, une geste, puisant dans ce qui s’oublie si facilement : le fonctionnement d’un esprit prêt à jongler, jouer, avec tout ce qui reste finalement tout à fait extraordinaire au sein des choses et des mots. Un poème : ‘La petite dame voit régulièrement / Une infirmière psychiatrique / La moindre panne de courant / Et elle pense mettre fin à ses nuits / La petite dame est sans appui’ (31). S’entretissent souplement une touchante vulnérabilité, une touche de dépréciation de soi ou serait-ce un besoin de dire vrai, d’avouer l’inavouable, le génie des compressions (électricité et nervosité, suicide et cécité sans canne) et d’un scénario qui se dédouble, tout comme Valérie devenue dans le miroir déformant-réformant des mots la ‘petite dame’.
Charme et naturel qui brillent et ce qui peut parfois les sous-tendre, un subtil récit plutôt grisâtre, refoulé mais perçant. Un autre poème, si splendidement jaillie de l’enchevêtrement de quelques syllabes spontanément recombinées : ‘Après l’hiver persévérance / La fleur perce et révérence’ (37). Inutile ici de souligner la grâce et l’enchantement de cette performance digne de l’avant-scène de la Comédie Française. Et un troisième : ‘Elle tremblait en plein cauchemar / Endettée jusqu’’aux oreilles / Coupable en tranches comme une brioche / Un jambon un ananas une vie / Tout au fond de son lit / Quelle chance d’avoir un lit / Rondelles et rondeaux ridelles et rideaux / Voleuse de pataquès de cheminots ? Quand elle se réveilla sur la bonne voie / Alors un jour nouveau démarra’ (38). Changement de ton ici et pourtant d’incessants jeux de mots jonchant partout la scène du poème qui flotte librement sur son erre, jonglant entre rêve et réalité, auto-accusation enjouée de vol-fraude-contrefaçon, tissant finement tous les glissements entre les éléments-termes spontanément surgissant du récit, le poème corrigeant d’un dernier rebondissement dans le réel tout malentendu concevable quant à ce qu’il aurait pu offrir de strictement non-poétique, non-inventif, non-souriant.
Se déroulant ainsi ‘de distraction en distraction’ (40), comme écrit Rouzeau, son poème persistera toujours à rester joueur, quoique parfois ‘triste au point d’éclater de rire’ (77); et là on voit clairement cet instinct qui ne cesse de pousser le poème à déplacer son centre, de bouger, tournoyer, sans chercher à accumuler les éléments d’un argument, d’une intensité ou focus lyrique, affectif même. Plutôt le poème s’accomplit au moyen d’une petite ou grande multiplication ou foisonnement des plis de l’esprit et du cœur, de leur clignotement, leur scintillation. On a l’impression non pas d’une orchestration raisonnée mais d’un crépitement spontané, intuitif dégageant des étincelles de couleurs différentes, de petites beautés jetables, throw-away, mues par une certaine désinvolture, une simple légèreté, une aisance ou sans-façon. Que ne démentiraient nullement les quelques touches plus sobres, latentes, souvent presque effacées par l’insistance ludique, la magnanimité, l’affabilité qui restent essentielles à la vision distinctive de ce poïein : réenchantement, réimagination de son faire, repoétisation de ‘l’ordinaire’, ce partage qui s’avère un être-avec et ‑parmi, une amitié qui veut ‘prendre des choses [non pas de travers mais] de trouvère’ (51). À titre d’exemple, ‘l’accident de vélo à huit neuf ans avec son frère cadet / Ça c’est du pour jamais du pur toujours’ (54). Une poésie qui embrasse, donne des bises, sororale et fraternelle, ‘ram[ant / …] ne sa[chant] quand ni pélican / Ni comment ni cormoran / […] / Joyeuserie drôlerie’ (52) On ne demande pas mieux.
Présentation de l’auteur
- Claude Ber, Le Damier de vivre - 6 septembre 2025
- Valérie Rouzeau, La Petite dame - 6 mai 2025
- Daniel Kay, Le perroquet de Blaise Pascal - 5 février 2025