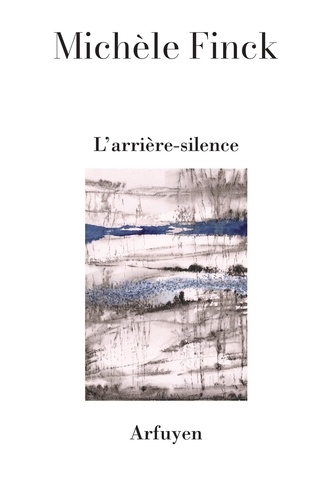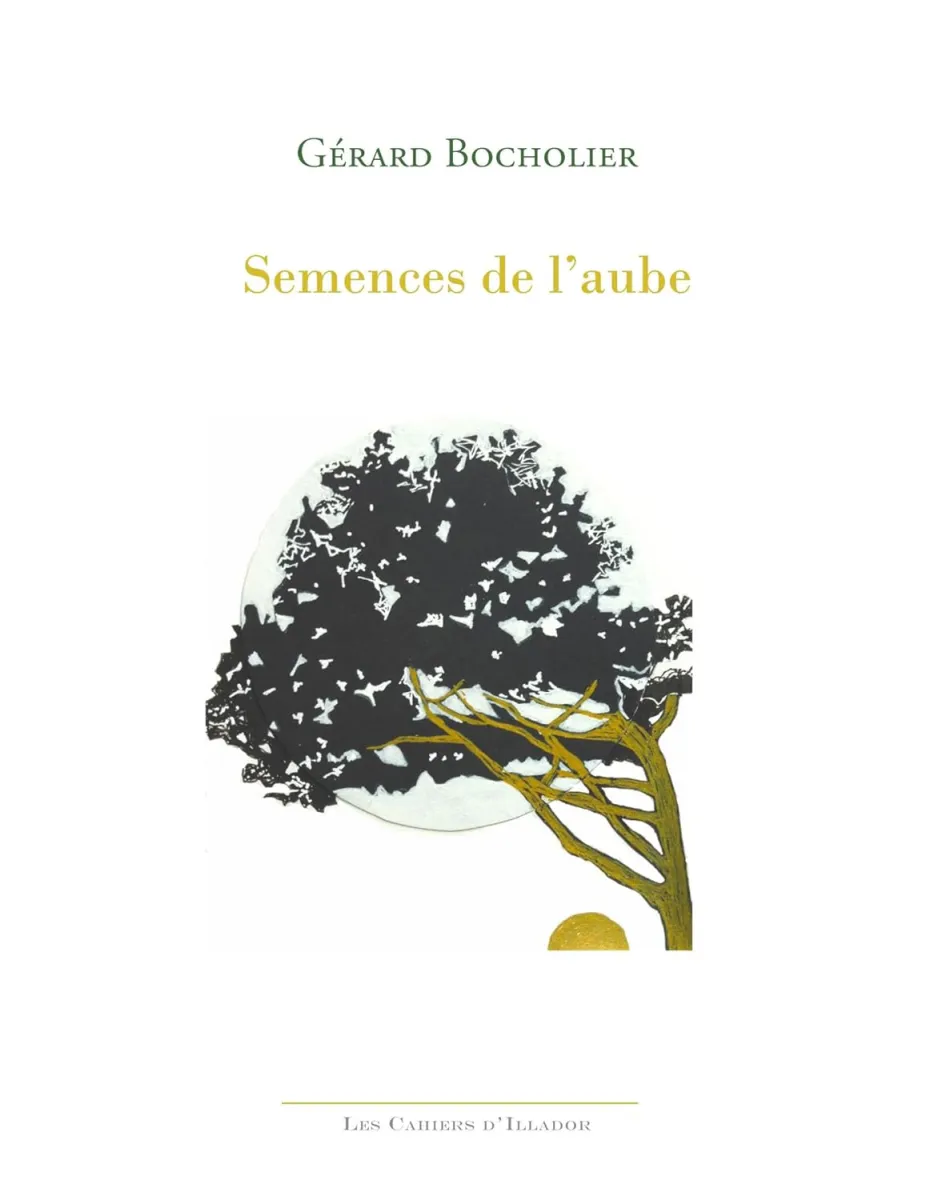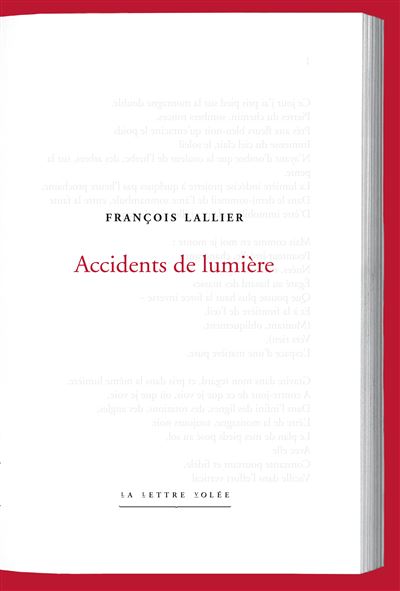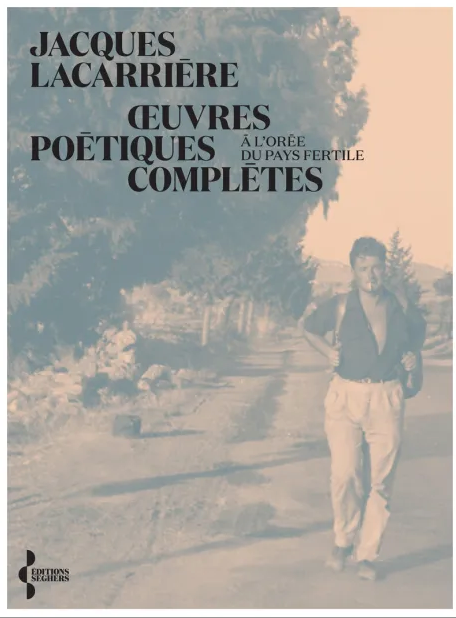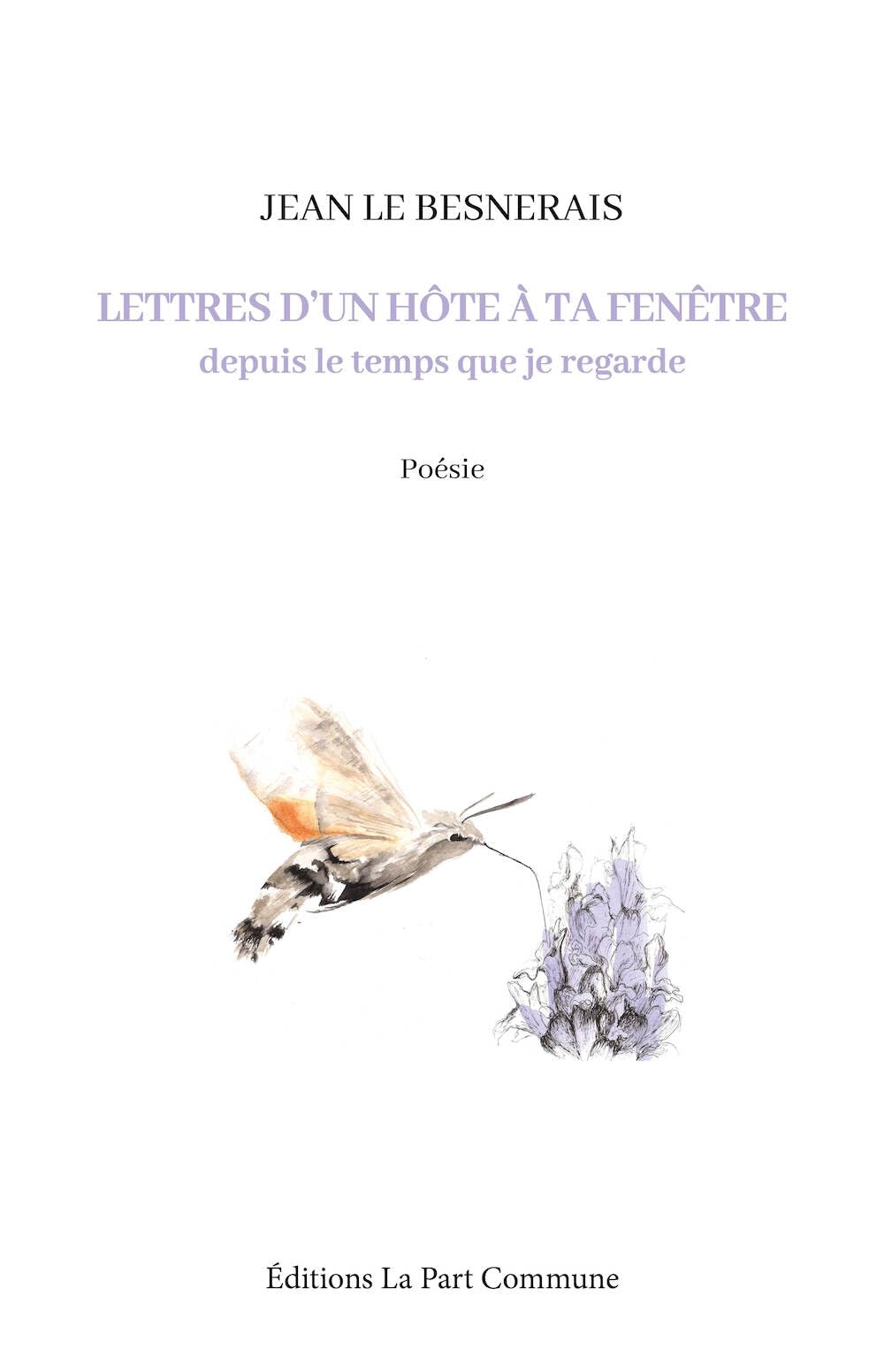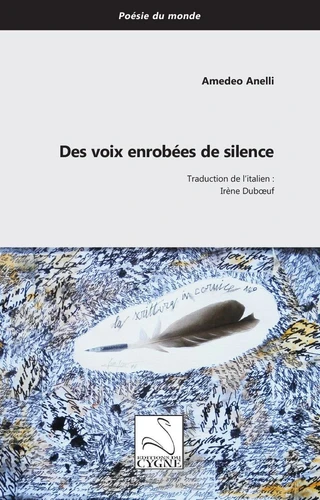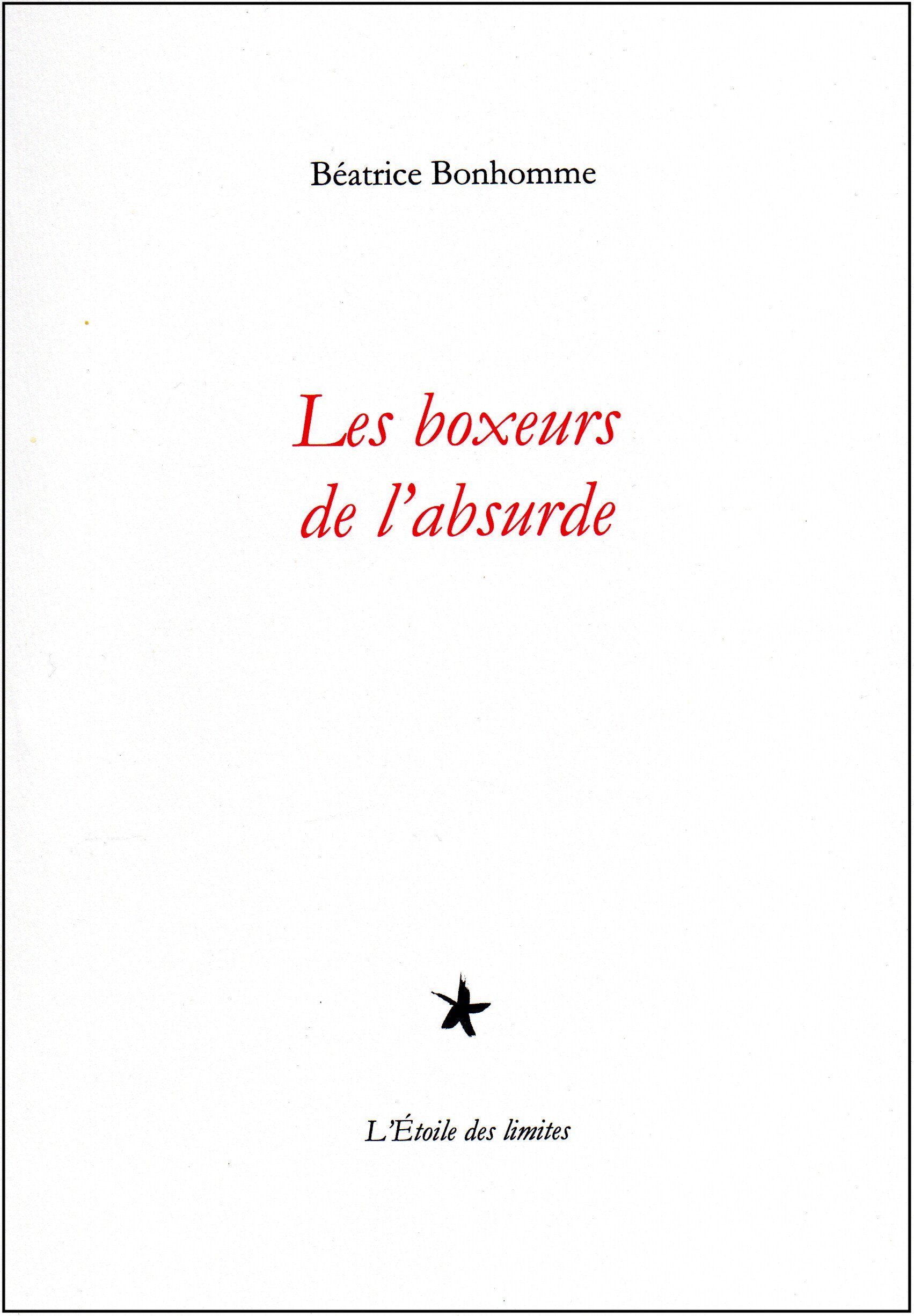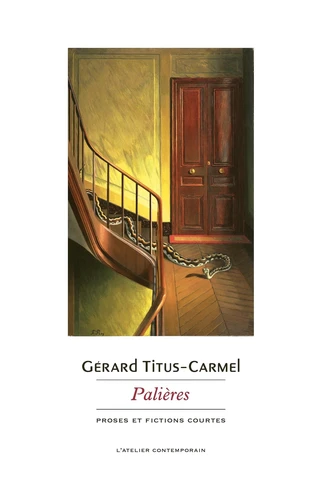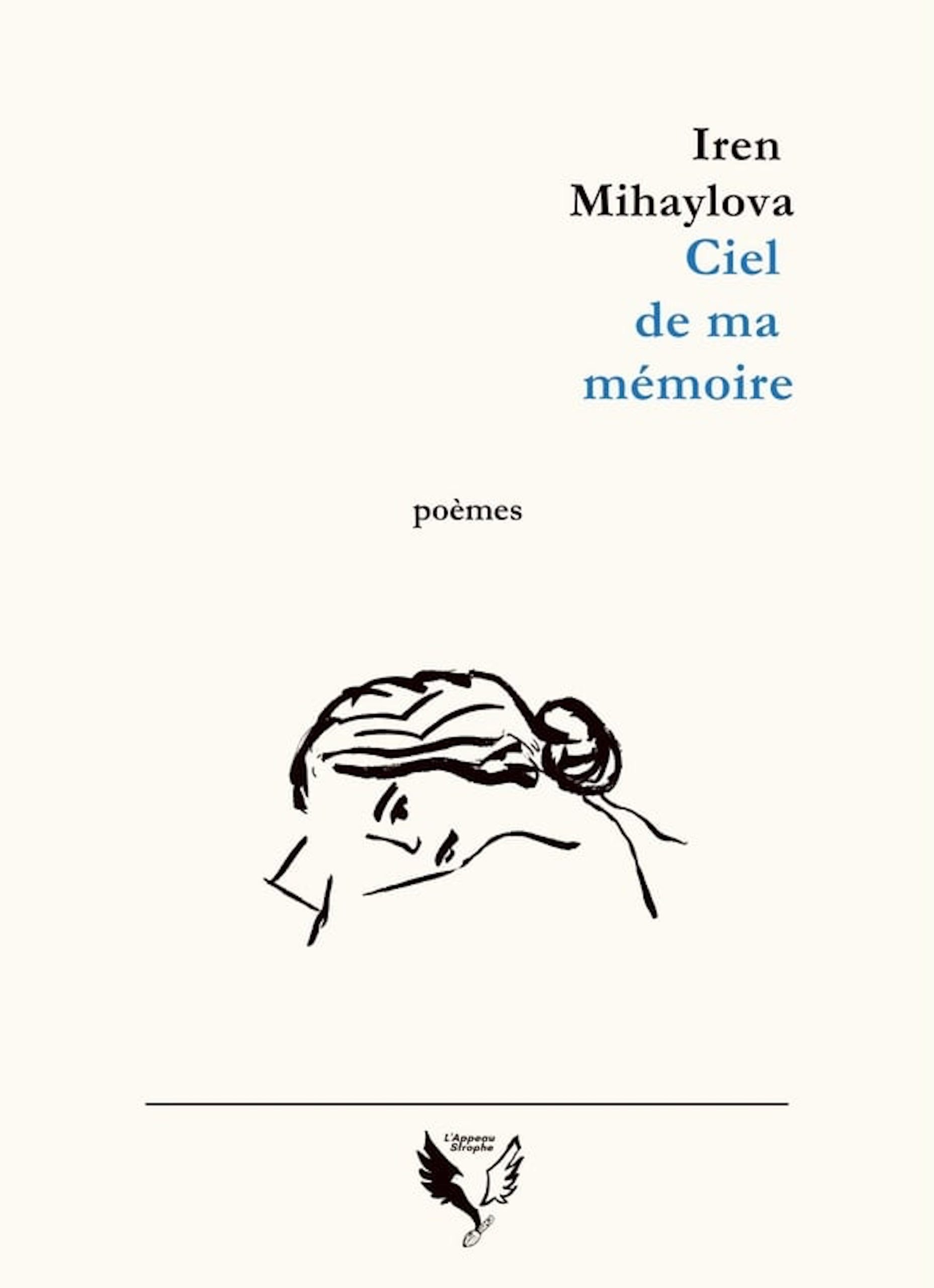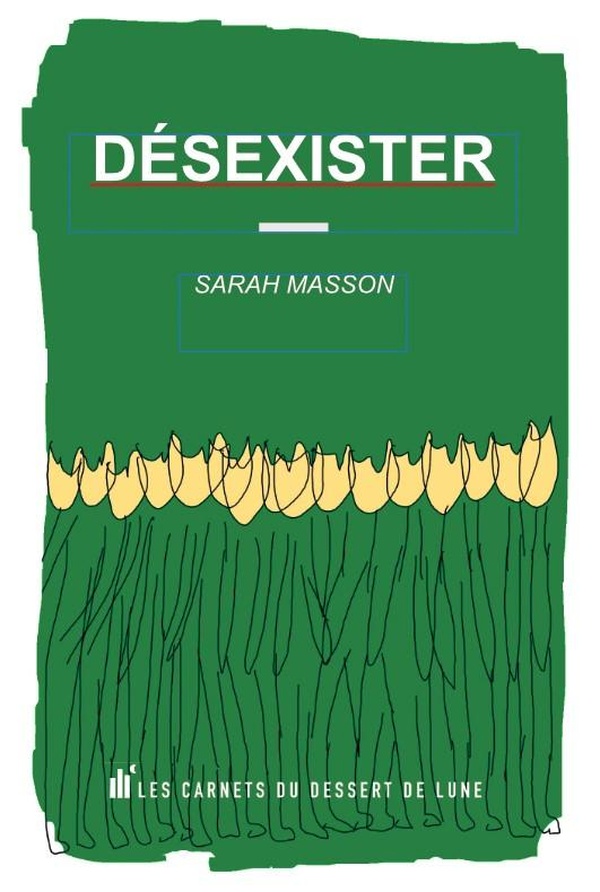Voici un livre prenant, proprement bouleversant, constitué d’un seul poème avec ses différents mouvements. Huit en tout. Un père y crie muettement sa douleur après la mort de son fils, ne la quitte pas mais finit par l’habiter comme une demeure pleine de lumière grâce à l’aide silencieuse de l’absent.
On est pris, immédiatement, dès les premiers mots, emporté par ce poème, son rythme, sa densité, son insoutenable gravité et littéralement enlevé, soulevé par le mouvement qui le traverse de part en part ; on est écartelé entre la douleur la plus extrême, telle qu’elle s’y transcrit, sans pathos ni complaisance, et la joie la plus intense, la plus aiguë qui nous emmène si haut dans le sillage de la marche et du sourire du fils ; on est avec le père estourbi par la nouvelle du décès, vacillant comme après un immense coup à la tête dans le wagon du RER, on est avec lui un certain midi dans le surgissement d’une joie imprévue, comme une crue, qui le submerge et l’emporte avec son chagrin.
La couverture l’indique mais on ne peut que le recevoir ainsi : ce texte constitue un seul poème en raison de son rythme, de la façon dont l’anaphore le scande et transforme le cri de douleur en une question, puis en une conversion, portées par une musique. Sa force vient en partie de sa relative sècheresse, une sécheresse de couteau, de sa maigreur, son acuité, presque sa violence ; de sa frappe singulière, son phrasé, ces suites de quatre versets qui donnent sa scansion à l’ensemble, qui le portent, et qui, de temps à autre, se détendent à l’occasion de séquences plus longues pour laisser la vie entrer par la porte du souvenir, soleil entouré de larmes.
Ce livre s’ouvre par une citation suivie d’un prénom en guise de signature. Celui d’un prophète, Isaïe. Ce prénom est aussi celui qui avait été choisi pour le fils à sa naissance. Cela fait de cet exergue, de la parole du prophète, une parole du fils qui s’adresse à son père depuis le non-lieu où il se tient. Et que dit Isaïe ? Il ne fera pas entendre sa voix au dehors.
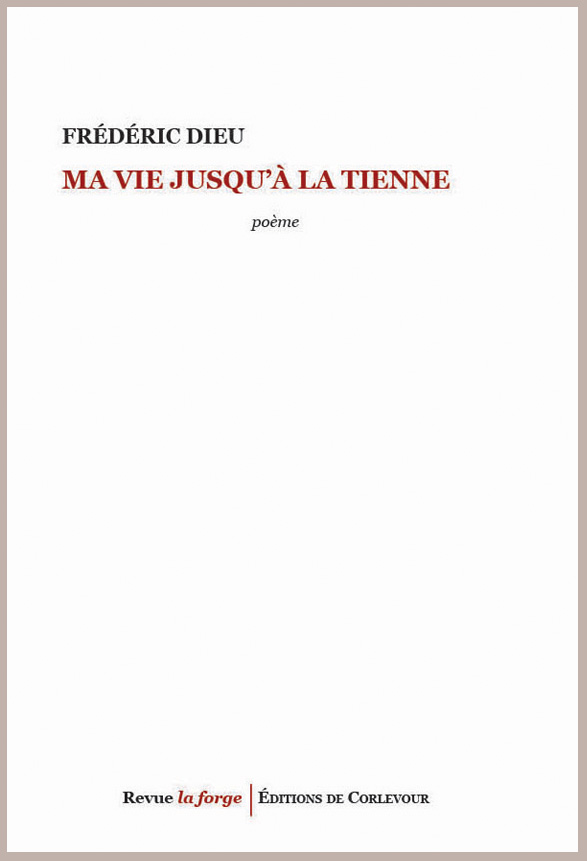
Frédéric Dieu, Ma vie jusqu’à la tienne, Éditions de Corlevour, 73 pages, 25 euros.
Le poème commence par un cri impossible à pousser, un cri qui ne sortira pas, une forme d’expression qui se situe au-delà du cri et du silence qui sont déjà eux-mêmes au-delà de la parole. Pour cette raison, ce cri devra s’écrire et, en s’écrivant, se moduler, devenir autre chose qu’un cri : un poème avec toute la douleur dedans, mais une douleur transfigurée qui est de la vie éclairée par une lumière qui vient d’ailleurs qu’elle. Pour dire la vérité de cette douleur inimaginable, pour nous aider à nous la figurer, Frédéric Dieu a recours à des notations très suggestives comme cette oscillation dans le RER qui restitue le balancement des corps en prière devant le mur des lamentations, ou cette façon de se nommer soi-même à la troisième personne du singulier, d’effacer le « je » du sujet dans la phrase comme si la douleur ôtait à celui qui l’endure toute sorte de subjectivité ou de personnalité, visage défiguré, vie anonymisée.
Pour guider le père hors du cri vers la parole, on retrouve ce mot, plus exactement ce nom propre qui se trouvait au seuil du livre, un prénom qui désigne non pas une catégorie d’êtres, une abstraction, mais la singularité d’une présence : Isaïe. Prononcer ce prénom du fils, c’est, pour celui qui lui survit, former avec ses lèvres le geste de son sourire à l’intérieur de la douleur. Restaurer doublement sa présence, par l’évocation, par l’imitation. Survivre pour prononcer le nom. Ou pour l’écrire. Et quand le poète l’écrit, à deux reprises, c’est pour l’associer à la joie (p. 41) puis à la naissance (p. 44).
Isaïe mon fils, à quelle naissance m’appelles-tu ? À quelle élévation quelle ascension, à quel enfouissement ?
Isaïe est le nom propre de la joie et de la naissance, de la joie de la douloureuse naissance à l’intérieur de souffrance et de la mort. Le sens même du mot « prophète ». L’usage de ce prénom, qui ne vient pas tout de suite est précédé par le recours au tutoiement, qui est une manière de faire exister au présent celui qui n’est plus, de le tenir, de soutenir sa présence dans la vie et cela fait de ce poème à la fois une lettre d’amour adressée par un père à son fils et une prière parce que l’adresse s’illimite.
Le fils, ainsi désigné, comme interlocuteur et comme prophète, guide le père à l’intérieur de l’événement qui s’est imposé à tous les deux, à leur relation. Il vient le chercher au milieu de son incompréhension, de sa sidération face à la radicalité, à la brutalité inouïes de l’accident, et l’aide à entrevoir la possibilité d’une naissance dans cette brèche ouverte à coups de hache dans sa vie et les contreforts de son moi. Comme si ça pouvait naître encore quelque part, et comment et pour quoi.
Ce que le fils apprend à son père, en le devançant dans son chemin vers la lumière et en renversant par sa mort l’ordre de la relation, et même sa chronologie, c’est à faire en sorte d’accueillir dans le silence de la détresse le fait que la mort et la vie, la joie et la douleur se fondent l’une dans l’autre en même temps que la vie du fils devient celle du père et que leurs voix se confondent. C’est précisément cela qui se réalise dans le poème : grâce à cette conversion opérée par l’intercession du fils, il y a, animant tout à la fois la douleur et la parole qui cherche à la dire, tout au fond de l’abîme, cette circulation, ce grand mouvement de la vie plus vaste que la vie, qui ouvre celui que sa souffrance aurait pu enfermer en lui-même à ce qui n’est pas lui et qui l’emporte vers une lumière, une joie proprement impensables, semblables à la pure lumière de février et au clair sourire d’Isaïe. C’est peut-être cela le plus difficile à comprendre : que cette joie soit semblable à la douleur, unie, intérieure à elle. Tout comme est impensable, inimaginable pour le lecteur que je suis, ce que le poète a réussi à écrire et à nous donner, à nous tendre avec ce livre : de la lumière humaine extraite du fond du puits de la douleur la plus extrême. De la douleur convertie en lumière. Il fallait sans doute une aide hors du commun pour y parvenir, celle de la poésie, celle du fils, celle d’une transcendance accueillie malgré la révolte.
Ce qui contribue pour une grande part à l’émotion que provoque ce poème, c’est que de brefs éléments narratifs, des micro-scènes de vie, s’introduisent par intermittence dans le chant et viennent donner une assise concrète à son élan tout entier spirituel. Ils le rattachent ainsi à la terre du vécu ordinaire, faisant voir des visages vivants comme dans ce passage, par exemple, où le regard du père se pose maternellement sur ses enfants, ou cet autre où il les entend rire à l’étage supérieur de la maison. Au centre des rires, comme un soleil avec ses rayons, celui d’Isaïe, le fils perdu. On voit ainsi un nouveau « nous » se former sous nos yeux, le visage d’une famille avec absence, éclairée par cette absence. Il y a enfin ce souvenir évoqué en fin de poème qui vient rétrospectivement l’éclairer tout entier et lui donner son sens : le père fatigué, peinant dans sa marche, voit son fils se retourner vers lui, revenir sur ses pas et l’aider sans sa progression tout comme il le fait dans la traversée du deuil, présence active, lumineuse à l’intérieur de la mort.
Voilà pourquoi il y a quelque chose de, non pas plaintif, mais déchirant dans ce poème. On y entend un long cri absorbé par le silence de l’absent, et qui, grâce à ce silence non pas vide mais plein de la présence tout à la fois en retrait et solaire de l’absent, se change en chant, joie et douleur, vie et mort mêlées, portées par une même musique, un même mouvement d’offrande lumineuse qui nous atteint, qui nous emporte comme si ce livre avait cessé de n’être qu’un livre pour devenir geste, action, transmission d’un élan venu d’au-delà de la vie.
Présentation de l’auteur
- Michèle Finck, L’arrière-silence - 6 mars 2026
- Frédéric Dieu, Ma vie jusqu’à la tienne - 24 janvier 2026
- Paroles de résistance — Postface à La Tour des corbeaux suivi de Fait d’arme de Mathieu Hilfiger - 6 septembre 2025
- Philippe Jaccottet en Pléiade - 21 février 2014