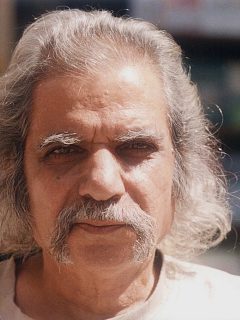En 1977, juste un an après sa parution, Jejuri, très significativement, reçoit le Commonwealth Poetry Prize. Pour Kolatkar, qui compose en anglais et en marathi, il s’agit là d’une valorisation exceptionnelle : le recueil s’extrait de sa circulation confidentielle, si ce n’est underground (publié dans la petite imprimerie de Pras Prakashan, il touchait jusqu’alors surtout les artistes et intellectuels avant-gardistes de Bombay) pour connaître une diffusion nationale et internationale.
À la date, l’Inde, en plein essor, développe un urbanisme cosmopolite. Les poèmes qui forment Jejuri sont écrits en anglais (on se réjouit de la récente édition bilingue, parue en 2020 aux éditions Banyan, avec une traduction de Roselyne Sibille) : quelque trente ans après l’indépendance du pays, Kolatkar choisit de perpétuer cette langue que les Indiens, par la force des choses, se sont appropriée (à la lecture, on note, par contagions d’usages et de sens induits par l’hindi, quantité d’aménagements, de sens détournés, de faux-amis).
Par ailleurs, choisir Jejuri comme aire (non seulement un lieu, mais aussi un ensemble d’images, de symboles, de représentations) où déployer des poèmes est un geste signifiant : faisant un pas de côté par rapport à ce Bombay qu’il habite et connaît par cœur, Kolatkar n’en est que plus sensible, parce qu’il le reçoit frontalement, à cet ensemble composite et complexe que constitue la ville de pèlerinage.

Arun Kolatkar, Jejuri, Banyan éditions, 2020, 170 pages, 16 €.
Le poète, accompagné de son frère Makarand et son ami Manohar Oak, appréhende cette cité d’un œil neuf. La construction du recueil, qui s’ouvre par « Le bus» et se ferme par « La gare », ensemble de six poèmes que l’on pourrait qualifier de ferroviaires, souligne bien le caractère particulier de ces poèmes ambulatoires : Kolatkar n’est aucunement un pèlerin, mais bien plutôt un pérégrin ; il circule dans des espaces choisis, en un temps donné, car à Jejuri, le voyageur ne demeure pas longtemps. La brièveté de son séjour est à l’aune du caractère éphémère de tout ce qui s’y rencontre.
Le voyage en bus, puis la promenade à pied dans certains quartiers de la ville, favorisent une perception très morcelée, toute de concaténations et de raccourcis visuels ; le poème liminaire, «Le bus», où le narrateur s’amuse de son reflet dansant dans les lunettes de son voisin d’en face, l’établit d’entrée : « Ton propre visage reflété deux fois dans une paire de lunettes/[…] Tu sembles te mouvoir en permanence », « continually forward/toward a destination », écrit Kolatkar, et la juxtaposition des adverbes, la redondance qu’ils établissent avec « a destination », sont révélatrices du mouvement irrépressible qui s’exerce dans l’ensemble du recueil, entre élan et attraction, incoercible curiosité et appel puissant.
Le Jeruri de Kolatkar n’est pas précisément conforme à l’image attendue. Fi des impressions usuelles et des clichés de cartes postales : pour peu, on oublierait presque qu’il s’agit d’un site fréquenté par des milliers de fidèles venus y faire leurs dévotions. Peu portés au prosélytisme, les poèmes de Kolatkar n’ont pas non plus vocation touristique, ni même ethnographique ; ils explorent plutôt l’envers du décor – la vérité nue et crue des lieux. Dans un environnement dédié aux traditions et aux croyances ancestrales, a fortiori parce qu’il s’adresse à une société fondamentalement clivée et hiérarchisée, on pourrait s’attendre à des structures solides et à des organisations pérennes. Or, il n’en est rien. Les lignes de démarcations sont très minces, si ce n’est inexistantes. Par exemple, Manohar, l’ami de Kolatkar, au gré d’une péripétie plaisante, prend une étable pour un temple : « La porte était ouverte/ Manohar pensa/que c’était un temple de plus.//[…] Ce n’est pas un autre temple,/dit-il,/c’est juste une étable ». Et cette méprise, comique dans ses effets, trouve sa justification quelques pages plus loin : « qu’est-ce qui est dieu/et qu’est-ce qui est caillou/la ligne de séparation/si elle existe/est très mince à Jejuri » ; il faut dire que les dieux eux-mêmes n’aident pas à imposer préséances et hiérarchies : s’ils « ont tous à être honorés », pour autant, ils se confondent dans des équivalences peu glorieuses ; Kolatkar, dans le poème intitulé « Yeshwant Rao », les décrète « too symmetrical/or too theatrical » : qu’ils soient trop ressemblants (« symmetrical », voici un exemple de ces faux-amis soufflés par l’hindi que j’évoquais plus haut) ou trop cabotins, trop comédiens, cela revient au même au final : comment y croire ? Rien d’étonnant si la piété elle-même est très dégradée, si prieurs et vieilles mendiantes, sur le parvis des temples, rivalisent de vénalité et de vulgarité.
Par une espèce d’ironie fatale, le temps fait son œuvre de délabrement. Aucune valeur, aucun édifice qui tienne définitivement dans Jejuri. Ainsi, « Cœur de ruines » décrit un temple abandonné : « Une chienne bâtarde a trouvé place/pour elle et ses chiots // Au cœur des ruines./Peut-être qu’elle préfère ainsi les temples ». Dans l’indifférence la plus complète, « Personne ne semble s’en soucier », la « maison de dieu » se détériore, sa « porte [est] encombrée de tuiles cassées ». Rien n’est plus à sa place, ni ne remplit son office premier : « Ce n’est pas un seuil./C’est un pilier sur son côté » (« Le seuil de la porte »). L’œil du voyageur, de poème en poème, pointe des équipements hors d’usage, tels « un robinet à sec » ou encore « un gond cassé ». Seul Kolatkar, avec le sens du détail qui le caractérise, semble percevoir ces réalités tristement banales, qu’il transcrit avec une minutie exemplaire.
Quand tout, très vite, devient désolé, il n’est qu’à cultiver des enchantements passagers – même si, ainsi l’atteste la chute du poème, l’illusion ne saurait durer : « une canalisation/court sur sa base/tourne au coin de la maison/s’arrête net sur son parcours/avance tout droit/rase le mur/revient sur ses pas/s’enroule sur elle-même/et s’arrête soudain/souris de cuivre au cou brisé » (« La distribution d’eau »).
Difficile de garder des souvenirs quand tout est promis à la décrépitude. Le poème intitulé « Le réservoir » joue avec ces diverses dimensions (strates de mémoire, épaisseur de matière), le réservoir d’eau figurant la réserve des souvenirs collectés : « Il n’y a plus une seule goutte d’eau/dans le grand réservoir construit par les Peshwas.// Il n’y a rien dedans./ Seulement cent ans de vase ». La rime « built/silt », dans le texte original, fait apparaître le destin de toute construction : délitement, déliquescence. Qu’est-ce donc qu’un réservoir privé de ses réserves ? Une vanité des temps modernes, vaseuse, informe, malodorante. Ainsi en va-t-il de la mémoire – lieu de stockage incertain, de classifications douteuses. Le poème « Le placard » souligne la difficulté à conserver toutes choses : sa porte vitrée est brisée et rafistolée avec des morceaux de vieux journaux jaunis ; cette réparation de fortune crée un « assemblage » (tel est le mot du poète) fait de proximités nouvelles : « tu peux voir les dieux d’or/au-delà de bandes/de cotations boursières » ; se jouxtent les réalités du monde moderne, dominé par l’économie et la finance, et les traditions du passé. Et il se trouve que les journaux comme les dieux, au moment où s’écrit le poème, sont tous, autant qu’ils sont, d’un autre âge. Tout change, vieillit, devient caduc, en proie à une obsolescence absolue.
Les temples sont désertés par les dieux, désertés par les hommes – mais, tant qu’il est un poète pour les regarder, ils ne sont pas désertés par la poésie. Le regard de Kolatkar n’est pas désenchanté, mais formule plutôt des constats souriants ; il collecte des notations empreintes d’humour et de dérision : « La porte serait partie/depuis très très longtemps/ s’il n’y avait eu/ce short/mis à sécher sur ses épaules ». Et, dans le même état d’esprit : « Le temple de Khandoba/s’élève avec le jour./Mais il ne doit pas tomber/avec la nuit ».
C’est que la ville, dans ses méandres et ses retraits, ménage des surprises saisissantes, fait surgir des émotions stupéfiantes. Ainsi, dans le poème « Entre Jejuri et la gare», Kolatkar note sa stupéfaction : « Tu t’arrêtes à mi-chemin entre/Jejuri d’un côté et la gare de l’autre./ Arrêt complet/et tu restes immobile comme une aiguille en transe./ Comme une aiguille qui a atteint un équilibre parfait entre des graduations égales. […]
Rochelle Potkar talks about Arun Kolatkar and his multilingual page poetry, and reads some of his finest work.
Et tu te tiens là oubliant comme tu dois sembler stupide ». Interdit, stable sur ce point d’équilibre qu’est le regard, tel est le poète : saisi d’une émotion, d’un émoi tel que, faisant mentir le sens même de ces mots, il se voit immobilisé. Dans cet univers qui s’effrite et s’effondre progressivement, dans cette accumulation de chutes et de ruines, la seule instance qui soit, solide, fiable, stable, est le regard sidéré du poète. Là est l’ancrage sûr, la balise, la mesure : l’instrument précis, infaillible, qui permet de percevoir que « l’esprit du lieu/vit à l’intérieur du corps galeux/du chef de gare ».
Quand on habite Bombay, parangon, s’il en est, de l’effervescence bouillonnante des villes indiennes de ce début des années soixante-dix, curieusement, le plus court chemin pour accéder à l’essence même de l’agglomération urbaine est de passer par Jejuri, soit d’effectuer un détour de presque deux cents kilomètres. Jejuri figure une forme de recueil premier, où les grands motifs de la poésie de Kolatkar se façonnent et s’organisent : la ville, et, dans son prolongement, la poésie de la ville, du fait de la distance et du changement de focale, plus nettement définissent leurs contours. Ce qui intéresse le poète, c’est la façon dont une cité orchestre des proximités insolites, des conjonctions qu’on dirait organiques (enkystements, absorptions inattendues, greffes) entre des univers fondamentalement différents. L’hétérogénéité est source de transformations incessantes, toutes d’adaptation, d’incorporation – de création. Kolatkar, après avoir écrit Jejuri, concentrera toute son attention à la ville-phare de l’état du Maharashtra : Kala Ghoda, poèmes de Bombay, désormais peuvent s’écrire.
Un documentaire sur le poète hindi Arun Kolatkar. Produced by Sahitya Academy.