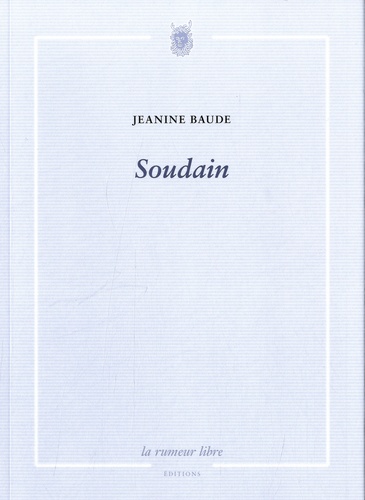Oui, le chant
Oui, un titre, qui dit bref et fort la déclaration d’adhésion à la vie que décline le livre foisonnant de Jeanine Baude. Adhésion malgré la douleur de vivre indissociable de sa joie, la violence trop souvent du monde, la conscience de finir, mais adhésion intense, que déploie ce chant lyrique dans le sens premier de ce terme
Car ce recueil est chant — « le chant, seul recours, étincelle à l’oreille/ du labyrinthe, ton congé de clarté, ta nuit sereine » — chant liturgique même construit autour de la répétition et de la variation, « rêvant de formes fixes » et s’employant à en inventer : ce sont les poèmes de deux strophes de sept vers balançant entre non et oui et terminées par un envoi de la première partie, les Proses vénitiennes s’ouvrant par « Si Venise en hiver » et se terminant par un quintil justement nommé d’acquiescement, les treize vers des poèmes d’Epilogue en treize vers, les reprises sémantiques du Chant d’Adrienne, dont chaque fragment s’ouvre sur un « Et je te parle, Adrienne » ou bien le « Ô solitude » augural des poèmes en prose de Ô solitude, l’île ou encore la scansion finale de chaque poème d’Antiphonaire par le mot « lectures », sonnant comme un amen. Ces reprises formelles, dans ce qu’elles ont de rituélique, constituent l’unité des six ensembles, qui composent le recueil, dont la richesse thématique s’étoile autour d’un axe central tressant l’éloge du corps amoureux à l’histoire collective, la louange de la présence sensuelle au monde à l’élan spirituel, la méditation sur le poème à sa mémoire insistante.

Jeanine Baude, Oui, Éditions La Rumeur Libre.
Le premier « chant » — car ainsi pourrait-on nommer chaque partie- donne son titre de Oui à l’ensemble et fait alterner les plateaux de la balance entre refus et acquiescements. À la première strophe le rôle de dire non, à la seconde, qui débute toujours par « mais », celui d’un oui, qui « vague après vague roule l’acquiescement ». Mais ce balancier ne distribue pas mécaniquement la dualité, les non sont aussi « brulants de révolte », de juste « rage » quand, par exemple, dans « la ruelle embrasée » « tête et poing dressés » résonne « le chant qui monte des visages », célébrant une fraternité et une aspiration à la liberté qui emportent adhésion. Impossible et inutile d’énumérer ces oui et ces non, qui font résonner « le cri de l’enfant enchaîné à la guerre », « les décombres anonymes/ que les hommes poudroient », avec, en contrepoint, le oui proféré « sur la différence des langues, des couleurs, des emplois », sur « la brume d’un corps d’à côté éclairant de ses courbes la brillance d’un ciel », sur « le vertige des hommes, toujours monter plus haut », égrenant un « poème de joie » à dire « le corps et le corps encore/ le centre et la chute amoureuse » et la beauté du monde, celle de « l’univers, le vaste », celle de la houle, des dunes, du soleil, celle du « désir attelé », de la chair à son épanouissement quand la dune évoque « une hanche de femme, son rut » comme celle de l’élan spirituel loin des dogmatismes semeurs de carnages et puisant aux sources de Patmos. La parole de St Jean — l’amour est plus fort que la mort- semble résonner allusivement à l’arrière de ce livre habité par des voix, qu’il convoque explicitement et implicitement, d’Homère à Nietzsche, de « la tour abolie » de Nerval aux « fleurs du mal » baudelairiennes ou au « loriot » de René Char. Entre la prophétie et le laurier de l’oracle pythique, le poème, « déversant son ruisseau secret, sa clarté, sa lumière », éclaire le flot emporté de la vie. Car océanique est aussi ce chant s’élevant aux confluents de mers, rivières, ruisseaux, dont il brasse le tourbillon contradictoire.
Une même eau baigne chacune des Proses vénitiennes et leur quintil final, invitant à la contemplation. Ce sont tableaux précis de la ville — ses rues, des places, ses monuments- qui se déploient et semblent se refléter, éclatés, réinventés dans les tableaux des peintres évoqués, Tintoret, Tiepolo, Jérôme Bosch, Ruskin, Caravage, Le Bernin, Kandinsky… À moins qu’à l’inverse la ville ne reflète la peinture dans un réel inventé par l’art qui, tableau ou poème, en construisent l’image, paysage extérieur et intérieur confondus, où, de même que précédemment, se met en scène un colloque imaginaire joignant Villon et Rimbaud, Pound, les élégies à Duino et Robert Browning, l’infinito de Leopardi et « la libre Marianne entre les mains d’un peuple heureux ». Si le poème joint temps et espaces disparate, c’est parce qu’il se fait méditation sur la destinée humaine en même temps qu’introspection. Venise semble devenir cette femme prise dans des plis d’eau et de pierre, mer et draperies mêlées, dont « les longs cris sont appel d’air ».
L’intime de la vie devient allégorie et l’art et le poème disent le monde. Si la poète « emprunte à Fontana sa lame » c’est pour la hausser, « pli après pli, sur la vergue tendue, lisant la comète, la joie, l’audace qui déferle » et délivrer son art poétique : « la phrase roulant sensuelle sur la page, l’écrivaine séduit son verbe, l’envoûte et le place en un lieu toujours indéfini car peu importe l’azur, la nuit ou l’ensoleillement des termes, la vigie, celle qui dirige le chant, implose puis explose, et suivant le fleuve, le canal et la mer qui les brasse, s’expose souveraine, fuyant le port, l’arrivée, caressant les coraux d’une plage et jusqu’aux fonds marins étirant sa demeure, enlace l’univers… » et la phrase continue, une seule phrase-vague marine d’une demi page, qui dit l’amplitude du geste et de la geste du poème contant celle des hommes.
C’est encore de l’histoire humaine, de son tragique, que « parle » le chant d’Adrienne (toujours lui, le chant) s’élançant depuis « les rivages de cette mer qui encercle la terre » (toujours elle, la mer) et ramène à la mémoire les temps d’horreur concentrationnaire, ranimant la figure des déportées. « Si le diadème était pour vous cette fumée noire qui faisait cercle autour de vos têtes » dit le texte liminaire dans une inversion les couronnant et auréolant d’une mandorle de sainteté ces femmes martyres. Adrienne, la Résistante, reprend vie au poème qui la nomme et se fait récit, évoquant sa jeunesse insouciante puis « le temps démesuré de la souffrance » dans un requiem où s’unissent les deux visages de la sacrifiée et de la poète qui « épelle Ravensbrück sous le dais des saveurs » car, affirme-t-elle, « je le sais, même dans la boue de ce torrent, mélasse et merde exsudant leur foutre inutile et vert, suint sans clarté, ici, tu espérais ». Au plus profond du mal qui ronge l’histoire humaine, Adrienne, Germaine T. et Charlotte d’Auschwitz sont figure d’espoir et d’humanité : « Oui, ton geste résistant accomplit un enfantement… »… Dans la douleur, dans l’horreur s’enfante encore et malgré tout ce « oui » qui titre l’ouvrage. Le oui d’une ténacité, d’un courage, d’une espérance disant notre humanité, le oui du poème dans sa «clameur de kermesse l’inondant » quand cette adresse à Adrienne, à la fois descente aux enfers et résurrection, se clôt sur une scène de fresque unissant « ceux enterrés et ceux renaissants » « le livre et le corps », l’Eunoé et le Léthé, « l’architecture de la révolte » et « le son de la lyre ».
On pourrait continuer d’explorer de même les trois autres parties de ce livre, Ô solitude, l’île, Antiphonaire et Désert, qui réservent mêmes dédales de sens et des sens conjugués. Ce sont les douzains de Ô solitude, l’île qui enserrent dans leur forme, elle-même insulaire, le parcours de l’enfance à « l’homme dernier », « liant les hommes à ce courant d’amour » qui les emporte, « mains plongées dans l’épaisseur des langues et des algues », habités comme la poète par « la passion, son courroux, ses veines tendres », « une mesure d’espoir grêle sous la peau ». « Fontaine sous mes doigts, le feu, l’eau liés ensemble », le poème explore « l’églogue et l’épopée », « la ruelle qui ouvre sur l’océan en son entier » le « qui suis-je » de « l’étrange bête humaine », le « chemin giboyeux des anciens lus sous la lampe » comme « l’appel du plus haut que toi ». Ce sont les « Lectures » d’Antiphonaire dont chacune égrène un « épisode de vie », interrogeant « ce pourquoi en cerceau qui danse sur l’humaine traversée » en « cantique » et « prière » à l’éphémère entonnée par « un danseur cannibale ». C’est Apollinaire, Michaux, Artaud qui viennent se joindre à l’ivresse et à la beauté. Et si Désert il y a, au final, c’est non stérilité, mais dans l’analogie des dunes et des vagues, pour y « reprendre marche à l’avant », entonner de nouveau le « chant » au confluent de « l’Orient blessé » et de « l’Occident en perte de formes, de sens », jouer sur le geste de l’archéologue — « creuser » - refaisant parcours de « la naissance à la mort ». « La nuit reste à éclaircir » et cela fait le poème quand il « nomme », creusant la langue, qui charrie ensemble l’étreinte sous « la yourte nuptiale » et les charniers des massacrés.
Lyrisme ai-je dit. Oui, car c’est chant, solo d’une voix qui s’élève en multiples tonalités et chœur de voix qui résonnent à travers elle. Chant, psaume, mélopée, cantilène, prière, antienne, ces mots et d’autres encore ponctuant le texte, donnent une des clef de ce recueil à la fois bilan, somme et profession de foi, qui charrie le tout de notre condition humaine énigmatique et contradictoire dans sa houle océane.
- Jeanine Baude, Oui - 6 juillet 2023
- Jeanine Baude, Oui - 3 mars 2019