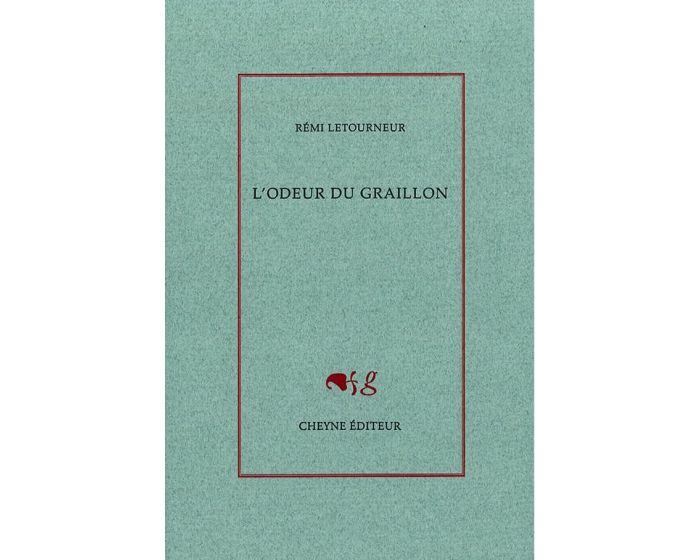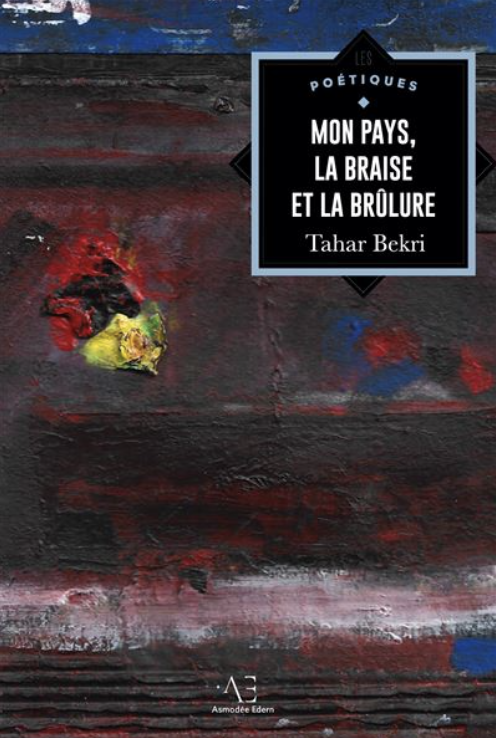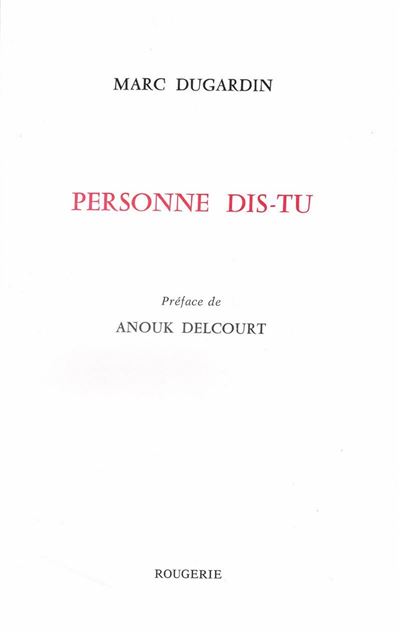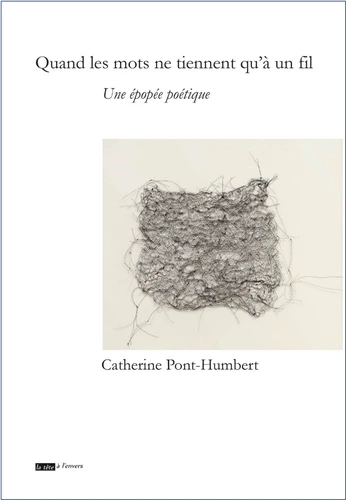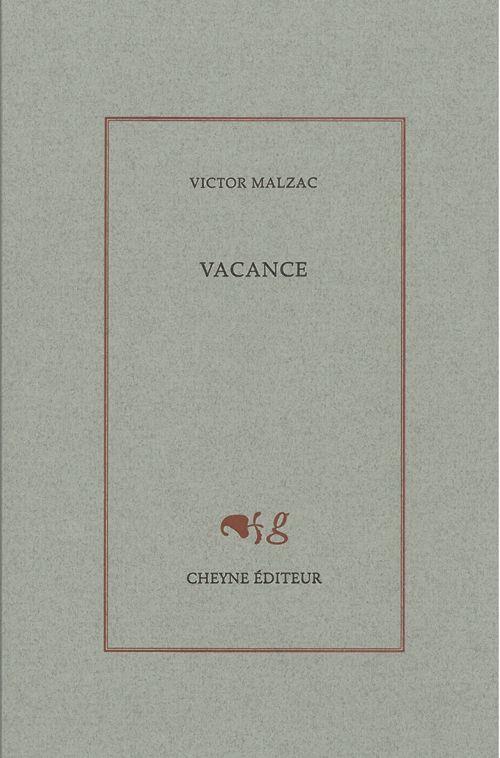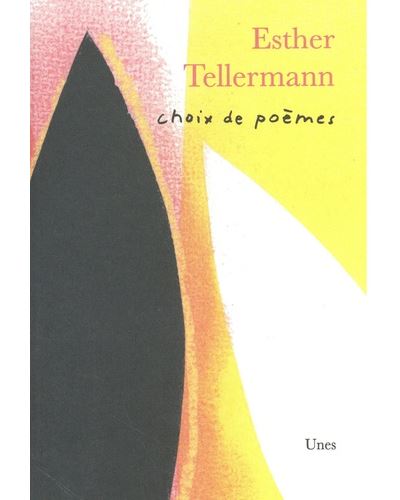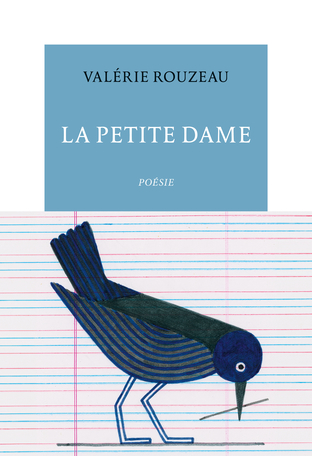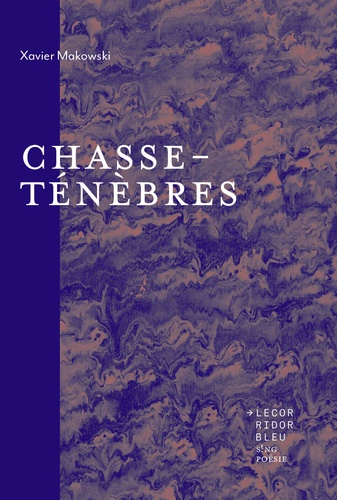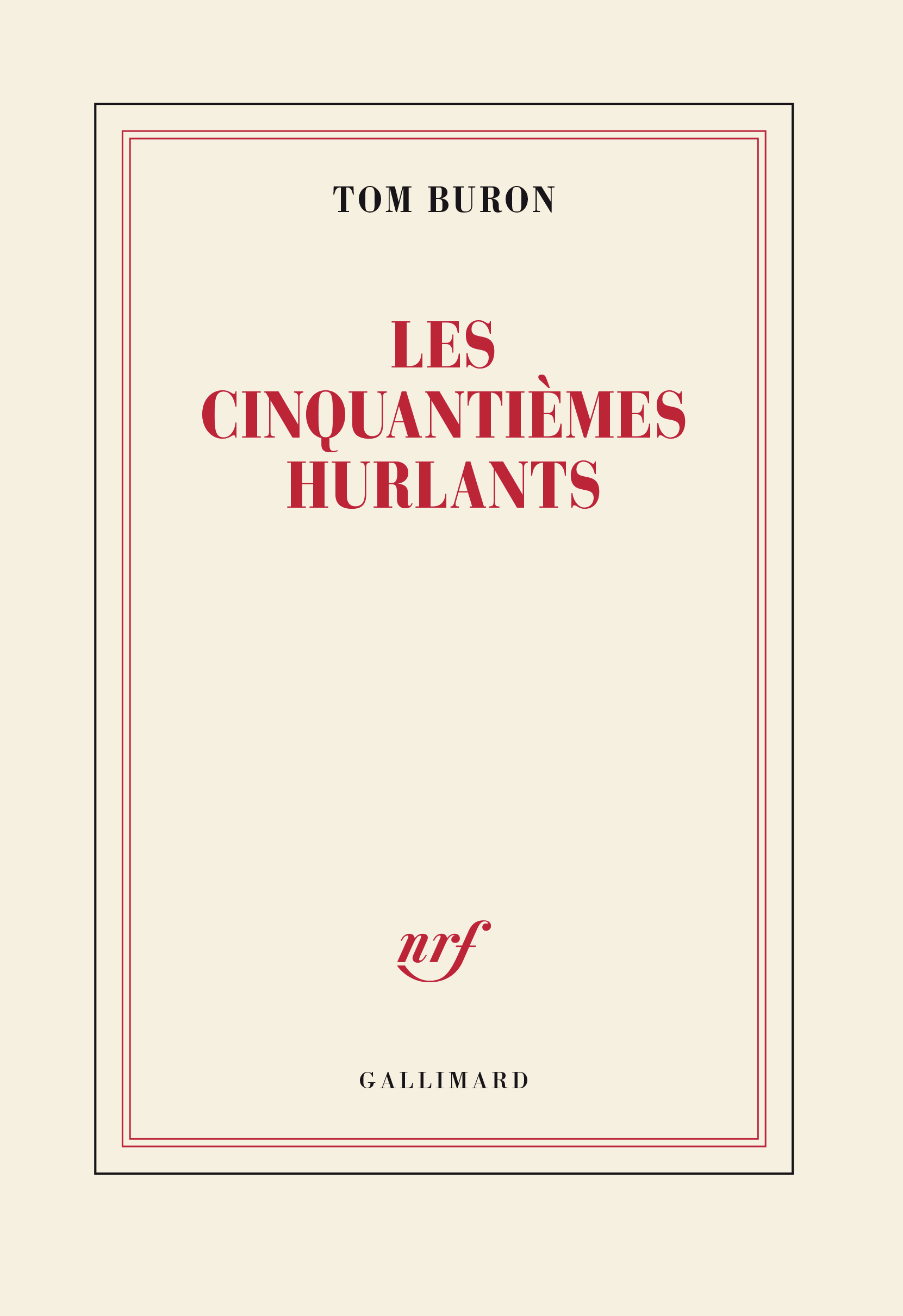Ce livre de grand format, aéré pour des pages souvent lapidaires, commence par une épigraphe empruntée à Yuan Zhen, poète chinois du 9ème siècle après J. C. : « Je n’ai à t’offrir que mes yeux ouverts dans la nuit. » Il s’achève, entre deux pages blanches, par ces seuls mots, mais qui définissent l’ouvrage : « Un petit bouquet mortuaire tendu maladroitement par un enfant au crâne rasé. » Entre ces extrémités, tout Bobin s’insinue. Le mobile est clairement exprimé, page 51 : « Rien de plus heureux que de penser à ceux qui ne sont plus : ils reviennent par cette pensée et c’est comme si on gagnait au bras de fer avec la mort, éprouvant la douceur d’être momentanément vainqueur des ténèbres. »
Noireclaire est constitué essentiellement de sentences, sans être sentencieux. Le monde, Bobin le tient foncièrement à distance. Il le brocarde d’entrée de jeu. « Les yeux vides ont envahi tous les métiers. » Ce monde, toutefois, l’intéresse assez peu. Ainsi vingt ans suffiraient pour que des os [d’une femme de trente ans] ne soient plus que poudre. C’est invraisemblable, dans un cimetière, même qualifié de “joli” page 12. Peu importe, selon lui ! Car les poèmes « donnent des nouvelles du ciel, jamais du monde ». Comment n’en pas douter, pour les nouvelles du ciel aussi ? Que loge en effet Bobin derrière ce vocable ? Il demande, et cette question emplit la totalité de la page 25 : « Chers oiseaux, combien payez-vous de loyer ? » Sur un plan plus symbolique, page 13 : « Le manque est la lumière donnée à tous. » Si, à l’évidence, un réfugié ne peut lire ça sans tordre la bouche, Bobin pour autant croit-il au Ciel ? « Le corps est le seul tombeau. Le mort est une enveloppe dont on a enlevé la lettre. » Ailleurs, il maintient l’éternel. Cette femme perdue, il la qualifie : « ange et pécheresse, inextricablement ». Au milieu du gué, d’un côté, c’est très clair, pour lui. Page 71, cette morte n’est plus : « Ce verre de cristal, je l’ai rempli d’eau fraîche […], je peux le boire d’un trait, toi pas. » Déjà page 14 : « Les ténèbres sont de notre côté, pas du tien. » Mais de l’autre, sur la même page, dans la sentence suivante : « La mort se crispe de te voir lui échapper. » Donc, là, cette morte vivrait encore. Le sésame se trouverait-il page 40 : « À genoux dans la chambre de ta fille tu mets de l’ordre dans ses jouets : c’est la dernière vision que j’ai de toi dans cette vie. Quelques heures après tu n’es plus rien — comme Dieu. »
Si l’ambiguïté constitue assurément une richesse, d’autres imprécisions s’avèrent moins constructives. « Le foulard à ton cou savait tout de ton âme », écrit-il page 35. Facile ? Un peu comme, sur le plateau de La grande librairie, le 15 octobre, il déclare un chant de moineau supérieur à Bach ! Le lecteur curieux lit encore que « les âmes sont des cigales ». Mais encore ? Deux pages plus loin, Bobin affirme que « même nos erreurs, il faut les faire d’une main ferme. Il est impossible de vivre sans cruauté. Respirer, exercer sa joie, c’est déjà blesser quelqu’un alentour. » La quatrième de couverture met au contraire en avant : « Le sourire est la seule preuve de notre passage sur terre. » Plus avant, ce qu’il écrit de la lecture, qu’elle change tout « en bonne farine lumineuse de silence », ne vaudrait-il pas pour son style ? Ainsi peut se comprendre cet appel au meurtre : « Je veux tuer Christian Bobin. » Ne resterait plus, sur la page, que l’impondérable, la voix du silence.
En bref, l’ensemble laisse un peu sur sa faim. Quand, tout au début de Noireclaire, il consigne : « Un tremble se tient à l’entrée du champ comme un jeune garçon de ferme venu demander du travail » et qu’il poursuit, après un intervalle de blanc/silence : « Il attend sa casquette de lumière dans son poing serré », ne se croirait-on pas chez Jules Renard ? Ou bien, sur cette autre méditation, page 42 : « Une goutte d’eau se suicide dans l’évier après une longue hésitation » – comment ne pas rester sur notre soif ? Si Noireclaire, livre de la maturité, accomplit la mission que Bobin s’est assigné : « Je t’écris pour t’emmener plus loin que ta mort », la traversée de ce qu’il ne nomme pas des enfers – sans fermer totalement la bouche à sa douleur, heureusement – connaît des trous d’air, des cahots. C’est un recueil riche, souvent brillant que Noireclaire, mais ce n’est pas le chef‑d’œuvre qu’on est en droit d’attendre de l’auteur.
- Christian Bobin : Noireclaire - 7 juillet 2024
- Christian Bobin : Noireclaire - 1 décembre 2015