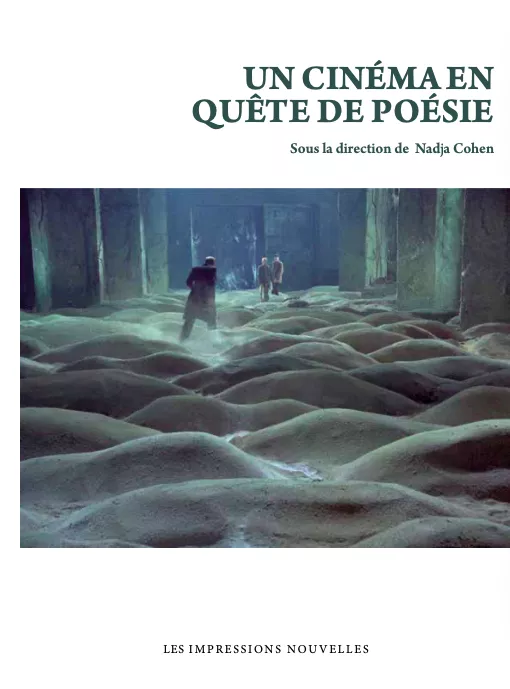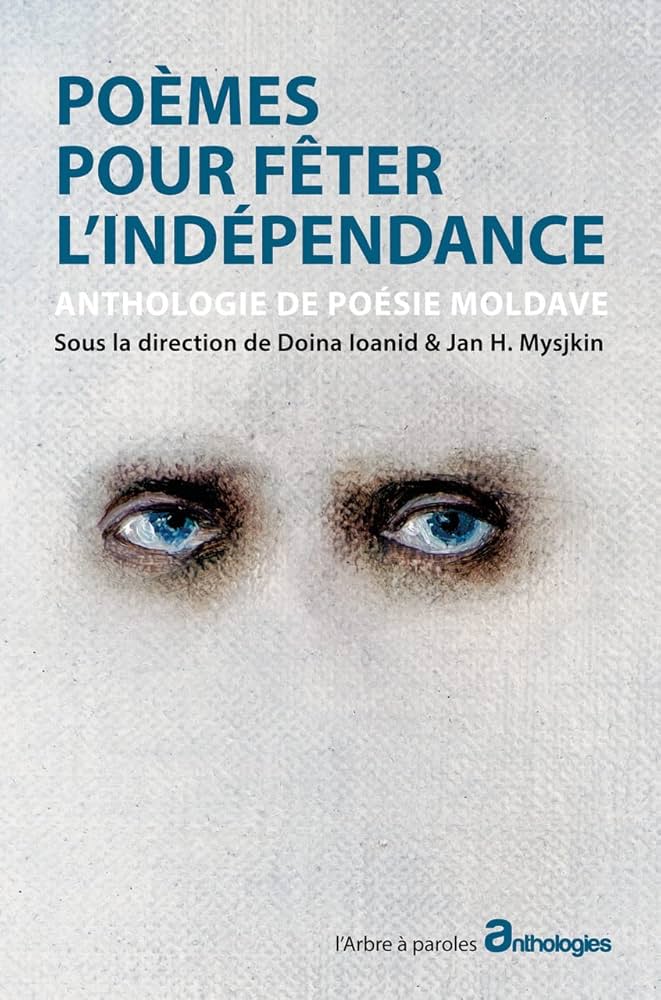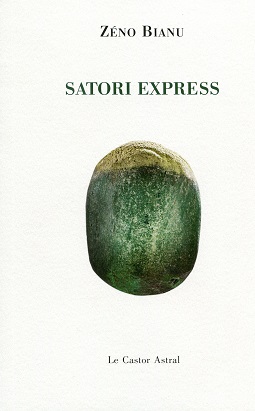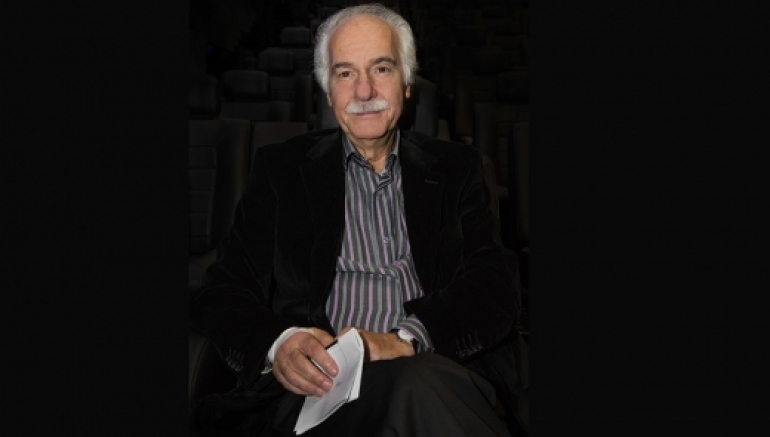Cet article interroge l’atelier d’écriture à l’université comme outil de transmission de la poésie, tout en mettant le cadre institutionnel à l’épreuve d’une certaine idée de la poésie affirmée par nombre de poètes contemporains qui en reconnaissent la part obscure, insaisissable. Il souligne l’importance de la proximité de la lecture et de l’écriture dans l’atelier d’écriture, et parcourt les différentes modalités de transmission attachées à la poésie, l’écriture, la lecture silencieuse et à voix haute, à l’aune de cette idée partagée des poètes.
Le présent article tente de confronter une certaine tradition poétique et critique qui souligne la part d’obscurité convoyée par le langage poétique – tradition dont l’une des voix majeures, dans le domaine de la critique, est celle de Maurice Blanchot – et la pratique de l’écriture et de la lecture dans un atelier d’écriture de poésie à l’université. La raison d’une telle confrontation résulte du paradoxe existant, susceptible d’influencer la réflexion didactique, entre la pratique collective et « ouverte » de l’atelier et la dimension irréductible au sens, autrement dit : de secret, de la poésie. En effet, si l’on considère que le sens constitue le seul canal de la transmission et de la reconnaissance collective, l’on peut dès lors s’interroger sur la place faite dans un tel cadre d’apprentissage à la part d’obscurité inhérente à la poésie.
Dans l’atelier d’écriture, les « inducteurs » d’écriture sont souvent des textes littéraires, de telle sorte qu’y sont conjointes les pratiques de lecture et d’écriture. Si on l’appréhende du point de vue de la durée, cette conjonction est surtout sensible dans un atelier dédié à l’écriture de textes poétiques dont les rythmes et les sonorités sont, dans un tel cadre d’étude, une invitation presque immédiate au lecteur à devenir auteur à son tour. Généralement, les textes donnés à lire pour introduire à l’écriture sont lus sans être soumis à l’interprétation comme ils le sont dans d’autres pratiques de classe. Même si certains éléments de commentaire sont énoncés, l’appréhension de l’extrait n’a pas pour objectif l’interprétation.

De plus, là où un texte inducteur narratif impose l’enchaînement de sa narration comme durée immédiatement intelligible, le poème ou l’extrait-bloc de vers ou de prose poétique n’offre, en fait de prise, qu’un signe, ne fait que suggérer au lecteur quelque chose qu’il serait la plupart du temps bien en peine, sur le vif, de désigner avec précision.
Saisi dans la même immédiateté qu’un poème offert à la lecture dans l’intimité, l’on peut donc supposer qu’il conserve une part de l’obscurité convoyée par le mot, que surgit dans la lecture et est invité à surgir dans l’écriture le langage dans sa « matérialité », pour reprendre le terme utilisé par Maurice Blanchot1. L’écriture alors, dans l’atelier de poésie, porteuse des interrogations et des incompréhensions que la lecture a suscitées, les prolongerait, faisant ainsi acte d’élucidation du réel et se substituant en même temps à l’interprétation. L’obscurité dans le mot, demeurée en suspens dans la lecture, serait pour ainsi dire « reversée » dans l’écriture produisant un effet. Cette obscurité dont le mot est porteur, qui fait de lui un « mot- chose », prolongée dans l’écriture, permettrait de conserver intacte l’émotion poétique que Philippe Jaccottet affirme être « à l’origine de la poésie » (Jaccottet, 2002 : 23), et faciliterait son effective transmission. Ainsi, la proximité des textes – le(s) texte(s) inducteur(s) et le(s) texte(s) produit(s) par l’étudiant – dans leur succession et leur objet (le signe) reconstituerait simultanément les conditions d’émergence et de transmission « active » (en acte) de la poésie.
L’on peut prêter idéalement un tel pouvoir à l’atelier d’écritures poétiques, mais force est de constater que le cadre institutionnel (scolaire, universitaire) dans lequel il a lieu, représente pour beaucoup un obstacle que le pédagogue devrait s’efforcer de neutraliser autant que possible.
Extrait de L’Espace littéraire, de Maurice Blanchot.
Le mort et le vivant
Neutraliser tout d’abord la représentation de la littérature comme « corps mort », pour ainsi dire, ensemble clos destiné à l’étude dont la seule légitimité est la postérité. Entre autres héritages critiques, celui de Maurice Blanchot nous oriente vers la chose vivante, à la fois vers le « livre à venir » et vers le néant en amont de l’écriture ; il fait de la littérature cette chose mouvante, insaisissable, toujours susceptible d’être rendue au néant dont elle est issue et, tout en affirmant l’existence impérieuse de son langage, il en souligne le caractère aléatoire. Peut- être offre-t-il là des outils propres à démonter la certitude attachée à la littérature appréhendée dans un cadre institutionnel…quelle en serait l’utilité pour la transmission de la poésie ? Christian Doumet apporte une réponse à cette question, en plaçant en un même mouvement créateur la lecture et l’écriture :
Lecture de tel poète avec lequel on se sent une sorte d’affinité́ : aussitôt relancé le désir d’écrire notre poème. Pulsion d’imitation. C’est pourtant autre chose qu’il s’agira d’inventer. (…)
(Imiter, mimer : l’un servilement complice du modèle, astreint à re-produire, à retrouver dans les formes le fantôme d’une production antérieure ; l’autre, au contraire, revivant la scène de la création même, en recréant l’élan, la force, le sens, non sans parfois ajouter au spectacle un indice de parodie.) » (Doumet, 2004 : 18).
Revivre « la scène de la création même » est réintroduire le vivant, le mouvant, l’aléatoire de l’œuvre. Au lieu de figer le « modèle » en une « copie », celui-ci devient le moteur d’un acte poétique qui n’outrepasse pas le moment créateur.
Philippe Jaccottet, sur la poésie, 1974.
Cela peut être induit par la pratique même de l’atelier où l’étudiant est engagé dans un procès que l’on peut ainsi désigner : 1. lecture (du ou des textes proposés par l’enseignant) — 2. écriture guidée (à partir d’inducteurs précis) — 3. écriture délivrée (le devenir de l’écrit de réécriture en réécriture). La part du « vivant » relève, au cours de ce procès, de l’appropriation individuelle du texte lu puis de l’acte d’écriture, qui elle-même pourrait bien dépendre du nécessaire « contact », pour ainsi dire, avec une obscurité inhérente à l’œuvre que Maurice Blanchot identifie ainsi :
L’œuvre est la liberté violente par laquelle elle se communique et par laquelle l’origine, la profondeur vide et indécise de l’origine, se communique à travers elle pour former la décision pleine, la fermeté du commencement. C’est pourquoi elle tend toujours plus à rendre manifeste l’expérience de l’œuvre, qui n’est pas exactement celle de sa création, qui n’est pas non plus celle de sa création technique, mais la ramène sans cesse de la clarté du commencement à l’obscurité de l’origine, et soumet son éclatante apparition où elle s’ouvre à l’inquiétude de la dissimulation où elle se retire. » et la lecture « doit donc être aussi retour profond à son intimité [intimité de l’œuvre], à ce qui semble être son éternelle naissance. (Blanchot, 1955 : 271–272).
L’acte de lecture comme d’écriture qui ramène le lecteur à l’origine réalise en cela l’expérience vivante de l’œuvre, non en la rendant intelligible mais, au contraire, en éprouvant « l’obscurité » originelle. Réintroduire le vivant est accueillir et accepter cette obscurité sans vouloir l’expliquer, l’analyser pour la rendre intelligible comme l’on s’y livre ordinairement dans une situation de transmission. Aussi l’atelier d’écriture où les étudiants sont invités non pas à interpréter, mais à écrire dans la continuité de la lecture, semble être d’emblée un lieu propice pour maintenir la part irréductible au sens, donc un lieu particulièrement propice à la lecture et l’écriture de poésie.
Pour Christian Doumet, il existe un mode de lecture rendant sa place à l’obscurité dont l’œuvre est porteuse, abolissant le prévisible qui participe de l’horizon d’attente : « Lire, relire, sur le mode de la lecture la plus désertée ; celle qui, en fin de compte, ne voit plus, n’entend plus. Lecture dépourvue de sens, seule capable de nous arracher au prévisible sens de la suite.» (Doumet, 2004 : 20). La recherche du sens ferait donc obstacle à une compréhension vivante de l’œuvre.
Rejoindre par la pensée l’obscurité antérieure à l’acte créateur, accepter d’éprouver l’inintelligible part de l’œuvre, tel serait l’acte de lecture‑écriture rétablissant le vivant et, peut-on ajouter, l’expérience du réel ouvrant à la transmission, tout cela peut avoir lieu dans l’atelier d’écritures poétiques. Car plus qu’à rechercher le sens, la poésie nous induit à un prolongement, prolongement du poème d’autrui et de son propre poème :
Lire le poème en cours afin de trouver ce qui vient après, c’est prolonger sa mémoire. On dit : invention. Mais la trouvaille est un travail : travail d’une mémoire qui se creuse elle-même pour extraire de son peu encore quelque matière à projeter en avant.
Le poème est une mémoire sans objet (sans contenu) projetée au-devant d’elle-même. (Doumet, 2004 : 31)
Le prolongement est creusement de la matière du langage dans le poème et de la mémoire dans la langue. Ce travail peut avoir lieu dans l’atelier grâce à l’écriture mais aussi grâce à la lecture à voix haute, et c’est bien cette pratique qui pourrait permettre à l’étudiant de tourner le dos à la représentation conventionnelle, close, de la littérature. Il faut cependant surmonter un autre obstacle que celui de la quête spontanée du sens, le cadre lui-même, ou, plus précisément, les contraintes qu’il implique.
Dans l’atelier d’écriture, la lecture comme l’écriture sont tendues vers une double évaluation, celle, immédiate, des lecteurs-auditeurs que sont les participants de l’atelier – dont l’enseignant– et celle, plus lointaine mais constituant un horizon indépassable, qui contribuera au diplôme à venir et pour laquelle l’enseignant a aussi un rôle à jouer. En raison du cadre dans lequel ils opèrent, les étudiants situent d’emblée leurs productions dans la perspective de l’évaluation. Aussi vont-ils rechercher l’acquiescement dans la confrontation aux textes d’autrui ou aux « conseils » de l’enseignant.
Jean-paul Daoust, J’écris.
Mais ce dernier peut bien parfois aspirer à rester muet afin de garantir l’aléatoire, de laisser s’installer progressivement la présence des mots, nécessité (du destin poétique du langage ?) dont il a une vive conscience, et qu’Armel Guerne désigne ainsi : « Des mots, rien que de les poser / L’un à côté de l’autre, / Qui disent plus et vont plus loin/ Que nous n’allons ; des mots / Soudain qui ne sont plus les nôtres / et qui se tiennent tellement / Près d’une vérité suprême » (Guerne, 1973 : 57) Dans la confrontation immédiate à autrui, la durée ouverte où s’inscrit le poids des mots semblerait pourtant refusée, or sans ce « poids » vivant de la parole, la poésie est affaire de conventions et du seul « homme de lettres ». Doit-on en déduire que, pour cette raison, dans l’atelier d’écritures poétiques, l’on se tromperait d’altérité, prenant celle des autres pour celle du monde, appréhendée à travers les autres présents, étudiants et professeur ? Dans ce cas, ne peut-on penser que la transmission de la poésie, vivante de son rapport au réel, en est exclue ?
Il n’en est rien, d’une part parce que la chose écrite est de toute façon livrée au monde, et l’atelier constitue un microcosme dans lequel s’accomplit le même geste d’abandon à autrui, de dépossession de la part de l’auteur ; d’autre part, le rôle de l’enseignant consiste précisément à abolir autant que faire se peut le cadre institutionnel non seulement de la représentation de la littérature et du « littéraire », mais aussi de l’évaluation et du diplôme. Il doit aider les étudiants à ne pas écrire pour les autres, pas plus qu’à lire pour les autres – le diplôme visé participe de cette altérité –, et, pour cela, avant tout autre objectif, veiller à faire acquérir une conscience singulière de la matérialité du langage. Aussi faut-il sortir du cadre des séances d’atelier et placer les étudiants en position de création poétique continue, chez eux, tout au long du semestre, afin de rétablir la durée nécessaire au creusement de la mémoire, pour reprendre l’idée de Christian Doumet.
Il convient également d’éviter que les étudiants éprouvent trop rapidement la satisfaction du texte achevé – sentiment que l’on imagine bien étranger à l’auteur-lecteur solitaire –, en les incitant à privilégier le rythme et le son plutôt que le sens, afin de les sortir de la représentation conventionnelle du « littéraire » et de rendre la primauté à la langue. Certes, généralement, il semble difficile d’échapper au sujet dans un atelier d’écriture, mais l’atelier d’écritures poétiques en ouvre peut‑être plus qu’un autre cadre la possibilité. L’écriture et la lecture de poésie, en effet, imposent un face à face mondain qui permet d’abolir plus facilement qu’ailleurs la médiation que constituent la représentation du « littéraire » et la situation d’apprentissage. Paradoxalement, l’atelier d’écritures poétiques, espace détaché du monde, espace d’exception, d’apprentissage, fermé sur lui-même, où les seules apparentes ouvertures sont celles produites par la présence physique des corps, par des bruits et des odeurs entrés par la fenêtre ouverte sur la pièce et par la langue travaillée, opère à la fois comme lieu de connivence où s’échangent les signes de reconnaissance du face à face mondain, et comme lieu de l’éveil au sens où Yves Bonnefoy l’entend lorsqu’il évoque un livre ayant marqué son enfance, Les Sables rouges : « Et si c’étaient nos lectures qui nous rêvent ? S’il fallait, en tous cas, se réveiller de certaines pour mieux comprendre la vie, et d’abord et dans son sein l’écriture […] ? » (Bonnefoy, 1972 : 127). Éveil à la vie, à l’écriture, à la matérialité du langage, et creusement de la mémoire, de la langue, tel est l’acte « demandé » au lecteur dans l’atelier de poésie, et, si tel est le cas, rien ne pourrait alors faire obstacle à la reconnaissance de cet « ordre qui semble être derrière les apparences, en dépit de tout » (Jaccottet, 2002 : 32), reconnaissance qui paraît nécessaire à la transmission de la poésie.
Henri Meschonnic L’Oscur travaille (1).
A haute voix
Il ne s’agit pas ici de répertorier les divers modes de lecture possibles dans l’atelier de poésie mais il en est un qui apparaît particulièrement propice non seulement à anticiper et prolonger l’écriture du poème, mais aussi à transmettre la conscience d’une poésie vivante, en prise sur le réel : la lecture à voix haute. Certains poètes la considèrent comme nécessaire au processus d’écriture. Ainsi, pour Christian Doumet, elle fait effet de relance :
En cours d’écriture, l’idée vous vient assez régulièrement de lire à haute voix une première ébauche. Vous y mettez le ton de la plus fervente conviction — ton qui n’est pas exempt de vibrations déclamatoires. Cette lecture vous conforte. Il se peut même que l’entraînement suscite quelque avancée supplémentaire. » (Doumet, 2004 : 21).
Cependant, dans l’atelier de poésie, espace collectif, l’on se trouve, toutes proportions gardées, dans une relation au texte lu à voix haute assez identique à celle des lectures publiques de poésie qui, comme on sait, ont fait débat. Je renvoie ici à divers articles de l’ouvrage collectif coordonné par Jean-François Puff (Puff, 2015), dans lequel, notamment, Thierry Roger rappelle la controverse, dans les années 20, autour de la mise en voix et en scène de Un coup de dés de Mallarmé par le groupe Art et Action2 et la résistance de Paul Valéry aux arguments des comédiens selon lesquels cette entreprise aurait répondu au vœu du poète et favorisé la compréhension du poème. La question de l’interprétation scénique valant interprétation sémantique fut un débat d’époque, et T. Roger cite en ce sens le Billet à Angèle d’André Gide daté du mois de mai 1921, dans lequel ce dernier propose de lire à haute voix des pages de Proust pour les rendre intelligibles (Puff, 2015 : 64). Cette théâtralisation de la poésie ou de la prose par la lecture a donc pour objectif le sens et, si elle peut intéresser l’atelier, il n’en reste pas moins que l’objectif, comme cela a été expliqué précédemment, en est bien différent puisqu’il a trait à la matérialité du langage.
Si la lecture publique fait acte, c’est davantage au sens scénique du terme : en ce sens, l’atelier d’écriture me paraît être comme une seconde scène où les modalités (françaises) de la lecture à voix haute, partagée collectivement comme dans une lecture publique, se trouvent reproduites : elle participe de l’écriture. Modalités françaises en effet, comme l’explique Abigail Lang dans le même ouvrage où il présente l’émergence et l’évolution de la lecture publique de poésie aux Etats-Unis et en France au cours des décennies 50 et 60. Abigail Lang y note que la spécificité française de la lecture publique de poésie est d’être restée attachée au texte très longtemps, alors qu’aux Etats-Unis, dès les années 50, peu d’attention est portée à la forme écrite (Puff, 2015 : 205–235). Certes, la distinction ne vaut plus pour les décennies suivantes (en témoignent Bernard Heidsieck, Julien Blaine ou Jacques Rebotier, entre autres poètes) mais il faut reconnaître que le texte écrit persiste dans l’idée même de poésie, comme on le constate en lisant Jacques Roubaud qui préconise – non sans humour – de nommer « performances » et non « poésie » les mises en scène de poèmes soumises au « VIL » (Vers International Libre) responsable de la « domination d’une poésie versifiée selon un mode d’organisation uniforme, valable partout » (Puff, 2015 : 311).
Les planches courbes, Yves Bonnefoy, 2002, lecture pour un disque édité par Gaster Oprod / ERE Prod.
Lecture à voix haute attachée au texte écrit, certes, mais aussi à l’écriture car cette représentation plutôt française de la poésie va de pair avec l’idée d’une lecture à voix haute participant de l’acte d’écriture dont Christian Doumet a fait l’expérience et que reconnaît aussi Abigail Lang. Qu’elle ait lieu dans un espace public ou dans la solitude de sa chambre, la lecture à voix haute reste bel et bien une étape importante de la création du poème pour plusieurs poètes, tel Jean-Marie Gleize qui reconnaît en cela une fonction majeure de cette pratique, établissant un passage permanent entre elle et l’écriture :
(…) je dirais que la fonction institutionnelle, ou promotionnelle de la lecture publique, (l’élargissement de la réception de pratiques dites difficiles), ou sa fonction incantatrice (de passage spectaculaire de l’abstrait du livre au concret d’un corps parlant, supposé faciliter la compréhension ou tout au moins l’appréhension sensible du texte), viennent à mes yeux au second plan derrière cette fonction (…) qui consiste à comprendre la lecture (il faudrait d’ailleurs dire les lectures, les séquences de lectures, impliquant va-et-vient entre inscription et oralisation, entre travail en retrait et confrontation directe à des auditeurs), comme partie prenante du geste et du procès de l’écrire, comme nécessaire composante de ce procès. Il me semble très sincèrement aujourd’hui que je ne pourrais plus envisager pleinement la composition écrite sans ces aller-retours, sans ces passages répétés par l’épreuve de la lecture publique. » (Puff, 2004 : 245–246).
L’atelier d’écriture offre en cela aussi l’occasion de dépasser son propre cadre, de tourner le dos à la fonction « institutionnelle » – pour reprendre les termes de Jean-Marie Gleize – : l’oralisation des poèmes, quel qu’en soit l’auteur et le lecteur, permet à l’enseignant, au moyen de la répétition, l’insistance, voire le commentaire phonétique, d’éveiller chez les étudiants la conscience de cette « fonction incarnatrice » de la lecture qui, comme l’indique l’adjectif, participe aussi de la transmission vivante de la poésie.
Rythme, son et sujet
Or, ce qui rendrait possible l’éveil de cette conscience est le fait que cette fonction de la lecture à haute voix et publique, qualifiée d’« incarnatrice » par Jean-Marie Gleize, résulte à mon avis d’une opération des sens qui opère sur le mot et à partir du mot en amont même de toute tentative d’oralisation et, de surcroît, de théâtralisation du texte, comme l’invitent à le penser les propos de Claude Esteban recueillis dans un entretien réalisé par Laure Helms et Benoît Conort :
Bernard Heidsieck, “Dans l’atelier”, documentaire de 1994.
Renonçant à leur claustration implacable, à l’hégémonie de la chose écrite, il importait que les mots recouvrent un volume, une teneur charnelle dans la bouche, une véritable matérialité́ sonore. Cette rythmique visuelle dont je les avais investis, jusqu’alors prépondérante, devait se doubler, même au cours d’une lecture silencieuse, de scansions perceptibles par l’oreille, de tempos différents qui précipitent ou retardent le flux verbal, de telle sorte que le poème, désormais, ne se présente plus sous les dehors d’un texte épousant l’étendue de la page, mais bien plutôt comme une partition orchestrale, qu’il appartiendrait au lecteur de déchiffrer et de suivre dans son développement mélodique. Le poétique devait s’allier au prosodique, si du moins celui-ci ne se résumait pas, comme on feignait de le croire, à de pures contraintes métriques et à des codes de versification. […] Je m’autorise à penser – et c’est à quoi j’espère me tenir – qu’il ne s’agit pas uniquement de la musicalité́ inhérente aux sons des vocables, tels qu’ils s’organisent et se distribuent dans l’élaboration de la matière poétique – assonances, allitérations, jeux de syllabes longues et brèves – mais en vérité́ de la poursuite d’une harmonie plus vaste, qui régit aussi bien les constellations que le souffle qui nous porte, et chacun de nos pas3.
Claude Esteban, s’attachant au mot, en éprouve la musique, le « poids vivant » – pour reprendre les termes d’Armel Guerne –, qu’il lie au souffle et au pas, au corps en mouvement. De la lecture silencieuse ou à haute voix au texte écrit, il s’agit moins d’une transition formelle que d’un passage de souffle, de rythme. Henri Meschonnic qui se situe dans la perspective du sens souligne la prépondérance du rythme dans et pour le sens dans le troisième chapitre de Critique du rythme intitulé « L’enjeu de la théorie du rythme » (Meschonnic, 1982 : 70). Après avoir affirmé le « rapport d’inclusion » dans lequel se trouvent rythme, sens et sujet, il met à distance le primat du signe dans l’approche épistémologique et constate qu’une théorie du rythme rendrait sa véritable importance au sujet (ahistorique) et à l’individu (historique)4. D’Esteban à Meschonnic, l’on peut établir une forme de continuité malgré la différence d’intention : le rythme (le souffle) serait – en tant que système d’organisation de tout discours tel que le décrit Henri Meschonnic – la clef d’accès à une présence qui se dérobe, à l’« harmonie plus vaste » évoquée par Claude Esteban. La quête obstinée du sens qui pourrait faire obstacle à cet accès se trouverait en quelque sorte détournée dans l’appréhension du rythme, l’appropriation du souffle, et aboutirait à un sens, certes plus aléatoire, mais « plus vaste » que la signification.
Dans l’atelier d’écritures poétiques, comme cela a été dit, le sens lié au signe n’est précisément pas en défaut, bien au contraire, il a tendance à capter toute l’attention ; sa prépondérance ratifie, dans le contexte de classe, l’absence de ce que j’appellerais, par convention héritée des poètes, l’ouverture à la « part obscure » ou « vérité » ou « réel », qui œuvre à une transmission vivante de la poésie. Encourager le rythme permettrait d’introduire cette ouverture sur ce qui échappe :
Débordant des signes, le rythme comprend le langage avec tout ce qu’il peut comporter de corporel. Il oblige à passer du sens comme totalité-unité-vérité au sens qui n’est plus ni totalité, ni unité, ni vérité. Il n’y a pas d’unité de rythme. La seule unité serait un discours comme inscription d’un sujet. Ou le sujet lui-même. Cette unité ne peut être que fragmentée, ouverte, indéfinie. » (Meschonnic, 1982 : 73).
L’insistance sur le rythme et, ce faisant, sur la conscience du souffle – ce à quoi contribue notamment la lecture à voix haute — atténue le primat du signe et favorise le vivant, « l’ouvert », et ce, notamment, en introduisant l’aléatoire, la fragmentation de l’unité, du sujet.
Enfin, mettre à distance le sens au profit du rythme ne peut-il pas aussi résulter de la convocation d’un surcroît de signes ? Rompre les rythmes d’une langue en convoquant d’autres signes, d’autres rythmes donc, afin de les rendre plus tangibles, telle a été l’expérience de Claude Esteban, et c’est ce qui l’a conduit à la traduction. Si l’on place les étudiants face à la nécessité d’opérer le transfert d’un poème de sa langue originale vers une langue autre, ils saisissent la différence des rythmes, du verbe, de la phrase, et prennent pied dans la matérialité du langage. Et c’est bien parce que la poésie touche à autre chose qu’à l’immédiat intelligible qu’elle y donne accès : « La poésie ne se souciait nullement des significations établies, elle était seule à conférer aux signes verbaux une charge signifiante qui échappait aux critères de l’entendement, qui faisait de ces mots, à quelque langue qu’ils appartiennent, les porteurs d’un sens qui les dépassait sans les détruire. » (Esteban, ibid.). Il est notable qu’Esteban attribue à la seule poésie ce pouvoir d’accès au réel, poésie à laquelle il oppose ce qu’il désigne comme « discours », une chaîne syntagmatique « soumise aux codes », au commun intelligible. La poésie l’entraîna à explorer toujours davantage les œuvres de langue espagnole, et la traduction lui permit d’atteindre le point « d’indifférence » de la lecture et de l’écriture : « Traduire Guillen, c’était croire derechef à la cohésion du monde, à son ordonnance, à son invulnérabilité, sous les espèces tangibles du poème. Et ce poème que je n’avais pas écrit, voici que de l’avoir porté jusqu’aux rives de notre langue, il devenait presque le mien. » (Esteban, voir note 3). Ecrire pour traduire conduit à une lecture en acte, à son tour génératrice d’écriture, en raison même de la relation concrète établie avec le réel dont le texte est porteur par le rythme et par-delà les mots et l’enchaînement syntagmatique du discours. Claude Esteban voit cela comme une « manière d’appropriation », mais aussi un prolongement, une reprise de la voix de l’autre, en résonance. Le travail sur le rythme, que ce soit, notamment, par la lecture à voix haute ou par la traduction, semble ainsi réaliser, par appropriation, la transmission concrète, vivante de la poésie.
Conclusion
Au terme d’un siècle où tant de voix se sont élevées pour reconnaître le rôle actif du lecteur, s’il est facile de comprendre en quoi l’écriture et la lecture se rejoignent dans le processus de création, il est plus difficile de situer l’activité de lecture et d’écriture poétiques par rapport à ce troisième terme, tapi dans l’épaisseur du réel, mystérieux et se dérobant sans cesse, qu’est la chose vivante et concrète, éprouvée d’abord ailleurs, avant même la parole, terme reconnu comme essentiel à la poésie. L’indifférenciation de la lecture et de l’écriture semble être une modalité du texte « en acte » pouvant rétablir ce troisième terme, y compris dans le cadre collectif qu’est l’atelier d’écriture. Cette indifférenciation relève d’un processus d’appropriation vivante (participant du vécu) du poème par la voix, le rythme, de l’oubli du cadre et de ses contraintes dans la mesure du possible, et, paradoxalement, du retrait de la signification. Si y parvenir constitue l’objectif premier du travail des étudiants et si de telles conditions sont réunies, alors ne peut-on considérer l’atelier d’écritures poétiques comme un outil particulièrement propice à la transmission de la poésie puisque c’est vivante, incertaine, lointaine et proche à la fois, qu’elle est non pas, du reste, à proprement parler « transmise » mais offerte ? En effet, comme s’en exclame le poète : « (…) à quoi bon l’interminable si la vie n’est pas rejouée / quand l’herbe aura poussé sur la langue on trouvera peut‑être / l’articulation du mystère parmi les restes d’une phrase » (Noël, 2007 : 183).
Références
Blanchot M., 1955, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard.
Bonnefoy Y., 1972, L’Arrière-pays, Paris, Gallimard, 2005.
Cools A., 2007, Langage et subjectivité. Vers une approche du différend entre Maurice Blanchot et Emmanuel Lévinas, Dudley, MA, Peeters.
Doumet C., 2004, Poète, mœurs et confins, Seyssel, Champ Vallon.
Gleize J.-M., 2015, « A quoi ça sert ? », pp. 237–248, in : Puff, J.-F., dir., Dire la poésie ?, Nantes, Éd. nouvelles C. Defaut.
Guerne A., 1973, Sourde écoute, repris dans Le Poids vivant de la parole, Gardonne, Fédérop, 2007.
Jaccottet P., 2002, De la poésie, entretien avec Reynald André Chalard, Paris, Arléa, 2007.
Lang A., 2015, « De la poetry reading à la lecture publique », pp. 205–235, in : Puff, J.-F., dir., Dire la poésie ?, Nantes, Éd. nouvelles C. Defaut.
Meschonnic H., 1982, Critique du rythme, Paris, Verdier.
Noël B., 2007, « Le volume des mots », in : Christian Hubin, Sans commencement, Bibliothèque municipale de Charleville-Mézières.
Roger T., 2015, « Mise en page et mise en voix du poème : le cas de Mallarmé », pp. 59–100, in : Puff, J.-F., dir., Dire la poésie ?, Nantes, Éd. nouvelles C. Defaut.
Roubaud J., 2015, « Poésie et oralité », pp. 307–318, in : Puff, J.-F., dir., Dire la poésie ?, Nantes, Éd. nouvelles C. Defaut.
Notes
1 Sur le concept de matérialité du mot et du langage chez Blanchot, voir la synthèse d’Arthur Cools dans Langage et subjectivité. Vers une approche du différend entre Maurice Blanchot et Emmanuel Lévinas (Cools, 2007 : 50–53).
2 Groupe fondé et animé par Edouard Autant et Louise Lara entre les deux guerres et promouvant un nouveau théâtre.
3 Séance de la Revue parlée consacrée au poète Claude Esteban le 11 décembre 1978 (Centre Georges Pompidou), reproduite sur le site de Jean-Michel Maulpois : http://www.maulpoix.net/esteban.html/. Consulté le 10/03/2016.
4 « Une théorie du rythme est nécessaire pour une théorie du sujet et de l’individu, car elle prend en défaut la métaphysique du signe. Celle-ci opère par l’effacement de l’observateur-sujet confondu avec la vérité de l’observé, de l’objet, comme si les conditions de l’observation n’étaient pas inséparablement subjectives- objectives. » (Meschonnic, 1982 : 78–79)