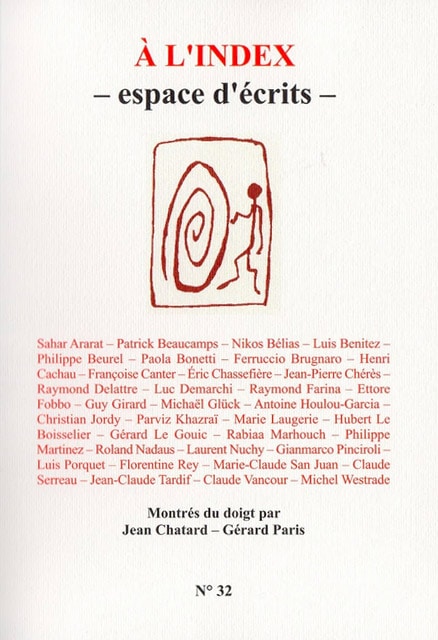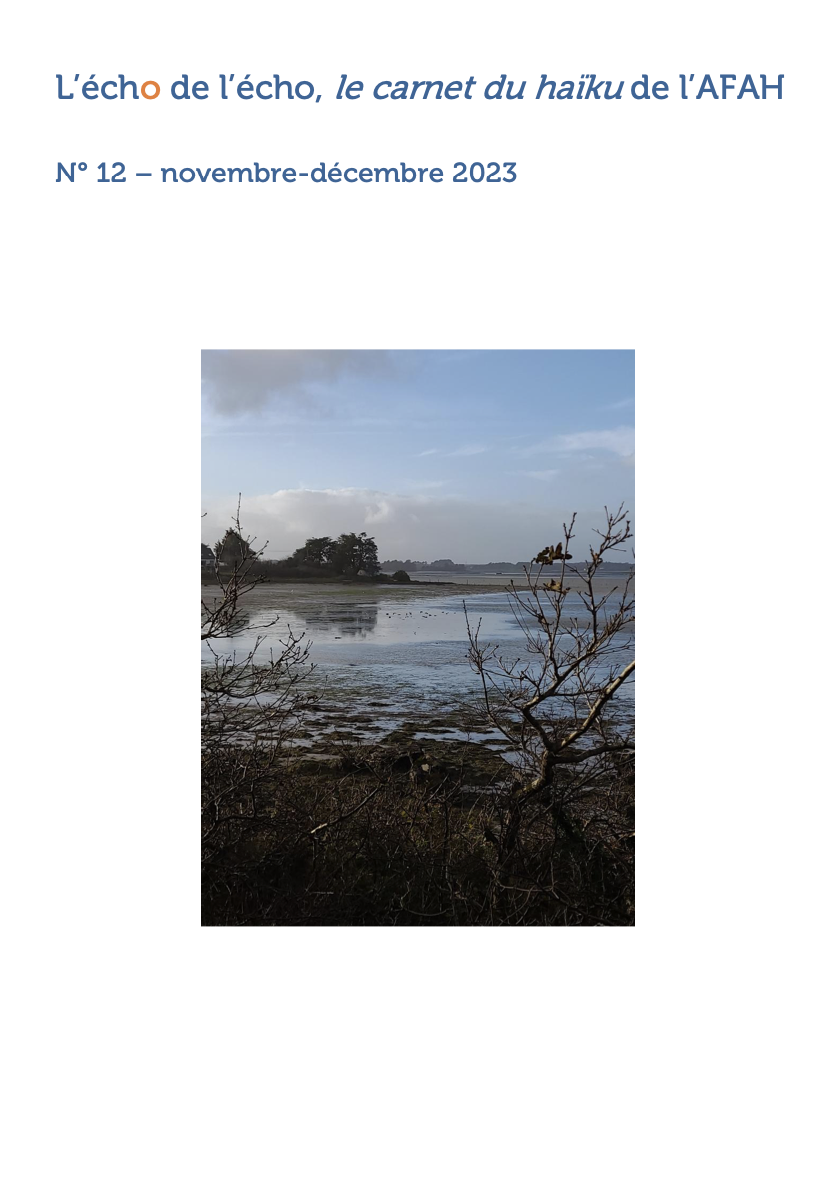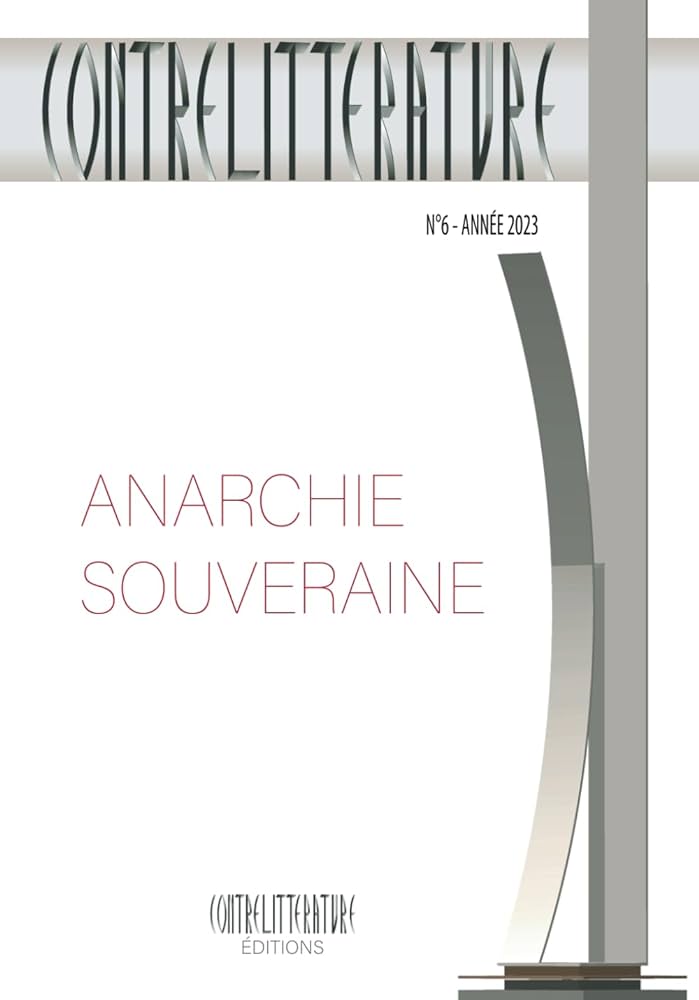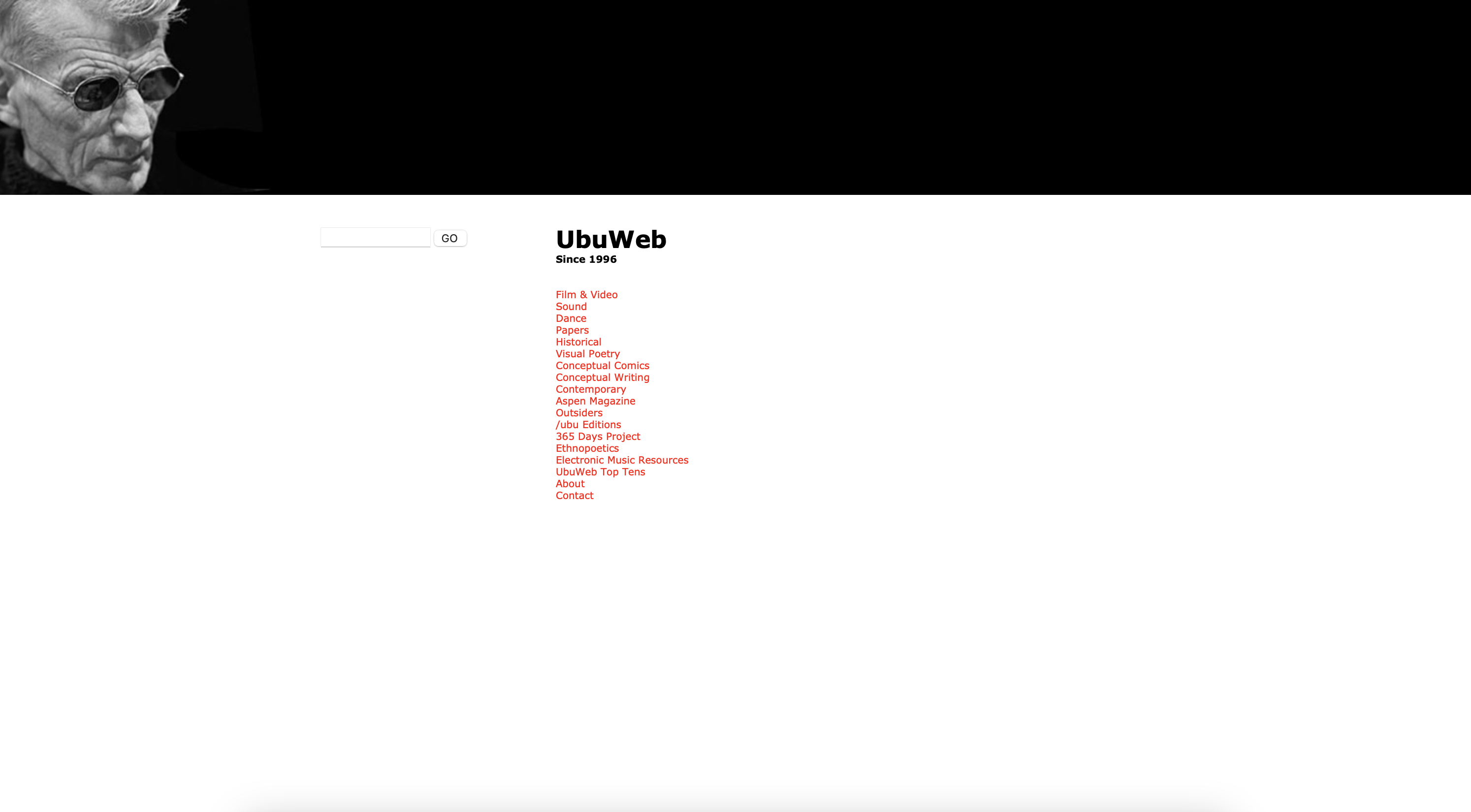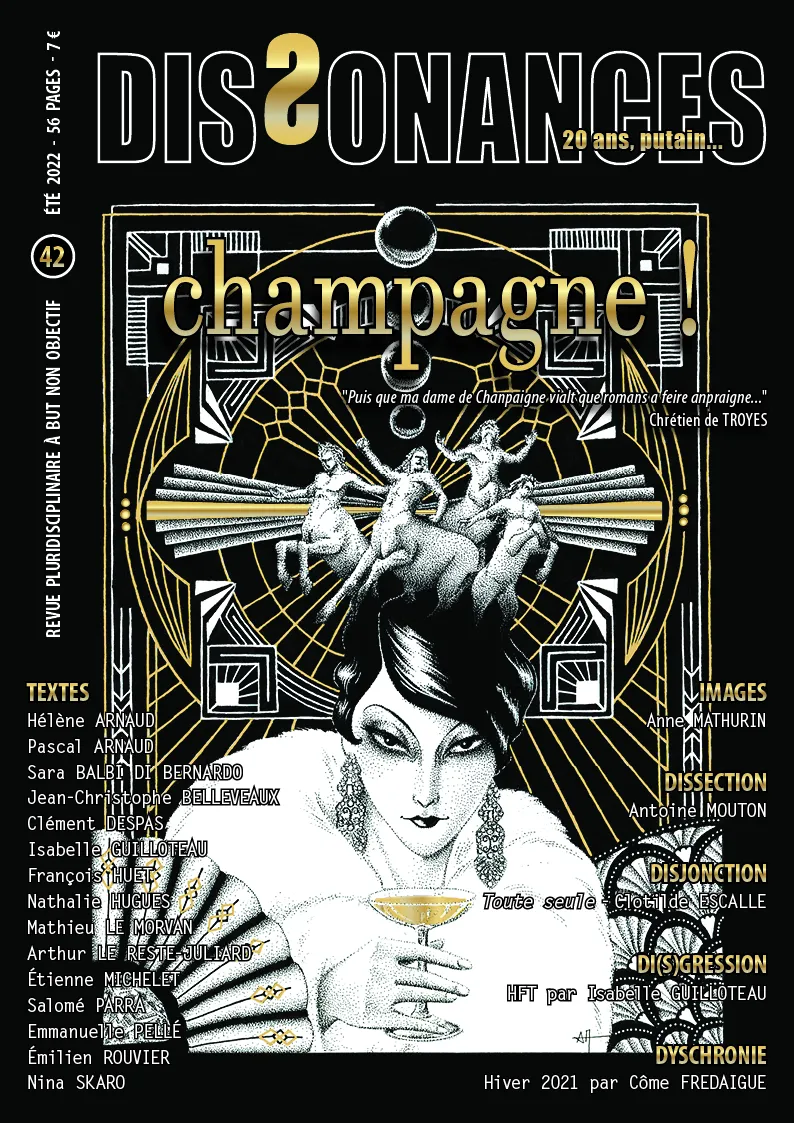Joli numéro, pour cette revue trimestrielle québécoise fondée en 1976 et dirigée par Véronique Cyr ! Et qui montre la vitalité de propos et de voix de la poésie du Canada francophone. Peut-être cette vitalité est-elle d’ailleurs en partie assurée par la forme très fréquente de l’interlocution dans les poèmes qui y sont présentés : le « je » s’y adresse très souvent à un « tu », le « toi » est désigné, apostrophé, abordé, qu’il soit le sujet lyrique lui-même ou un autre véritable.
« C’est toi que j’avais reconnu en moi au commencement du monde » (Faustino)
« Tu essaies de vivre la vie normale des autres » (des Roches)
« J’aime à braconner la fourrure usée de ton lit » (Cotton)
La narration, le mode épique qui semble fait pour décrire et raconter le trop plein puissant du monde, à la frontière du romanesque, cela aussi est présent, chez Patrick Brisebois, par exemple :
« Elle a toujours eu les hommes qu’elle voulait / avec sa dentition son apparence noble / ses cheveux d’encre chinoise / il dit qu’il arrive de trop loin / de la boue noire des hommes noirs / je titube entre les murs j’ai froid / il n’y a plus de bois pour le feu »
dont le poème fait penser à l’éparpillement synthétique du Dos Passos de Manhattan Transfer racontant les destins, les scènes de vies et les solitudes entrecroisées de New York.
Le numéro s’ouvre avec la présentation par Véronique Cyr de la thématique : « le ça qui hante » (exergue de J.-B. Pontalis) les « imaginaires de l’idée fixe », maladie, mort, apparition, « ça dérangeant », poésie elle-même, tant il est vrai que « l’écriture poétique est une voix basse toujours en état de veille » (p. 4). Mais cette hantise n’ouvre nullement sur un traitement « gothique » des choses. L’expression y est plus proche du roman noir et de la langue cinématographique et picturale de la Nouvelle Figuration Narrative (Monory) ou des Boulevards du Crépuscule.
Les auteurs y sont présentés par ordre alphabétique, et non par « manière » ou par centre d’intérêt : cette démocratie de l’irraisonnée, à la fois arbitraire et essentialiste (comme celle du dictionnaire), correspond bien, au fond, à cet univers mental fait de rencontres, d’aléatoire et de chocs, où l’on cherche les profondeurs du sens. Le premier, Jean-Philippe Bergeron, qui nous parle « Après la catastrophe », restitue notre présent à la fois préhistorique et technologique où « les mains armées de bifaces fouillent les carcasses de mouton, font jaillir le pétrole ». Il y fait dialoguer, sur huit séquences, microcosme et macrocosme, corps et planète, cancer et guerres civiles, maladie de l’un et corps exploité de l’autre. La poésie est comme l’expression de l’ignorance et du désarroi violent de l’homme moderne aux « sorcelleries antibiotiques » et aux luttes primitives, d’agressé plutôt que d’agresseur : « et tu fabriques de la survie mes seules têtes de flèches. »
Patrick Brisebois raconte ensuite un amour interdit moderne, un peu gothique tout de même, avec « Tampax dans la poubelle / cheveux au fond de la douche » mais aussi avec « transformés en loups de pleine lune », « Hors-las de Maupassant » et « nécropole de ceux à peau grise ». Avec Shawn Cotton, l’amour, le désir et la séparation se racontent dans une quotidienneté à la fois triviale et érudite, où le franglais naturel (« un bloc de download de temps ») côtoie Nerval et Gaëtan Picon. Véronique Cyr, sous le patronage du poème « 3 – Ménade » de Sylvia Plath, évoque les massacres du Rwanda en contrepoint d’une guerre de couple (ou pour le couple impossible ?) et l’impossibilité (métaphysique ?) de traiter « une guerre à la fois ». Carole David propose cinq scènes violentes et brèves du monde états-unien : « Je viens de t’abattre à la sortie du motel », « un autre debout avec un fusil », « les religieuses squattent les terrains des Indiens, elles crient au viol », avec en toile de fond cette violence sociale et historique américaine qui ne passe pas, malgré le temps, et que caractérise l’indigence des solutions : « il arrive qu’une voix noire me parle en rêve », « tu ne m’as rien donné pour guérir ». Roger des Roches présente, en trois proses poétiques « trois femmes hantées » dans « la chambre du fond. Que tu ne partages plus avec qui que ce soit depuis combien de temps ? Un an ? ». Alexandre Faustino est lui-aussi « hanté par ce lit […] rejoignant le calme brutal de la matière », mais sur un mode plus métaphysique, tandis que Catherine Harton dit, en sept poèmes strophiques la vocation de la mort inscrite dans la condition humaine, la poésie, cependant, comme espérance de vivre qui nous hante, comme « espérer autre chose que l’amiante des poumons, la lumière névralgique, les éclosions difficiles », et la rémanence qu’on voudrait croire exténuable du passé allemand : « maintenant que j’ai connu la Bavière sous forme bénigne ».
Anne Lafleur propose dix poèmes brefs d’un érotisme violent aux signifiants explosés. La hantise s’y exprime à travers le dé-signifiant, l’acte de dé-dire le sens, lacérer, hoqueter, étrangler la phrase pour ne pas dire tout à fait le sens tabou ; spasmes et bribes y expriment la dimension scatologique de la déjection-éjection poétique. La prose poétique de Frédéric Marcotte, elle, réfléchit avec une certaine finesse dialectique sur le regret d’amour, et la capacité à conquérir sa liberté en hantant l’autre parce qu’on est hanté par lui. Michaël Trahan termine cette belle suite de talents par trois poèmes placés sous le signe de Kafka et qui font retentir une voix étrange, entre Agrippa d’Aubigné et Samuel Beckett, pleine de fantômes, de corporel et de mystères ; il nous ramène en quelques sorte en-deçà des Lumières vers ce seuil inquiet de la Renaissance où le matériel et l’irrationnel ne sont pas encore mis à distance l’un de l’autre par le bel ordonnancement de la raison, des figures et des mythes gréco-romains :
« J’ai peur c’est ma peur ma peur longtemps.
J’ai os. J’ai allumette. J’ai rien je fais la liste
des choses qui cassent. Tête, ronde ou non.
Noir, cette lumière-là. Je fais la liste des choses
qui meurent. Je suis un fantôme, je suis
deux fantômes, pas trois, pas quatre,
mais j’ai de la clarté pour toute une vie.
Un drap qui bouge, quoi je hante. »
Beau numéro, donc, de poésie vivace. Si l’achevé d’imprimer date déjà d’un an exactement (mai 2014), sa poésie n’est pas à douze mois près, assurément, ni passée, ni fanée. Pour l’abonnement à la revue, il était à 41 dollars les quatre n° pour le Canada même ; prix au n° : 10 dollars, ou 8 euros … à l’époque. Revue subventionnée par les Conseils des Arts et des Lettres du Québec, du Canada et de la ville de Montréal. Ahhh ?! … Une poésie académique, alors ? Pas mal !
Emmanuel Baugue vient de publier son premier recueil de poèmes : Falaises de l’abrupt.