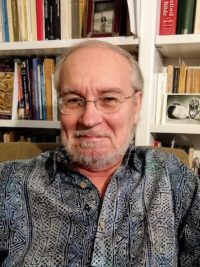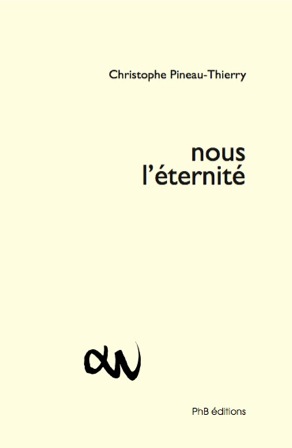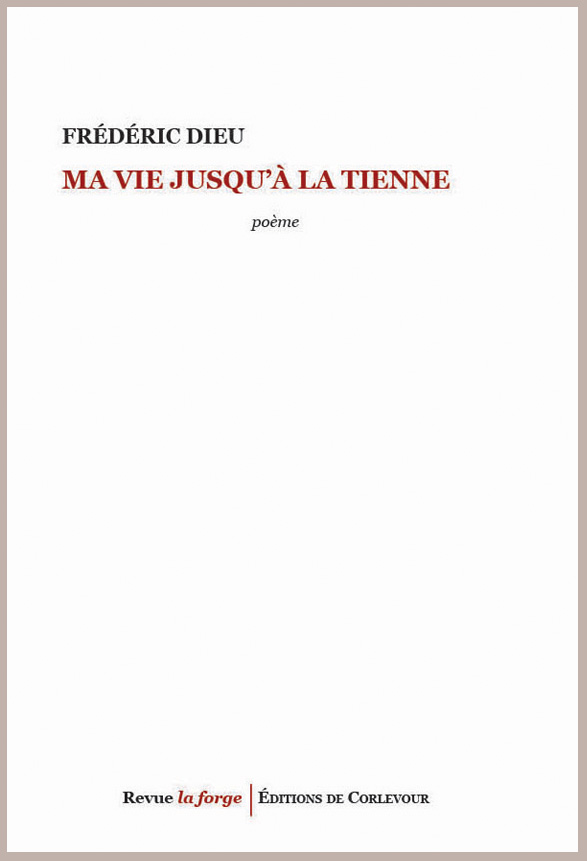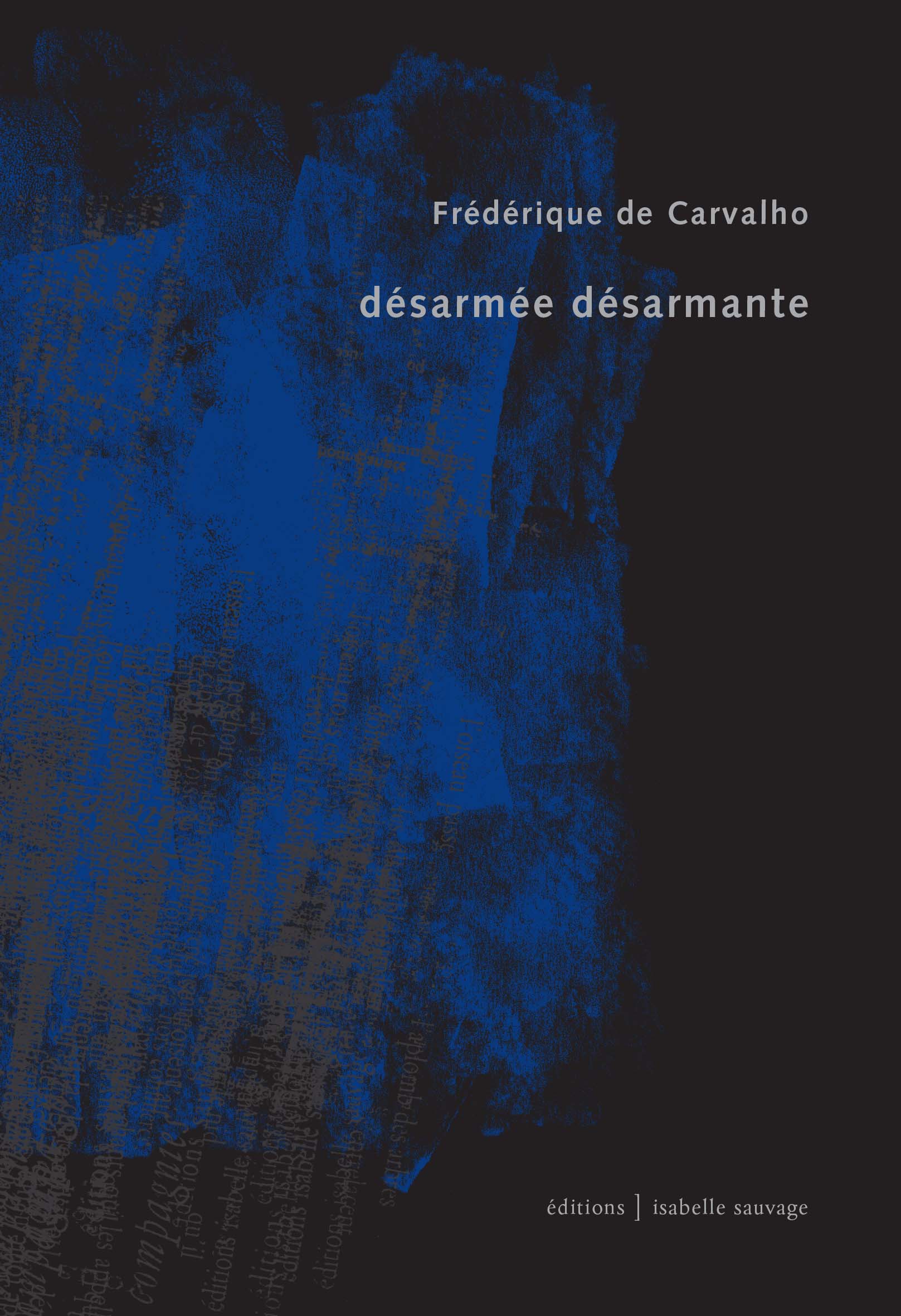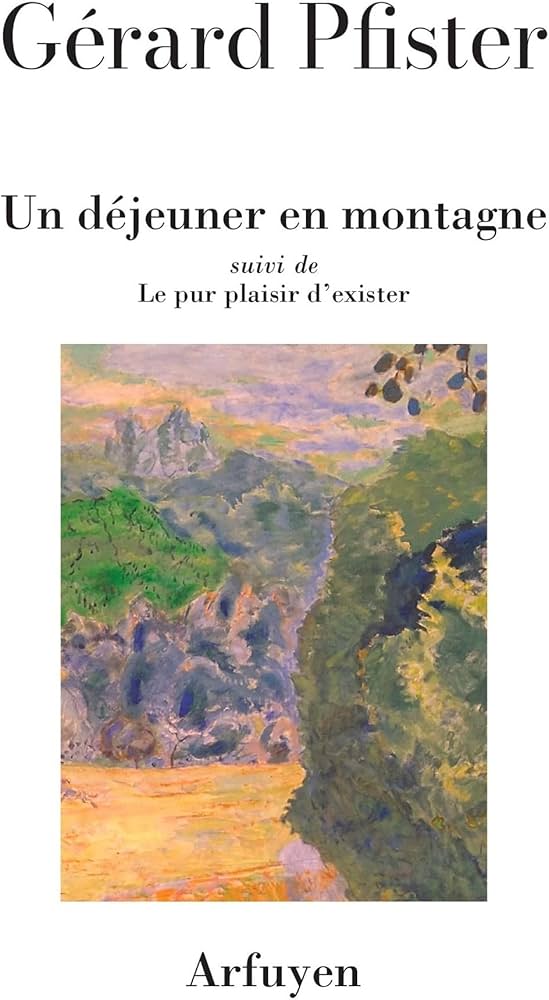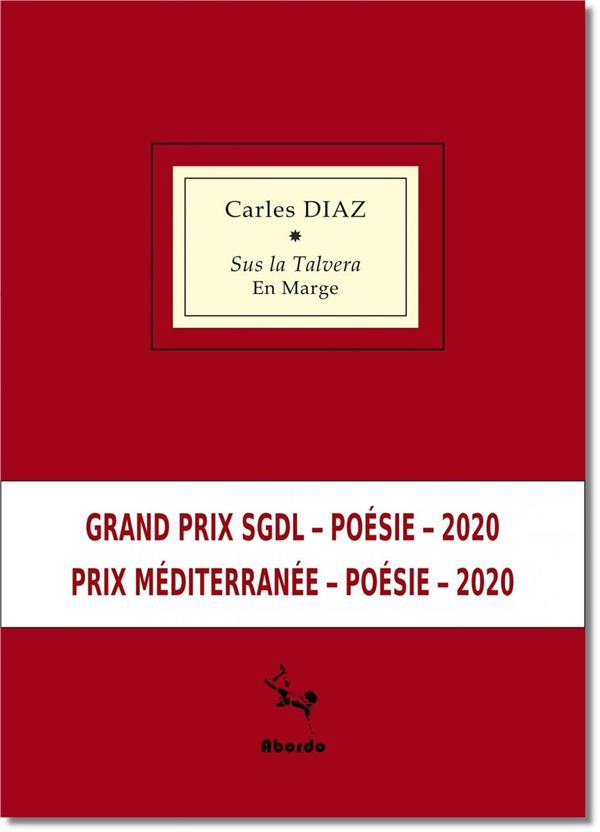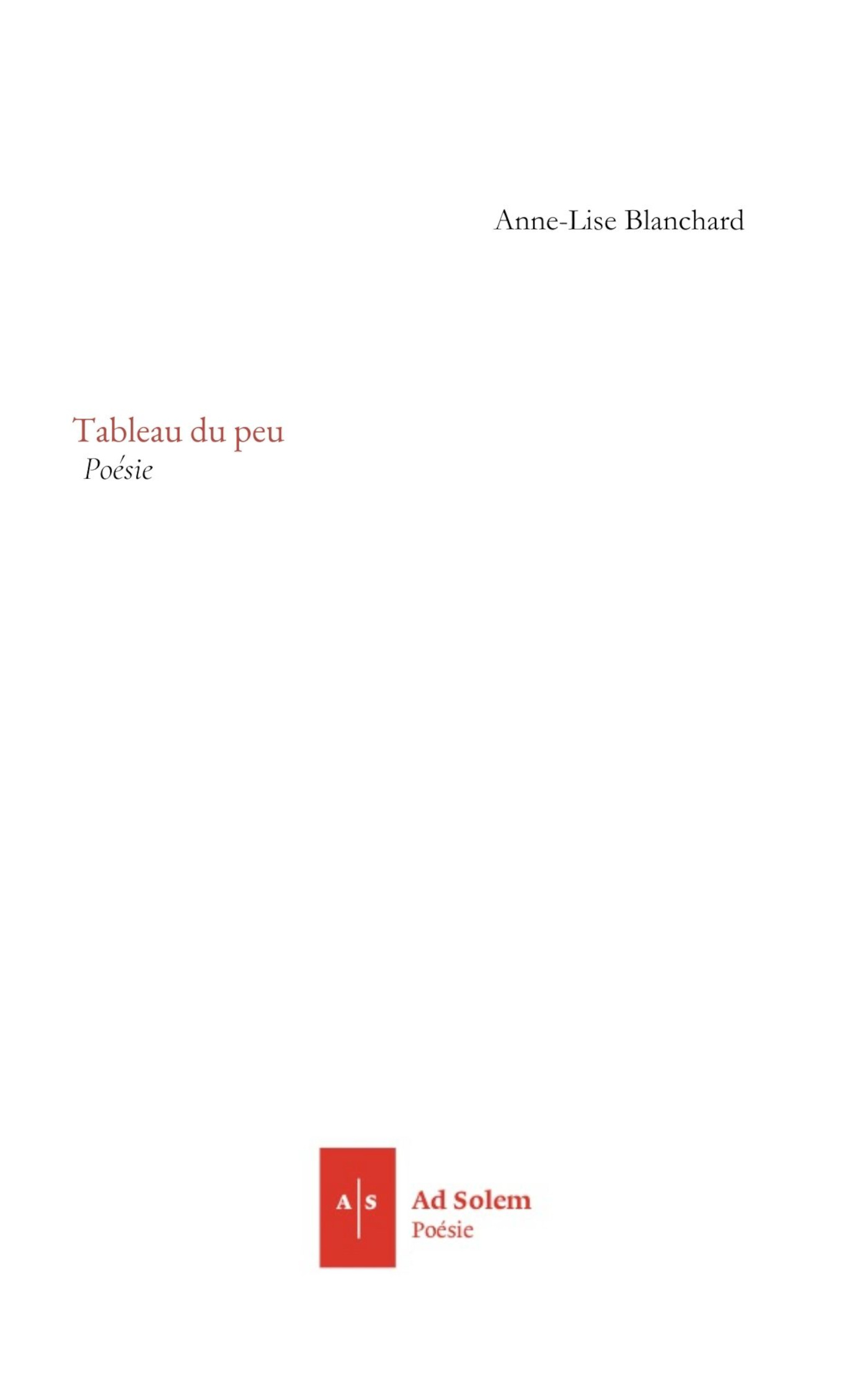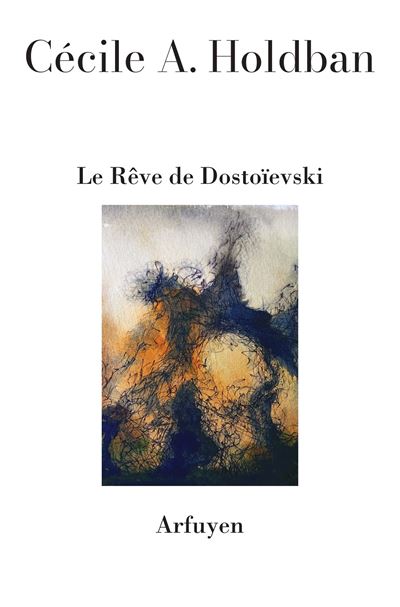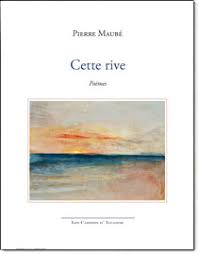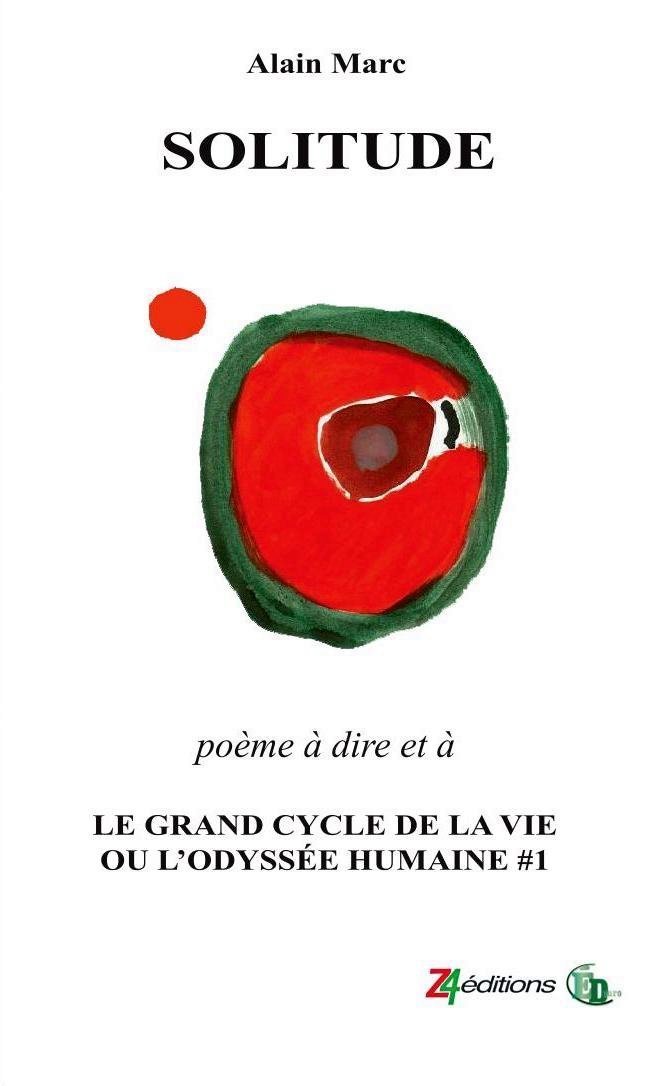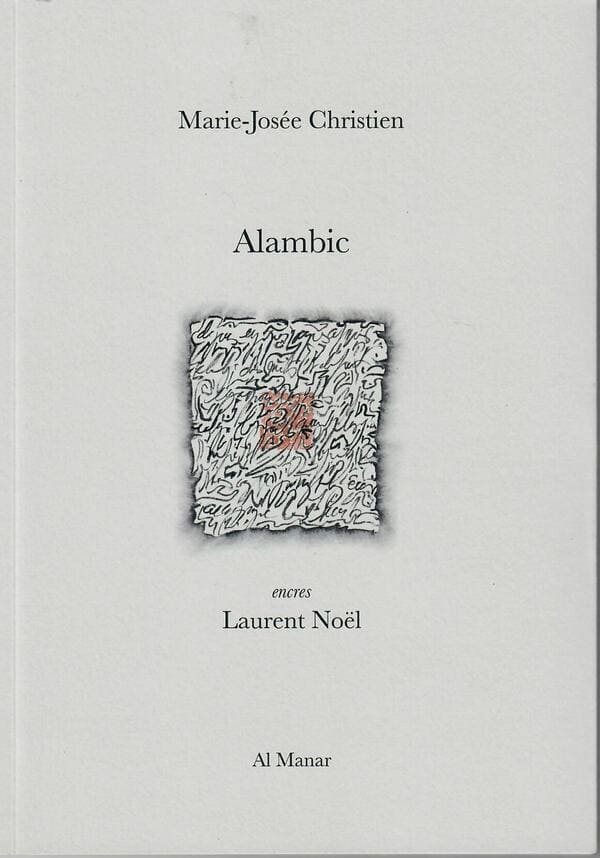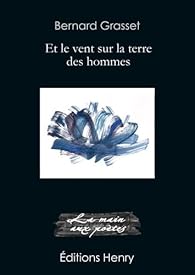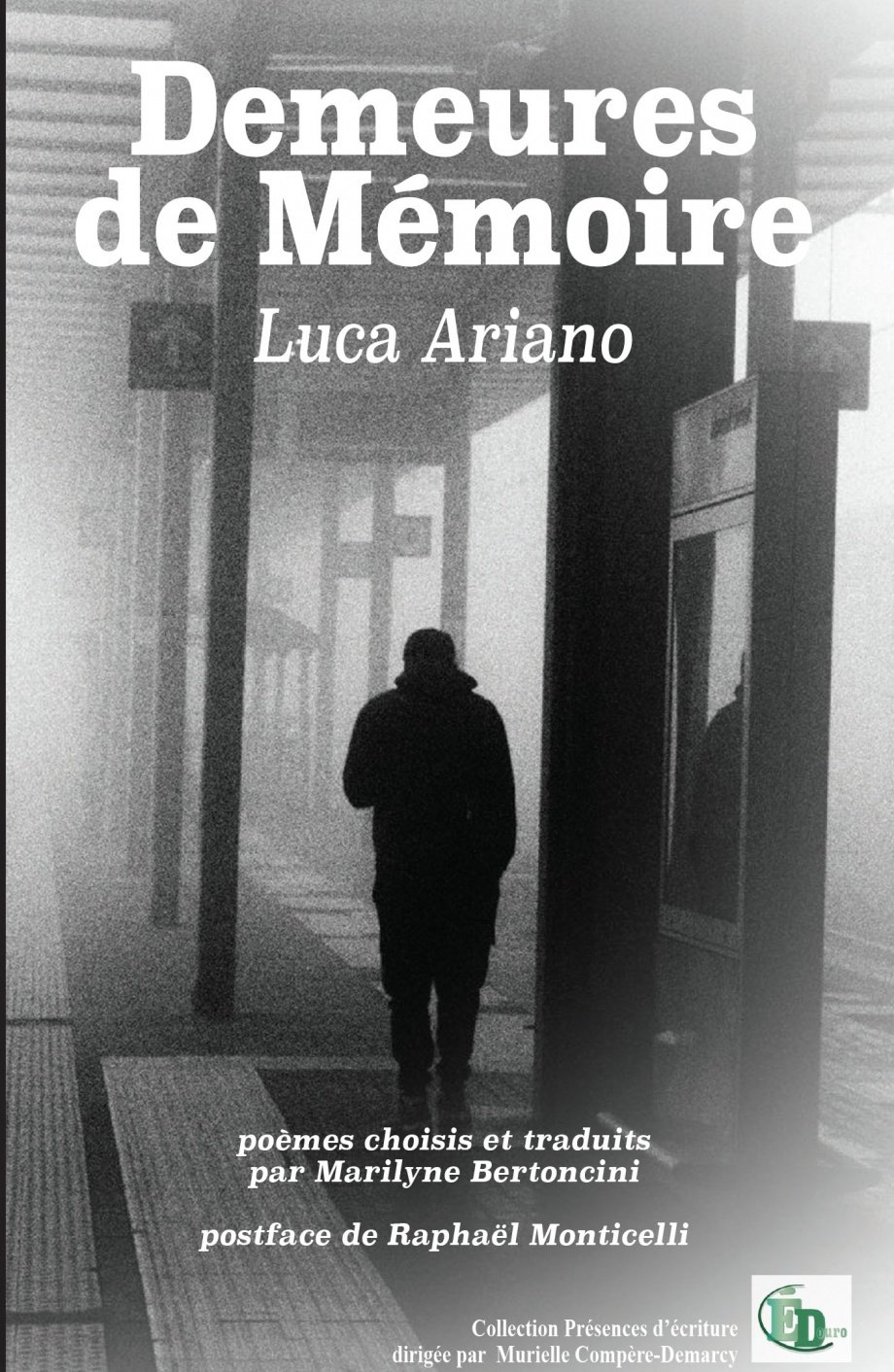La fatrasie est un genre poétique daté, né au moyen-âge et disparu au XVI°, dans lequel le sens cède sa prééminence au son, avec notamment des répétitions de syllabes et des accumulations de phrases aux sonorités étranges qui peuvent dissimuler des critiques, moqueries ou pamphlets. Genre d’autant plus virtuose qu’il est encadré par une forme fixe : nombre de vers avec six premiers de cinq pieds et les cinq derniers de sept, souvent construite sur deux rimes, selon une disposition stricte. Ceci donna une poésie souvent amphigourique, à la fois drôle, même franchement burlesque, apparemment sans queue ni tête ou en tout cas difficilement intelligible.
Depuis la fin du XX° siècle le genre s’est trouvé réinvesti, plus dans l’esprit que dans sa forme précise, par un certain nombre de poètes chanteurs, ou auteurs de « comptines » et autres « fatrasies », souvent pour enfants, entendez textes poétiques un peu loufoques, sans trop de sens ni de forme canonique. On pourrait peut-être d’ailleurs y rattacher aussi les « Chantefables » et « Chantefleurs » de Desnos ? Recueils posthumes parus bien longtemps avant que le terme fatrasie se trouve réinvesti par nos contemporains dont la plus connue est sans doute Brigitte Fontaine, artiste inclassable que l’on ne présente pas, qui, à propos de son dernier recueil de poésies intitulé « Fatrasie » proclame fièrement « les expliqueurs et les expliqueuses de textes devraient tous être passés par les armes ».
Jacques Merceron, lui, en plus de poète (nombreuses revues et ici même sur « Recours au poème »), est un érudit : universitaire, docteur en littérature, mythologue et médiéviste, auteur de plusieurs monographies savantes sur le Moyen Âge, la mythologie, les traditions et savoirs populaires (contes, légendes, médecine magique), un Dictionnaire des saints imaginaires et facétieux (Seuil, 2002), un Florilège de l’humour et de l’imaginaire des noms de lieux en France (Seuil, 2006)… auteur également de nombreux articles et études pointus publiés dans des revues spécialisées, notamment dans la « Nouvelle mythologie comparée ».
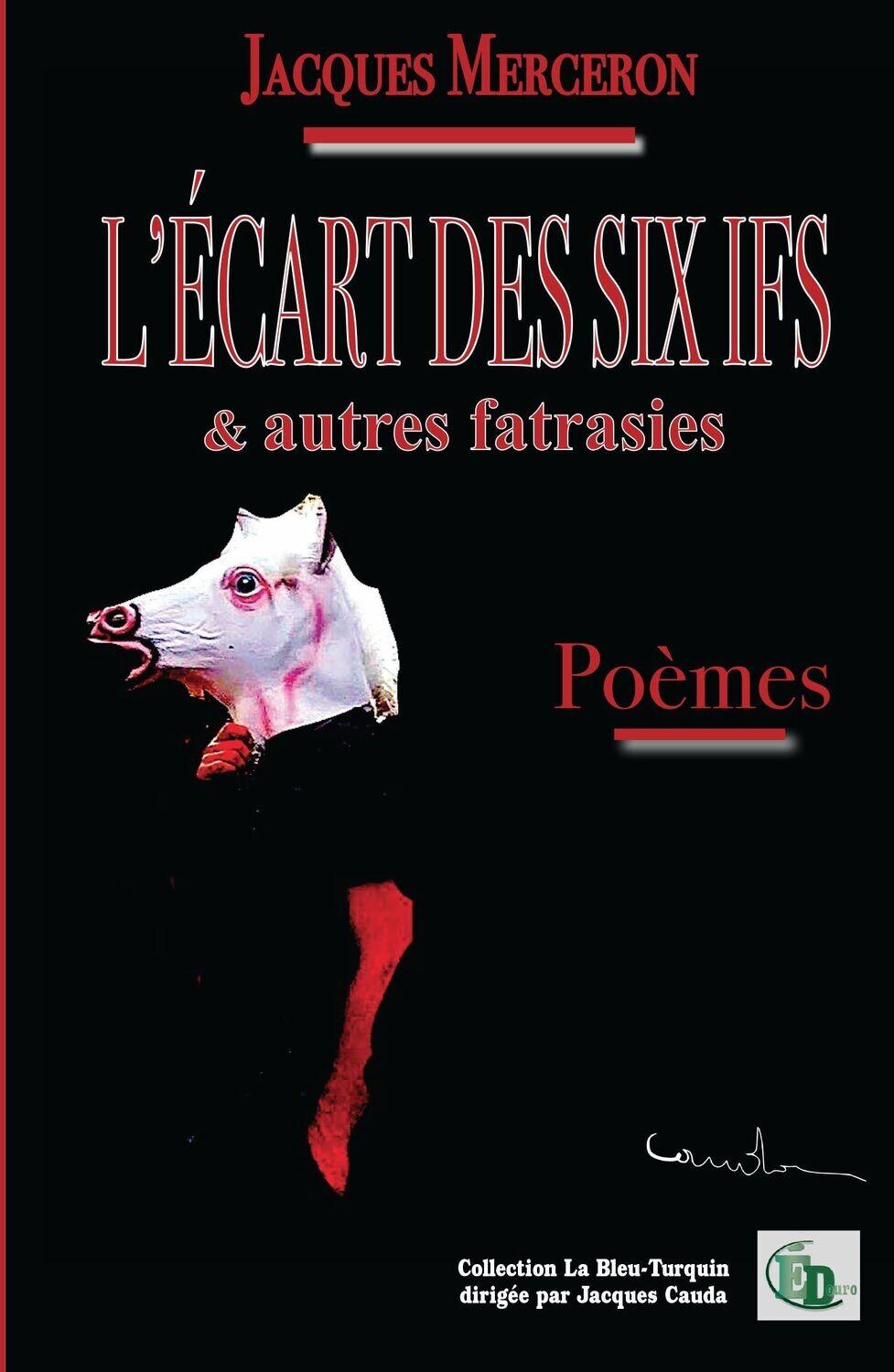
Jacques Merceron, Ecart des six ifs et autres fatrasies, éditions Douro, coll. bleu turquin, Chaumont, 2023, 86 p. – 16,00 €.
Ces précisions ne sont pas inutiles pour éclairer l’imaginaire et l’univers poétique de Jacques Merceron car, au diable le CV de l’œnologue ou du vigneron si le divin breuvage nous apporte l’ivresse et ici le tanin est si particulier que le tasteur est amené à se poser la question : Ces objets d’études ont-ils déteint sur sa vie ou sont-ce ses goûts, déjà « facétieux », qui l’ont amené à cette profession de « savant » ?
Toujours est-il que pour écrire cette poésie-là il faut avoir un grand Fin amor des mots et de la langue, mais pas que… tous les poètes ont de ces amours-là, celui de la langue, des mots (du sens et des sonorités) mais ici c’est un amour à la fois frivole et réfléchi, fou et posé, irrespectueux et révérencieux, passionné et sensé, bricolé et professionnel,… ; amour reposant sur une sérieuse érudition (au sens de solide) doublée d’un goût pour le facétieux, le burlesque, et autre « mot que rit », l’humour populaire, l’éclat de rire rabelaisien, la farce (telle celle de « Mètre patte lin » dirait J Merceron ! ) et l’on pourrait multiplier les adjectifs : insolent, irrespectueux, coquin, malin, espiègle (Jean passe et dé meilleurs) ; toutes ces qualités (ou des faux ?), sont servies par une connaissance fine de la langue : répertoire argotique ancien, inactuel ou récent, expressions et proverbes populaires désuets ou actuels, histoire de la langue et des jeux de langue d’avant-hier à aujourd’hui : menteries, contes et légendes, comptines, refrains, proverbes et dictons, folklore du Moyen-âge, sorcellerie et médecine de rebouteux, langues de métiers et vocabulaires anciens et/ou professionnel (menuiserie, cavalerie, marine…). L’auteur butine à tous les dictionnaires, tous les répertoires et registres pour élaborer un miel poétique des plus originaux, surprenant, incongru ou alterne non sens, absurde, humour et lyrisme (p 43), babelisme assumé (p33, 35), hommages ciblés (Boris Vian p 45, 47, Valéry ou Villon), saynètes granguignolesques à base d’amis-mots, rire rabelaisien voire délicieusement grivois (Oh ! nanisme oh ! /« Trombone aboyeur en gorge profonde »)
Jacques Manceron est un alchimiste de la langue, un saltimbanque de la phrase, un jongleur du vocabulaire, bref : au jeu des mots, un As ! Sous le grand chapiteau bruyant du cirque des Amimots ce serait un Monsieur loyal dompteur et régisseur qui manie à merveille tous les registres et procédés poétiques de langue : assonances et allitérations (le gris grain de nos jours / et vers le vin de vigueur) comme des jeux de mot (homophonie, calembour, contrepèterie, pastiche de proverbes et dictons, trompe-oreille et virelangue,…)
Sous le sourire complice, le rire, in fine le jeu gratuit, mais pas toujours, affleure, ça et là, « les mots scions » comme p44 « À la toute fin des fins pour jouer encore / mon destin à la roulette je reviendrai lancer/mes dés sous les sabots de mes voyelles/et consonnes cavalières espérant secrètement/leur échappée belle pour une dernière/pirouette sur le remblai des étoiles. » ; ou encore la « raie flexion » ironique, mi-figue mi-raisin, que forme cette magistrale définition de la poésie (p40), où sur une page « à découper suivant les pointillés — l’auteur nous livre — un petit pense-bête à l’usage de ceux et celles qui réclament toujours une définition de la poésie. Elle est … et suit une liste de 76 qualificatifs les plus variés et inattendus, à mémoriser en toute simplicité, à réciter en solo duo ou trio au choix »… Avis aux diseurs, lecteurs, performeurs et Chœurs parlés : voilà une pièce de choix à ajouter à votre répertoire !
Cette moqueuse définition de l’indéfinissable ne rejoint-elle pas, sur le fond, mais par l’humour, la lapidaire sentence guerrière de Brigitte Fontaine citée plus haut ?
Cri tique fête le plus saint serre ment et sans brosse à relire !
Celles et ceux qui n’auront pas été étourdi par la virtuosité tournoyante du grand « écart des six ifs et autres fatrasies » pourront suivre l’aventure langagière avec « Ombreuses fratries » (Encres vives, n°547) où, de cavalcades en escalades, Jacques Merceron vous fera « Descendre en rappel/jusqu’au tréfond des mots/Nobles ou infâmes […] ou bien remonter/En varappe risquant/Chaque pointe de pied/Dans l’échancrure friable des mots/Dans leurs frêles crevasses/Dans leur éclat sans pareil/Ou dans leur glaucité/ /Au risque de lâcher prise.
Une mise en garde toutefois : impossible de « faire rendre gorge aux mots… une lettre et c’est tout un monde qui bascule… à nous faire perdre l’esprit sain » Les mots auront toujours le dernier mot : Gare à la vire tue oh cité !
Présentation de l’auteur
- Jacques Merceron, L’Écart des six ifs & autres fatrasies, Ombreuses fratries - 6 novembre 2025
- Poétique d’un désastre annoncé par un collectif d’auteurs de la revue la page blanche, d’après les discours de Greta Thunberg - 6 septembre 2025
- Revue L’Éponge n°7, décembre 2024/mai 2025 - 21 décembre 2024
- L’Éponge - 6 janvier 2024
- Forêt(s) : Anthologie - 18 novembre 2022
- Generación de la amistad : poésie sahraouie contemporaine - 31 décembre 2021
- Platero y yo : élégie andalouse pour narrateur et guitare, Juan Ramón Jiménez - 3 mai 2021