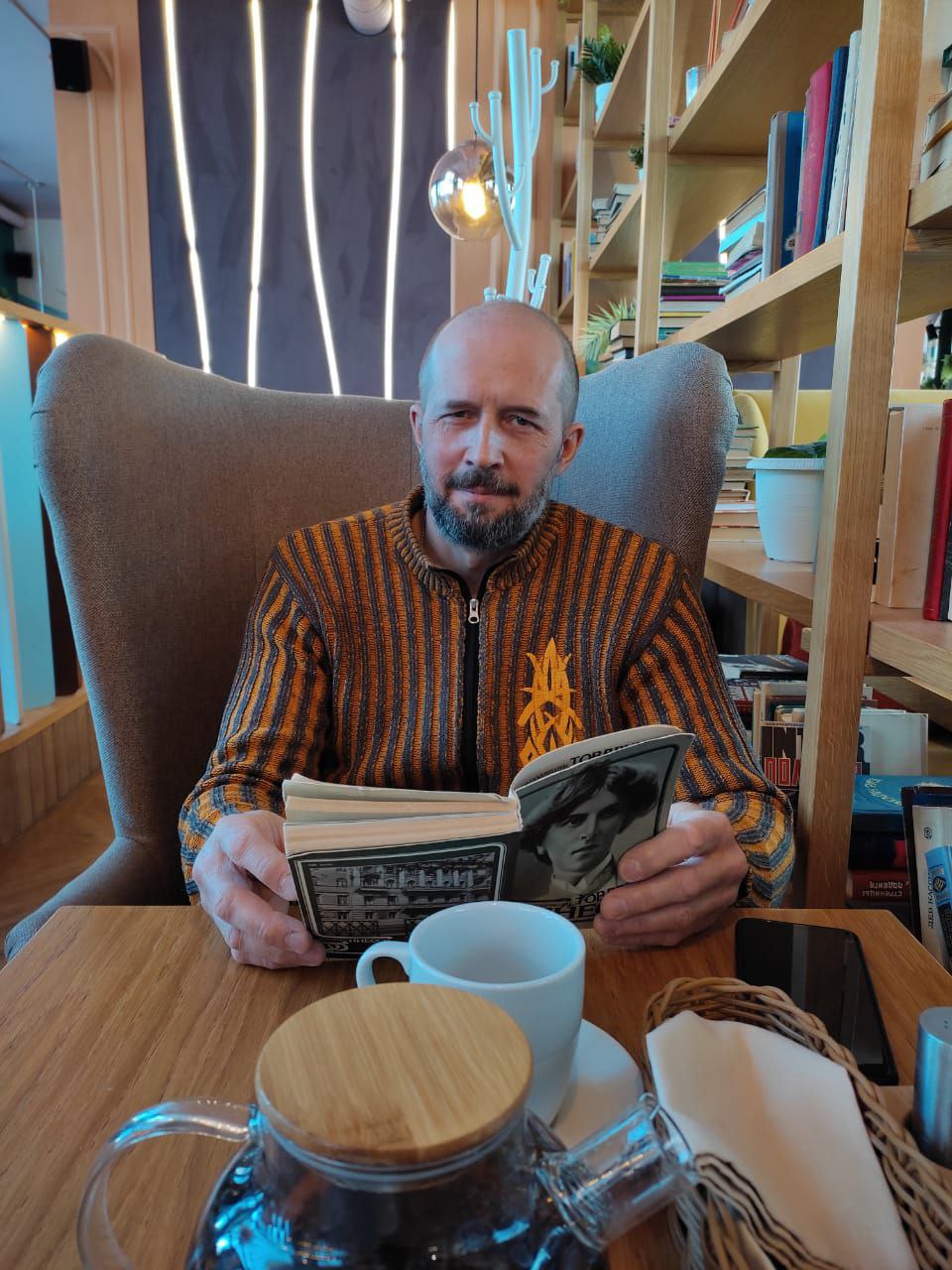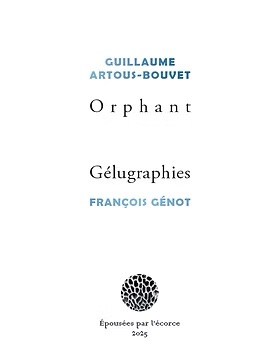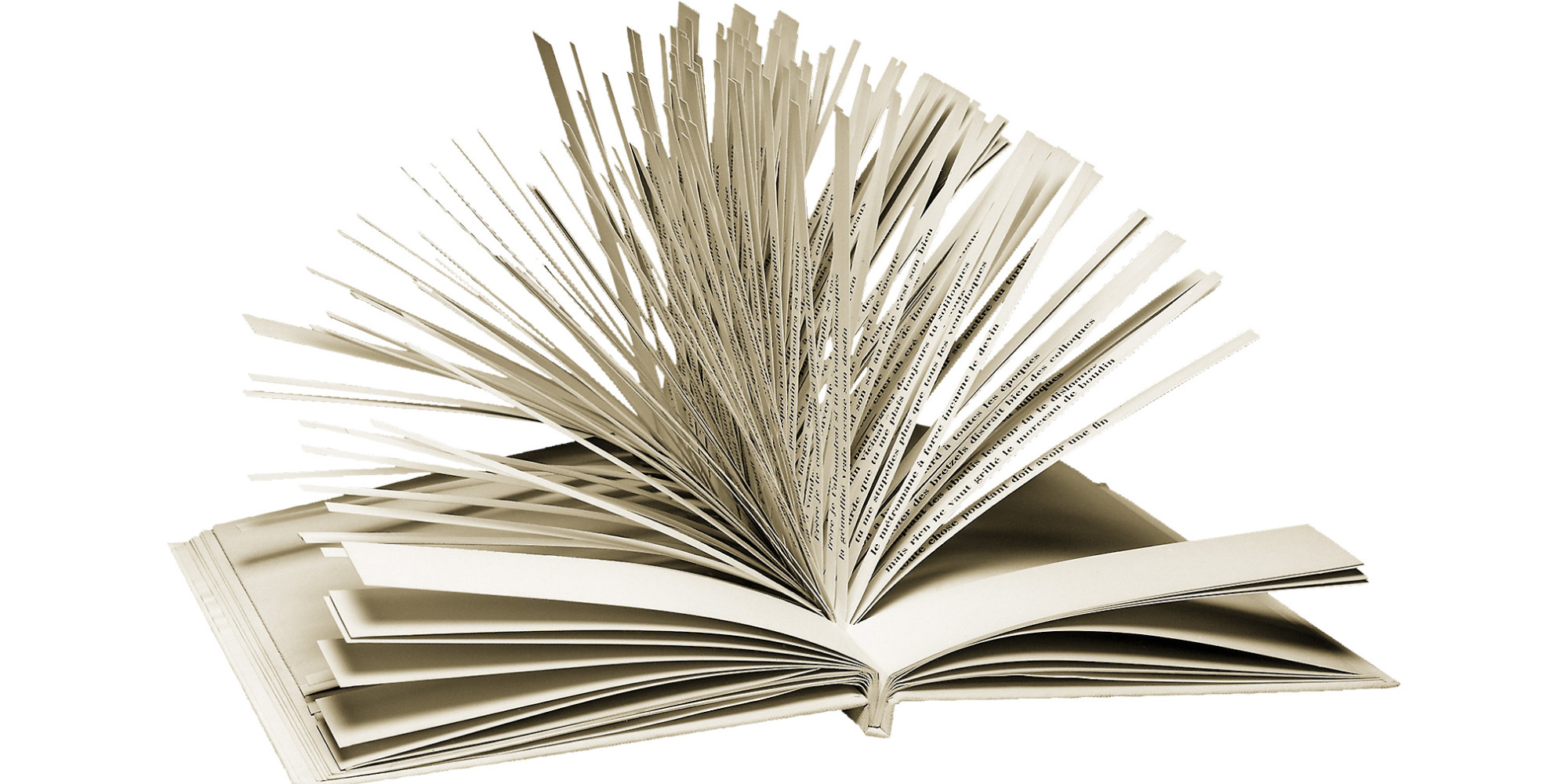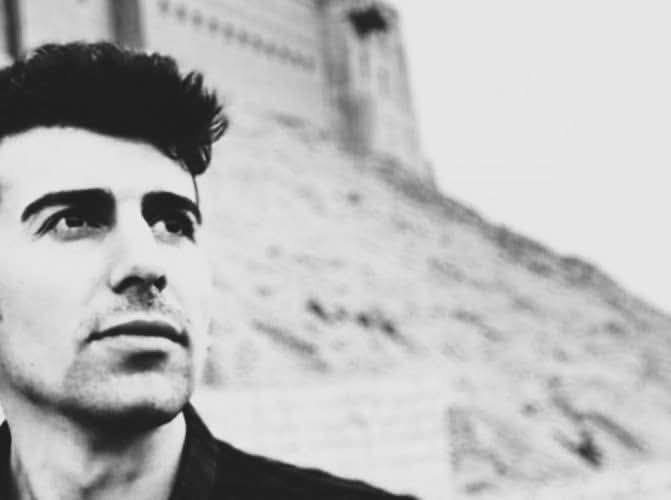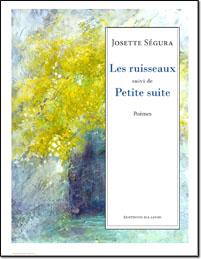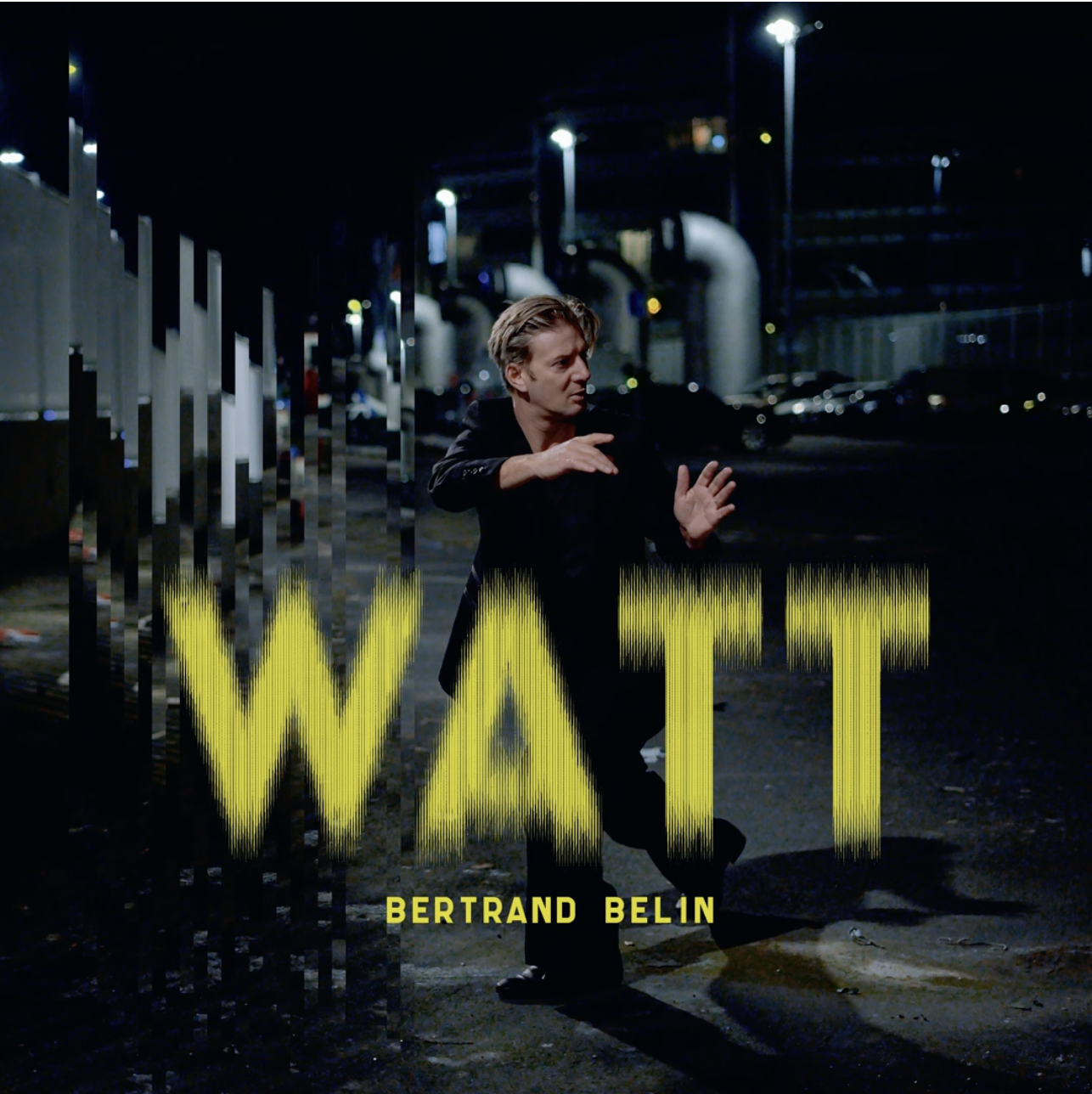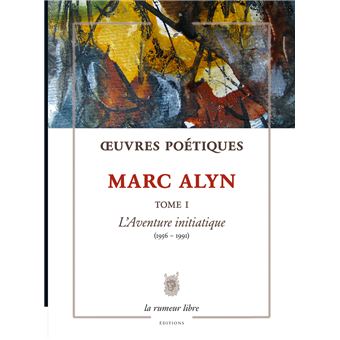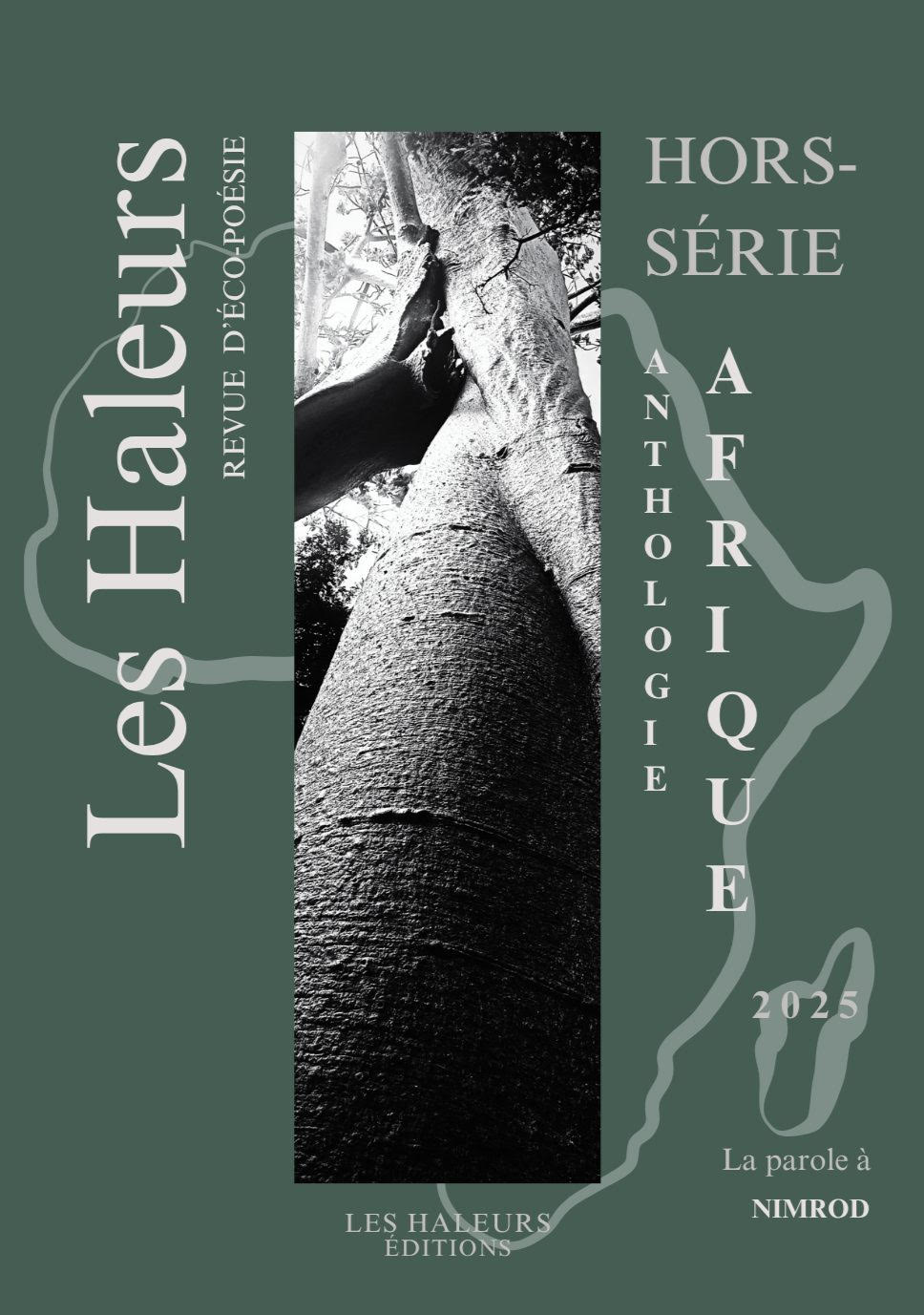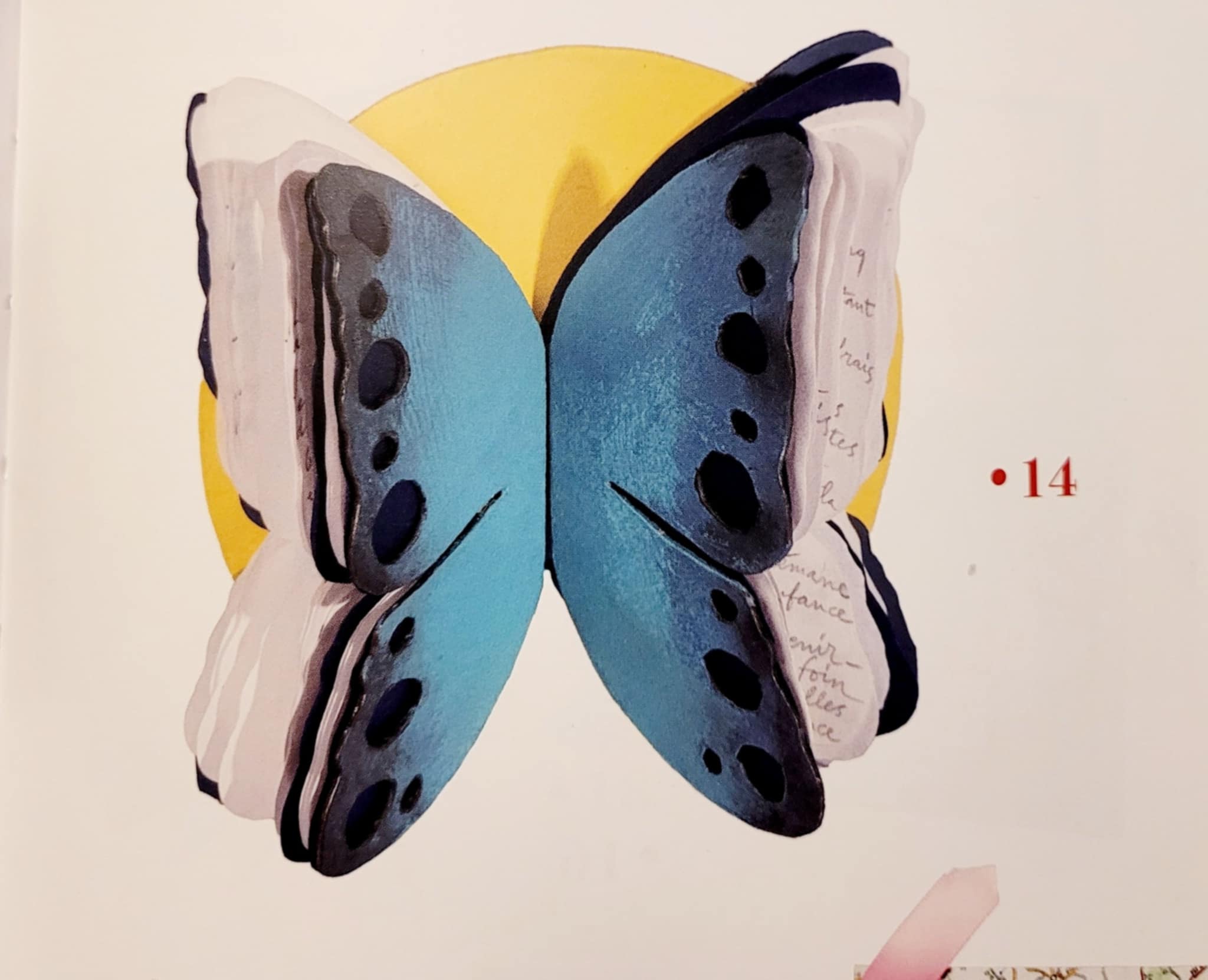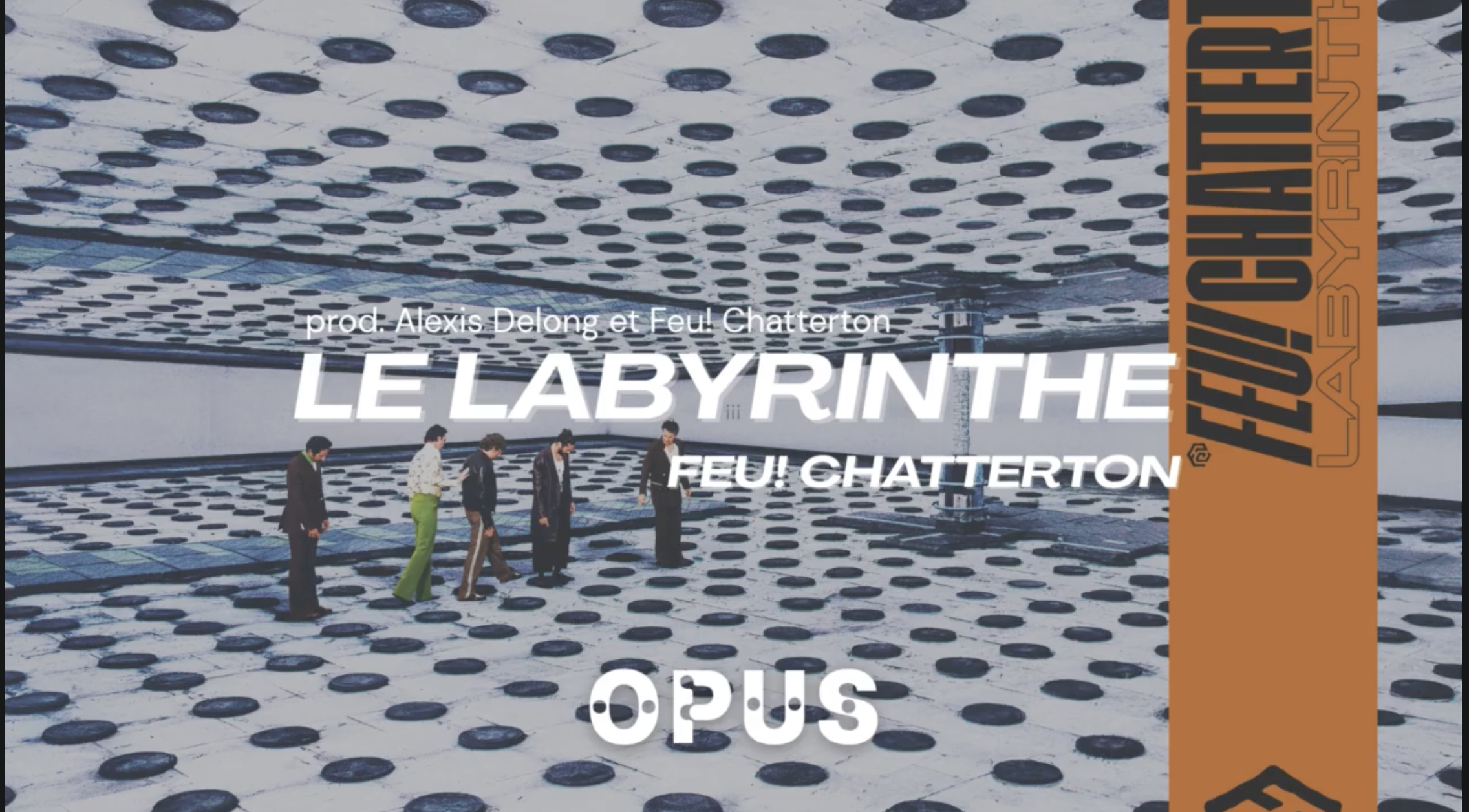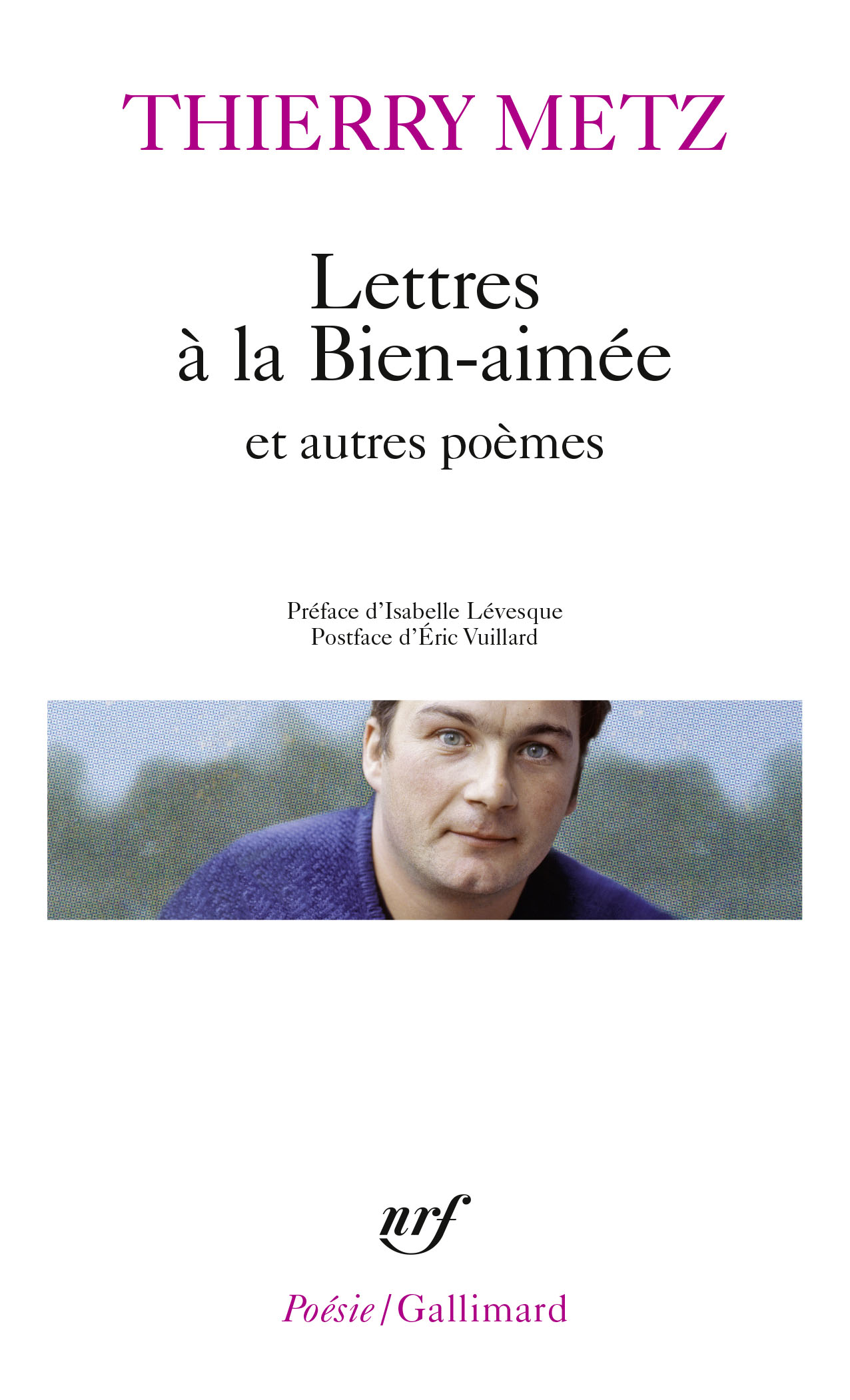Nous sommes déjà nombreux à connaître le talent d’éditeur du créateur de Tarmac, base d’envol de nouveaux talents, de plumes de rare qualité. Peut-être connaissons-nous moins l’œuvre remarquable de Jean-Claude Goiri. Or, c’est un fait – ce dernier excelle la plume à la main !
Les quatre œuvres1 qui feront l’objet de cette étude, derrière la diversité de la forme – nouvelles, poèmes, textes de réflexion en prose – portent une pensée, une tension dont le lecteur s’imprègne et qu’il prolonge dans la durée en mûrissant ce Verbe.
La solitude est un thème que nombre de poètes ont évoqué, et nous la trouvons en effet dans ses écrits. Mais le lecteur est frappé par l’originalité avec laquelle il la met en scène. Nous trouvons par exemple dans La Part Ductile de l’Être plusieurs personnages repliés sur eux-mêmes, seuls, monologuant. Ce qui rend ces récits tout à fait différents des larmoiements romantiques est le ton enjoué, souvent absurde, voire grotesque, avec lequel le narrateur nous plonge dans leur intériorité. Entre un voyeur, une femme acariâtre même avec son fils, ou le beauf vulgaire, ces êtres esseulés nous apparaissent dans la vie la plus intense, concrète, humaine. Le narrateur de L’enterrement du voisin d’en face en fait l’aveu : « Je ne suis pas adorable. La preuve : je n’ai aucun ami. »
Permanence, Jean-Claude Goiri lu par Jacques Bonnaffé. Poème.
Jean-Claude Goiri fait en effet ressentir une diversité essentielle. Il y a d’une part les solitudes négatives, comme celle de la mégère des Vibrisses, qui vomit l’existence d’autrui jusqu’au ressentiment le plus rance, ou encore de La Prisonnièreoù le déferlement de haine se déchaîne sur son fils, un jour particulier de la semaine : « « Elle rit uniquement le samedi parce que le samedi, son fils lui ramène les courses pour la semaine et qu’elle peut enfin vomir sa haine sur quelqu’un. Il se montre toujours de marque de lessive ou de café. Il oublie toujours quelque chose. Alors elle gueule et ça lui fait du bien. Elle rit uniquement le samedi parce que le samedi, c’est le seul jour où elle peut voir un être humain, c’est le seul jour où elle peut voir un vrai con d’après elle, c’est le seul jour où elle voit celui qu’elle a mis au monde et qu’elle a laissé dehors. Quand il part, elle referme les quinze verrous de sa prison, râle et braille. Et recommence une semaine où elle ne respirera que l’air qu’elle expire. » Enfin, nous avons le quotidien du beauf mis en scène dans Le Feulement, sorte d’imbécile borné, bas de plafond que la satire réussie nous peint d’une façon amusante.
À ces portraits déplaisants, malgré l’humour, vient s’opposer une palette fascinante de solitudes rarement choisies, mais lumineuses. Nous ne pouvons que recommander la lecture de La maison morte, véritable pépite, proche de l’univers fantastique – mais combien de nouvelles s’en rapprocheraient sur ce point – qui fait de ce lieu fascinant une vision de rêve. Et puis, comment ne pas évoquer ce marin d’Alteration, voyageur épris de solitude mais ne ressentant désormais celle-ci – sentiment si clair dans l’expression « se sentir seul » – que depuis la rencontre d’un autre dont, pourtant, il ne comprend pas la langue. Le début du voyage s’apparente à un rêve poétique de liberté : « Si l’on veut prendre la mer, il faut avoir le désir de l’horizon. L’horizon. Cette limite qui n’en est pas une. » Mais que l’expérience de l’altérité se fasse et, soudain, tout oubli se volatilise : « Je ne m’étais jamais senti seul avant de le rencontrer. Mais, depuis son départ, je me sens différent, je me sens un autre. Ce qui est troublant, c’est que je ne sais pas s’il s’agit d’une autre présence ou d’une absence nouvelle. Depuis ce jour, j’ai envie de dessiner autre chose que des lignes et des ronds. Je décore mes topographies avec des bémols. Finalement, la solitude, c’est la conscience de l’autre. Et l’avenir, c’est le désir de l’autre. »
Tectonique de l’aube, Jean-Claude Goiri. Subductions et autres glissements tectoniques permettant un soulèvement efficace de l’autre et de chacun.
Cette belle prise de conscience de notre humanité la plus profonde aux prises avec le réel est la pierre de touche de la poésie de Jean-Claude Goiri. En effet, poète du lien, de la fusion, Jean-Claude Goiri fait la distinction entre l’impression cauchemardesque d’être, comme dans le fascinant et étouffant Procès de Kafka, collé, fusionné aux autres, et le fait d’être relié à autrui. Déjà, dans Monsieur Plomb, le lecteur est hanté par la vision d’enlacement infernal, d’emprisonnement créée par la hantise de ne plus être libre : « Il se retrouva seul, flottant directement sur les eaux : c’est alors qu’il réalisa que cette île n’avait pas de terre. Elle n’était composée que de personnes emmêlées. » Le recueil Ressacs laisse aussi apparaître la compression insupportable venant de l’enfermement dans la dictature. Jean-Claude Goiri a lui-même grandi dans l’enfer du franquisme, et ce texte en est l’écho : « c’est quand on veut sortir un bras, rien qu’un bras pour toucher un peu ce qu’il y a autour, on ne sait jamais si quelqu’un passe par là il vous aidera un peu […] de la douleur au bras ou du soulagement de l’après-douleur ou de cette rencontre qu’on voudrait honorer parce qu’on vous a sorti de quelque chose d’autre que la vie ». Cette vie que chante la poésie et que déteste, par essence, le despotisme.
Vient s’opposer à cette perception aliénante l’œuvre poétique elle-même. Le plus ancien, Ce qui berce, ce qui bruisse, chante l’harmonie universelle rendue possible tout en portant au plus haut l’exigence de se réapproprier le plus proche, le plus intime. Ce besoin se visualise magnifiquement à travers la métaphore du regard : « Tout ce qui tombe n’est pas chute, ainsi mes paupières affaissées relevant le défi de raccorder toutes ces choses découpées le jour […]. » Cela se complète avec la fusion – cette fois libératrice – avec celle qu’il aime et de laquelle naissent ces magnifiques lignes : « Déraciner ces baisers ancrés sur tes lèvres et en planter un tout neuf pour que ça dure, mordre tes tympans de mots si surprenants qu’ils épuisent ta fatigue pour que ça dure vraiment, […] ne plus penser en toi mais penser en nous pour que ça dure vraiment beaucoup ». Jean-Claude Goiri ravive cette vérité déjà énoncée par André Gide, dans Les Nourritures terrestres, proclamant avec justesse : « Que l’importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée. » Cette injonction porte en son sein la responsabilité du contemplateur chez qui l’acte du voir n’est pas sans conséquence sur l’univers dans lequel il évolue. Cette vérité se reflète dans le passage suivant où le corps et l’âme ne font qu’un vers le réel : « Au large, l’ombre lie mes vœux mes vagues à mes rêves d’oreilles collées au mur, rien qu’un murmure, entendre descendre par la cheminée un bout de moi par la voix d’un autre comme une offrande à réchauffer mes charnières[…], ramasser bras et jambes vers l’oreille, tout coller vers le concentré, s’en remettre au mur qui saura confier tout ce qui parle dans les racines de l’ombre ». Ces lumineuses « racines de l’ombre » sont l’objet d’une quête à la fois universelle et tournée vers autrui, et cela passe par le Verbe, ce « verbe-lierre agrippé aux choses / tant d’essences cachées par tes feuille-langues / pourtant les murs / se sentent bien seuls en automne. » La contemplation n’est pas simple regard, parole vide, mais acte vers l’univers – et vers l’autre : « l’ample langue […] s’étend vers l’un l’autre étant / comme ce soi ductile / rejoint l’autre ».

Le lecteur attentif se laisse de même gagner par une vertu essentielle inhérente à tout grand poème : la lucidité. Celle-ci sait distinguer le silence créateur duquel naît le poème, et l’autre, noir, de la chape de plomb. Sous Franco – symbole, dans le dire du poète, de toute dictature – l’altérité véritable est détruite. Entre soi et l’autre, « aucun […] pont d’échange n’est possible. On retrouvait ainsi la dissonance du silence, les agrégats du “taire” ». Cette mise entre parenthèse du « dire » permet à Jean-Claude Goiri de mesurer la valeur de chaque mot. Il y a les mots sans profondeur, notamment ceux qui reposent sur l’ignorance : « on chante mal le vide / quand on confond le vide avec le rien », dit-il dans Ressacs. Aussi décrit-il avec justesse cette pourriture que constitue le bavardage ne reposant pas sur le poème : « Tout dehors, tout est dehors, tout cracher dehors, hors la langue aussi, cette planche à repasser les mots, à les blanchir, dans le palais pour rien ils errent les mots blanchis repassés pour rien […], alors il ne reste que les glaires alors, cracher les glaires d’un monde trop dehors ».
Le remède est l’élan poétique, autant regard qu’acte libératoire de la plume, « cette paupière que tu inventas pour vivre ta nuit même en pleine lumière » dit-il dans Ce qui berce. Cette métaphore de la « lumière » traverse sa notion de la poésie. Dans le même recueil, il y revient pour, fidèle à la perception grecque du terme, faire dévoiler l’être même : « Il n’y a plus de noir, il n’y a que la lumière pour assouvir ma soif […], il n’y a que le clair pour me servir de chemin, il n’y a plus rien à faire pour me sombrer dans le sombre, car si je te vois, c’est que la lumière t’enrobe, et la poésie, c’est assembler, assembler tes ramures éclairées, la poésie, c’est TE reconstituer, et puis la poésie c’est surtout… surtout… la restitution, l’essence de l’acte poétique est là : / Je TE restitue. / Nous ne sommes que lumière. » La poésie dévoile, en effet, et forge dans la même « gestuelle », comme l’exprime le recueil du même nom que l’on peut comprendre – à l’aide de son nom complet – par Gestuelle pour la prolongation spatiale et spirituelle d’une vie. En effet, comme Marcel Proust déjà l’avait expérimenté, l’acte d’écrire nous crée nous-mêmes en même temps qu’il met à jour une œuvre. D’où l’émergence, dans le mouvement de l’écriture, de ces idées qui surgissent malgré nous : « Tous les mots ne passent pas par la langue. Certains, primitifs, sont agglomérés derrière le cerveau. Et à force de les oublier, ils surgissent au détour d’une idée, avec des revendications qu’on ne peut plus assumer seul », ce qu’il précisera dans Ressacs en rappelant « cet arrière-pays où les mots se forment ». Or, la poésie n’est justement réelle que dans l’action même. Le rêve, le projet, la simple idée s’évaporent sitôt projetés. La poésie, elle, est au contraire dans l’action : « La poésie n’est pas une promesse, elle concrétise la singularité, la diversité, et permet de les unir dans un élan d’échange. » En cela, nous devinons qu’avec Jean-Claude Goiri, nous avons affaire à un auteur qui connaît le prix à payer que constitue tout acte authentique de création. Il ne s’agit pas d’écrire, peindre ou autre pour, comme disent les médiocres, passer le temps ou s’occuper. C’est un « divertissement » au sens pascalien qui réclame que les veines s’écoulent sur la page, que l’on écrive « avec son sang » comme le dit le Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra. Nous en trouvons l’illustration dans La Part Ductile de l’Être, avec le récit intitulé « La boîte à tête » : L’art est une entreprise vitale qui tout à la fois prolonge et renverse le réel, et condamne nécessairement l’artiste authentique au bannissement. L’artiste, une fois terminé son œuvre, le contemple : « Je le posai sur un tronc, m’éloignai un peu, et avec la distance, je me rendis compte que c’était tout à fait moi dans la splendeur de ma solitude. » Cette émergence symbolisée de lui-même – seule possibilité d’échange universelle par-delà l’inévitable incommunicabilité – n’est transmissible que pour ceux qui peuvent se mettre à l’écoute. Mais c’est une entreprise pénible, donc rare : « Hé bien toi, tu vois un cube noir, alors qu’en réalité, c’est moi, c’est tout moi parce que j’y ai mis tous mes doigts, toutes mes tripes, toute mon âme, j’y ai mis tout mon corps, j’y ai mis tout mon regard, c’est moi, c’est moi !! Tu comprends ? Ce n’est pas un mensonge, c’est un prolongement de moi-même et peut-être même de toi, c’est le prolongement nécessaire pour t’atteindre, pour t’intégrer en moi et inversement ». L’acte créateur, pour être véritablement, n’est jamais gratuit. Il est enchâssement universel.
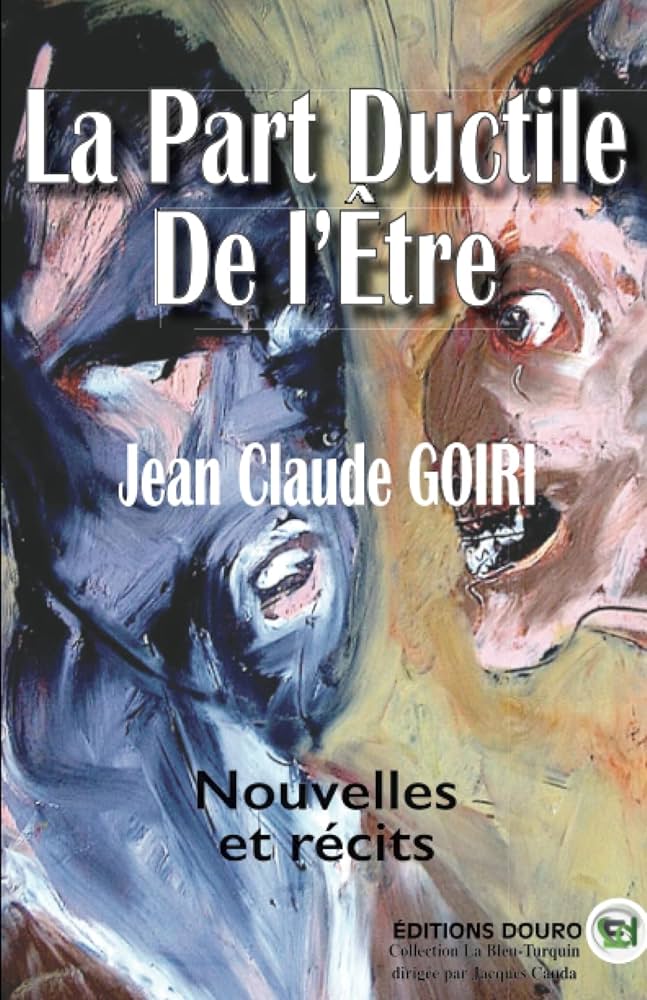
Note
- Ces quatre livres sont les suivants : Ce qui berce, ce qui bruisse, paru en mai 2016 dans la revue ficelle chez Rougier V. éd., avec des gravures de Claire Illouz ; La Part Ductile de l’Être, Nouvelles et récits, Éditions Douro, 2022, avec des illustrations de l’auteur et de Jacques Cauda ; Gestuelle, Z4 Éditions, 2018 et enfin Ressacs, Z4 Éditions, 2018, avec Ysabelle Voscaroudis.

Peinture de couverture © Nathalie Oso.
Présentation de l’auteur
- Jean-Claude Goiri – le poète de l’éveil et de l’unité - 6 mai 2025
- Pascal Boulanger – la poésie comme méditation et combat - 6 janvier 2024
- Gwen Garnier-Duguy, Ce qui se murmure par-delà l’indicible - 20 mai 2023
- L’approche du silence - 6 mars 2023
- Marilyne bertoncini, La Plume d’ange - 12 octobre 2022
- Agencement du Désert – Quand le feu irascible se dompte dans la forme - 6 septembre 2020
- Georges Rose, Jeunesse de l’instant - 6 avril 2020
- Carole Carcillo Mesrobian, Ontogenèse des bris - 20 décembre 2019
- La poésie comme enchâssement dans l’unité métaphysique - 6 novembre 2019
- La poésie et l’indicible - 6 septembre 2019