Frêle jeune femme, Karthika Naïr s’attaque et se mêle aux géants, est une géante. Et une discrète Amazone. En s’affrontant au Mahabharata, l’une des deux immenses fresques fondatrices de l’hindouisme avec le Ramayana, elle s’inscrit dans une longue et inlassable histoire d’écritures et réécritures de cette grande épopée qui relate les fardeaux infligés par les anciennes générations aux nouvelles.
Dans la vie courante, Naïr bataille entre scène et clapotis sur le clavier, entre mots et corps : son Until the lions a fait l’objet d’une adaptation dansée à Sadler’s Wells et sera (en 2020) donné en opéra à l’Opéra national du Rhin. Akram Khan, qui adolescent participa au légendaire Mahabharata de Peter Brook, chorégraphie ses vers : tels les hommes mythiques sur les femmes, grandes oubliées du mythe, Akram prend appui sur la poésie de Karthika comme nos corps sur nos métatarsiens et nos métatarsiens sur la Terre mère.
De son côté, Naïr s’appuie sur le contexte indien multiple, notamment le polylinguisme, pour nous livrer une polyphonie aux inspirations, f®actures et teneurs variées, qui dépassent d’ailleurs volontiers les frontières de l’Inde comme de la « grande » culture : elle dessine, tisse et tend ses subtils fils d’araignée gracile entre poésie mystique penjabi et mise en page (entre autres) résolument contemporaine, entre sestina provençale, landay afghan et références aux dialogues du Bollywood des années 60.
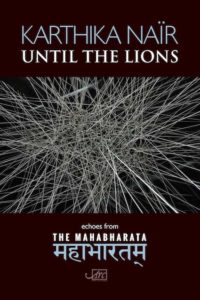
KARTHIKA NAÏR Until the Lions – Echoes from the Mahabharata,
Arc Publications, Todmorden, 2016, 293 pages, 15 € 16.
En Inde, Until the Lions a remporté le prestigieux prix Tata normalement réservé aux romans, comme en Angleterre en 2010 le poème A Scattering de Christopher Reid avait remporté le Costa Book Prize. C’est donc une victoire (notre vocabulaire se laisse influencer par la fougue belliqueuse du Mahabharata), de la poésie sur le roman – dans ce cas précis, de la poésie indienne en langue anglaise sur le roman indien en langue anglaise, qui se taille d’ordinaire la part du lion non seulement sur le marché mais aussi dans l’esprit des critiques. Notons que Jeet Thayil, romancier et poète lui-même, dont un commentaire apparaît sur la couverture de la version indienne de Until the Lions, a consacré son récent deuxième roman aux poètes des années 80 à Bombay, à paraître en France (2019) dans une traduction de l’auteur de ces lignes : soufflerait-il une brise délicate au milieu des miasmes colossalement putrides de l’époque?
Until the Lions n’est pas romanesque mais de l’ordre de la poétique. S’ancrant dans une réalité invue de l’ample texte, plus que biblique ou homérique, attribué à Vyasa ( IVe av. J‑C./IVe apr. J‑C.?), Karthika Naïr le revisite à‑bras-le-corps. On aurait toutefois du mal à traiter d’épique son subtil remaniement, tant elle ne garde de l’épopée que ce qui, justement, n’appartient pas à son image dominante, virile et idéalisée : elle préfère s’infiltrer dans les failles, frayer avec les oubliées, les laissées-pour-compte de la grande fable.
Son sous-titre (Échos du Mahabharata) l’indique bien, le livre est fait de blancs, d’élisions, de rebonds, de relectures et relectures de relectures de la matrice, dont il n’existe d’ailleurs pas vraiment de version originale ; mais aussi de sauts temporels et autres entre passé et présent. Des sauts légers, aériens comme une danse, et comme une danse éminemment pesants, charnels et puissants, voire violents. Signe de l’élasticité de la méthode de Naïr, il arrive que la forme se modifie au sein même d’un poème, afin de mieux souligner les différences entre les incarnations.
Le titre du volume vient de l’écrivain nigérian Chinua Achebe : “Jusqu’à ce que les lions aient leurs propres historiens, l’histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur.” Dans ces Échos du Mahabharata, les lions sont les femmes : amantes ou servantes –personnages secondaires ou pas de la mâle épopée –auxquelles la parole est ici enfin permise au fil de poèmes d’une belle grâce érotique, autant que dans des monologues dramatiques. Le récit s’articule autour de voix de femmes et du personnage de la matriarche Satyavati, le tout créant une contre-généalogie matrilinéaire.
S’il faut céder un instant à l’hellénocentrisme, disons que l’ensemble est animé d’un pathétique à la Troyennes. Non que l’histoire du sous-continent indien ait eu besoin de la Grèce ou d’Euripide pour abreuver sa terre de sang, de haine et d’hégémonie religieuse masculine. “Nulle mère ne devrait avoir à allumer le bûcher de ses fils. Non. Nulle mère ne devrait/ survivre à son sang. Moi si, moi si./ Le coeur n’a pas d’os à briser./ Il continuera de battre, néanmoins.” Le c(h)oeur des femmes fortes, fières, grinçantes et tapageuses continuera de supporter, colérer, crier vengeance, se lamenter – de dire et maudire. Naïr dit et maudit sa geste, elle la brode avec fougue, maestria et finesse à la fois.
Malgré la virulence de ses créatures, elle-même n’est pas dans une contestation frontale de féministe aguerrie, plutôt dans un décalage qui ajuste le texte sacré comme si de rien n’était, comme un couturier ou plutôt une couturière qui, par une à peine perceptible modification d’une pièce ou d’une couture, transformerait le corset, le carcan, la camisole, la carapace, l’armure en vêtement fluide et libre. Ce vêtement dont on lit en filigrane dans ce Mahabharata déconfisqué que la citoyenne indienne d’aujourd’hui, prisonnière de la dictature religieuse naissante, aurait bien besoin de le revêtir, et vite.
“Quand le roi décide de me violer, moi ou mes soeurs, personne n’emploie le mot ‘viol’. Ce mot n’existe pas dans l’univers du roi. Ce corps n’est qu’une des myriades de provinces qui sont siennes, du nombril au téton et à la paupière, de la plante du pied au clitoris.”
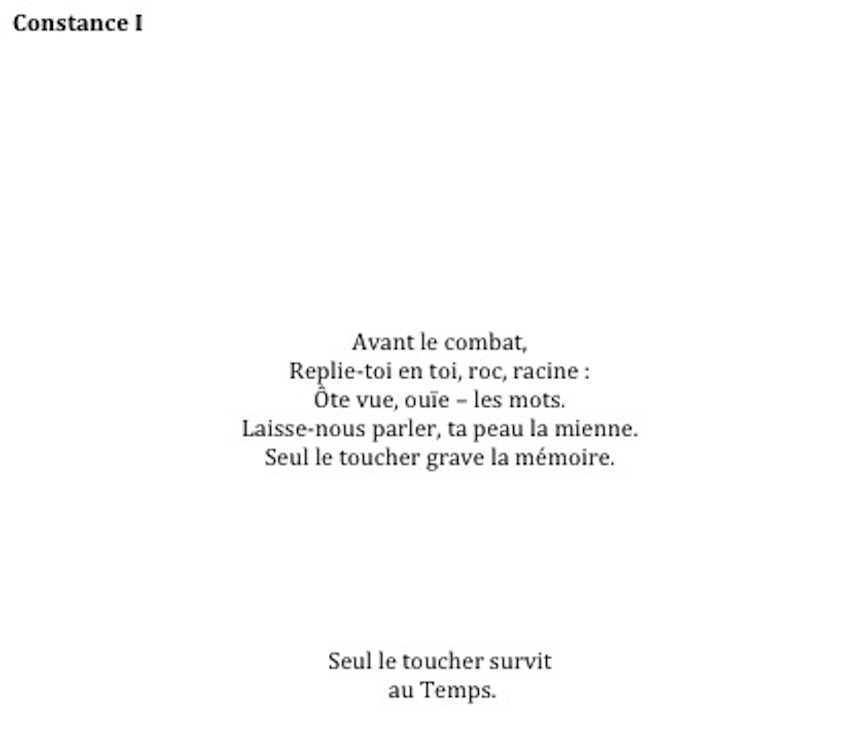


- Victor Malzac, Vacance - 24 mai 2025
- Deepankar Khiwani (1971–2020) : Entr’acte - 6 mai 2025
- Pankhuri Sinha, la femme blessée - 5 mars 2021
- Arun Kolatkar, JEJURI - 21 décembre 2020
- Sonnet Modal, poète indien - 5 janvier 2020
- Karthika Naïr, Until the Lions – Echoes from the Mahabharata - 5 octobre 2018
- Hommage à Laurence Millereau - 3 juin 2018
- Ping-pong : Sudeep Sen, Incarnat /Incarnadine - 14 août 2017
















