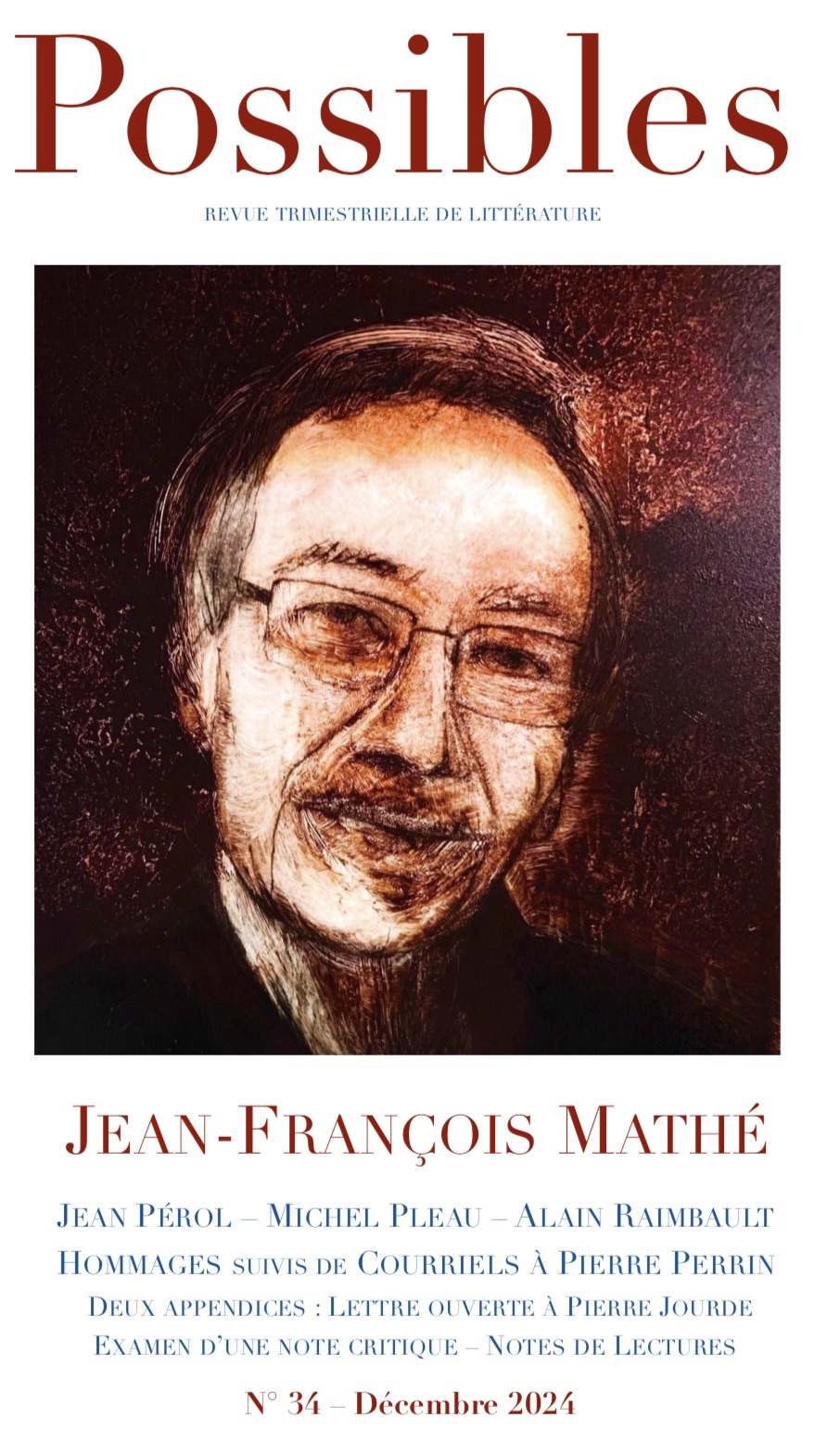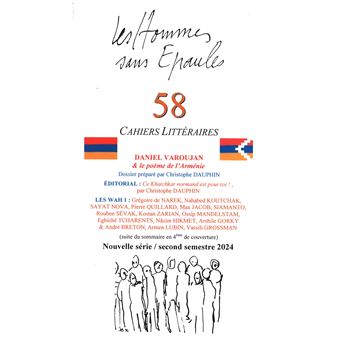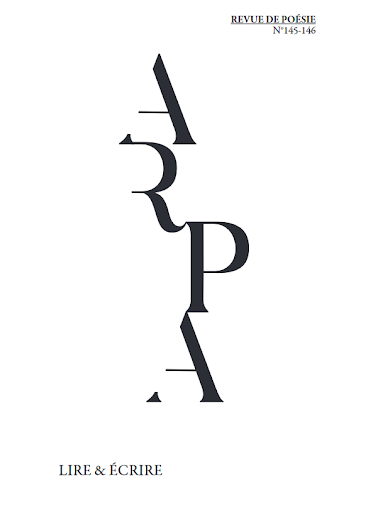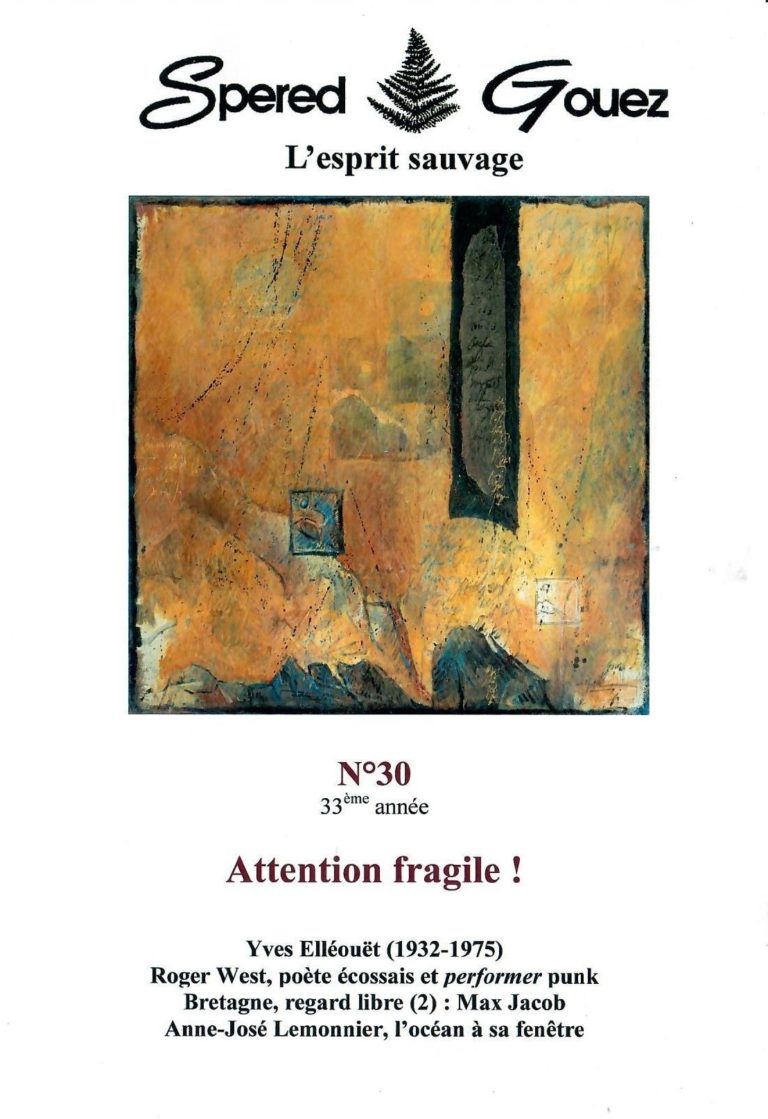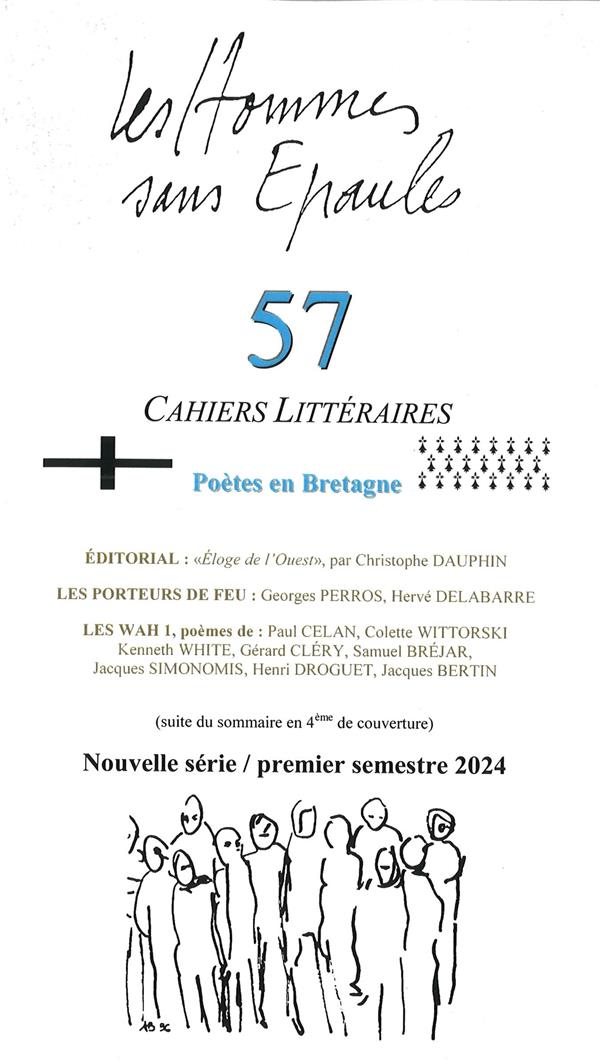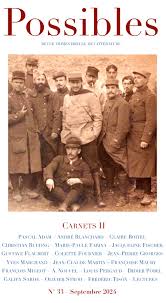Une Revue des revues que nous devons à notre très regretté collaborateur et ami Michel Host, parue au sommaire 138 de Recours au poème, en mai 2015.
∗∗∗
PRÉCIEUX CAHIER
Federico García Lorca a fait plus que passionner une foule innombrable de lecteurs, il les a fascinés et ensorcelés. Lorsqu’il vivait, certes, mais aussi après qu’on l’eut assassiné, à Grenade, en août 1936, longtemps après, et aujourd’hui encore le charme joue et agit. La personnalité élégante du poète, son inscription dans le XXe siècle, son Romancero gitano, toute sa poésie, son théâtre… il est juste que les jeunes gens de ce début de siècle puissent y être conduits et initiés. Cette seconde livraison de la revue EUROPE consacrée à Lorca satisfait à cette intention de fort belle manière. Il faut la saluer[1].
Marie-Claire Zimmermann ̶ avec Sur le seuil ̶ ouvre ce précieux cahier par l’affirmation de la nécessité d’aborder aujourd’hui les recueils du poète « en utilisant d’autres biais, en attirant l’attention sur des aspects moins abordés ou ignorés… ». La revue répond à ce souhait. Sont relevés, notamment, les « biais » poétiques apportés par les poètes Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, José Ángel Valente, Pablo Neruda, mais aussi par la vision éclatante, inspirée, que nous propose le romancier et poète cubain José Lezama Lima. Jaime Siles, jeune poète espagnol, est aussi convoqué… D’autres contributions, concernant le théâtre lorquien notamment, nous donnent une idée précise et enrichissante des directions de la recherche lorquienne actuelle, et Marie-Claire Zimmermann elle-même, qui n’est pas des moindres analystes, nous propose une belle réflexion au sujet du Chant funèbre pour Ignacio Sánchez Mejías, l’un des sommets de la lyrique andalouse et universelle du poète.
Commençons cependant par ̶ Une rencontre décisive ̶ entretien que Jean-Baptiste Para conduit auprès du biographe Ian Gibson[2]. Nous y sont apportées des informations nouvelles, particulièrement sur les causes et circonstances de l’assassinat au ravin de Viznar : des grenadins issus de la C.E.D.A. (Confédération espagnole des droites autonomes), dirigée par le politicien María Gil-Robles, sont à l’origine de la dénonciation ; parmi les motifs de la haine de cette droite catholique, la critique faite par le poète de la bourgeoisie locale ̶ « la pire de toute l’Espagne » ̶ , à quoi il faut ajouter l’inimitié envers le père de celui-ci, riche propriétaire terrien aux idées progressistes, et, outre le péché d’homosexualité, les jalousies, des « facteurs familiaux », avec sans aucun doute la colère d’un commandant local de la Garde civile pour les portraits peu flatteurs que l’on trouve de cette corporation, notamment dans le Romancero gitano.
Avec Un fleuve, Luis Cernuda propose un portrait inattendu du poète : « … il y avait bien quelque chose de l’orgueil du matador dans son attitude », et cet « ángel » singulier, grâce ou charme si espagnol, notamment quand il jouait du piano, le tout mêlé d’une « tristesse fondamentale » liée à ce qu’Unamuno définit comme « le sentiment tragique de la vie ». Un poète inspiré d’abord par « les influences avides et aveugles de la terre, du ciel, des hommes espagnols éternels.»
Le cubain José Lezama Lima nous propose une superbe offrande lyrique, enflammée, torrentielle, à la mémoire d’un « Orphée traversant les enfers de l’instant ». « Hellénisme et romanité, un peu en amont des jardins arabes de Grenade, parcourent sa sentence poétique. » C’est là l’essence de l’esprit lorquien, ses parfums essentiels. Par-dessus tout cela, la clôture d’un destin et la résurrection dans l’œuvre : « Et le cavalier qui lui donna cette fleur obscure, que l’on ne peut toucher que lorsqu’on est déjà dans l’invisible… » « … Lorca affronte le grand mythe de sa race : le taureau noir, celui de la mort, et l’offrande du sang. » Un hommage somptueux !
Clara Janés fixe le curseur de sa réflexion sur le poète de vingt ans, qui ne peut mourir ̶ « Sa mort est une vie plus ouverte » ̶ et sur ce chien assyrien qu’il avait « repéré » à Londres, au British Museum. Elle leur dédie un émouvant poème-hommage : « Le chien assyrien s’arrache aux ombres / et, à son premier hurlement, / la lune et les étoiles se hissent vers le rêve… Ton voyage nocturne est déjà métaphore. / Se met alors debout / la sauvage fraîcheur de l’aurore. »
Michèle Ramond nous donne un commentaire analytique fouillé du Romancero gitano, où sont évoquées aussi bien les figures filiales que les figures symboliques du poème. Outre l’utilité évidente d’une telle réflexion, il s’en dégage cette leçon à méditer : « La figure filiale, avec ses infractions, ses tentations, sa passion, sa tragédie, est centrale, elle inspire toute la matière de l’œuvre, elle est la grande pourvoyeuse d’images… » On le voit, et c’est aussi l’intérêt de la revue, les angles de vision, les points de vue peuvent y diverger, non pour s’entrechoquer, mais pour révéler la multiplicité des paysages que présente une œuvre aussi dense que celle de Lorca.
Henry Gil ne contredit pas cette idée en analysant la même œuvre selon les thèmes du paganisme ̶ en tant que « polythéisme propre à l’Antiquité grecque ou romaine ̶ et du christianisme. Étude serrée et stimulante, où est souligné ce fait que « Lorca invente ses propres signes » car pour lui « le monde est symbolique comme si chaque chose était un objet total. » « Quant au conflit paganisme / christianisme », il se fait matière et songe dans bien des pièces de l’œuvre (poèmes, théâtre), tout le Romancero en est composé, et, selon moi, on pourrait aussi bien y voir une « alliance », ou un « alliage » inédit : « … une sorte de sacré susceptible d’exprimer le sens tragique propre à l’homme. »
Jaime Siles (« Deux notes sur le Romancero gitan »), y relève l’alliance de la thématique traditionnelle et de l’innovation propre à Lorca. Contribution claire et toutefois plus savante qu’il n’y paraît, qui met en relation le romance lorquien avec les « idées poétiques » d’Ángel Ganivet, autre grenadin. Le « génome » de la poésie lorquienne est ici relevé, observé et analysé.
Zoraida Carandell ̶ avec L’ÉCLIPSE OBSCURE de Poète à New York ̶ propose un regard scrutateur sur ce recueil complexe, « difficile d’accès », écrit par Lorca durant et après son voyage aux États-Unis. Retenons le choc de ce séjour : « Les rues de New York ne sont pas, dans la langue de Lorca, des objets comparables à ses paysages familiers. » C’est toute une réflexion qui nous est ici livrée à propos de cet écart, de cette distance, mais aussi de cette nécessité de nouveaux travaux sur les images et la vision. Retenons ces vers, dans la belle traduction d’André Belamich :
« Ce regard était à moi, mais il n’est plus à moi, / ce regard qui tremble tout nu dans l’alcool / et lâche des navires incroyables / sur les anémones des jetées. / Je me défends avec ce regard / qui sourd des ondes où l’aube ne s’aventure pas, / moi, poète sans bras, perdu / parmi la foule qui vomit »
Invention d’une seconde lyrique, en opposition, en résistance par la seule vision radiographique de ce qui s’offre à voir : « Les jeunes Américaines portaient dans leur ventre des enfants et des pièces de monnaie. » Traduction crue de l’impossible rencontre des deux mondes ?
Suivent de belles traductions, par Laurence Breysse-Chanet, de plusieurs poèmes orientaux du recueil Divan du Tamarit (1931–1934). La traductrice donne ensuite une précise réflexion sur ces poèmes, leur genèse et leur sens, mais aussi sur la perte du manuscrit, sa non-publication, sa complexe restitution, le tout étant lié aux événements de 1936, à Grenade. « Tout dans Divan du Tamarit est vie violente et souffrante, sous le signe du trànsito. »
Parmi les autres contributions, relevons celle de José Ángel Valente : « … la poésie de Lorca correspond à l’un des moments complexes de transmission de vieux contenus cachés, où viennent converger les éléments d’ordre populaire et les éléments d’ordre hermétique. C’est pour cette raison que son œuvre est plus transmissible et, en même temps, plus mystérieuse que celle de tous les poètes de sa génération. » Celle aussi de Virginia Trueba Mira, qui n’est rien moins qu’un descente dans Le tréfonds lointain de l’œuvre de Lorca, à partir des lectures de J. A. Valente. Croisement des regards, miroirs emportés sur les routes lorquiennes, richesse et variété du propos, l’œuvre dans son ensemble est spectrographiée. Lorca, cette « âme qui n’en finit pas de se dire. »
Lorca était un connaisseur de musique et un excellent pianiste. On trouvera donc, sous la plume de Thomas le Colleter, les « Ombres profondes de la mélancolie », Beethoven dans les textes de jeunesse de Lorca », où tous ceux qui n’oublient pas la musique dans la structuration de l’art poétique trouveront une réflexion digne du compositeur et du poète : «… il (Beethoven) ouvre la voie au poète, qui lui aussi, en tant qu’interprète, lecteur, traducteur, se lancera à sa suite et pourra prétendre transfigurer son affect dans la grâce d’une “écriture blessée”.
Avec « F. G. Lorca et le cinéma », Stephen G.H. Roberts propose une utile confrontation de l’œuvre lorquienne (le théâtre notamment) avec le cinéma de son temps, si riche, avec les Luis Buñuel, Fritz Lang, Salvador Dalí… Une voie peu fréquentée pour la connaissance du poète, lui-même auteur d’un scénario, et de « dialogues » dramatiques, « réponses claires » au cinéma…
Enfin, le théâtre lorquien trouve dans ce numéro d’Europe, un écho digne de son importance. Albert Bensoussan en recherche les racines dans l’enfance et la jeunesse du poète, soulignant son attachement aux grands classiques Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón… Il retrace une véritable carrière, qui va des représentations enfantines à la grande aventure de la compagnie errante La Barraca, et aux représentations nombreuses que connurent les grandes œuvres dramatiques de Lorca. Parmi les observations pertinentes du grand hispaniste, celle-ci : «Ce théâtre est, avant tout, une représentation exemplaire de la vie, de ses passions, de ses frustrations, de ses aspirations ou ses manquements. »
La touche finale, dans ce domaine, est apportée par Jocelyne Aubé-Bourligueux ̶ avec « Un théâtre de la cruauté » ̶, où est scrutée cette œuvre mystérieuse et difficile qu’est Le maléfice de la phalène, ainsi présentée par Lorca lui-même : « comedia brisée d’un être qui veut griffer la lune et se griffe le cœur… » Le cercle lorquien se clôt-il sur cette image prégnante de la lune ? On se souvient du Romance de la luna luna, qui ouvre le Romancero, et de tant d’autres occurrences.
Catherine Flepp boucle la boucle avec la Comédie sans titre, connue encore comme Le Songe de la vie, œuvre inachevée (composée entre l’été 1935 et janvier 1936) par laquelle le poète voulait rendre compte de ses préoccupations sociales et esthétiques, par le chemin de ce qu’il qualifiait de « drame social, de comédie et de tragédie politique dont la “vérité” est à chercher dans « le problème religieux et économico-social », inséparable de la réflexion méta-théâtrale et de la question sexuelle… » C’est Monique Martinez Thomas qui ferme la marche en jetant le regard sur « Le théâtre de Lorca au XXIe siècle », et singulièrement en examinant les dimensions tragiques auxquelles le poète souhaitait atteindre par son théâtre. Il s’agit ici de « dis-poser le tragique ». Yerma, Noces de sang, La maison de Bernarda Alba sont au centre de l’analyse, pour un retour « au secret de notre imaginaire » : « Ne pas construire du sens mais des images, des chocs, du plaisir, des sensations douces ou fortes. Telle est la dimension atemporelle des pièces de Lorca, qui n’affirment rien mais nous offrent une matière brute à déchiffrer… » Cela est clairvoyant, et peut-être applicable à tout le Poème lorquien ?
Les visions, les analyses, les études concernant les œuvres si nombreuses et diverses du poète et du dramaturge andalou sont en perpétuel mouvement. Ce numéro d’Europe en témoigne avec luminosité et profondeur. Choisissons de dire « en mouvement » plutôt que « en évolution », parce que, selon moi, le temps de Lorca est encore bien proche du nôtre, que la plupart de ses questionnement biographiques, poétiques, esthétiques, politiques… ne peuvent encore être mis à plat, froidis, classés en somme ! Toute une matière de vie ̶- et de mort, dans divers registres ̶, se meut sous nos yeux, dans nos mains lorsque nous tenons un de ses recueil. C’est encore, du frémissement au tremblement, de l’effroi au plaisir, de la surprise à l’illumination, comme un tourbillon torrentiel dans lequel nous ne nous baignons pas sans entrer dans des champs magnétiques violents et suaves à la fois. Une zone en voie d’exploration, zone de non-droit peut-être, où le premier de nos droits est de nous y forger une âme dans la « noire peine » des hommes, si violemment perçue par Lorca, dans la glace lunaire et les ardeurs solaires de son Poème.
[1] Europe, en août-septembre 1980, avait consacré un premier numéro à F.G.Lorca, Marie-Claire Zimmermann nous le rappelle en p.3
[2] Europe, n°1032, p.30
- Marc Kober, L’ours des mers - 5 juillet 2021
- Revue EUROPE, avril 2015 : Federico García Lorca - 4 juillet 2021
- Michel Host, LES JARDINS D’ATALANTE - 4 juillet 2021
- Le scalp en feu (1) - 3 juillet 2021
- LA MÈRE MICHEL A LU - 20 mai 2021
- MARC KOBER, L’OURS DES MERS - 6 avril 2018