L’ATELIER VINCENT ROUGIER
L’Atelier Vincent Rougier existe depuis près de trente ans (1991). Il est établi à Soligny-la-Trappe, dans l’Orne. Ce nom nous vient du Haut Moyen-Âge (Solinelum, attesté dès 1091) et de son abbaye cistercienne, monastère des moines Trappistes.
Il s’y publie deux collections de recueils de poésie : « Ficelle » et « Plis Urgents », soit respectivement 142 et 57 parutions.
Vincent Rougier est le maître du lieu. Peintre-graveur, il s’est lassé de ses travaux parce que trop solitaires (sans les abandonner pour autant), y ajoutant la lecture attentive et l’illustration de beaucoup des recueils qu’il choisit. Il choisit parfois aussi « le peintre à marier avec l’auteur et plutôt que de faire un enfant ils font un livret. » Il est aussi le maître incontestable du choix littéraire − ce qui lui plaît −, néanmoins aidé par quelques auteurs pour la publication annuelle de huit à neuf titres. Il peut encore demander un changement de titre, etc. Ce choix est guidé par divers critères : « forme, thème, genre, « afin d’offrir une découverte-ouverture poétique au lecteur abonné. » Un considérable avantage de ces publications est qu’elles nous offrent des poètes en grand nombre et particulièrement de ces presque inconnus, parfois lumineux, auxquels les pages littéraires de la grande presse ne prêtent aucune attention.

Ces livrets sont d’un véritable format « de poche », minces et munis d’une couture ficelle qui permet de les tenir à l’œil et dans la main (ils sont aisément repérables). L’Atelier fait tout : impression, façonnage… Les tirages sont limités, mais peuvent être augmentés à la demande. La publication est « À compte d’éditeur », l’auteur restant propriétaire de ses droits. Dépôt légal assuré. Textes non retenus : non renvoyés.
QUELQUES MOTS SUR LE RECUEIL POÉTIQUE
Un recueil de poèmes est un cadeau. On ne sait ce qu’il nous réserve. On le découronne au coupe-papier, avec une hâte maîtrisée : il s’agit de l’ouvrir sans l’endommager. C’est que l’on y soupçonne quelque trésor plus ou moins enfoui. Suggestion d’une âme inattendue, proche ou éloignée de la nôtre… Évocation de notre monde, heureuse ou malheureuse, obligatoirement sous d’autres angles de vue, saisie à travers des expériences autres ou identiques, dans une houle d’impressions et de sentiments dont certains entrent dans les oscillations de nos sismographes intérieurs, quand d’autres nous surprendront, nous proposeront des approches nouvelles, surprenantes…
Ce sera donc, pour chaque recueil, son titre, son accueil, une séduisante promesse. Je veux dire qu’il convient de l’ouvrir, les yeux et la conscience libres de tout engagement littéraire, de tout préjugé quel qu’il soit, y compris de celui qui pourrait être lié au poète, à la poétesse, à ce que l’on aura éventuellement appris de sa personne, de ses faits et gestes. Il faut y marcher nu, vierge en somme, dans sa forêt de mots, de musiques et de signes. Aux hasards de paysages neufs, sans s’encombrer du bagage de nos connaissances, goûts et préjugés. Oui : vierge et nu !
Dès lors, comment lire ? En critique prêt à la réprimande, au contrôle, à la comparaison ? Certainement pas ! Je dirais en simple lecteur, en gourmet et en amoureux. Dans l’acceptation préalable d’un mets aux saveurs encore inconnues, et tout autant de délices ou délires surprenants, comme aussi bien de l’amour fou. Ce sera alors une lecture, ma lecture, accueillante mais n’ignorant pas que d’autres lui sont substituables.
Ceci, ma pensée de la poésie, n’est en rien un préalable ou un pré-requis. C’est une pensée qui ne demande qu’à être portée plus loin, plus profond que je ne n’ai su la concevoir : « Elle est mutation, traduction ou translation dans la langue maternelle, selon des cadences très intimes, de la langue des sources, langue du mystère de l’être, de émotions et des intuitions. »
J’adhère, par conséquent, à cet avis de Frédéryck Tristan : « La poésie n’est jamais fictive. » M.H.
∗∗∗∗
LES RECUEILS
Catherine ANDRIEU. À Fleur de peau (éd. revue-ficelle), Nicole BARROMÉ. Génésiques (éd. revue-ficelle), Paul de BRANCION. Glyphosate for ever (éd. revue-ficelle), Claude-Lucien CAUËT. Le Rire et le Vent. (éd. revue-ficelle).
Catherine Andrieu, née est passée du Sud à Paris, où elle écrit et peint : « Ut pictura poesis » ! Elle a publié de nombreux recueils aux éditions du Petit Pavé, de Surtis, ainsi qu’un essai sur Spinoza aux éditions de L’Harmattan.
Son recueil, À Fleur de peau, comme le laisse augurer l’énigmatique vignette-illustration de Vincent Rougier, nous propose des visions en avalanche, un maelström, tout notre monde encombré d’images et de souvenirs ramenés à un présent parfois léger, parfois pesant, car « rien ne meurt »., ce sont d’incessants frissons, ceux des sentiments partagés, connaissables, reconnaissables. Nous marchons au pas de chaque poème : ce sont les divinités ou personnages des légendes antiques, Athéna et son casque pour l’aurore, Eurydice pour l’effroi d’une bougie qui va s’éteindre… Parmi les animaux (la nature, sphère première) prévaut ici le petit chat Gabby, « mon Gabby… petit ange » : « Le Monsieur t’a fait une piqûre et tu t’envoles / Au Paradis des petits chats. »
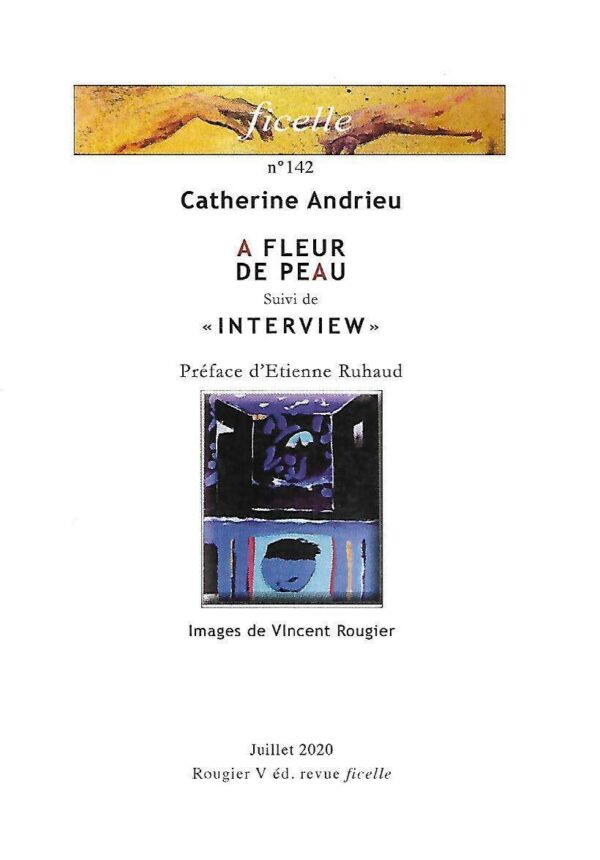
Catherine Andrieu, A fleur de peau, Rougier, collection Revue Ficelle, 2020, 13 .
L’expérience (je l’ai plusieurs fois vécue) n’est que douleur et regrets, traumatisme récurrent. Nous ne sommes ni omnipotents ni omniprésents ! La mort étend son empire. Il est une « petite sœur » dont la destinée semble plus que fragile, avec un insuffisant contrepoids notre impuissance : « Tu cherches en vain la preuve / Que quelque chose est vivant. » Le cœur de l’âme est étreint. Imaginer l’éléphant, même « gracieux », « des femmes à tiroirs… des montres molles…» n’est qu’un pis-aller. Dali n’y pourra offrir qu’un répit d’un instant. Viennent les visions de sang… « Maman dévorée » par « les dragons d’eau ». Où sommes-nous désormais sinon, dans l’effroyable capharnaüm, gisant parmi nos restes annoncés, presque vestiges : « Je ne suis pas belle ma jeunesse se fane / Mais j’ai le secret du cœur et de l’Univers » Dans les derniers poèmes, Catherine Andrieu évoque des « délires hallucinés », sans doute ceux de « la Coke », et conséquemment la possibilité d’« atteindre les comètes ». Un écrivain succède à ces cauchemars et nostalgies : « homme sans visage »… vu « comme une limace sur une rose », et à qui l’on peut dire encore : « Quelque part, pour un écrivain tu n’es pas si mal. / Il y a pire… » Comme à chaque fois, dirai-je !
Fait suite à cette salve de douleurs une passionnante « Interview inédite » de Catherine Andrieu. Elle y revient sur son trajet, sur ce qu’elle y lit elle-même : « … j’écris, pour m’ouvrir les veines sur le papier seulement. Et pour être Dieu aussi. » Elle l’est et l’avoue. − Comment échapper à cette nécessité ? − Elle reste néanmoins « un poète, mais un poète rock and roll. » Cette interview donne fort à penser à tout humain qui n’a pas trouvé à se satisfaire dans la fréquentation des supermarchés, des boutiques de fringues, des sports d’hiver… et qui cherche les échappatoires au néant : « L’écriture est ce qui me sauve de la folie en laissant une “trace” de mes allers-retours d’un monde à l’autre… » Comme l’on comprend ! Car c’est bien la seule solution.
∗∗∗∗
Nicole Barromé vit depuis 1990 dans « la ville au ciel toujours bleu » − je pense à Toulouse, mais je puis me tromper − où elle écrit pour le théâtre d’abord, puis pour l’art du bref : nouvelles, poésie « compacte ». Elle lie son écriture à d’autres disciplines : musique, sculpture, photographie, danse. Elle donne aussi des lectures publiques et participe à différents festivals de poésie.
La sensualité, la « gourmandise », un Éros rayonnant habitent ses Génésiques, et cela ne déplaira à personne j’imagine. Le fruit ouvert, modeste et mûri que nous propose la gravure introductive de Vincent Rougier nous en donne une traduction suggestive.
La « déesse » nous ouvre les portes du domaine végétal et minéral où loge cette inconnue, qui avait « Des pieds d’églantier / Des jambes de rocher / Un tronc d’ébène (…) Ses bras étaient lichen / Ses mains / Touffes (…) Son visage / Un lac où les regards s’abîmaient… ». Peut-être un paradis déjà ! Cela fait penser à la grotte sicilienne où l’espagnol Luis de Góngora abrita le cyclope Polyphème jusqu’à l’arrivée d’Ulysse. Il y aura le « rêve » d’un arbre-homme, d’un arbre-amant intemporel : « Elle avait dû l’embrasser / Se frotter à son tronc / Lécher son écorce / Mais quand ? (…) Il l’avait gratifiée de sa sève / Elle avait dû bien s’amuser… » Métaphore lisible et joyeuse. Les plaisirs des corps sont une forme de l’innocence première. Ils entrent dans une « … mémoire / Libre de frayeurs. » Notre éducation est sans cesse à faire pour ce qui est de l’enchantement des corps.
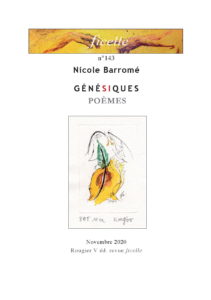
Nicole Baromé, Génésiques, Rougier, collection Revue Ficelle, 2020, 13.
Elle est bonne et belle : « La vie s’il le faut pour retrouver / L’affabulation des soupirs / Les empaqueter de mystères et les précipiter / Bruts. » /// La livraison / poil à poil / Des corps parfumés ». Une fragrance d’antiquité. « Affabulation ? » On s’interroge. Est-ce le plaisir feint ? Est-ce la possibilité d’un récit, d’un poème après coup ? Tout peut s’apprendre, en effet, et tout en vient à son acmé ! « Le balbutiement des fantasmes / Les regards entrés en collision / Les narines étouffées d’un désir dru / Baiser des lèvres de lave ». Oui, ce sont là « jeux antiquissimes », règlements de la chair, flammes de l’incendie… qui n’empêchent pas les retombées dans « la peur d’aimer », les angoisses de passage… quoique l’on reste à la portée de la déesse − Aphrodite ? −, de « Ses joues écarlates / Ses seins étonnés (…) sa nuque frémissante / Sa tête arrogante… » Comment dire de façon plus intense la transe amoureuse, ses arrois et désarrois, les corps enthousiasmés, les flammes débordantes du désir, l’Éros absolu ?
Après l’étreinte, les regards, tous les sens se portent aux alentours, vers la lune, « …quartier d’orange incandescent «, navigant dans l’ailleurs. Ils vont jusqu’aux yeux, à « la fixité de leur bleu » qui mène au passé, à « l’écume de la mer dans leur colère ». la mémoire s’est allégée, et de nouveau « On s’enracine dans le sous-bois ». Du monde vivant, tout fait signe. Le vers est irrégulièrement cadencé, long ou bref, suivant la mesure du souffle. Il mène plus loin : aux sentiments vifs et alternés de « La lumière », il y aura une « postérité des saisons voluptueuses », que je tente de m’éclairer : les souvenirs d’abord, puis rien, la nada. Fugaces remémorations, heureuses ou malheureuse : « Quiproquos et souvenirs interchangeables », une chute dans un ruisseau, sur sa balançoire une petite fille « Le nœud de satin finissant ses tresses / Violet / Volette… » Et puis, « Transformée en momie ambrée » (qu’est-ce à dire ? vieillie ? condamnée ? enfouie dans le natron du temps ?), l’amante, l’aimante va au « mépris », tente un retour à la déesse… Puis connaît l’«Advenir cendres de notre enfance », le possessif incluant le lecteur. S’invitent alors la tristesse en « torrents de papillons noirs » (surprises et pénombres des images !), les rides, des « émotions amphibies », « nos masques de mort… ». En sarabandes se présentent les rêveries et visions inéluctables qui n’empêchent pas d’ « Éclater de rire ». La déesse, à la fin, reparaît : ce sont, dans « La rotation des jours », « l’océan velouté du plaisir », le retour de la lumière, le parfait cycle cosmique il me semble, et, pour la déesse, avec elle, « Choisir d’être / Le lit / Au couchant / Elle est présente / Rose / Jadis / Tintinnabulement / Dévisager / Confier ».
Ces poèmes n’en forment qu’un seul.
Admirable, méditatif.
Il dit les temps de la vie, les mythes de l’enfance à son premier jour, au jardin d’Éden… Puis la scansion folle et voluptueuse de ses amours du bel âge, le fruit succulent avant l’assombrissement du terme deviné, avec, sur la ligne d’arrivée, ce « Confier » qui suggère l’abandon à quelque chose, à quelqu’un peut-être… Le mot désespoir ne figure nulle part, c’est un indice. Chacun, chacune s’y retrouvera.
∗∗∗∗
Paul de Brancion est « Écrivain de poésie, romancier, agriculteur bio, cavalier, dirigeant d’entreprise, producteur de radio. Il a vécu hors de France une partie de sa vie.
C’est en ces termes qu’il se présente, nous faisant comprendre qu’il est un homme d’action et d’actions variées, autant que d’écriture, et que ses écrits embrassent le poème et le roman. En taquinant l’Internet, on en apprendra bien davantage sur lui et ses étonnantes capacités et activités dans les champs les plus divers ! C’est, selon moi, un point fortement positif, car nous ne sommes plus aux temps des aèdes s’accompagnant d’un luth ni des troubadours et trouvères vagabondant de château en château.
Notons que la qualité d’ « écrivain de poésie », ici revendiquée, est fort exacte, car l’écrivain-poète use des formes poétiques contemporaines pour servir un projet polémique, situé dans le hors-champ du poétique conventionnel, quoique la défiguration de la nature abrite un lien profond avec des sentiments de révolte qui s’expriment aussi de manière spontanée sur le mode poétique.
Il se trouve que le livret s’intitule Glyphosate for ever, soit le poème et l’action poétique tout ensemble. Quelle action ? Celle de dénoncer l’emploi de pesticides et d’insecticides dans l’agriculture, dans le but d’accroître la production agricole. Causes et conséquences sont ici traitées poétiquement. Il s’agit d’un pamphlet, pour tout dire, d’une satire en accord avec notre époque désaccordée, pareille à un instrument endommagé.
Endommagé, détérioré cet instrument, pour avoir trop souvent surpassé les sages façons de jouer d’Ovide et Virgile. Il est notamment question du glyphosate, appelé aussi « roundup », un désherbant féroce qui anéantit toute plante et herbe qualifiée de « mauvaise », qui l’empoisonne de la tête à la racine, empêchant toute photosynthèse.
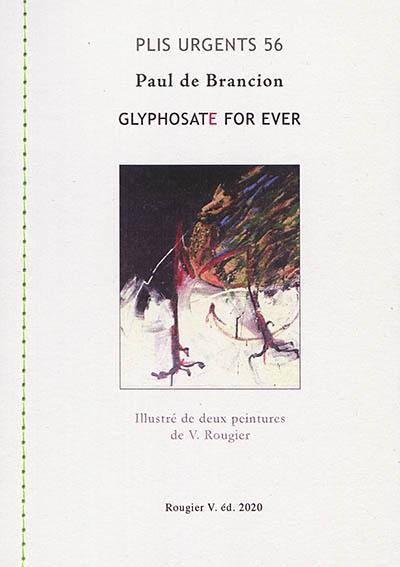
Paul De Brancion, Glyphosate for ever, Rougier, collection Plis urgents, n° 56, 2020, 16 €.
À la dénonciation de ce désordre se joignent la plainte et la colère. Selon une formule qui m’est chère, nous sommes arrivés aux temps de la « destruction du Jardin d’Éden », aux temps des angoisses, entre autres celle des Gilets Jaunes venus récemment jusqu’au pied des Arcs de Triomphe et des palais hérités de nos rois-bourgrois, peuplés des nouveaux gérants de l’infernale machine, dont on ne peut pas ne pas entendre la voix :
faut bosser
faut payer
faut douiller
fatigué(e)
t’es viré(e)
consommer
sans money
pas marrant
La machine à dénaturer, à rendre la vie invivable est bien là, décrite en peu de mots, sournoise, silencieuse :
Le banquier
A distance
……………..
pas d’réponse
y’a personne
pour causer
Le tableau est complet, déjà, dès les sept premières pages ; la machine faucheuse et voleuse de vie fonctionne à merveille, machine à détruire, à faire souffrir… Avec son mécanisme, chaotique en apparence mais au fonctionnement huilé : chasse aux boucs émissaires (on les trouve sans mal, ils sont à nos portes… mise en évidence des ravages de la « bagnole »… ceux des « casseurs » qui spectacularisent le chaos… Tout autour, le silence, personne jamais ne répond au bout du fil ! Le monde va de biais, en crabe, en arrière en prétendant foncer vers l’avant, vers le progrès… Tout y passe de la funeste mécanique, jusqu’à son carburant : « l’argent [qui] nous étouffe / et ce pas / depuis peu ». Jusqu’au « conjoint de Brigitte / [qui] n’a toujours pas compris / et demeure un valet ». Jusqu’au ravage du petit commerce et du confinement au gré des impressions du docteur X, des sentiments de l’épidémiologiste Y… Paul de Brancion avance dans notre présent immédiat, où le n’importe quoi règne jusque dans les cerveaux de ceux qui prétendent gouverner. Et cependant, « à Paris / ça décide / ça préside / ça concocte / ça dialogue / et ça taxe / ça retaxe / et relaxe / mais ça dé- / toxe pas / ça bavasse… ».
Le chaos du monde, le tohu-bohu de notre espace-temps, le poète l’inscrit dans son vers court, parfois brutal et heurté, malmené à l’image de la terre :
dès le quinz-
E du mois
c’est la cart’
E‑visa
Qui s’enrhume
plus de sous
le banquier…
à distance…
Le phrasé se brouille ici ou là, la phrase se désarticule car rien ne s’unit plus harmonieusement au Jardin du monde ancien, la syntaxe grammaticale est violée, parfois, à la corne du bois, car les champs, la terre, y sont quotidiennement violés. On ne parle plus que dans l’extrême difficulté : « Plus personne à qui causer. »
Paul de Brancion fait état d’une catastrophe planétaire, peut-être universelle, provoquée par un système totalitaire. Reste que les derniers mots suggèrent un espoir, une ligne de résistance, tout en désignant la maladie : le crachat sur la terre, le crachat sur nous-mêmes, l’oubli méprisant :
J’irai pas
Cracher sur
Les étoiles
Vincent Rougier, en peignant le ventre plein et les serres d’un rapace comme ancrées dans une neige blanche, et, pour clore le poème, un caddie de supermarché renversé, incendié, sorte de berceau d’un jouet ou d’un pantin anthropomorphe, souligne avec force et pertinence le propos de Paul de Brancion.
∗∗∗∗
Claude-Lucien Cauët se présente dans la discrétion. Il vit et travaille à Paris. Il participe aux activités du groupe surréaliste. L’essentiel par conséquent. Respectons ce laconisme. N’allons pas titiller Wikipedia. On peut soupçonner le poète de se plaire à Paris, d’y vivre peut-être, et de ne pas aimer outre mesure s’ennuyer. Il voudrait ne pas donner de titres à ses poèmes qui, à son dire, sont un « assemblage », un unique poème en vingt-cinq « prises » numérotées en chiffre romain. » Son éditeur en a décidé autrement, comme il s’en est donné le droit.
L’ « introducteur » du recueil, son préfacier concis, Yves Barré, recommande de le lire ainsi : « On ira surtout, sans préface ni filtre, au bonheur, d’avant que le vent ne se lève. »
Le bonheur, donc !
Il est sur les rivages, en vue de la mer qui, à la « course [sera] prise de vitesse », pour laquelle on se fera chapelier, ou plutôt modiste : « je la coiffe sur la ligne d’horizon d’un feutre de gangster »
Est-il des frontières au bonheur… du moins à celui-là ?
Est-il des frontières à l’art de coiffer la mer ?
Par bonheur, aucune !
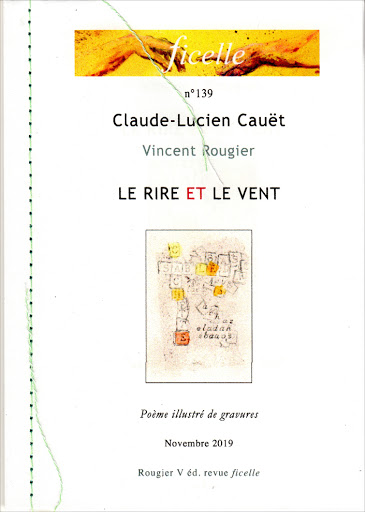
Claude Lucien Cauët, Le Rire et le vent, Rougier, collection Revue Ficelle, 2019, 13€.
Où est ce bonheur ? Il est dans la cruauté des rêves perdus, celle d’ « une fille [qui] se jette au cou du vent et le mord à l’aile de sa bouche aux dents de thé », ou « d’une belle armée qui va courant le long des digues et rugit du plaisir de tuer »
L’image surréelle, voire surréaliste, pointe son nez. (Ici, Vincent Rougier dessine le souvenir d’un jeu ancien nommé « Lexicon », sachant le kaléidoscope miroitant des mots, surtout lorsqu’on les veut croisés !)
Où est ce bonheur ? Il est dans un « vortex qui perce le tissu du spacetemps et me précipite dans l’absence ». Désirable absence dans un monde de la surprésence et des représentations fictives… Il est dans les rébus qu’Iris envoie depuis l’espace, quand elle vous « tient par la barbichette » et que vous la tenez « par la pointe d’un sein ».
Nous allions oublier le Rire qui, selon le bon sens le plus terre à terre est le compagnon du Bonheur, quoique l’on puisse pleurer de bonheur ! Tous deux, ils savent « marcher sur la pointe des os » et « [rire] dans la mitraille en clamant des priapées ». Avec eux, entrons-nous dans l’autre monde ? Non pas. Seulement, et c’est immense, dans une vision métamorphosée de notre vieux monde. Nous savons que souvent l’antithèse, le contrepoint, l’antiphrase, le reflet inversé, les contraires, les pléonasmes, l’hapax, les apories et autres oxymores arment la stupéfaction et le rire. Claude Lucien-Cauët en usera à son gré, dans la course du vent et de sa fantaisie…
Ils forment un trio : le rire, le vent, le bonheur, et, autour d’eux le lecteur rencontrera un simple « joueur de flûtiau »dansant sur les pierres de la rivière (vision entre ovidienne et virgilienne, par effraction…) Il entreverra « deux seins palanqués qui se ber-cent dans une haie d’orties rouges » − Guette un danger mystérieux ! On « risque sa peau ». Ils traverseront les hauts plateaux où « les bergers n’y conduisent leurs troupeaux qu’à recu-lons guidés par des ondes sauvages ». L’image insolite nous apporte le paysage champêtre avec sa pastorale. La nature est traversée « de mille et une figures licencieuses / d’intrications frénétiques ».
(Ici, tapisserie s’extrayant de l’ombre, portant aussi la lettre B‑couleur coquelicot et le bleuet des champs, talus et fossés d’antan).
Ici, « les esprits… sortent du ravin où la tribu a coutume de jeter ses morts ».. Le bonheur rejoint les régions premières, où l’on se débarrasse des morts. Alors s’interpose « la joie d’un matin », et « la bête va seule au bout de son rêve ». Ou plutôt de ses songes ! C’est le terrain d’aventures du poète. Le lieu de son imaginaire délivré, quand il lui est indispensable d’abandonner les formes anciennes et connues. Il les habille d’oripeaux brillants, les maquille d’onguents magiques faits pour renverser l’habituel, le déjà-vu, pour substituer son chant heureux aux vieilles rengaines versifiées :
… tous les rires se valent
Tout vent varie sa carte à l’aventure
Et le temps est toujours neuf
Ici, le peintre brouille l’ordre des lettres, le lexicon est aux prises avec une clé de 12 : l’ordre doit être nouveauté, désordre donc. Sans doute destructible). Contraste brutal : « on se tait en fixant son voisin / immense désastre de bouches qui articulent des silences en levant aux étoiles des yeux vides ». Le monde vide et réel (imaginé réel) n’est jamais si loin qu’on le croit. Cela effraye ! Les deux univers se côtoient, se touchent presque : « là où vous entendrez la forêt qui rit et le chant des moulins […] les filles du bourg se glissent parmi les ifs à la recherche de leurs idiots » !
De cette lecture, tirons une leçon : gardons notre plancher des vaches où des idiots courtisent des filles ingénues ou stupides, ou encore, seule alternative, changeons ce monde, inventons l’autre, celui des songes, celui où « un génie apparaîtra à la limite du ciel », fût-il un mirage. Partons‑y « en claquant la vague ». Ne revenons plus à la planète d’antan, à moins que de la garder en mémoire soit la condition et le piment du rire et du bonheur.
- Marc Kober, L’ours des mers - 5 juillet 2021
- Revue EUROPE, avril 2015 : Federico García Lorca - 4 juillet 2021
- Michel Host, LES JARDINS D’ATALANTE - 4 juillet 2021
- Le scalp en feu (1) - 3 juillet 2021
- LA MÈRE MICHEL A LU - 20 mai 2021
- MARC KOBER, L’OURS DES MERS - 6 avril 2018
















