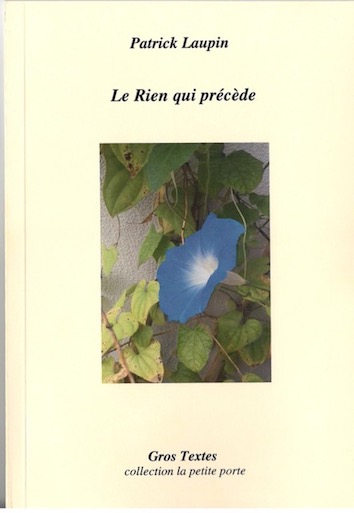Quelque chose d’impérieux, venu du plus profond, porte l’écriture de ce livre; la lecture ne peut que suivre le mouvement même de cette force, au fil des pages-poèmes qui lui donnent le rythme profond d’une respiration.
Saisi, le lecteur vit l’expérience poétique de l’intérieur, page à page, chacune centrée sur elle-même, chaque texte centré sur la page ; quelque chose de vivant palpite dans l’écriture.
Comme écrite d’une traite, cette œuvre du « temps de la cueillaison » embrasse et brasse toute une vie dans le flux des visions, pensées, réflexions, souvenirs, images, sensations, qui constituent l’étoffe mémorielle. Sujet actif, incarné dans la phrase, le poète nomme, énonce, énumère ; il accomplit les tâches nécessaires à celui qui retourne dans sa vie car « il est l’heure de tout reprendre et de faire le vide dans la maison des démons » ; confronté à « la terrible urgence de tout relire à l’envers », il laisse monter en lui, affleurer à sa conscience, les images qui font signe. « La fin d’automne récite tout à l’envers ». Des pages hantées par l’enfance, la mort des êtres chers, la proximité de la folie, la passion pour la « chair parlée des choses » dans une langue saisissante qui joint l’abstrait au concret, le sublime au trivial : « J’écris ma langue Moyen Age Une langue du fond qui touche la folie muette et ne veut pas du poétisme ».
Tourmenté par la disparition, l’effacement, l’oubli, masques les plus terribles de la mort, le poète destine son écriture : « on voudrait laisser quelque chose pour quand on ne sera plus là. Le sens mystérieux des aspects de notre existence ».
Cherchant des réponses à la question « pourquoi écrire ? », il l’examine, en la vidant de la prétention dont elle semble toujours chargée : pourquoi ou plutôt pour qui écrire, dans quel but, et surtout à qui ? Répondre à cette question, c’est aussi dire dans quel sens va la vie. Une page très belle, sorte d’hommage éluardien, répond fermement, usant d’un résolu passé composé : « j’ai écrit » :
A la pierre ponce du lavoir A la fleur
maigre Aux vassalités A la fièvre Aux
têtes de chiens des démons Au Roi sans
Roi des chimères Aux dents féroces des
apprentis funèbres Aux barreaux de
chaise Graminées lentes Aux gamins
des premiers crayons A la rouille et aux
arbres qui étudient J’ai écrit J’ai pris
soin de nos vies
Ecrire est la seule chose à entreprendre, la seule nécessité : le monde sensible en est à la fois la matière et le destinataire.
« Ecrire, frêle isolement d’un remuement d’ailes, le monde sans sauvegarde, la dureté nominale des cieux… »
Les bruits
passent et filent à l’eau des regrets Tant
pis j’écris je commue ma peine dans
mes pages de carnet
Bouleversant toute cohérence narrative, la cavalerie des mots et des images aboutit dans un tournoiement à une page-sensation qui bouscule même la logique de l’association d’idées, en des moments proches de la transe.
Les mains crispées des petits mouchoirs à devise. Le calme écrin tremblé des cœurs épris de la mort. Fuyards qui n’ont plus qu’un sort Nacelles voyelles et consonnes Nudité lasse de la folie des gens Le mal pose bien mal ses griffes La vie n’a plus assez de lignes pour creuser sources et rideaux vétustes La laine pâle file des mailles fuyantes La mer fait aux nuages des têtes étranges Tout peut arriver Dans la main terrible du hasard courent pierres et visages Et tous les petits effacés dans les enclos de groseilles à saveur lisse Arrive automne La cavalerie légère du rouge des érables frissonne Triste on a froid au corps La trace des rayons se perd Les erreurs posent leurs frusques à la remise N’en veux à personne Toi qui faiblis debout en douceur traversé par les rancunes et les épées silencieuses
Ponctuation omise, les majuscules guident la lecture dans l’unité de la page, où les rapports entre la phrase et le vers sont contraints par le centrage du texte qui « garde les ressacs en marge ». La juxtaposition de phrases courtes et de phrases de grande amplitude instaure un rythme qui demande à prendre et reprendre son souffle. L’oralité gîte dans l’écrit. Quelqu’un parle à « voix haute ».
A mes pieds plusieurs aveux de regrets Les sept voiles que plus rien ne traverse et les natures basses qui offensent Où je sais la folie triste de l’enfant au poison des légendes quand il pose ses mains près de la fenêtre et se rétrécit dans le double miroir de son éclipse dévoré de connaître quelle partie de lui-même s’envole si loin vers
le ciel des comètes
La même énergie impulse la composition du livre : le poète prend son élan, se ravise pour partir « visiter l’air du temps » dans des pages sans concession où se glissent colère et parfois amertume, puis accélère le rythme, évoque, invoque, jusqu’à l’hallucination. L’écriture court vers un but, une résolution. Est-ce que l’on va voir défiler, et même revenir, les êtres, les lieux, les sensations, les émotions qui leur sont attachées, le « film » de toute une vie, la course fulgurante d’images qui envahissent dit-on la conscience des mourants ? Est-ce que l’écriture a ce pouvoir, de donner à ressentir, à partager, toute une vie, une âme ? Comme dans un assemblage cubiste, se côtoient sur la page tourments, obsessions, êtres croisés, choses vues, pensées, sensations, images d’un instant de vie que l’émotion tire de sa banalité…tout ce qui dans la rêverie, activité essentielle de l’esprit, nous rapproche du délire et de la vérité.
Ma vérité tiendra toujours un peu à l’hélice rose
des moulins du matin, des prières du
vent, à la vétusté des choses sur l’étal
d’un bazar, l’écorce d’érable ou de
tilleul, les ballots de laine, coton, soie
allégée, fichu par côté Et ton long
soupir d’épaule pour monter la pente
Avec « l’entêtement d’un éternel mendiant des fruits vrais », Patrick Laupin salue « l’enfant qui nous montre l’intérieur des choses », les enfants-poèmes rendus au langage, porteurs du Dernier Avenir. « Je parfais en rêve les enfants du silence. »
Seuls les oiseaux
et les enfants ont ce geste d’aumône
invraisemblable de retourner le temps
dans le refuge des âmes esseulées plein
vent
Compagnon halluciné de ce voyage intérieur, car « écrire c’est tendre une main miroir d’âme », le lecteur fait l’expérience de l’évidence poétique, éprouve « la vie immédiate » par le pouvoir de l’écriture :
L’ombre des dieux déchus couronnés de Tristesse
Cette blessure Aspic furieux du vent du
monde gris Midi qui tremble Grand
nageur déjà noyé Ciel flottant à
nouveau immobile libre Et moi un homme
Avec ce qui reste Muet
d’astreinte Rêvant d’absoudre Rêvant
midi qui tremble au désir d’aimer
Le Dernier Avenir est le geste puissant d’un poète.
Un poète. Un homme. De chair et de papier.
- Coralie Poch, Tailler sa flèche - 21 décembre 2022
- Réginald Gaillard, Hospitalité des gouffres - 21 janvier 2022
- La Maison de la Poésie Jean Joubert et ses partenaires en période de “distanciel” - 1 novembre 2021
- Enza Palamara, Ce que dit le nuage - 19 octobre 2020
- Impressions de lectrice sur quelques ouvrages de Marilyne Bertoncini - 6 mai 2020
- Estelle Fenzy, Gueule noire - 26 février 2020
- Frédéric Jacques TEMPLE, Poèmes en Archipel - 6 décembre 2019
- Patrick Laupin : Le Dernier Avenir, Poèmes - 23 novembre 2015