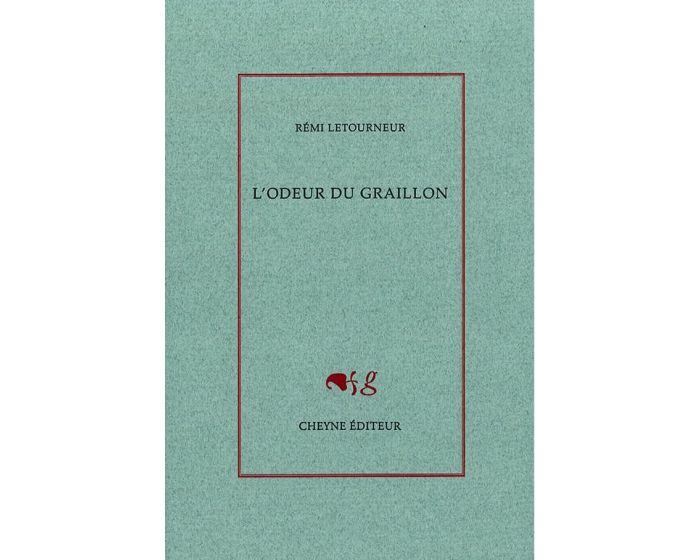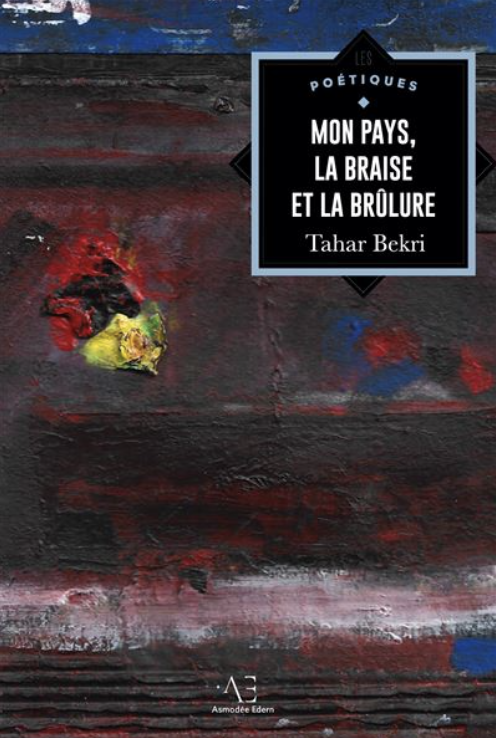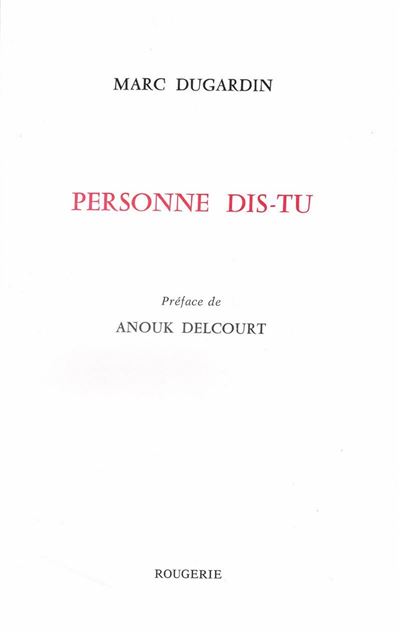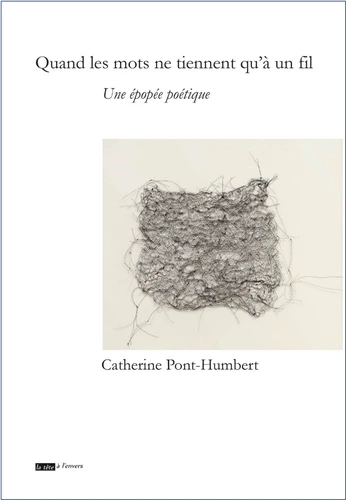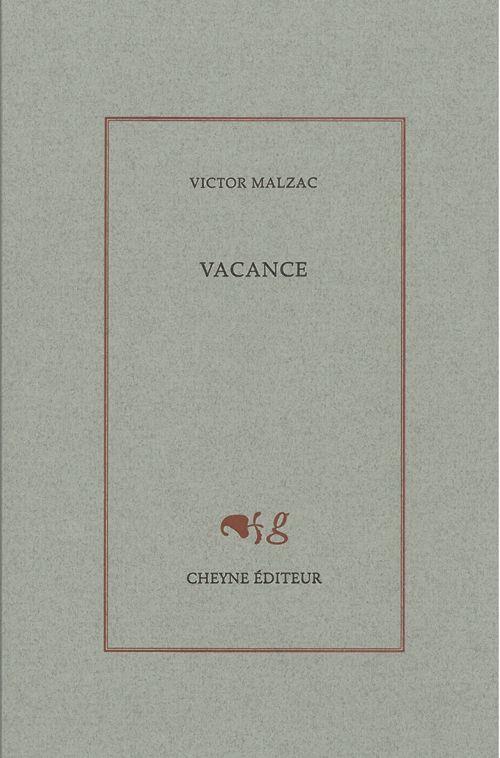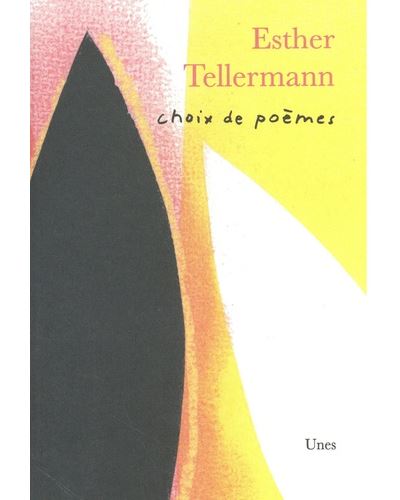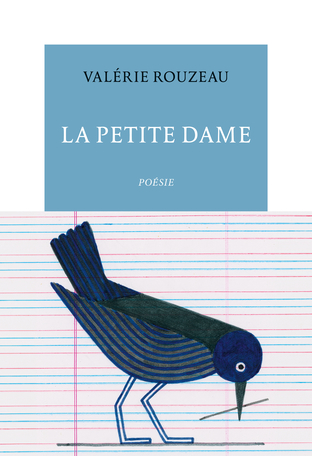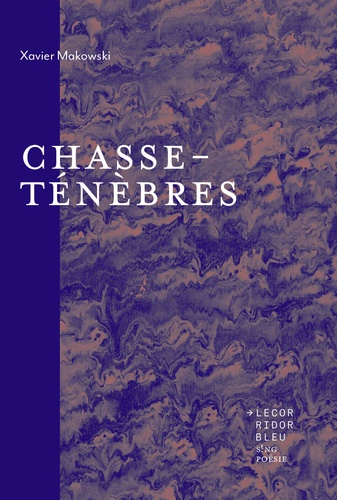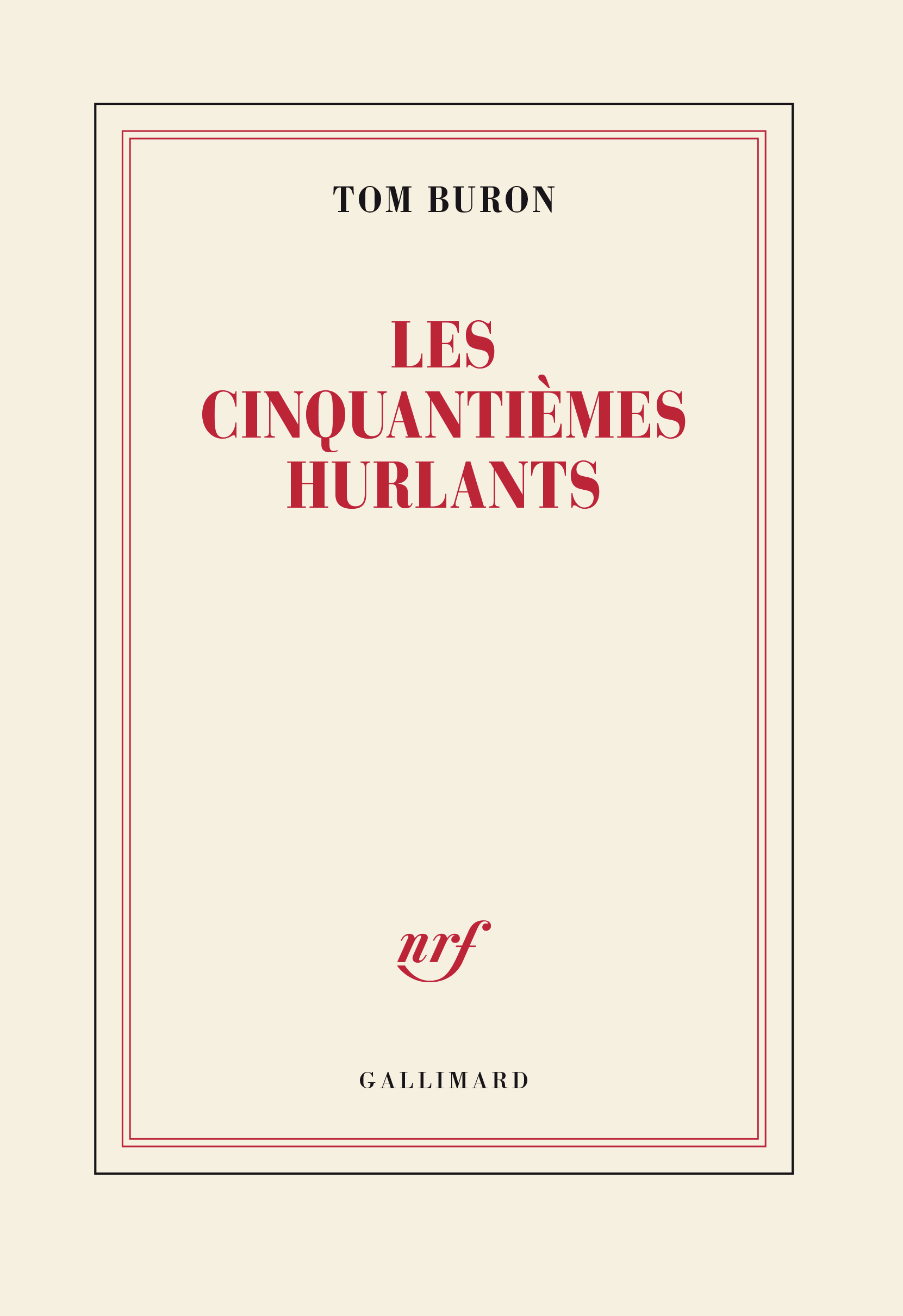A quelle aventure le poète invite-t-il le lecteur, en lui faisant signe par le mystère de cette alliance de mots ?
Hospitalité des gouffres, de Réginald Gaillard (Ad Solem), qui a reçu en 2021 le Prix Max Jacob, ex aequo avec Mon livre, de Patrick Laupin (le Réalgar), ainsi que le Prix Paul Verlaine de l’Académie française, est le troisième volet d’une trilogie poétique, comportant L’attente de la tour (2013) et L’échelle invisible (2015). Une trilogie qui est aussi un édifice. Car l’auteur est un bâtisseur.
De recueil en recueil, une architecture se dessine, sur les fondations des scènes d’enfance. Nommées « Kinderszenen », elles empruntent à Schumann le titre donné aux pièces musicales écrites pour évoquer la persistance de l’enfance et son empreinte dans sa vie d’adulte. Ces « scènes d’enfance », non seulement constituent le terreau de l’écriture et de la vie, mais définissent aussi les choix d’écriture.
Il s’agit donc de scènes, qui ne sont pas racontées ni décrites, mais données à voir et à éprouver, comme les états, les sentiments, les expériences, par visions, images furtives, éléments du réel mêlés de façon troublante à ceux de la mémoire ou de la rêverie. Cette écriture restitue la densité des moments, leur charge émotionnelle, suscite l’empathie : le propre de la poésie.

Réginald Gaillard, Hospitalité des gouffres, Editions Ad Solem, 2020, 128 pages, 17 €.
Comme un indice, le premier texte du recueil, faisant signe à Apollinaire, est un souhait devenant prière, l’image de ce qui va s’opérer grâce à la poésie :
Vienne le jour nouveau qui efface la nuit
Et que disparaisse enfin le doux tumultedes voix fausses, car elles égarent l’esprit,
instaurent le règne d’un silence funèbre ;que fonde le givre que partout je dépose,
quand tout semble mort en mes terres. Alors,alors, se lèvera le léger bruissement
d’une robe où enfant je me réfugiaisaujourd’hui de terre rouge salie,
mais, demain, transfigurée de lumière.
Les distiques, les quatrains, en vers libres, les poèmes courts, de quelques vers, les versets, livrent de façon à la fois pudique et violente, le cœur de l’émotion, du ressenti, d’un seul trait.
Qui pleure oublié dans l’ombre d’un coin ?
Un enfant de ferme désormais seul- mais fort –Renfermé dans la cour de l’école ;
Un orphelin qui perdit dans le pli serréde la peau du temps, celle qui était sa terre,
sertie de sang. Elle file en continu…
Les choix typographiques, la ponctuation (usage du tiret, des points d’interrogation), l’élasticité entre la phrase et le vers, l’enjambement, préservent et restituent la spontanéité de la pensée.
Qui de nous deux rejoindra
l’autre pour lui donner
le baiser fougueux du pardon ?
- J’ai besoin de la ramure de tes bras….
Le recours permanent au concret et au visible font de l’image et des correspondances l’expression naturelle de l’écriture.
Quand même le ciel serait lacéré
Par nos ombres meurtrières,Recousons-le avec les fils ténus,
Et même usés, de nos poèmes
(…)
Les onze textes du prélude constituent un territoire auquel l’ensemble du poème se réfère. Ils complètent, renchérissent, ou constituent des variations sur ce thème (presque au sens musical) des Kinderszenen de L’échelle invisible. Ces scènes contiennent tous les enseignements pour la vie à venir.
L’état d’innocence de l’enfance est bouleversé par le premier drame, il est le théâtre de l’ouverture du premier gouffre : la mort de la mère.
Il n’est plus temps de tricher,
De prendre la pose et de faire miroiter ;
De croire au merveilleux, aux fables.
Les chevaux ne sont plus de bois – las…La cloche de l’école a sonné – elle est fêlée.
A son bruit les jeux de l’enfance ont fui- Je n’avais guère plus de six ans.
Maintenant, on meurt pour de vrai.
Voici livrée l’expérience d’initiation à la cruauté de la condition humaine : l’élan vital est désormais en permanence menacé par ce qui pourrait le briser. Ce qui est le sort partagé de tous, l’éternelle hésitation.
Evoquée dans les précédents recueils, dans une distance subtile, la mort de la mère confronte l’homme en devenir à ce qui sera le tourment de sa vie : l’injustice du sort et la nécessité de croire, malgré le silence et le doute.
Ces scènes fondatrices ouvrent sur les trois parties centrales, aux titres ostensiblement connotés.
Acedia, Dies irae, effata : les termes appartiennent au champ de vocabulaire de quelqu’un qui fréquente les Ecritures, en est nourri, dont la vie, comme le poème, est imprégnée par la foi chrétienne. Pas d’effusion explicite à ce sujet à la manière des romantiques, mais l’évidence d’une coloration mystique assortie de signes, de références, comme si, discrètement, allusivement, le poète se disait résolument constitué par cette vision de l’existence.
Dans L’Echelle invisible, ces termes étaient déjà présents, dans une partie intitulée « Acédie et colère ». Dissociés ici, ils marquent la conscience d’une progression.
Acedia , titre de la 1ère section centrale, est un mot qui désigne le péché de négligence de soi, de sa vie spirituelle, mais aussi l’ennui (au sens de lassitude et de tourment) de vivre.
Dans cette section se trouvent les poèmes de la tentation du renoncement, du désintérêt pour les luttes vitales et les combats. Toute une gamme de sentiments liés à cet état sont évoqués, la mélancolie, l’indifférence, le détachement de la vie. On est proche parfois du spleen baudelairien.
Aridité
Lente progression du chaos, tu peines
Parmi les pierres, dans le râle des vents,
A la vie contraires. Douceur, chaleurNe sont de mise. Ô calvaire
Quand l’attention se fait aride,
Quand l’aigreur calcine le figuier.
A jamais me tairai
Pourquoi es-tu si seul et cette maison si vide
Quand même t’entourent tes frères,
Mineurs de fond, âpres et brillants travailleurs ?Pourquoi plus rien ne te tranche en deux,
Ni la brûlure des baisers interdits
Ni la trahison joyeuse des amis ?Tu glisses, lent – et l’ennui bâtit sa demeure.
La deuxième partie, Dies irae, le jour de colère, le chant de la mort dans la liturgie chrétienne, tant de fois traité comme un motif, devient un espace poétique exploré comme celui d’un homme aux prises avec sa foi, ses doutes, et ses pulsions, et dans lequel il va côtoyer d’autres gouffres, les habiter, et peut-être y sombrer .
Car la mort qui « repasse » est nommée à nouveau, ainsi que les autres abîmes, les « vilenies », les « noces sombres », le ciel « bouché par la ouate noire/ du souvenir malade des absents »,
Dans cette partie cependant, un combat est mené, l’homme cherche à dépasser l’acédie. La révolte, la colère, infusent leur énergie.
Je vole au ciel le murmure de sa promesse
jamais tenue
Dies irae IV
La nuit est tombée ; commence la vie.
Seuls restent éveillés les guerriers en armesQui vont, chant sur les lèvres, vers leur mort,
La peur au ventre, la peur d’être indignes.
Epreuve du feu, du sexe ; brasier de la langue
— Que ne suis-je devenu prêtre, ou soldat !
La progression continue de s’accomplir dans la troisième partie centrale, Effata. Jean-Yves Masson, dans son éclairante préface, rappelle le contexte et le sens de ce terme : « Ouvre-toi » est le mot prononcé par le Christ pour amener à la parole un homme sourd et muet, et le geste qui l’accompagne, dans l’Evangile selon saint Marc.
L’ouverture à la parole poétique et à ses pouvoirs, c’est une injonction que le poète se donne à lui-même, à cet effort d’écrire, de nommer ce que l’habitation des gouffres lui a appris.
Un seul geste suffira
(…)
Malgré tout, malgré l’abîme flamboyant, toute
honte bue, au calice calciné, maintiens sauvela pure possibilité de reconstruire en dur,
l’innocente circonstance de revenirvraiment au monde, renouvelé par un geste !
Car seul suffira un geste à effacer l’affront
Effata !
C’est la partie dans laquelle le dialogue du poète avec sa foi est le plus explicite, où l’image presque physique du Christ traverse les poèmes, le moment où il recherche la main amie qui va le conduire et l’aider.
Une lumière pâle
Persiste dans le crâne une lumière pile
infime mais tenace. – Calme, n’ayez crainte…Tant que je la verrai luire, tout au fond,
Sans heurt je marcherai. Et que jamaisNe me menacent, ni me saisissent
Les ténèbres qui rôdent, alentour et ici.
Par degrés, nous avons été conduits du fond du gouffre à la lueur puis à la lumière, à la « promesse du soleil ».
Enfin, à la fois comme un aboutissement et comme un mouvement de côté, dans la dernière section, les « éléments épars pour une poétique », montrent un moment où le poète est au travail, où l’écriture a pris toute la place et donné du sens, et a presque éloigné le doute.
Les « éléments épars pour une poétique » apportent les éléments pour un art de vivre.
Le gouffre devient l’espace où l’écriture transcende le vécu. Le combat pour ne pas sombrer trouve dans le gouffre lui-même la matière de l’écriture.
La lueur des gouffres
J’avance en aveugle, me dirige à l’instinct.
Ainsi seulement je vois et connais des gouffres
la lueur hospitalière. C’est parce que je ne sais rien,
ne vois rien ni n’entends comme les autres
que tout m’apparaît possible, sous un autre jour,comme si je croyais, naïf,
en quelque efficacité de la parole,
à augmenter la matière du réel
à accroître le désir des regards.
Rimbaud est présent, comme un exemple et un secours. (Adieu, Une saison en Enfer)
J’espère l’usage, l’usage inconnu
Ecrire, contre tout écrire, tenir le pas gagné,
Arraché aux gravats qui s’amassent dans la tête
(…)
J’aspire à la nage, j’espère l’usage ; l’usage inconnu
D’une langue qui osera tout, tout autrement,
(…)
et qu’enfin je voieet qu’enfin je sente
et qu’enfin je soiset dans le monde et du monde
étiré entre terre et cielentre le chant de la chair
et celui des morts.
C’est le moment de la résolution, aux deux sens du terme : le poète est déterminé, et il a résolu son tourment par l’écriture.
Le dissimulé
- Que cherchez- vous ainsi comme un fou ?
- Ce qui demeure dissimulé, là, que je sens, mais qui échappe à mon regard. Ma chasse n’est pas folle ; elle est elle-même le sens.
Ce recueil, dans la continuité des deux autres volets dont il est l’aboutissement, construit l’histoire d’un chemin d’écriture qui est aussi une leçon de vie. L’oxymore du titre est aussi une métaphore de la contradiction qui habite l’être humain, entre l’élan vital et le désespoir.
Une « postulation simultanée », associée à cette puissante et archaïque image du gouffre, rejoint « L’expérience du gouffre » baudelairienne, analysée par Benjamin Fondane. Attente de la « tour », « échelle » invisible, hospitalité des « gouffres » : que les mots des titres ne nous trompent pas. Le mouvement est bien celui de l’élévation.
Hospitalité des gouffres trouble et réconforte. Un partage d’humanité auquel seule peut parvenir la haute poésie.
Présentation de l’auteur
- Coralie Poch, Tailler sa flèche - 21 décembre 2022
- Réginald Gaillard, Hospitalité des gouffres - 21 janvier 2022
- La Maison de la Poésie Jean Joubert et ses partenaires en période de “distanciel” - 1 novembre 2021
- Enza Palamara, Ce que dit le nuage - 19 octobre 2020
- Impressions de lectrice sur quelques ouvrages de Marilyne Bertoncini - 6 mai 2020
- Estelle Fenzy, Gueule noire - 26 février 2020
- Frédéric Jacques TEMPLE, Poèmes en Archipel - 6 décembre 2019
- Patrick Laupin : Le Dernier Avenir, Poèmes - 23 novembre 2015