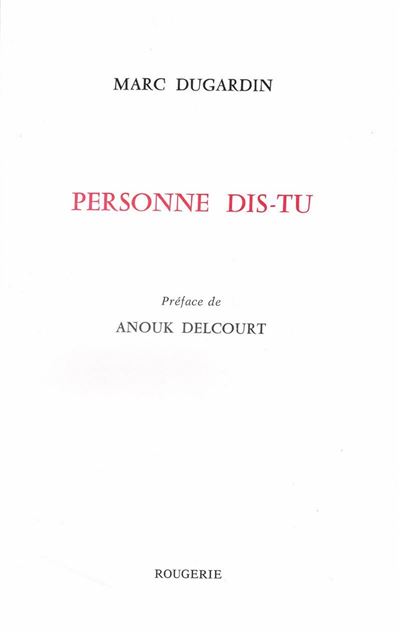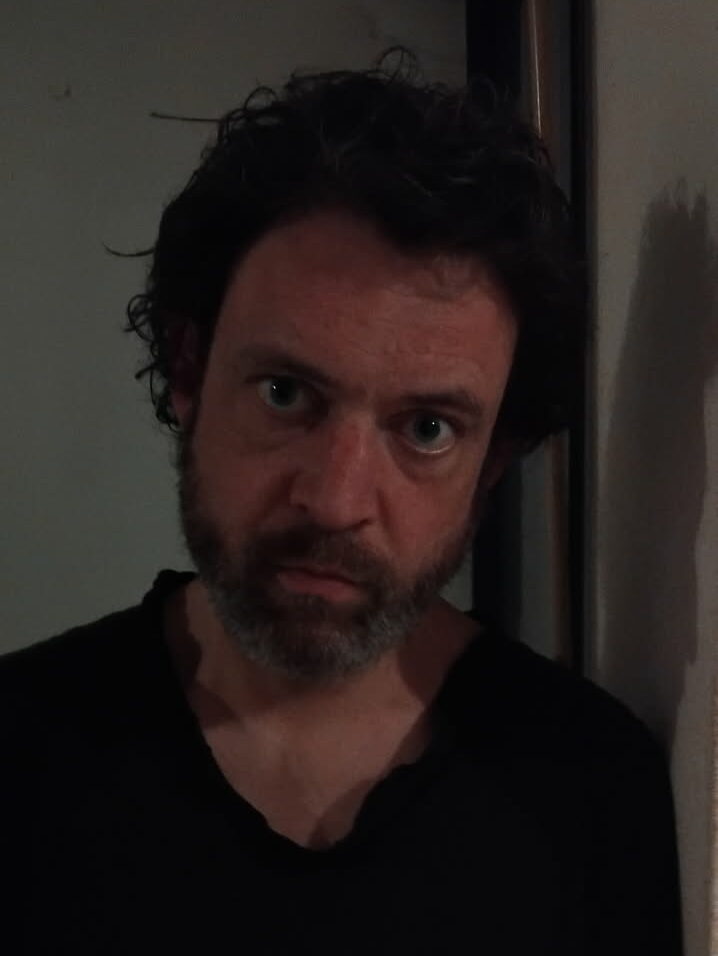table
simplement
paroles
enracinées
dans le silence
mie de pain
à cœur ouvert
oiseaux, dehors,
et dedans, un peu,
pour le réveil des chambres
ce qui s’écrira
avec quelques mots malvenus
(ceux dont personne ne voulait)
fondations
qui se taisent
depuis longtemps
puis les murs
le vent dans les charpentes
et la fenêtre
giclures sur le papier
et déchirements
cris, braises
flammes
et la danse, la danse
ciel avec nuages
on y devine
le présent
le sans preuves
nuages
pour être l’étranger
le jardin
ne se trompe pas
de désordre
ni l’enfance
dévorée
dévorante
rire
qui entame le jour
une rose dans la chambre
tant de roses alors
sous les paupières
ça ne veut rien dire
ça dit :
venir au monde,
le quitter
chantonner — bercer le
bercement qui manque
chanter par défaut
c’est chanter tout de même
II
ce n’est pas une simple parenthèse
papyrus de cauchemar
Je sais qui me poursuit (…) … Je sais qu’ils ont des machettes.
(Scholastique Mukasonga)
d’un coup, poitrine
ouverte, une nouvelle fois
ce n’est pas rien qu’une cicatrice
ce que les parents taisent
tas de fumier de la honte,
à ne plus savoir qu’en faire
Bien sûr, il y eut des survivants. Un génocide n’est jamais parfait.
Boucle. Ca revient
en boucle. Fugue,
à la vie, à la mort.
Maison, ronde, comme
un sein où se blottir.
Sentier qui n’y ramène
pas.
III
elle
la mère
si elle avait pu…
(au moins juste ce qu’il faut)
sur la langue
le lait a pris feu
indulgence
de la rosée
tout de même
plus tard
parole
qui s’ébranle
cherche l’embouchure
retour à la
table
doucement (on aimerait)
pour disparaître
silence
à la fin
sans clôture
à Kigali
août 2013
Notes au retour du Rwanda, où j’ai passé trois semaines. Je les rédige à partir de ce que j’ai griffonné sur place, dans un petit carnet de poche. Et sachant que, d’abord, c’est un poème (un long poème constitué de séquences très brèves) qui s’est écrit là-bas. Tout comme en février 2012, cette écriture « à chaud » témoigne de l’intensité de ce qui a été vécu, dans la relation d’amitié, dans le rapport complexe à ce pays, magnifique et terrible à la fois.
Je ne sais trop alors ce qui « mérite » d’être retranscrit ici, de ces notes de chantier dont le poème est sorti avant que j’y mette « de l’ordre ». Poème qui a choisi (cela s’est imposé) la concision, le peu de mots, la simplicité de l’écriture (puisse cette simplicité-là rendre compte de toute la richesse à laquelle me renvoie l’expression « table simple » !)
Lectures à Kigali (et à Remera, dans le Nord du pays ; mais là, j’ai souvent déposé le livre pour reprendre la contemplation – silencieusement, longuement – du paysage : les montagnes, la chaîne des volcans qui émergeait parfois des nuages, le lac Ruhondo en contrebas, mais aussi les villages à l’avant plan, sur les collines, les gens au travail, avec les cris d’enfants, leurs pleurs ou leurs rires, l’esquisse d’un chant de temps à autre, les hurlements d’un cochon que sans doute on égorgeait…) : Cuisine d’Antoine Emaz (tandis que Nicolas lisait le Journal de Lucien…), Inyenzi ou les cafards et La femme aux pieds nus de Scholastique Mukasonga, relecture de Juan Gelman (Lettre ouverte suivie de sous la pluie étrangère) et de passages de Mieux taire d’Armand Dupuy, et de passages encore de Poèmes de Paul Celan (les traductions et l’essai de John E. Jackson), livre lu lors de mon précédent séjour à Kigali, que j’y avais laissé pour que Nicolas puisse le lire à son tour… Des fils dans tout cela, comme ce rapprochement troublant entre la situation de Paul Celan (survivant à la mort de ses parents) et S. Mukasonga, seule de sa famille à survivre aux massacres de 94 (elle était en France à ce moment, mais elle avait connu tous les pogroms qui s’étaient succédé depuis 20 ans à l’encontre des Tutsi)…
Mais que dire, justement, de tout cela, sinon écouter les témoignages, y entendre toute l’atrocité qu’il y a à y entendre, jusqu’à l’insoutenable, et y entendre ce qui reste possible d’humain, malgré tout, malgré tout, fût-ce seulement dans le fait de faire porter par une langue humaine la charge de ce qui semble à ce point inhumain… Assumer les liens, les échos avec des situations personnelles (ou ce que l’on sait de celles des amis), parce que l’on ne peut parler qu’à partir de sa propre inclinaison, comme l’écrit précisément Paul Celan. Mais dans une extrême pudeur aussi. Ne pas ramener à soi, ne pas faire de ces massacres la toile de fond de ses propres blessures, si brûlantes soient-elles encore parfois (et si vive encore, la terreur dans le ventre). A d’autres, les proches, les « survivants », de hurler ou de se taire, pour ceux qui sont morts en hurlant ou dans un mutisme terrifié. A nous de ne pas nous boucher les oreilles, ou de ne pas couvrir leur silence de paroles d’imposture.
…
La belle voix, si sensible, de Rokia Traoré, chanteuse malienne… Musique africaine dont j’ai ramené des enregistrements (d’autres aussi, d’Ouganda, du Congo). Grande émotion, hier, pour Madame S., la dame d’origine burkinabé, qui nettoie ici, en entendant ces chants, surtout ceux du Mali (dans la même langue que celle parlée au Burkina Faso). Et pour moi, c’est une façon de me replonger « là-bas », dans ces rythmes, ces tonalités, cette « insouciance » (du moins est-ce comme cela que nos clichés qualifient souvent une certaine manière qu’ont les Africains d’aborder la vie…) « Les Africains » ! C’est déjà une fameuse approximation de considérer qu’ils sont « tous pareils », vus par des Européens qui croient souvent que le reste du monde n’est qu’une annexe de leur propre continent. Parler d’ « insouciance » à propos du Rwanda serait particulièrement cynique, même s’il est vrai que j’y ai éprouvé ce « quelque chose » (plus intuitif que raisonné, sans doute, et peut-être bien fortement imprégné de « musique ») qui rend « l’Afrique noire » si attachante…
Je pourrais parler en effet des sons, des cris, des voix, de ce goût pour la parole, la « palabre » (mais, paradoxalement, avec ce côté « réservé » de beaucoup de Rwandais). Des bruits de la nature aussi (mais je les imagine bien différents dans d’autres régions de l’Afrique), de la présence extraordinaire des oiseaux (leurs chants, leurs couleurs, comme les rues, dans les villes, sont pleines de bruits et de couleurs). Mais revenir alors également sur les moqueries ou les remarques parfois « hostiles » (ou … les silences) des Rwandais lorsqu’ils voient passer des « muzungu », et cela surtout dans les campagnes, dans les villages. Il est vrai que le « promeneur », admirant le paysage (si admirable en effet), dans la région montagneuse du Nord, n’est rien d’autre que totalement étranger à ce que cela signifie de travailler là, de cultiver ces terres sèches (ou au contraire transformées en bourbier, à d’autres saisons), de grimper interminablement ces pentes raides (on les cultive jusque bien haut souvent… ). Oui, j’en ai vu marcher, des Rwandaises, des Rwandais, partout, sur les sentiers de montagnes, le long des routes, les outils à la main (la machette…), les charges sur la tête (les bananes, mais pas seulement), et tout cela était bien autre chose que des images « exotiques ». J’en ai vu marcher aussi, il est vrai, pour se rendre à un mariage, presque dansants au bord des routes, et tout de même on pense alors à ce « sens de la fête » que « les Africains » sont censés vivre, plus que nous. Mais j’entends déjà ceux qui vont affirmer qu’il s’agit là de leur capacité « à se contenter de peu » (du peu qu’ils ont, bien souvent), et là-dessus, je préférerai me taire…