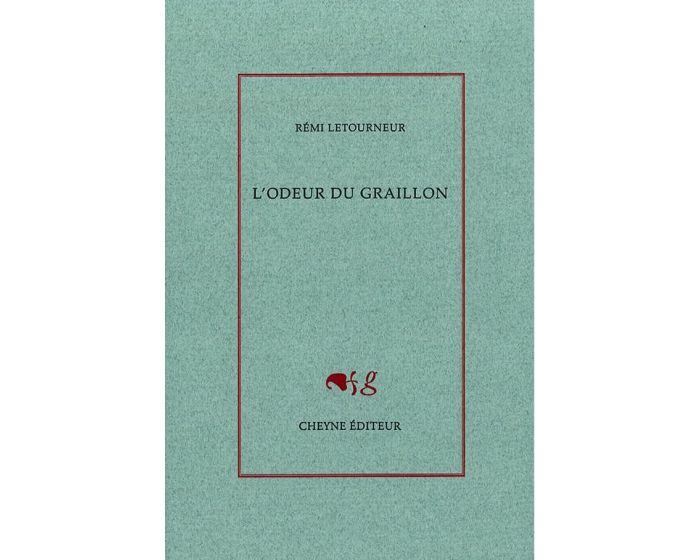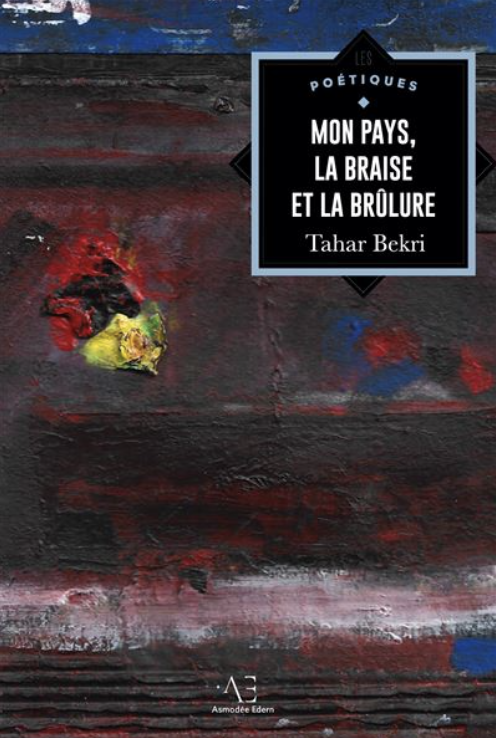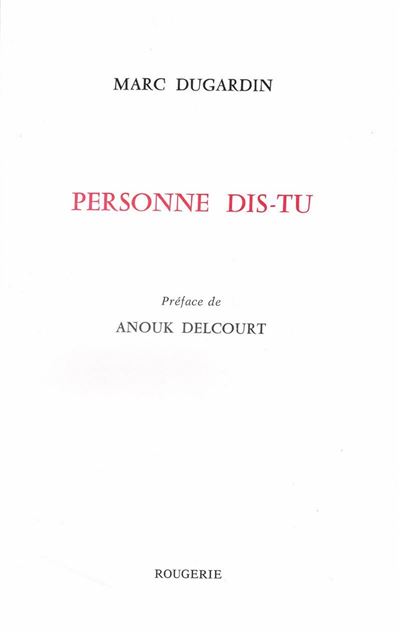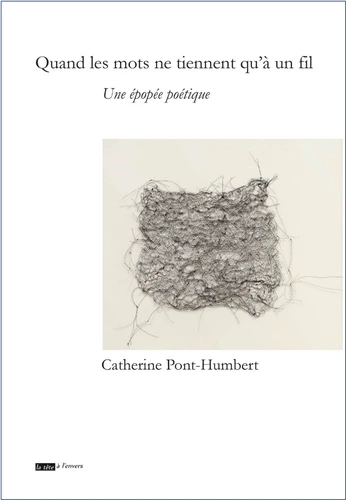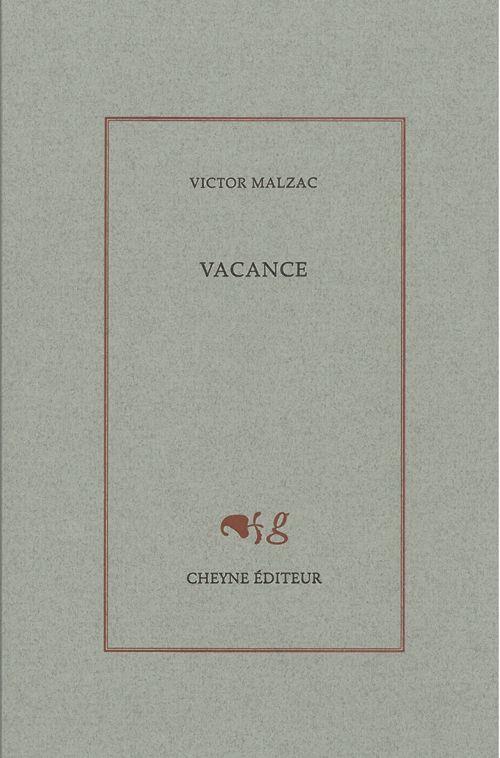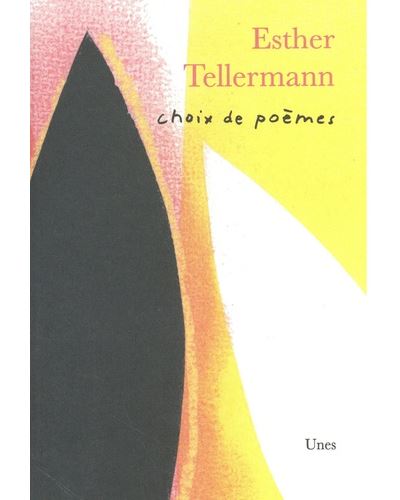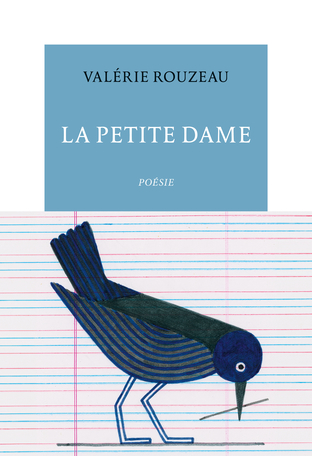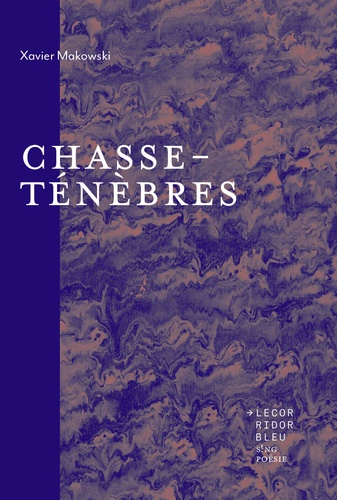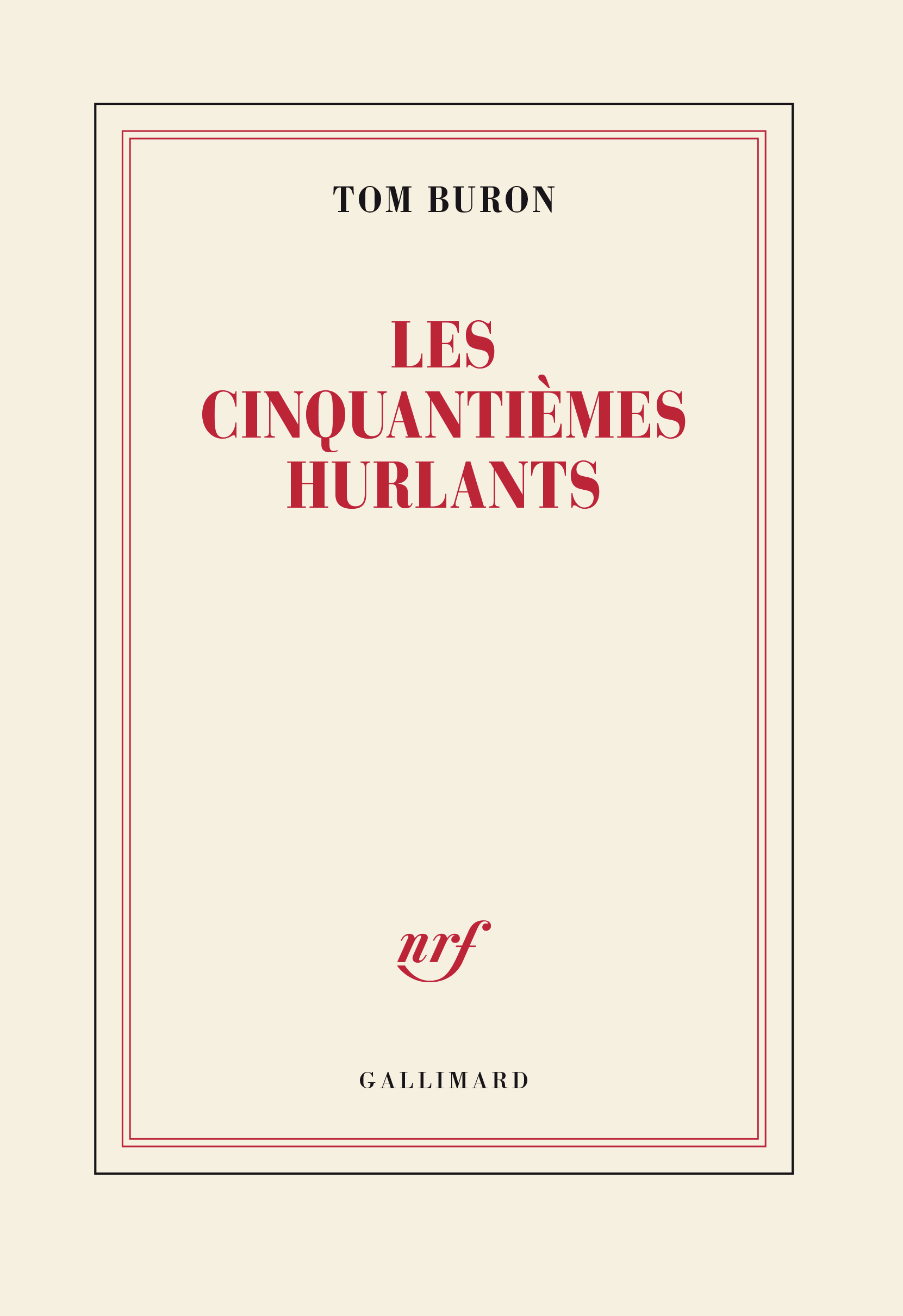L’exigence de la chair ou l’ardent poétique
14 septembre 2022. La Chouette Librairie, Lille. Nathalie Swan se tient fébrile sur sa chaise, les joues rosées, son recueil entre les mains comme un jeune oiseau au cœur palpitant. Son sourire désarmé est accueil.
Les rangées de lecteurs venus assister à sa première fois se forment encore. J’ouvre au hasard le recueil que j’ai acheté la veille sans avoir pu le lire :
entre mes cuisses tu te déverrouilles et cognes ma transparence
l’été m’atteint
entre l’étoilé de mes lèvres tu te vides (p. 37)
J’ouvre une autre page comme on soulèverait un pli de chair, pudiquement :
gros de nuages tes bras soulèvent mon ciel
mes feuilles s’endorment sur ton arbre
lui murmurent l’irrespirable de la vie (p. 59)
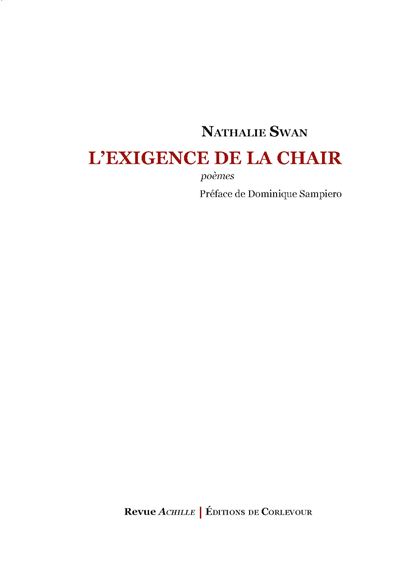
Nathalie Swan, L’Exigence de la chair, Editions de Corlevour, 2022.
Frappée. Je suis frappée par l’abandon total autant que par l’innocence audacieuse avec lesquels Nathalie Swan nous ouvre son intime, nous offre la violence de son désir et l’ardeur amoureuse qui fait battre son sang. Le recueil blanc est peau qui ressent et s’excite au jardin de l’amour. Dans un Eden d’avant la Chute, d’avant la nudité honteuse et flagellée, tout à l’écoute de son silence intérieur, la poétesse nous jette au visage des éclosions de fleurs qui ne connaissent pas l’indécence, sa joie à sa peine mêlée, la beauté en éclats de deux chairs traversées par le monde et devenant corps infini, accouplé sous un ciel qui est aussi solitude. Le sexe de géants aux yeux de bleuets, au cœur froissé de coquelicots. Elle nous ravit enfin par l’invention d’une langue dans la saison de sève, langue ardente qui pourrait résoudre in fine l’aporie de l’érotisation de la chair, dont la finitude intrinsèque se heurte toujours au serment des amants1.
A l’austérité presque janséniste du titre répond une urgence de vivre et une volonté de « faire frissonner l’amour », là « où tant d’amour a manqué » (p. 25). Car c’est une intense déclaration d’amour que ce recueil, une ode à l’amant, et à nous tous qui nous sommes séparés de la chair. C’est un don libre de soi que nous fait Nathalie Swan quand, dit-elle ce soir-là à La Chouette Librairie, « elle met en mouvement le vide qu’est le désir » contre le « Désert » (p. 22) de l’absence. Enivrez-moi, dit la chair désirante dans sa révolte.
Besogner les mots avec la langue
A une écriture qui assècherait le vers, la poétesse oppose la chair tiède et salée des mots, fouille les plis d’une écriture désirante et toute séminale, lancine le verbe, encore et encore :
mon axe creusé d’encore
culmine sur le chemin bleu de ta lumière
tes paumes m’acoquinent
ta langue m’ensevelit au-dedans de toi
le tréfonds de mes déchirures se ravit
des spasmes de vagues
s’éventrent (p. 36)
Il y a quelque chose d’un laborieux qui se cherche dans ses vers, n’élimine rien de sa patience aimante, accueille la surprise et cherche son plaisir, tend de toute sa bouche vers le jaillissement de l’image inouïe qui saisit toujours par sa grâce simple et nouvelle :
l’élan de ton ruisseau se dresse
abrite ton corps dans ma parole (p. 81)
Autour de la métaphore qui se détache singulière et où git l’instinct de la beauté : « Tu saccades mon point d’aube » (p. 47), s’expriment aussi l’instinct grégaire des mots de la chair, leur excroissance luxuriante qui répond à l’appel de la vie. Les mots se reprennent, ne se mâchent pas, sont retournés, changent de posture dans le vers et donnent à voir des copulations monstrueuses, toutes rabelaisiennes : « ta comète bombarde ma planète de succulences / le rouge de mes pommes d’amour ravagées fonce // les traversées en sourdine de ton nœud / m’arrachent des éboulis imprononçables / me forent d’euphorie / strient mon azur » (p. 62). Complément du nom du nom du nom jusqu’au fer rouge du plaisir : « l’odeur des fraisiers de tes mots respire le pas de loup / du velours / sur le fuseau horaire du battement de ton cœur… » (p. 43). Froissement, friction des mots, péché de chair, gourmandise et dévoration, tendresse de la prostituée qui se donne sans gain, plus sainte que chasteté triomphante. On est touché(e) par cette nécessité de la besogne qui est amour infini, langue libre et assoiffée : « et le sans-vie circule loin de nous » (p. 14) ; « que le sel de la vie s’en aille / qu’on m’enlève les ailes / mais jamais être descellée de ton amour » (p. 64).
Le répertoire amoureux est riche et entre tout entier dans l’enceinte du recueil comme un cheval de Troie : à l’hypocoristique des amants et bluettes d’un cœur d’enfant : « braconne mon lilas / donne à mon arc-en-ciel la couleur de tes rêves » (p. 19) ; « d’une seule bougie illuminer l’immensité de l’amour » (p. 21) ; « je pense à toi / mon lieu de vie » (p. 100) se mêle le verbe plus cru des alcôves du désir qui est comme Création du monde sortant du Chaos : « tes mains sont le levain de mon désir » (p. 49 ) ; « ton épée cambre ma colonne ruisselante et déchirée » (p. 66) ; « la droiture de ton arbre (…) / burine la béance à sa source » (p. 16) ; « mon effervescence chaude s’écartèle / ma flamme suffoque » (p. 31) ; « mon ciel se penche / tu laboures ma terre / (…) dans mon devenir frôlé / ton plein se vide » (p. 35) ; « que le lit tâche d’écumer ta main sur le tronc qui m’arrache / sous mes yeux notre noyade avale ton regard tout entier » (p. 58). Dans le lèvre à lèvre et la vitalité du verbe, la chair qui dit – trobar – trouve et invente aussi, bousculant les catégories grammaticales de l’amour « honnête » dans un nouveau fin ‘Amor où l’étreinte charnelle n’est ni retardée ni mise à distance et « réchauffe l’indicible » : « ton regard me falaise » (p. 79) ; « ma chair s’oasit à ton franchissement » (p. 30) ; « mes vaisseaux s’extrasystolent sous tes mains » (p. 20) ; « mes lèvres respirent le longuement de ta peau » (p. 38) ; « le touche-touche au plein du cœur » (p. 15) ; «tu me rages de vivre » (p. 49) ; «le printemps grimpe ma colonne d’air et ses trous noirs » (p. 115) ; « le décousu de mes mots pique au cœur le pas perdu de la joie » (p. 111) ; « Je suis le lieu où tu déposes ton désir liquidé » (p. 38). La part sauvage, asociale du désir, que les civilités de l’art d’aimer n’ont su apprivoiser, se livre dans les assauts d’un épique amoureux et les folâtries qui touchent toutefois de sincérité enfantine : « de mon ventre tu arraches un bouquet de violettes » (p. 12) ; « rends-les plus beaux qu’un incendie de roses » (p. 33).
La langue poétique de Nathalie Swan est animée d’une ardente pulsion de vie et sujette à toutes les métamorphoses d’une vigueur printanière : « du fond de mon interstice à mains nues / je ponce tes ronces » (p. 13). On ne peut s’empêcher d’y lire l’abrasif « Ronce ard ».
Une vie à bras le corps
Dans un vertigineux blason où le corps célébré devient monde dans le monde, les poèmes de Nathalie Swan épuisent toutes les prépositions du couple, écartelées entre le « sans toi » et « l’auprès de toi, face à toi, sous toi, à toi, en toi » : le « moi » et le « toi » dans toutes les variations de l’intime s’accostent jusqu’à « s’oublier pour se perdre l’un dans l’autre » (p. 103). Qui est qui ? Qui donne à l’autre ? Qui reçoit quand s’ouvrent deux chairs ? « pour mendier tes explosions je t’affame » (p. 30) ; « tes yeux s’ouvrent dans le fermé des miens » (p. 13) ; « tes bras me rassemblent où vacille la vie » (p. 14) ; « ta peau fait comprendre de près / vivre » (p. 114) ; « ton visage et ta voix sont dans mon tu » (p. 34) : car le « tu » de l’amant vit dans le silence de la chair, auquel la poétesse donne voix. Dans les angles morts des corps accouplés où la vie prend en embuscade, l’oubli qui ramène et l’absorption qui redonne sont généreux entre l’amant-ruche et l’amante-fleur : « ton absence affairée de pollen / bourdonne aux oreilles du silence » (p. 15) ; « la rosée monte l’échelle du souffle » (p. 93) ; « tes mains empruntent à ma peau / la marque de tes paumes / (…) / tu recueilles mon aube pour donner forme à tes dislocations » (p. 41). Le régime des corps est l’effraction qui ne craint pas de perdre son intact. Vie est violence consentie : « égratigner tes brèches / attaquer tes parois / donner l’espace à la lumière » (p. 71) pour lutter contre l’émiettement, l’éparpillement et l’hostilité de la solitude : « Intensément tu contiens / ton amour dans ma chair / il prend corps. » (p. 70) ; « tes doigts touchent l’éparpillement des grains de ma peau / pour agonir en déchirures toute la démence bleue du ciel / se coulissent en dévoration. » (p. 31).
L’espace se fait chair qui se creuse et s’emplit ; le corps devient paysage : « au carrefour de ma surface / se cogne le où-tu‑n’es-pas du paysage » (p. 26) ; « sous les mousses de ton corps / nos volontés se sourient / nos sourires se veulent » (p. 82). Et les corps accouplés dans les postures fantasques qu’autorise la chair se renouent au monde et à l’expansion de la matière, deviennent île qui étonne le monde lui-même, en régit les lois et le réenchante : « j’éboule les saisons » (p. 81) ; « le plus fragile de nos creux susurre le silence / à l’oreille des pierres » (p. 99) ; « la nudité dégrafée du cœur / rend à l’absence le palpable des ronces » (p. 101) ; « de la bordure de la nuit je soustrais la béance » (p. 113) ; « tu mouilles la lumière » (p. 116) ; « ton centre pur assassine le plein du jour / (…) / le ciel sur ton épaule ouvre la nuit » (p. 83) ; « ton arbre sèche les larmes du vent » (p. 16). Dans la chambre enclose, le monde s’agrandit dans la surprise et la plénitude : «le goût profond du matin hésite » (p. 29) ; « ta sève pousse le printemps à s’étonner de la lumière » (p. 24) jusqu’à l’extase qui dépossède et initie à l’être : « mon visage devient alors plus lointain que moi » (p. 38) ; « où es-tu ailleurs quand tout entier tu étais avec moi » (p. 40) ; « ma plaine neigeuse se fonde de silence » (p. 73) ; « l’horizon regarde nos visages superposés » (p. 20). Chaque caresse ouvre l’immensité ; toute lumière est désir, telle est l’exigence de la chair.
Poème infini en sa tournure de chair-mots, Nathalie Swan reprend inlassablement l’étreinte charnelle en chacune de ses pages, redit en chacune le grand amour en la chair, remonte à la source de la joie pour vaincre la finitude de toute érotisation : « ton oubli se réfugie dans le ventre de ma mémoire » (p. 108). Elle atteint à la transcendance d’une transsubstantiation poétique : « Ceci est mon corps » sans notion de durée, toujours commencement par le Verbe : « te rencontrer c’est la peine d’exister » (p. 88).
La Cathédrale du désir
La passion amoureuse déplace le sacré dans l’orbite de la chair. La chair exige en silence de « vivre sur le champ » (p. 39) dans un recueillement et un don de soi, une éternité du maintenant qui est « grâce de l’instant ». Citant Jacques Dupin et déplorant l’effacement du corps dans la philosophie occidentale, Nathalie Swan martelait ce soir-là à la Chouette Librairie : « on ne peut être dans l’impiété à la vie » !
effractionne la chapelle pointée dans notre ciel
le chat de tes vitraux caresse ma lumière
et m’aiguille de couleurs (p. 19)
Ou plus loin :
les brisures crissent jusqu’au ciel
les cris des vitraux des cathédrales
aux abords de mon silence
se rassemble ta nécessité pour éprouver
là où je t’accoste
où tant d’amour a manqué (p. 25)
La joie vaut morale qui sanctifie la chair et donne accès au mystère de l’autre : « ta ferveur rudoie mon visage / gravit l’instant » (p. 84) ; « sur les veines de ta peau s’ouvre mon horizon / s’y déchire l’énigme de ton azur » (p. 109) ; « la lumière des moments à tes côtés touche la grâce de l’instant » (p. 24) ; « au centre de notre histoire une fièvre faite d’enfance / l’intranquillité du printemps y flamboie / l’avenir serein s’excite sous tes mains / la nuit se fait calme et fragile » (p. 55).
Le premier recueil de Nathalie Swan, plein de ferveur amoureuse, se fait cathédrale, où le silence autour de la lumière des mots a la densité et le mystère de la chair, chair blanche des crucifiés et des martyrs heureux peints sur les vitraux :
sur ta croix s’ouvrent mes bras
le fond de ton cri monte en colonnes de lumière
tes crachats incrustés d’éclats
la clairière de mon intime reçoit ta rage (p. 107)
Présentation de l’auteur
- La Caryatide du Pausilippe : Paloma Hermina Hidalgo, les soupirs de la sainte et les cris de la fée - 7 janvier 2025
- L’usage des guillemets dans la poésie de Pierre Dhainaut - 6 septembre 2024
- Nathalie Swan, L’Exigence de la chair - 29 décembre 2022
- Sabine Dewulf, Habitant le qui-vive - 6 novembre 2022