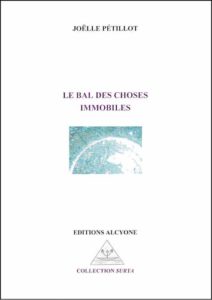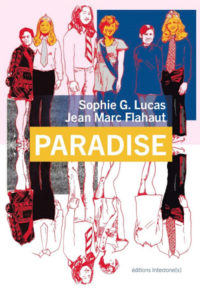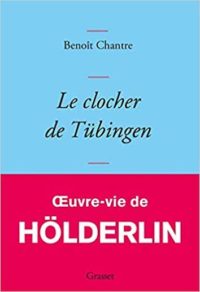Philippe Thireau, Melancholia
Ecrire est une femme, assurément. Une femme comme une meurtrière postée au faîte d’un donjon enfoui dans la broussaille du passé. Une femme créatrice du monde. Écrire est une langue maternelle.
Écrire est un homme, aussi. Un bruit organisé de la pensée, un verbe édificateur. Un visage comme un pôle d’amarrage qui protège de la perdition d’un réel qui échappe, qui s’échappe.
Écrire est l’évasion, une, un, champ de conscience unifié, où anima et animus fusionnent, où Eros et Thanatos s’effacent devant l’immanence d’une éternité retrouvée.
Je regarde le Saint Jean Baptiste de Léonard de Vinci. Seule la lumière dessine les contours de son corps, laisse émerger le tracé d’un visage doux et fort, femme et homme, que la technique du Sfumato employée souvent par le Maître rend aérien. D’où vient l’inspiration, l’Art ?
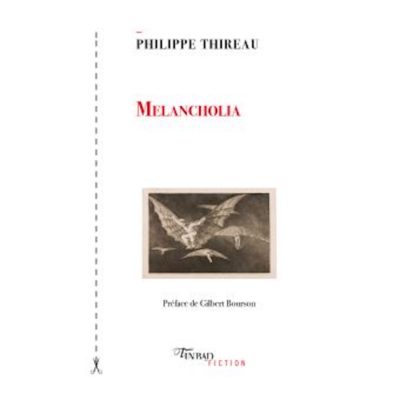
Philippe Thireau, Melancholia,
Editions Tinbad, 2020.
Quête éternelle du peintre. C'est aussi ce que pose comme question cette merveille travaillée au glacis, couche après couche. D’où vient l’art ? Est-ce d’une transcendance, d’une connection avec le divin ? On a pu interpréter cette toile comme vectrice d’un tel message, bien que la lumière n’imprègne pas le Saint de manière verticale, mais l’éclaire tout simplement, sans source identifiée, identifiable, elle l’enveloppe comme un manteau de ciel…
L'horizontalité de cette clarté pourrait permettre de voir dans le Saint Jean Baptiste de Léonard de Vinci la représentation symbolique d’un nouvel être, un Adam et Eve, unifiant les polarités féminines et masculine. A ceci près que les lignes directrices inscrivent la verticalité comme structure de la toile. Il reçoit, il est abreuvé de cette lumière cosmique, comme si Léonard de Vinci nous disait que l’Art est unification de toute transcendance et de l’immanence de notre existence. Plus sûrement, il est permis de percevoir ici une fusion cosmique tout comme le féminin et le masculin se trouvent épousés dans ce Saint Jean Baptiste, celle qui serait la transcription d’une inspiration qui puise sa matière dans le réel pour en transcrire l’essence divine dans l’Art. La lumière est ici et lui l’homme en sa femme aussi est relié à toutes les polarités du profane et du sacré.

Léonard de Vinci, Saint Jean-Baptiste, avant
restauration. Photo : © Musée du Louvre, dist.
RMN - Grand Palais / Angèle Dequier.
Tel est écrire. Et encore plus “l’Écrire” de Philippe Thireau, qui a réussi à laisser affleurer son anima et son animus, à exprimer sa globalité d’être et à confier ceci, cette complétude, à l’écriture qui est le lieu d’un jeu. Une Aire de jeu. L’espace scriptural devient le théâtre de toutes les métamorphoses, transformations, fantaisies. Est-ce résurgence du monde de l’enfance ? Pas seulement, le poète est posté sur un seuil qui surplombe tous ses âges, tous ses visages, tous les langages. Jeu du je pour dire ce qui de l’enfance a perduré en l’homme, pour aider à énoncer le dur labeur du temps à intégrer ce qui distord le discours. Aire de je, comment échapper au jeu/je de mots, qui s’impose ici. Oser dire, énoncer, en poète, ce “grand oiseau planeur qui régurgite l’histoire”, ce que rien ne raconte, ce que nul ne révèle, comment s’emparer de l’anecdotique pour le façonner, comme le visage du jeune modèle devient Saint-Jean Baptiste, auquel ce passeur, ce mage, cet observateur, l’Artiste, confère les traits archétypaux de toute figure biblique en l'homme/femme qui alors devient la transfiguration de la création ?
Melancholia “narre la fin d’une histoire (sans je)” nous dit la quatrième de couverture… Sans je, sans jeu, entre parenthèses, soit dit en passant, comme si l’auteur voulait nous dire “je n’y suis pour personne, ou bien pour tout le monde puisque je/jeu joue”… Est-ce à dire que la réconciliation des instances de l’être passe par la création, l’appropriation, sans le je du jeu puis avec, puisque dissimulé dans le jeu le je se montre, affleure dans les choix lexicaux, syntaxiques, dans le jeu du je avec l'espace scriptural…
Si l'on considère le jeu comme paradigme du travail psychanalitique (à cet égard la pensée de D. W. Winnicott est simple et efficiente) Melancholia plus que tout autre œuvre de l’auteur est LA matrice symbolisante qui les reprend toutes. Univers onirique, parfois purement autotélique, ou bien cadre référentiel, le travail lexical appel nombre de verbe d’action, de mouvement, ou bien se veut descriptif mais à peine, laissant le champ libre à l’imaginaire de dessiner les contours d’un univers onirique unique. Unification des polarités du féminin et du masculin, ou éviction de ces instances édificatrices d’identité, le pronom personnel de première personne n’apparait pas. Pas de « je » dans ce jeu, dans ce récit/poème hors-jeu/je, ou dedans, qui mêle le féminin et le masculin, les confond, les remplace, les gomme… et reprend le dire de l’enfant, aussi, petit garçon attendu fille par la mère confondue/confondu, et nié... Pas de majuscules donc, non plus, dans ce jeu de piste qui dévoile peu à peu les règles du je...
“ →restais sans voix admirative de ton dos d’athlète cela n’est pas facile de chercher l’innoncence dans la femme (tu ne voyais qu’un sexe tu le tripotais avec tes doigts sales) de la reconnaître (l’innoncence) de l’aimer (l’innoncence) sans ALARAME pourtant pourtant tu aurais dû découvrir la fillette vivante (ma part irréductible) sous l’enveloppe FEMME lui carresser la joue d’un sourire effleurer ses paupières l’éveiller ourrique bourricot→T’AIME (me souviens hier les enfants riaient) REPRENDS LE COURS IRRESISTIBLE DE MA CHUTE”…
La syntaxe est particulièrement remarquable, dans la mesure où quittant toute inscription protocolaire, elle propose à l’ordre des mots de nouvelles démesures…
une fusillade fusilla les yeux. paysages enfuis. toi partie où partie enfuie toi où.
C’est à nouveau l’enfant qu'on entend ici, dans ce parler bien spécifique. Le jeu avec les mots devient révélateur du je avec les mots, par et à travers le langage. Ce travail sur la syntaxe, est soutenu par une typographie qui devient un champ sémantique décuplé par les nombreuses audaces qui ponctuent le récit/poème. Cette structure syntaxique hachée et chamboulée qui laisse entrevoir un verbiage infantile me rappelle ce que dit Freud dans L’interprétation des rêves : il établit un lien entre les formations de mots dans le rêve et les mots que les enfants peuvent utiliser comme des objets de jeu (de je...). Dans le jeu avec les mots il est possible de percevoir un préalable indispensable au mot d’esprit qui trouve ses fondements dans un mouvement régressif vers le jeu infantile et dans une plongée dans l’inconscient. Ancré dans la matérialité grâce à l’étayage sur des objets matériels du monde réel, la création de récits imaginaires se dégage de la matérialité tout en restant enracinée dans les formes premières du jeu. Tout auteur éprouve le besoin de retrouver cet étayage propre au jeu de l’enfant dans la réalité. Le jeu théâtral est l’une des modalités d’expressions parmi d’autres, mais la plus manifeste. Le créateur propose au spectateur des personnages auxquels ce dernier peut s’identifier dans leurs actes et leurs affects, sans danger pour son propre psychisme puisque restant dans la sphère de l’illusion. Cet investissement objectal et narcissique reste donc sans danger pour le psychisme.
L'émetteur de Melancholia est avalé par l'aporie de pronoms personnels de première personne, mis entre parenthèses dès le paratexte. Mais cette disparition est révélatrice de toutes les potentialités de ses possibles, homme et femme, enfant et adulte, modèle et œuvre, grâce à la transfiguration offerte par le travail miraculeux de l'Art. Cette transfiguration, qui débute par un jeu, laisse entrevoir le "je" déployé dans toutes la puissance des temporalités, transfiguré par cette réconciliation des contraires, la disparition des dualités, tout comme le modèle devient le visage de l'humanité et son reflet divin.
Philippe Thireau invite le récepteur de son poème à partager son jeu, son je, à entrer dans la pensée magique du monde de l'enfance, où tout devient possible. Ce jeu avec je qui n’existe pas avec comme partenaire le destinataire, pluriel, indéterminé avec qui l’auteur partage ces multiples instances révélatrices du territoire non pas de un, mais de tous, car le poète transcende tous ses âges, tous ses visages, et ceux des personnages réels/imaginaires qui peuplent ses textes/poèmes. C’est ici que tout s’accomplit, que le modèle révèle les traits de Saint-Jean Baptiste, car ils sont aussi les siens, et que la fiction ouvre les paradigmes d’une lecture herméneutique du tracé de nos vie. En cela, la Littérature supporte chaque point-virgule de cette œuvre, chaque lettre, chaque blanc de marge, chaque souffle qui en un instant ouvre la voie/voix d’une unification salvatrice. L'œuvre devient l'espace d'une réconciliation qui porte la transfiguration de chaque instant vers l'essence même de ce qui fait que nous sommes cette chair confondue d'une humanité restituée dans le visage du saint, dans les lignes de Melancholia.