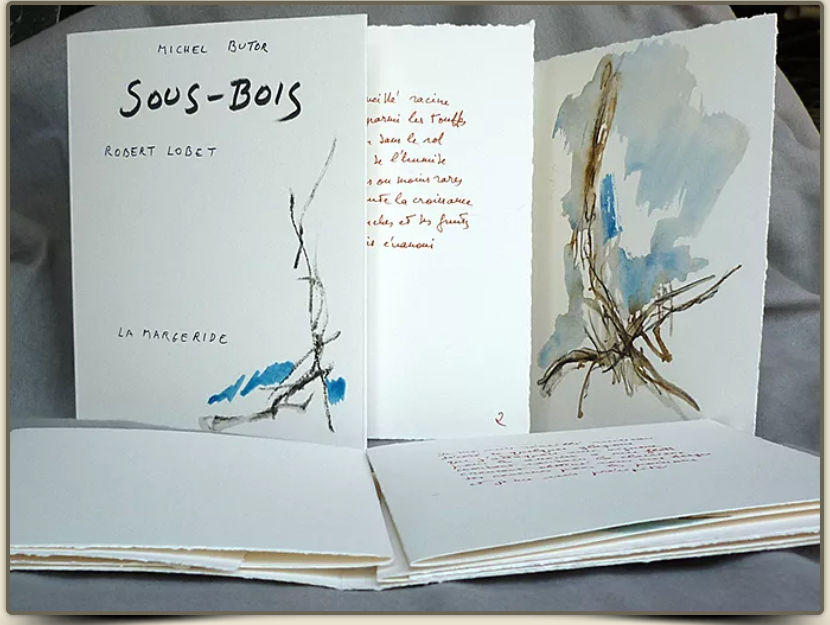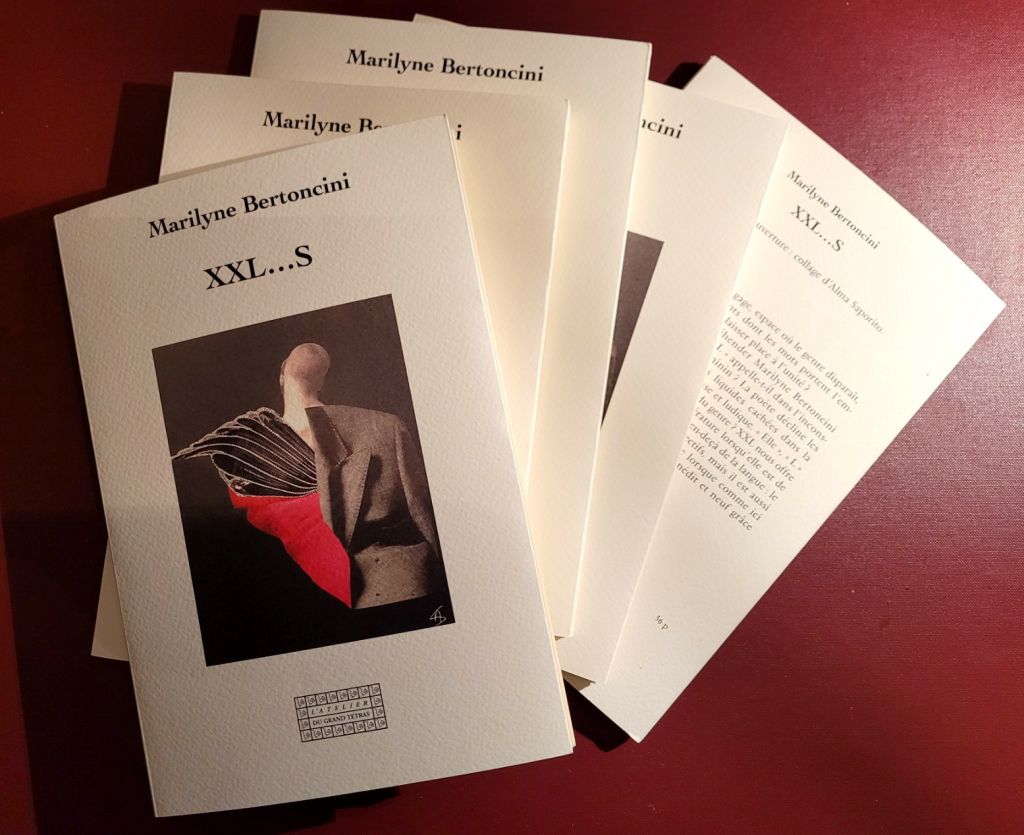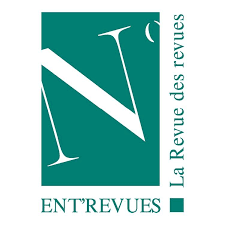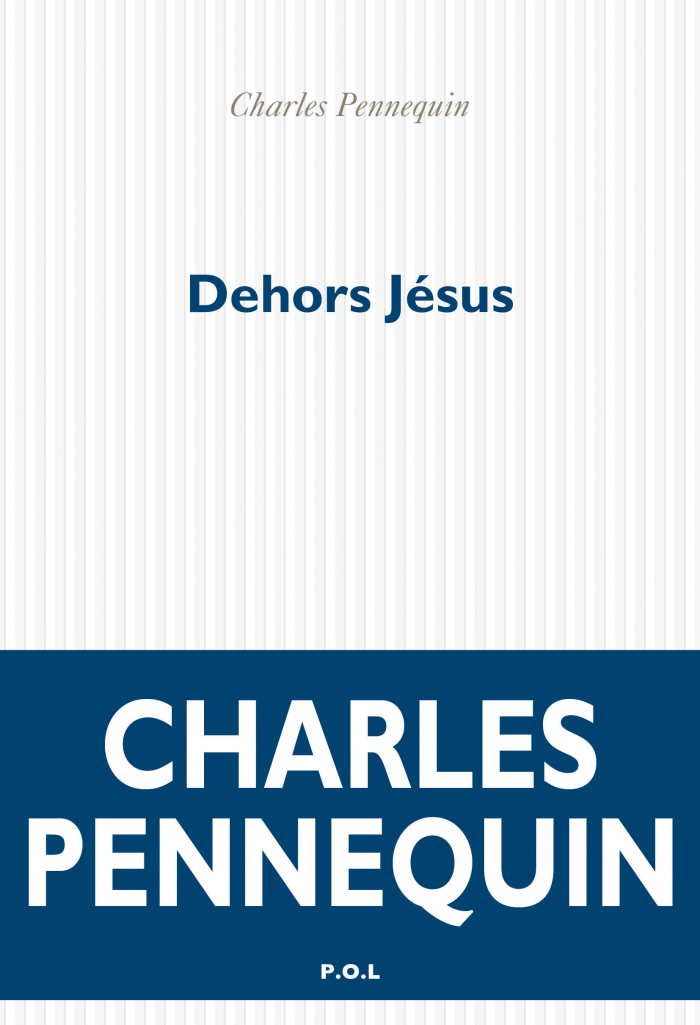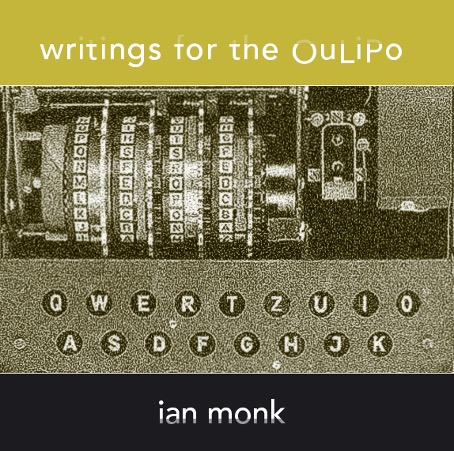Recours au Poème propose aujourd’hui à la lecture la version écrite inédite d’un entretien tenu le 27 novembre 2010 à la Librairie “Quartiers Latins” à Bruxelles. Il s’agit d’un “Coup de coeur” à la faveur duquel deux livres furent présentés à leur parution. “Voyageurs que nous sommes” aux éditions La Ravine de Muriel Claude, photographe et Marc Dugardin, ainsi que “L’ardent silence” aux éditions Rougerie de Serge Núñez Tolin. L’échange avec les auteurs a été conduit par Jean-François Grégoire, lecteur.
I. / Questions posées à Marc et Serge
1°) « Ainsi la réalité trouvée dans le poème, surgie de lui, est-elle avant tout une heureuse surprise, venant à la fois du dehors et du dedans », écrit Jean-Pierre Lemaire (« Marcher dans la neige », p.28)… Le poète toujours en quête des minutes heureuses dirait Georges Haldas. On parle aussi du bonheur d’expression de certaines formules poétiques… Quel serait pour vous le rapport entre la poésie et la joie – de se retrouver, p.ex., d’être ensemble, de favoriser la « commune présence » (Char) ?
La poésie est d’abord une solitude. Cependant, très vite –presque simultanément- elle postule la présence des autres. C’est ce que je nomme actuellement le « tutoiement ».
La joie, non je ne peux faire usage de ce substantif s’agissant du rapport à ma poésie. Mais je reçois fort bien cette impulsion en elle qui, me poussant à écrire, me pousserait à favoriser la « commune présence ».
&
2°) Jean-Louis Chrétien, philosophe-poète, pense que ce qui caractérise la joie, c’est son inclination à dilater – le cœur, l’univers, les liens. La joie augmente. Pour Reverdy, la poésie « apparaît chaque fois que l’auteur se fait une révélation au-dessus de lui-même. » On pense à Pascal et à son affirmation selon laquelle « l’homme passe l’homme »… Quel « territoire » cherchez-vous à accroître en écrivant des poèmes ?
Son livre « La joie spacieuse » chez Minuit est une excellente nourriture spirituelle.
Bien en accord avec la phrase de Reverdy. Mais cet instant au-dessus de soi-même –et il est vrai : fugacement, survient une sorte de joie au ventre, littéralement physique– cet instant de dépassement donc donne la sensation d’une amplification de l’être que l’on sait aussitôt illusoire face au réel. Toutefois, rien du réel, même le pire de l’homme, n’empêche l’écriture (l’histoire littéraire existe aux côtés de la permanence des guerres, crimes contre l’humanité, génocides, etc.) Il en va de même des arts en général.
Rien en tous les cas n’empêche d’écrire, avec parfois dans son flux, la sensation de se croire plus présent. Ni la conscience de la teneur illusoire de cette amplification.
3°) Personnellement, j’aime bien imaginer la poésie comme une forge à images, à métaphores. Comme l’atelier où se concoctent les « métaphores vives » (Ricoeur). Or, étymologiquement, la métaphore, c’est ce qui déplace – le point de vue, la vision du monde, les idées. Poète créateur, bien sûr – et créateur de nouveauté(s). Il y faut du courage : quelle tonalité donneriez-vous à cette espèce de courage : laborieuse, légère, surprenante ?…
Cette écriture dans mon cas a toujours pris une tonalité laborieuse. A savoir, pourquoi l’écriture plutôt que le silence ? J’ai toujours éprouvé des doutes quant à ce qui fonde le fait de s’adonner à l’écriture. J’ai profondément en moi, la notion de la dimension collective qui serait plus légitime que le fonds individualiste. Mais il s’agit d’un problème mal posé. En effet, l’individu peut ne pas exclure l’autre. De même, le plus grand nombre ne doit pas écraser l’émergence du singulier.
L’écriture est immanquablement surprenante ; c’est ainsi que l’on éprouve cette « joie spacieuse » de Jean-Louis Chrétien ou cet « au-dessus de soi-même » de Pierre Reverdy.
&
4°) La poésie, prétend Reverdy, c’est le lien entre moi et le réel absent. C’est cette absence qui fait naître tous les poèmes. « … tout nous résume en nous absentant », écrit Serge (p.41) Dans la bible, l’homme créé par Dieu se distingue par sa compétence à nommer les choses, les êtres. Mais ce travail ne le rend pas heureux : pour être heureux, il lui faudra trouver une aide, à côté de lui, qui ne soit ni ange ni bête, mais un(e) partenaire susceptible de lui permettre de fournir une substance au mot « je ». Est-ce la quête de ce « tu » jamais vraiment disponible qui nous résumerait ?
Cette recherche du « tu » : oui ! C’est également, « le néant fertile » qui nous conduit au « tutoiement ». Sortir de soi, ce n’est pas se contenter de cette sensation d’amplification dont l’écriture peut être l’occasion. Ecrire donc, qui revient à sortir de soi, c’est suivre sa piste –un sentier muletier–pour en arriver au développement d’un grand paysage que l’on peut comparer au tutoiement.
II. / Questions posées à Serge
1°) Dans le fabuleux livre qu’il a intitulé « Qui/ si je criais… ? » où il parcourt des œuvres-témoignages, Claude Mouchard cite un texte du poète russe/soviétique Aïgui : « Plus ferme/ que la fermeté/ fondement du silence/ le plus pur. » Comment comprends-tu cette fermeté du silence (qu’on aurait tendance, souvent, à qualifier d’évanescent), toi, qui en as fait le motif/moteur de ton dernier recueil ? Aurait-elle à voir avec l’ardeur dont tu qualifies le silence dès le titre du recueil ?
Le mot « pur » est bien un terme, une notion dont je ne crois pas avoir jamais fait usage dans mes livres, ni dans la vie… ! De même que celui d’absolu –si ce n’est pour le dénier.
Le dernier –l’ultime– état du silence, le premier, le dernier : celui du néant, ce silence du néant, je le reçois, l’accueille, comme un silence fertile qui me pousse. Je dirais qu’il me conduit au réel. Et c’est en cela que ce mouvement ne peut être qu’ardent. Comme est ardente la vie. Peut être pas nos vies mais la vie, elle-même.
Je conçois bien le « silence » comme une réalité ferme ; je ne le vois pas autrement. Certainement pas comme évanescent, cela je ne le comprends pas.
2°) Le romancier Michel del Castillo affirme volontiers que toute parole naît du silence. Mais on comprend que ce silence n’a rien à voir avec le silence « vide » qui a rendu fou certains mystiques ! C’est un silence habité, en quelque sorte : un silence qui écoute, ou pour écouter… Est-ce bien ainsi que tu verrais les choses, toi aussi ?
Un silence qui écoute : je ne crois pas. Je reçois ce silence plutôt comme l’indifférence du réel, l’indifférence naturelle à l’égard de notre présence. Ou la vie comme indifférente à nos consciences.
Mais un silence pour écouter : oui. Pourtant, il n’y a rien à écouter dans le silence si ce n’était ce « néant fertile » car si l’on entend en soi (l’oreille profonde) ce qu’il y engendre, nous décidons –un acte de notre volonté– de nous avancer ici et maintenant, dans ce monde où nous sommes présents, présents à la vie.
3°) Puisque je viens d’évoquer les mystiques, en voici un, et non des moindres : Eckhart, évoquant le silence comme « voie d’accès vers le lointain intérieur et la chambre secrète où s’épaissit le mystère » – qu’on rêve de rendre présent dans le langage. Se risquer à la lisière du mystère, est-ce le risque que tu prends en écrivant ?
Plus maintenant. Il est sans doute vrai que marchant aux limites du langage (les 4 Silo), je découvrais la tautologie, l’enfermement, la limite de la conscience humaine et l’écriture comme métaphore de cette tautologie.
Quelques livres après Silo, la courbe partie des mots s’est infléchie vers les choses, courbe aussi du silence vers la présence, du je vers le tu : soit dans chaque situation : voie de l’acquiescement à la vie, par là, la difficile acceptation de l’impermanence et de la mort.
Aujourd’hui, je prends plus le risque de l’autre, le tutoiement. J’éprouve une réticence au mot de mystère car je le crains quand on en fait usage pour barrer celui de conscience. J’admets fortement que nous sommes tant dépassés par le fait qu’il y a quelque chose plutôt que rien. Tellement, limité dans l’illimité. Mais je n’éprouve pas à partir de cela la nécessité personnelle ou collective d’une transcendance qui serait, par exemple le « mystère ».
&
4°) Dans un livre remarquable qu’elle a intitulé « L’œil de l’âme », Jeanne-Marie Baude prétend que « dans la période de dépérissement spirituel que nous traversons, il nous faut sans doute sortir du silence. » Le penses-tu aussi ou, au contraire, aurais-tu tendance à dire qu’il s’agit plutôt d’y demeurer et de le creuser ? Et est-ce qu’on pourrait dire qu’à certains moments le silence est assourdissant – et qu’il faut en sortir pour s’entendre ou se comprendre encore ? C’est un peu la question du « pourriture du silence » (p.63) qui se pose ici peut-être…
Je ne sais trop comment « demeurer dans le silence et le creuser» n’empêche nullement de parler. Je pencherais même que, ce faisant, il y aurait comme une obligation vitale à en sortir une parole. Le silence nous pousse littéralement à prendre conscience ici et maintenant.
5°) « Atteindre l’ignorance qui nous devance, écris-tu p.44 (…) L’ardent silence qui manœuvre dans ma langue, est comme l’évidement du je pour ne laisser de lui que ce qui y manque. »
« Effacement », suggère Jaccottet. Tsim-Tsoum disent les Juifs quand ils parlent de la manière don Dieu créa le monde – en s’en retirant. Qu’est-ce qu’on vise à travers ce retrait ? Le rien ? La simplicité ?
Si l’on se laisse fasciner, subjuguer par la question que pense-t-on le silence nous poserait, le silence est effectivement « assourdissant ». Il empêche de revenir en soi, au silence de « l’oreille profonde » vibrant de la même vibration que le silence du monde. Cette identité des vibrations résulte aussi d’un acte de notre volonté.
Cette ignorance qui nous devance, c’est sans doute, la capacité à se délester de la raison tyrannique propre à la tradition occidentale. Cette raison qui si souvent despotique s’impose en imposant le « je » comme son bras armé et violent, faisant violence au véritable moi, celui qui s’efface pour mieux s’ouvrir au réel, à la vie, au tutoiement.
Il faut se retirer pour être présent.
&
6°) « Je suis paysage dans le paysage », écris-tu p.12 Cette affirmation consonne pour moi avec cette suggestion de Jacques Reda : « Car s’il est vrai qu’on apprend à mieux se connaître quand on voyage, on fait aussi l’expérience d’une certaine dépersonnalisation, comme si l’on se transformait en un libre espace dont celui qu’on explore devient à son tour le promeneur. » Dirait-on que le silence nous découvre ?…
Magnifique l’écho que tu m’offres, ce « libre espace » que l’on peut induire en soi dans la marche. Oui, le silence nous découvre ; comme le paysage et comme le silence du paysage, aussi nous découvrent.
&
7°) « Chaque chose est pierre d’achoppement, non pas pour les laisser derrière soi mais pour les traverser. » La pierre d’achoppement, c’est le scandale (en grec) : c’est ce qui fait chuter. Quelle serait ta « philosophie » du scandale ? Et comment s’y prendre, le cas échéant, pour le traverser (plutôt que le contourner ou l’éviter) ?
Si le scandale est le fait que rien ne nous est donné du sens de ce monde où nous sommes, si le scandale est le fait qu’il n’y a pas de sens à la présence du monde ainsi qu’à la nôtre, à la vie (et dans son cas, le sens est la vie même), la pierre d’achoppement est doublement le « néant » et le « réel » : les traverser nous revient. Effectuer ces traversées, revient à admettre ce que nous sommes et ne sommes pas, ne pourrions pas être, accepter notre « ici et maintenant ». Le réel (néant inclus) nous conduit vers son immanence, et ainsi, cette immanence du réel, nous la sentons nôtre.
&
8°) Affût, vigilance, attente, patience, (espérance ?)… Etre poète, c’est être veilleur, guetteur (« ardent, ce guet ouvrier toujours à ses commencements », p.40) Guetteur d’aube, comme le moine ? Guetteur obsédé comme le militaire dans « Le désert des Tartares» de Dino Buzzati ? En attente de quoi ?
En attente de rien. C’est une attente sans objet. Une attente qui n’a pas de but. Quoi que, cette attente soit la mise en disponibilité de soi à ce qui pourrait arriver et que l’on ignore. Mais cette attente n’a pas la révélation du sens comme résolution : il n’y a pas de réponse à la question.
L’attente est une tension dynamique de l’intérieur de l’être vers son extérieur. L’attente, c’est, en effet, guetter l’aube pour y puiser l’acquiescement en une sorte d’immobilité active.
&
9°) « L’emprise du silence sur le langage, la supériorité de la patience sur l’attente : jeunesses permanentes de la simplicité. » (p.33) Que peux-tu nous dire de cette patience ?
Cette patience serait une sorte de confiance dans l’attente, en laquelle nous trouverions l’acquiescement au monde.
&
10°) « Celui-là même enfin, ce silence, qui à perte de vue s’est soumis à un imprenable ‘il y a’ » (p.22) « Formes accomplie du silence, ce qu’il y a, pollen, qui propage une même persistance des lieux. » (p.28) Je pense à ces réflexions d’Emmanuel Lévinas à propos du fond de tout : cet « il y a », précisément, qui n’est pas silence, à proprement parler, mais murmure vaguement inquiétant… Cet « il y a », toi, comment le ressens-tu ? Que te « dit »-il ?
Cet « il y a » ne m’inspire pas l’inquiétude, l’intranquilité certes, mais avant tout, il ne faudrait peut être pas utiliser l’adjectif démonstratif « cet » qui établit un face à face. Or nous sommes partie de l’« il y a ». En ce sens, il n’y a ni espérance ni désespérance, l’ « il y a » est. Il n’appelle pas de sens puisqu’il ne pose pas de question.
« Il y a » est le lieux où par un acte de notre volonté, nous pouvons rallier « cette chambre d’où nous ne sommes jamais sortis » en tentant d’y rejoindre ce que nous y sommes et comme nous en sommes.
&
11°) Car tu notes ailleurs (p.43) : « Le silence détaché de ses sources défait ce qui l’approche… » Pour éviter le chaos de la destruction (voire de la violence), sur quelles sources peut-on compter ? Sur quelque chose qui serait à voir, comme les fameux « éclats » de lumière chers à André Dhôtel ?… « Il y a une commune présence du silence et de la lumière, écris-tu par ailleurs. Ils forment cette plaine de la réciprocité où l’on trouve que l’un continue l’autre. » (p.51) Comment interpréter cette continuité ?
Toute la vie sociale repose sur cette idée de source. En effet, sur quelle source nous fondons-nous pour éviter le chaos, la destruction, la violence ? Quelle transcendance ou catégorie supérieure de la pensée, quel universel ?
Aujourd’hui, en nos XXème et XXIème siècles, je pense que nous sommes, quels que soient les transcendances, face à des récits. L’homme, la société, l’histoire nous l’ont montré.
La source où je considère que l’on peut, une fois encore –si ce n’est la dernière– chercher des fondements à notre conduite, c’est précisément cet « il y a ». Cet « il y a » duquel nous pouvons tirer les leçons qui sont d’abord en nous (ne pas oublier que nous sommes partie de cet « il y a »). La vie qui s’entend avec elle-même. La plante qui poursuit la lumière.
La continuité répond dans mon esprit à l’absence d’unité. Il n’y a pas d’unité en ce monde pour l’homme. Dieu n’en est pas une, la science n’en est pas une (et avec elle la ratio comme surplomb sur l’homme) : il n’y a pas de transcendance. Il n’existe aucun surplomb sur l’homme.
L’immanence –ici et maintenant– est cette continuité entre l’ici et le maintenant, entre l’homme, la vie et la mort. La continuité est ce qu’il résulte de l’opposition des contraires. La continuité m’est inspirée par l’ « il y a » et le rapport où je me perçois avec le monde. La continuité est un acte de volonté. C’est une discipline intérieure qui me porte au-dehors. Ce n’est pas exactement une éthique, ce n’est certainement pas une morale. C’est, je dois bien l’admettre, une conduite –une discipline intime– dont le fondement est encore à l’état d’intuition. Cependant, je ressens ce fondement, comme vrillé au ventre tel une intuition animale.
&
12°) « La question du silence est absurde, ayant pris au silence sa propre absurdité, comme il serait absurde de ne pas poser la question du silence. » (p.55) Comment comprendre cette espèce de paradoxe ? Comme l’expression de la limite de la pensée ? Ou comme le point de levier qui permettra de basculer vers un ailleurs de la pensée : cf. « Dire dans le silence : ‘la pensée n’éclaire rien, ni même, ce rien qu’elle laisse devant elle’. »
Expression de la limite de la pensée et comme point de levier qui conduit vers un ailleurs de la pensée. Se poser la question « pourquoi nous sommes là ? » n’a pas de sens. Comme poser cette question au silence même. Ne pas se la poser serait une inconséquence grave car nous sommes des êtres de profondeur ; sinon que faire de la conscience et de la pensée ? Toutefois, la réponse à cette question qui ne connaît pas de réponse ne doit pas attendre de la raison la résolution qu’elle appelle.
Cette résolution –qui n’est pas réponse– nécessite de se laisser porter par l’ « il y a ». Nous devons nous effacer et surtout mettre en retrait cet occident de la raison. Notre corps peut rejoindre le corps du monde. C’est peut être ce qu’il appelle le plus profondément et nous entendons mal cet appel, pensant qu’il est nécessité d’une transcendance. Le corps réclame de nous une émancipation de l’homme.
&
13°) « Le silence, c’est le langage du monde à venir », affirmait le moine Isaac le Syrien. Pourrais-tu faire tienne cette affirmation ? Et que serait alors le silence de l’écriture – ou le silence écrit ?…
Si le silence est le partage, la commune foulée avec l’ « il y a » que je nomme souvent « le paysage », je peux effectivement faire mienne cette phrase d’Isaac le Syrien. Le silence de l’écriture serait une écriture qui ne recourrait plus au récit pour se développer.
&&&
Pour finir en ne finissant pas…
Jean-François, maintenant que j’ai répondu à ces questions si riches, –bien que ce soit là des questions auxquelles nous n’avons jamais fini de répondre…–, il faut tout de même écrire ici que le poète a tout dit de ce qu’il peut dire dans la poésie qu’il écrit. Il faut dire que le poète est sans système.
Si le poète ajoute à son texte, c’est qu’il a pu dire tu à celui qui l’a interrogé et que ces mots de plus sont essentiellement l’exercice du tutoiement.
Jean-François, je t’adresse un très grand merci pour le travail que tu as fourni. Très stimulant. J’espère que ce que cela a déclenché en moi est à hauteur de ta profondeur.
Serge
&