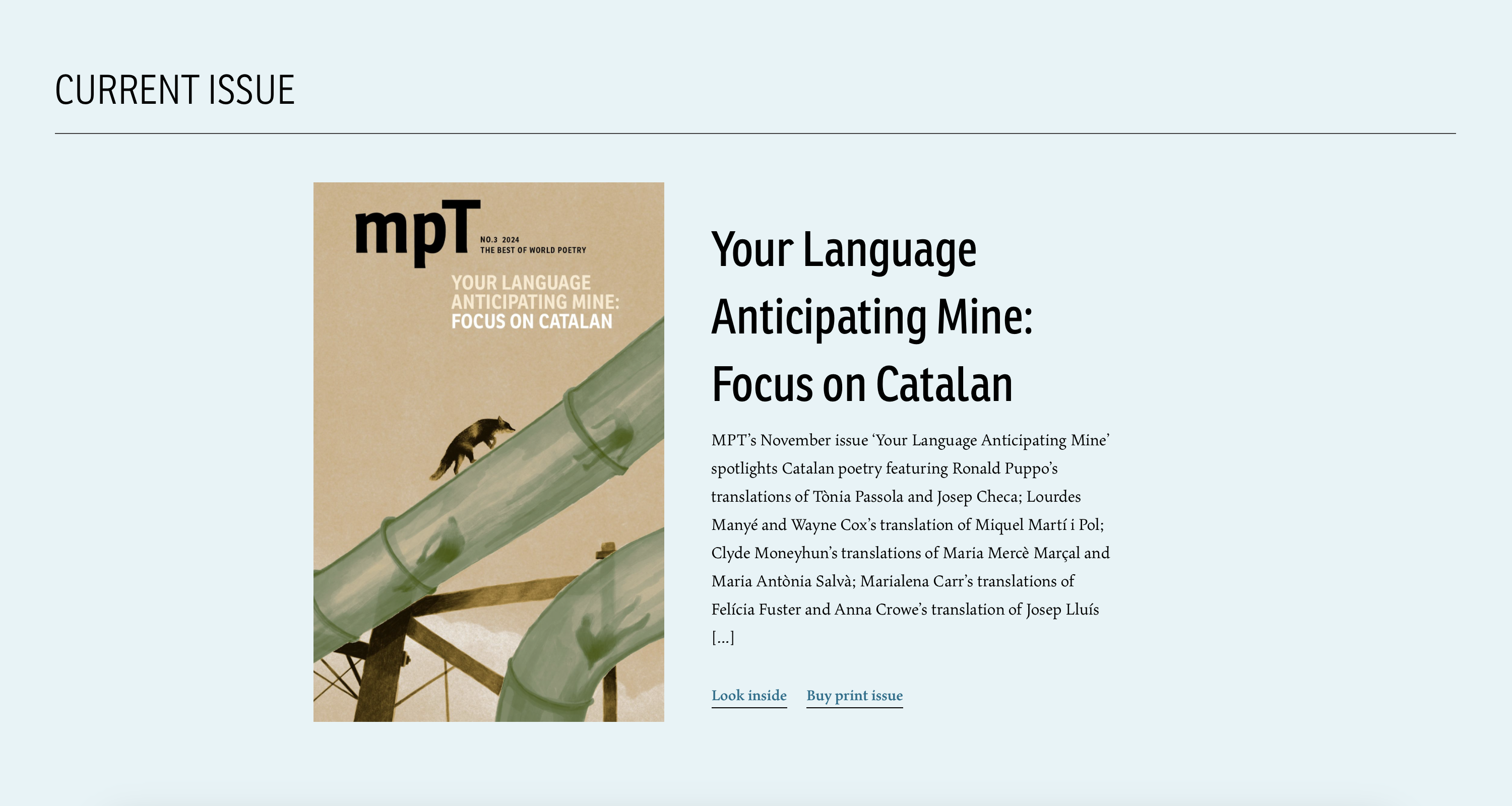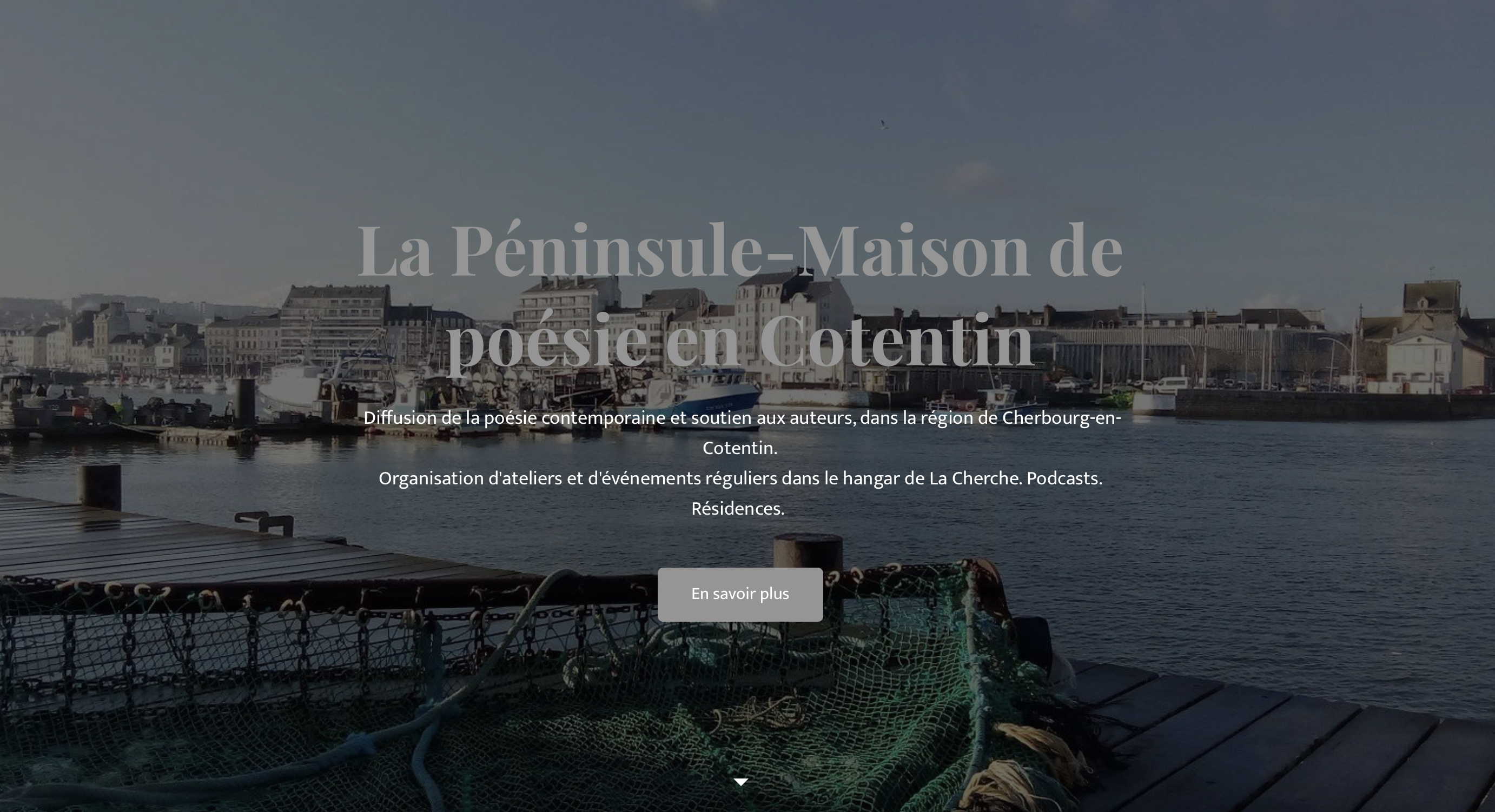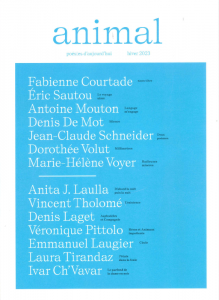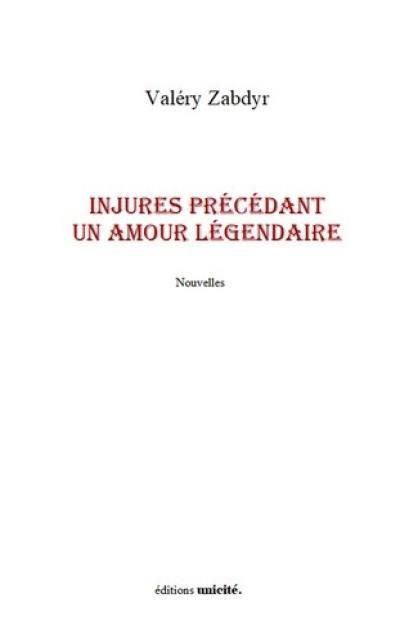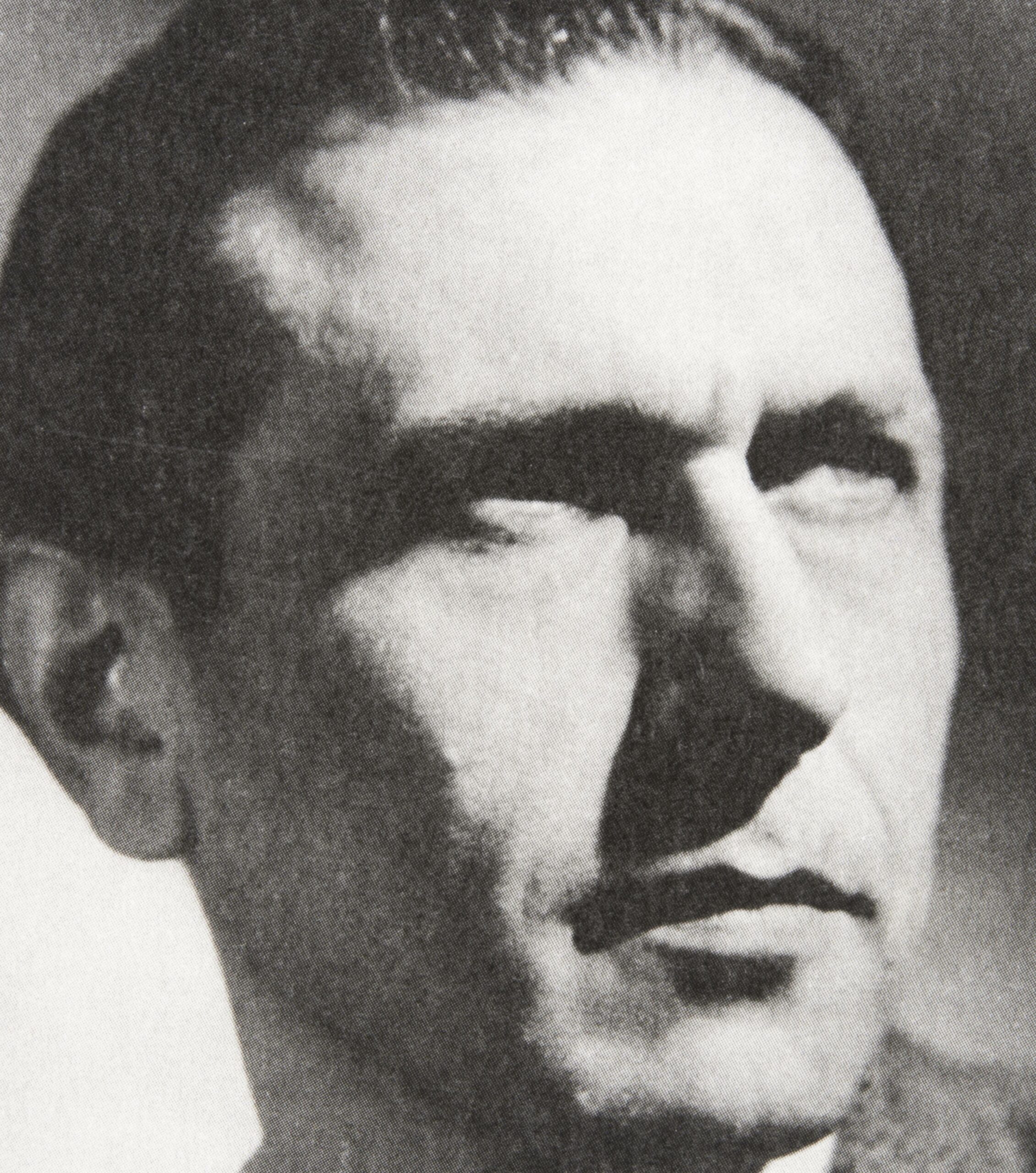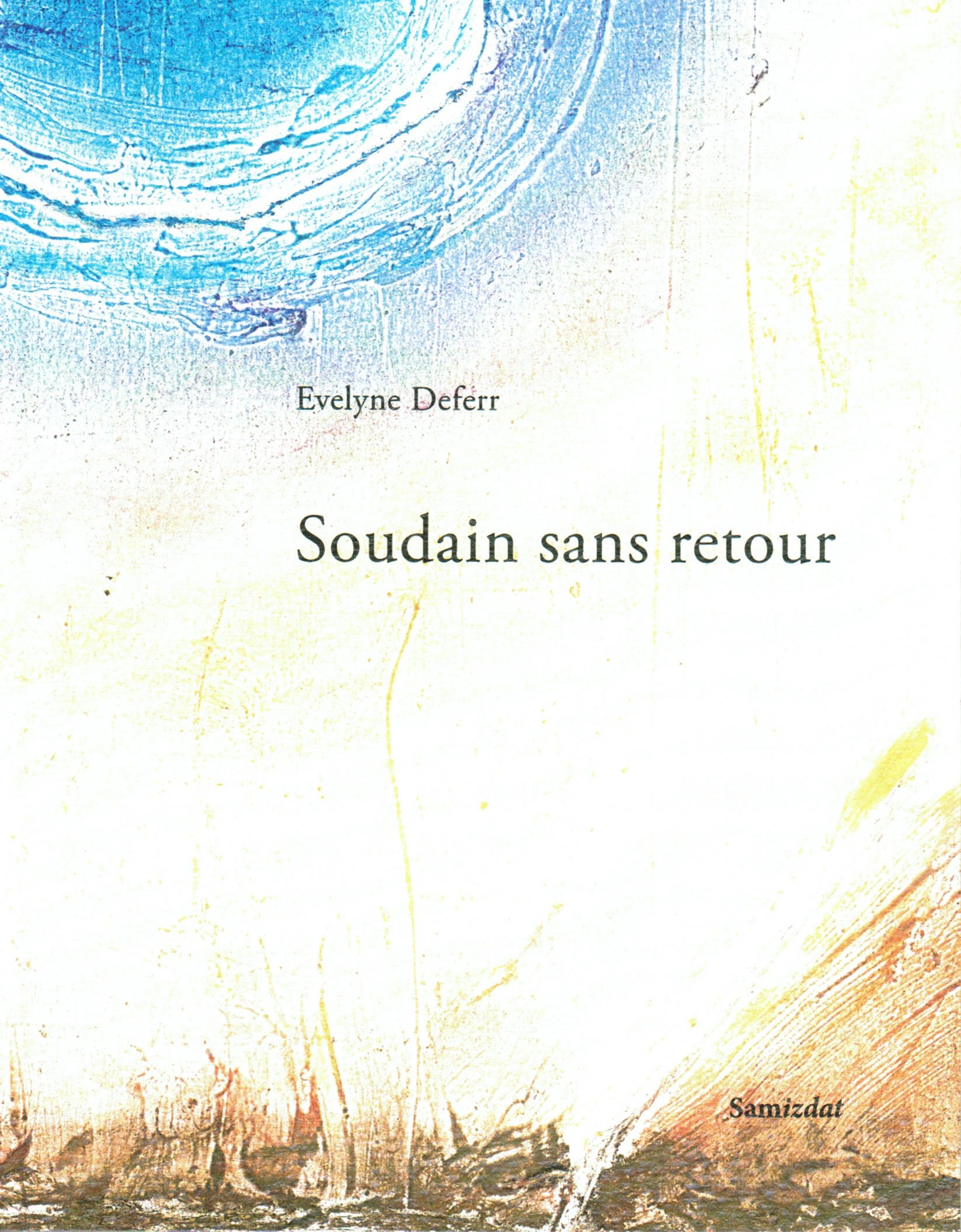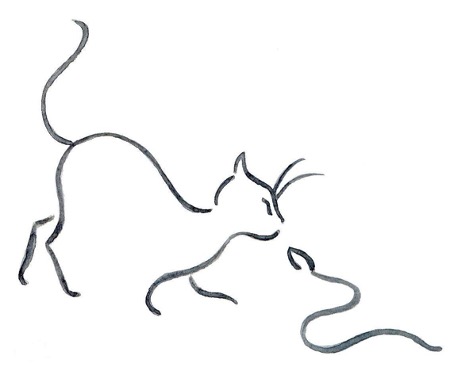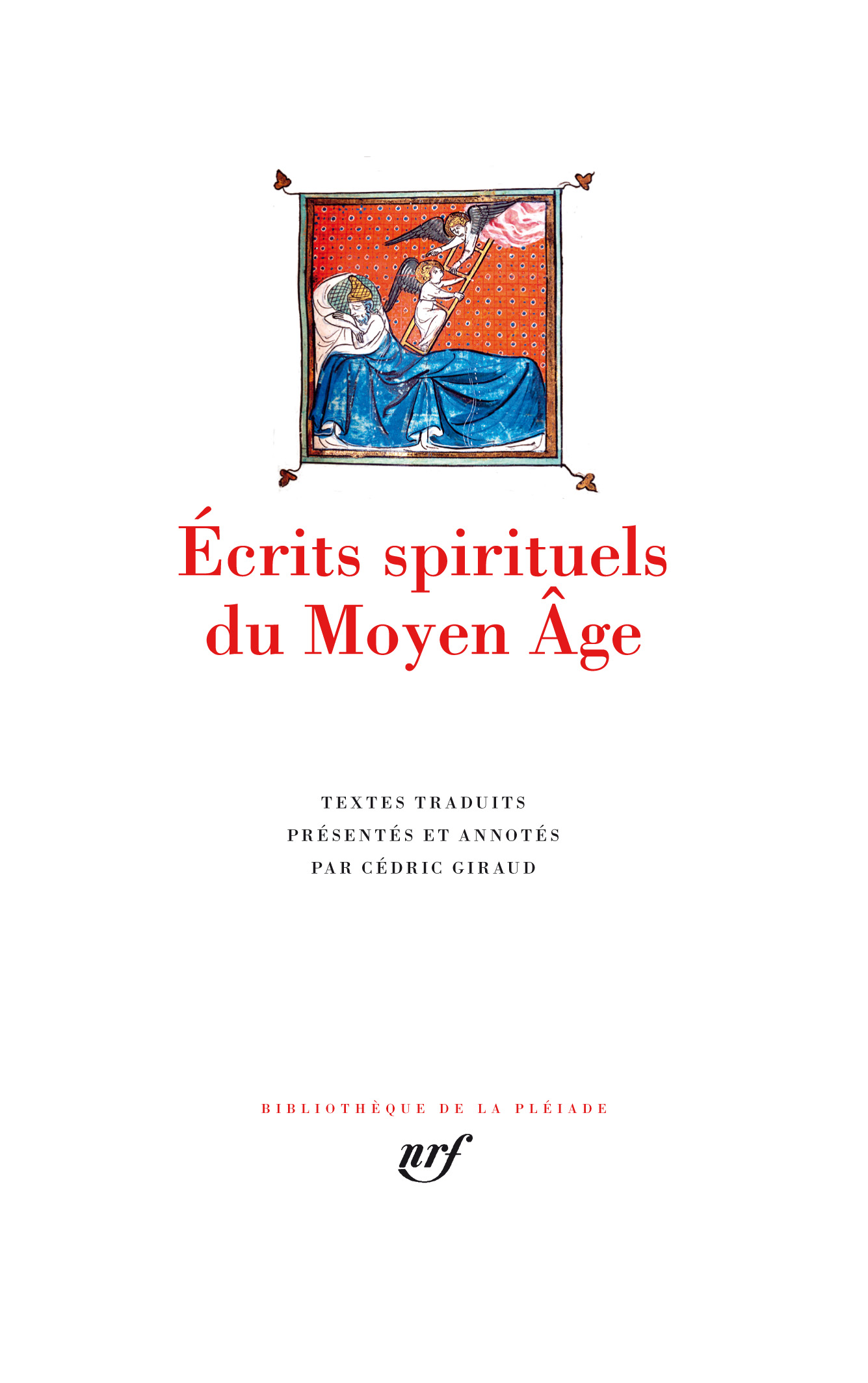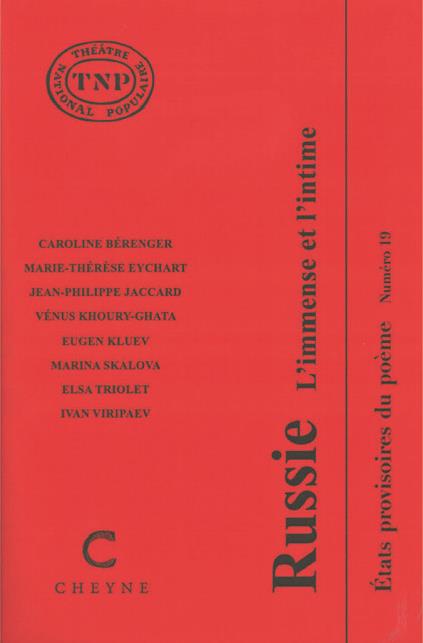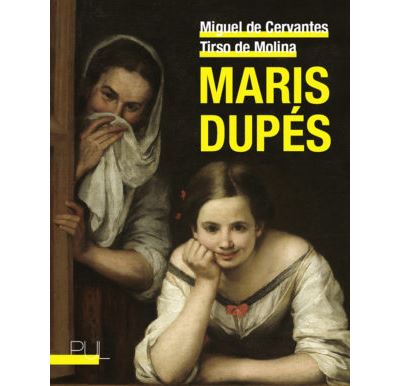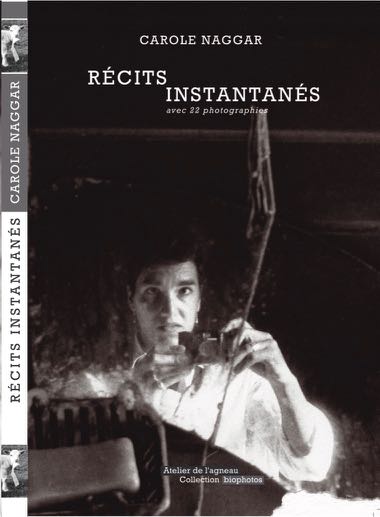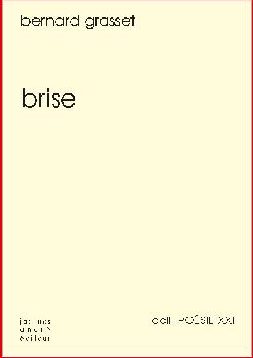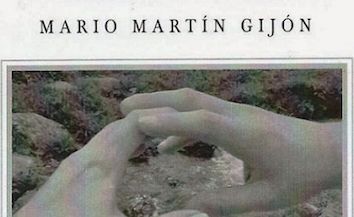En trois lignes, bien senties, bien frappées, témoigner de l’horreur de la guerre. Voici, réunis dans un livre, des haïkus écrits dans les tranchées de 14–18. Comment ne pas être touché au cœur ? Ce genre littéraire n’était-il pas finalement adapté à la situation, par son côté lapidaire aux allures d’instantané photographique, saisissant l’instant dans sa banalité ou sa cruauté, sous des cieux ici bien chargés ?
Une anthologie de ces textes écrits sous la mitraille est aujourd’hui proposée par Dominique Chipot, un des grands spécialistes français de ce genre littéraire. Quant à l’éditeur Bruno Doucey, il a eu aussi la bonne idée de faire préfacer l’ouvrage par Jean Rouaud, l’auteur des Champs d’honneur, un livre dans lequel celui-ci évoque notamment la mort de deux oncles de son père à la Grande guerre.
On prend véritablement les haïkus de cette anthologie « en pleine figure » (titre du livre), allusion au haïku de l’enseignant humaniste René Maublanc (né à Nantes en 1891) qui, réformé, ne participa pas à la guerre, mais fut fortement marqué par la disparition de nombre de ses camarades sur les champs de bataille. « En pleine figure/la balle mortelle/on a dit : au cœur — à sa mère », écrivit Maublanc. Et aussi ceci : « Mes amis sont morts/je m’en suis fait d’autres/pardon ».
Ecrire des haïkus au début du 20e siècle ? Oui, car la découverte du haïku japonais, nous rappelle ce livre, ne date pas d’Hiroshima. Le genre – connu au départ sous le nom de haï-kaï – se pratique dans certains cercles poétiques initiés à la sensibilité japonaise. On assiste d’ailleurs au même phénomène dans les milieux d’artistes (le japonisme) à la faveur de l’ouverture au monde de l’Empire nippon.
Quand ils partiront à la guerre, certains auteurs prendront donc le parti d’écrire des haïkus. Le plus célèbre d’entre eux est Julien Vocance. Né en 1878 – de son vrai nom Joseph Séguin – il avait rejoint le premier groupe de « haïjin » français autour de Paul-Louis Couchoud, qui fut l’importateur du haïku en France. « Dans un trou du sol, la nuit/en face d’une armée immense/deux hommes », écrit Julien Vocance dans « Cent visions de guerre » (1), allusion directe au recueil intitulé « Trente-six vues du mont Fuji » du graveur d’estampes japonais Hokusaï..
Il y a aussi, dans ces tranchées, l’Alsacien Maurice Betz (né en 1898), traducteur de Thomas Mann, Nietzsche et Rilke, dont il était l’ami. Dans sa Petite suite guerrière, on peut trouver cette vraie perle. « Un trou d’obus/dans son eau/a gardé tout le ciel ». Il y a aussi, dans l’effroi, Georges Sabiron, mort en mai 1918 au combat d’Arcy-Sainte-Restitue. L’homme avait lu Sages et poètes d’Asie de Paul Louis Couchoud. On lui doit ce haïku : « L’obus en éclats/ fait jaillir des bouquets d’arbres/un cercle d’oiseaux ». Que dire de plus ?
(1) « Cent visions de guerre », dans « Le livre des haï-kaï » publié en 1983 aux éditions Les Compagnons du livre. « Ce sont les Japonais qui m’ont fait découvrir cet ouvrage, totalement passé inaperçu en France », expliquait l’auteur brestois Alain Kervern (traducteur du Grand almanach poétique japonais) dans un article du 9 novembre 2003 qui faisait découvrir les haïkus de 14–18 aux lecteurs de dimanche Ouest-France. « Le recours à la forme concise du haïku, ajoutait Alain Kervern, a permis à Julien Vocance de nous faire revivre, en une série de flashes, ce que fut l’enfer de cette guerre ».