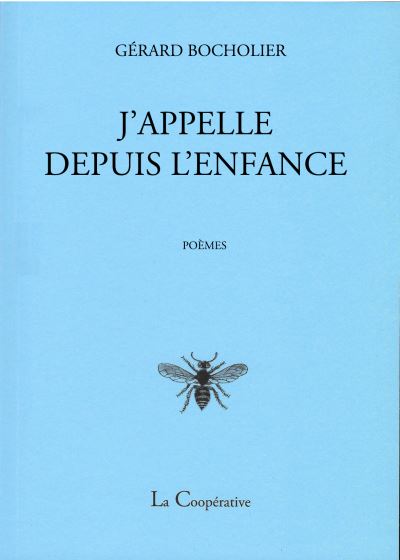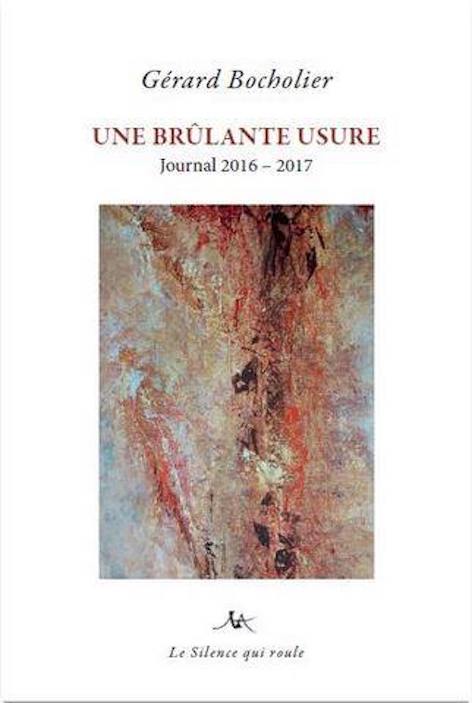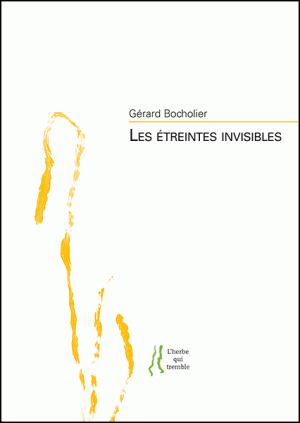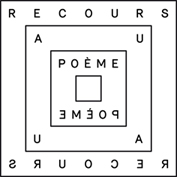Sans plus aucun poids de terre
Ni de chair qui me retienne
J’entre dans la gravité
De la mort que tu m’apprêtes (p. 63)
De quelle surface enfin vécue au-delà de soi s’agit-il ?
Mais que la voix soit aussi très profonde et que rien ne mente : voilà ce que le chant souffle tout au long du recueil d’ailleurs composé sur des sections rythmiques équilibrées. Vers de 8 syllabes dans la première partie, de 6 dans la seconde, de 7 dans la troisième, de 5 dans la quatrième et de 7 (de nouveau) dans la dernière. On peut sentir ce passage du pair à l’impair comme le socle toujours plus vivant d’un désir, d’une présence bien secrète mais qui mêle effacement et lumière en essayant de gagner cette dernière. Vers courts. Vers dans la régularité.
Car dès le liminaire « Depuis toujours ton silence… », (en italiques, et, disons-le, conçu comme un murmure, une prière) il est question d’une parole, d’un poème et, sans jamais dévoiler quelque rive d’or, du vent de l’Esprit qui, pour le veilleur, entraîne le cours du monde vers un intérieur d’amour.

Gérard Bocholier, Depuis toujours le chant, Arfuyen, 2019, 128 pages, 13€.
Ce dernier mot, s’il est répété régulièrement dans le recueil, ne s’accompagne pas forcément d’une promesse. L’écriture va devoir gagner son propre secret, son espace articulé au fond de l’être avec des images, des sons, des codes bien mystérieux, difficiles à déchiffrer de par leurs échos avant de suggérer que la silhouette de l’homme, même accompagnée de plus en plus par la « lumière », s’adresse à Dieu.
O Seigneur dépouille-moi
Du vieil homme qui s’entête
A manger en solitude
Le pain noir de l’amertume (p. 102)
C’est un tutoiement perçant, un relief au bout d’un jeu magique de pronoms personnels et possessifs. L’homme ne redit « je » qu’après l’avant-dernière partie où le mystère des morts trouve un ton sans fard mais non privé d’échos ; et le rythme exigeant qui ne doit rien à la nostalgie, quand vient la ou les dernières pièces de chaque partie, semble bien se fondre dans cette frontière en principe artificielle pour annoncer le meilleur, c’est-à-dire un équilibre, enfin, comme à force d’accorder la vérité aux quatrains, aux deux quatrains que chaque page imagine sans cesse en restant fidèle au ton du poète.
Depuis toujours le chant qu’aime-t-il si ce n’est le silence, l’énigmatique légèreté promise aux mots, au frisson encore plus fort qu’eux ? L’amour ? Le temps avec le présent montre un langage vivant, mais le futur, qu’offre-t-il déjà au veilleur ? On va du « je » au « tu » dans la foi. La répétition temporelle dans le liminaire ne revient pas quand se referme la dernière partie, « Mais jamais sur la colline/L’aube n’a été si belle. »
Le corps et la poésie auront pris le ciel comme les racines à témoin, et cette fête à la fois intime et universelle sera bien restée louange.
Ce recueil n’en finit pas de s’ouvrir sur le « feu secret » qui se consume, proche d’un coeur aux branches qui n’ont pas peur « du jour qui tombe ».
Présentation de l’auteur
- Gérard Bocholier, Depuis toujours le chant - 1 septembre 2019