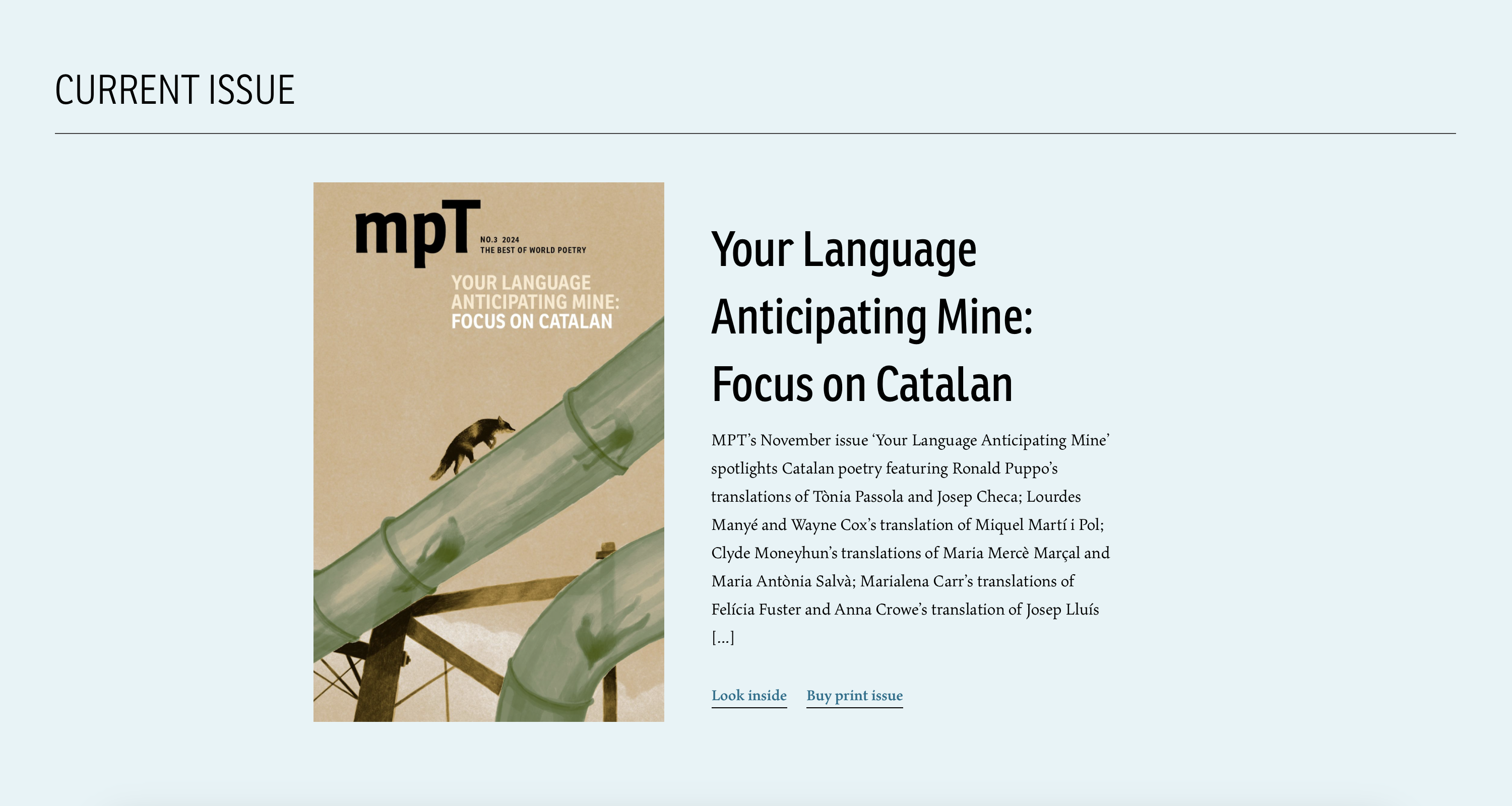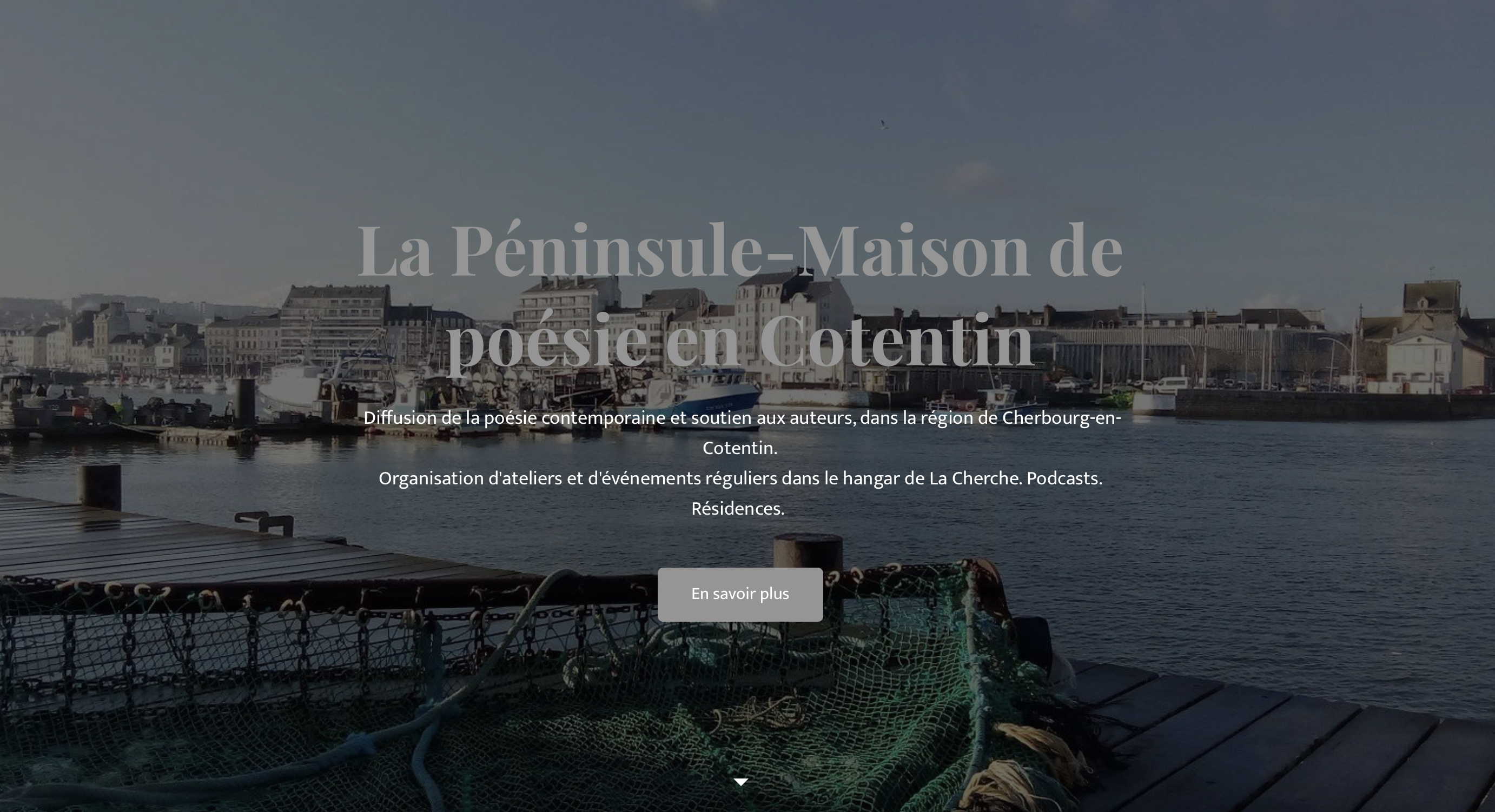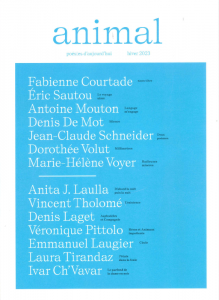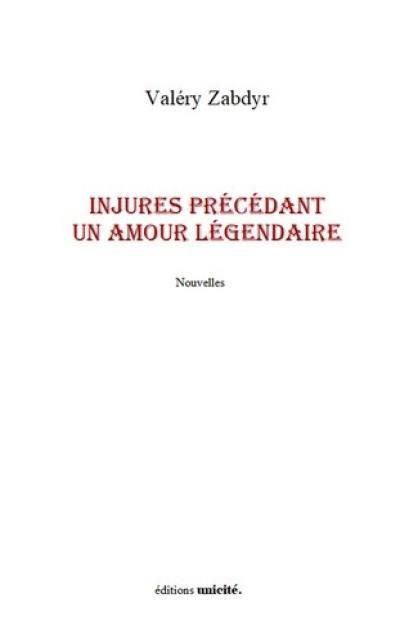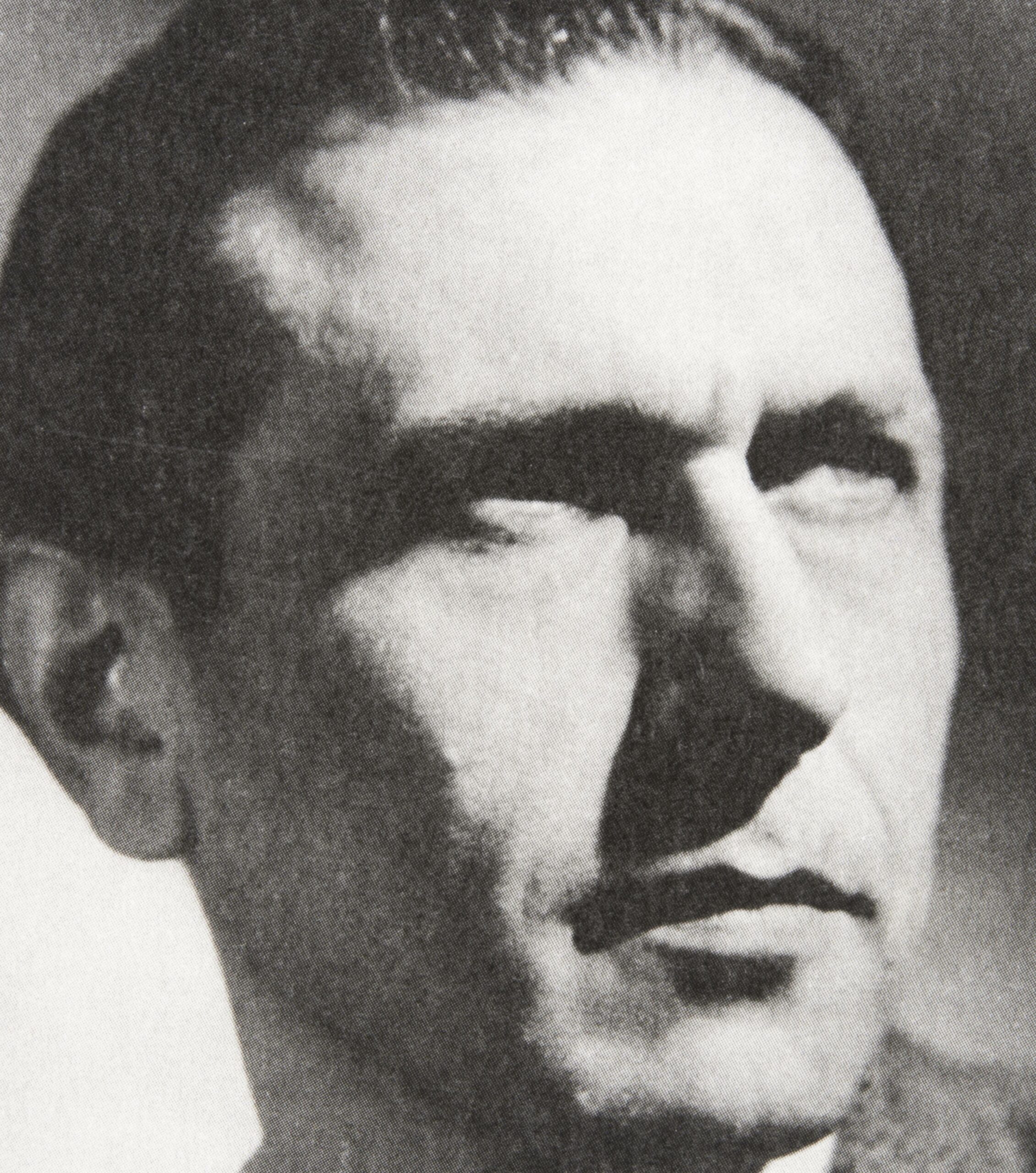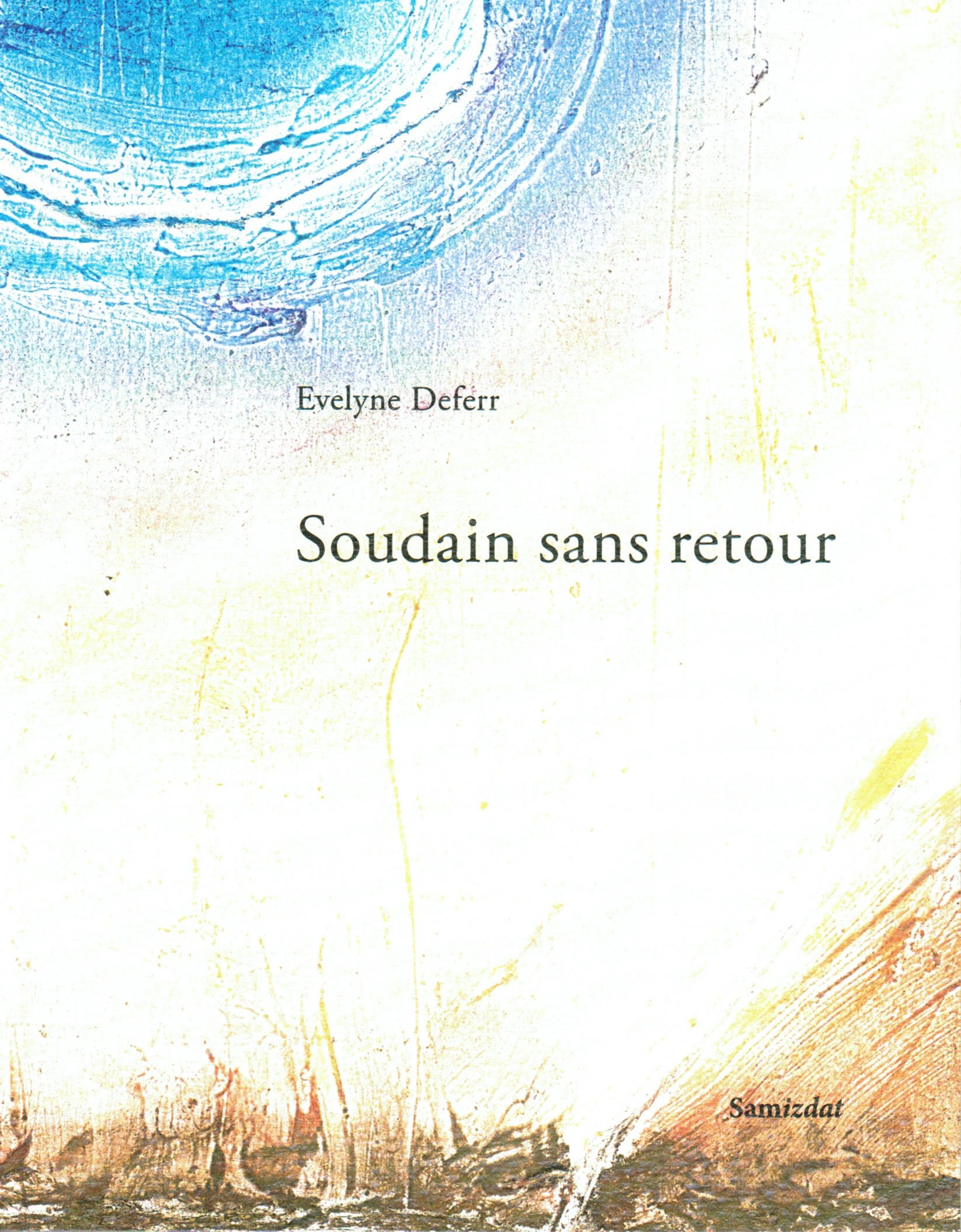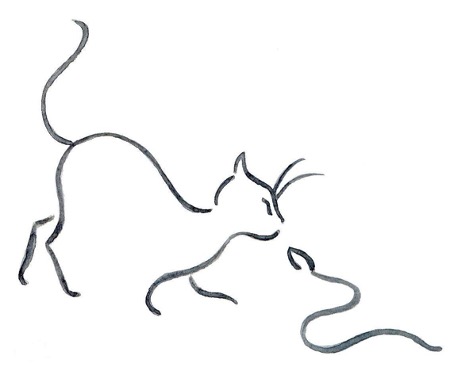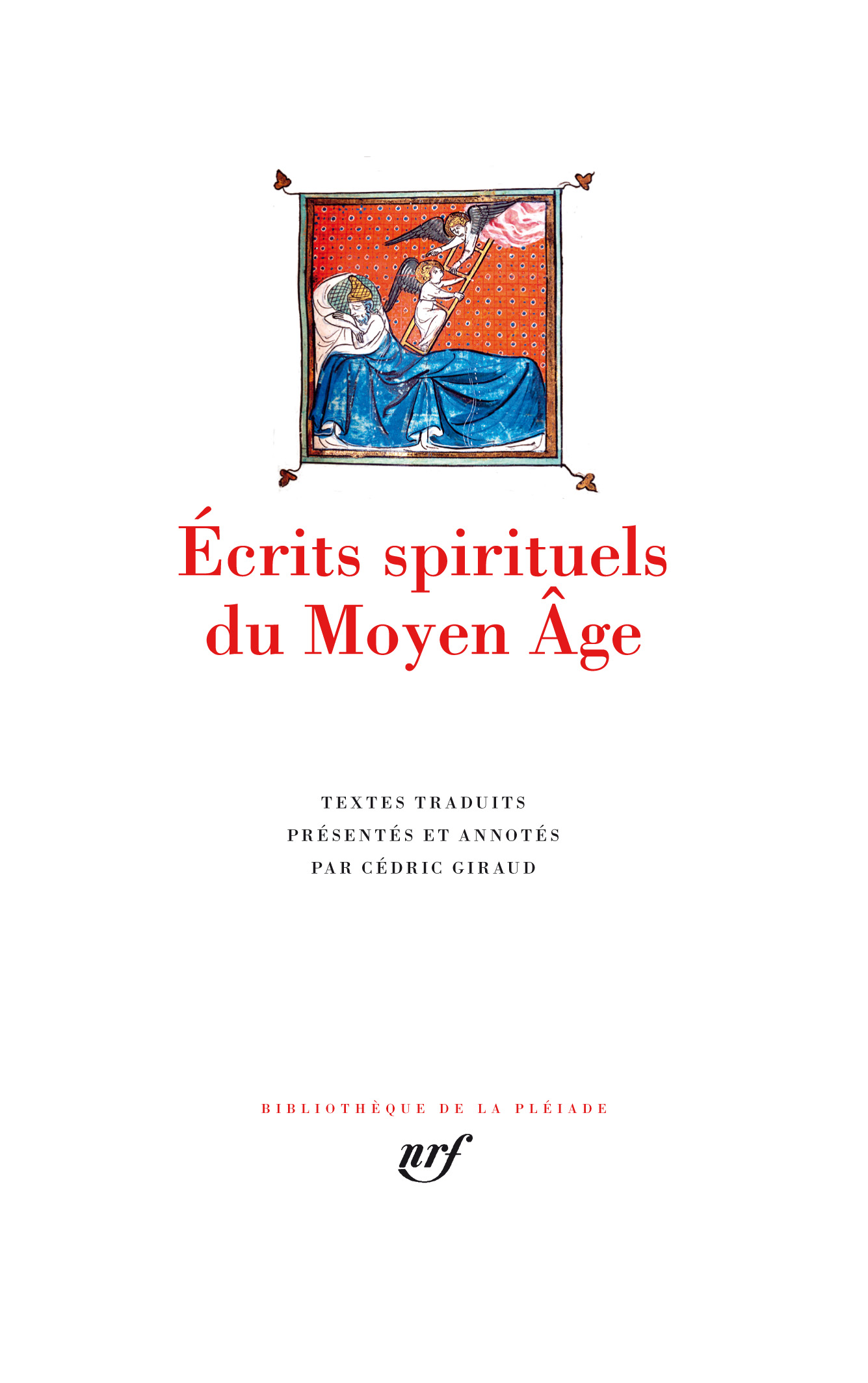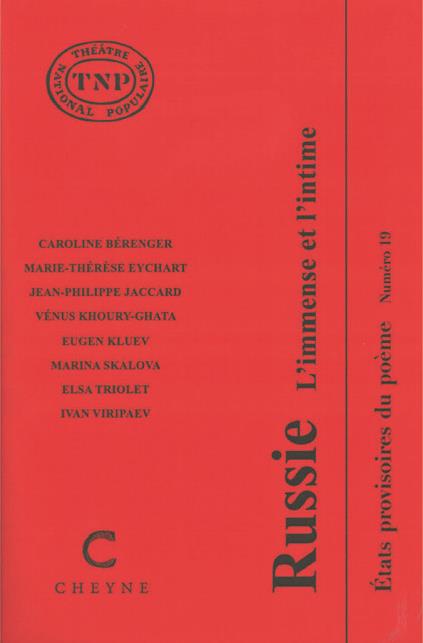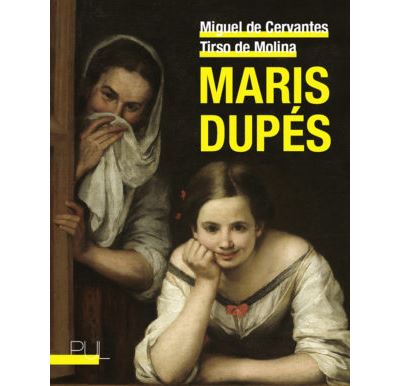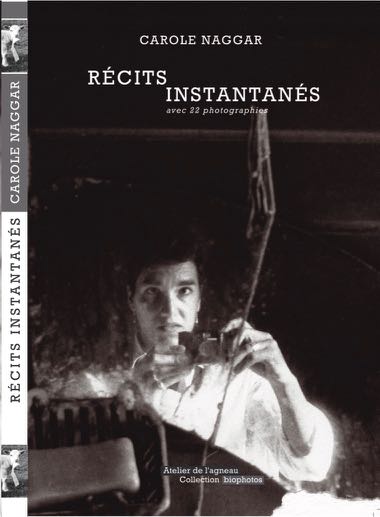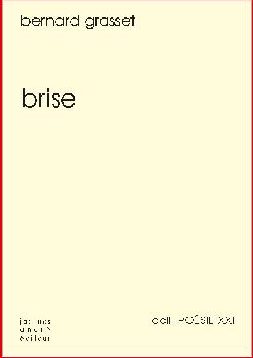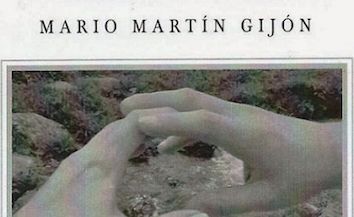Ecrire à quatre mains
Le genre annoncé sur la couverture a de quoi surprendre le lecteur habitué aux genres littéraires bien définis. Il ne s’agit pas d’entretiens, mais d’une conversation entre les deux auteurs du livre. Trois parties composent La Chance d’un autre jour : Paroles données, Pièces détachées et La Chance d’un autre jour, suite de poèmes épistolaires qui donne son titre à l’ouvrage. Mais Thierry Renard l’affirme dès le début de la première partie : ” Nous inventons un objet littéraire non encore identifié “, à quoi Emanuel Merle réponde par ” conversation en poésie “. L’ordre dans lequel ces trois parties ont été écrites n’est pas ici repris : il semble que tout soit né de l’échange de vers entre les deux poètes (la troisième partie), la première n’en étant que le commentaire…
Emmanuel Merle s’explique sur sa présence au monde et sa démarche,il s’agit pour lui de capter la ” réalité rugueuse “. Pas d’élan romantique : ” Il n’y a pas de romantisme dans la nature ” écrit-il. Il s’agit de donner sens à cet exil que représente cette présence au monde et d’accepter la puissance radicale de la vie. Retenant ces mots, j’ai conscience d’appauvrir le dialogue entre les deux écrivains car c’est un dialogue en recherche permanente, rien n’étant asséné une fois pour toutes. Thierry Renard comme Emmanuel Merle parlent de leur enfance, de leur vie donc de leur évolution. Écrire est un partage : ” Je reste du côté des opprimés ” affirme Thierry Renard comme en écho à la réalité rugueuse. Ces deux-là s’interrogent sur la poésie, sur le sens de leur vie à partir de la suite de poèmes qu’ils ont écrits et ils n’ont pas fini ! On découvre en passant les goûts littéraires de chacun : Yves Bonnefoy, Jim Harrisson, Baudelaire pour l’un, Camus, Pasolini, Duras, Senghor, Marx et Debord pour l’autre ; je laisse au lecteur le soin de rendre à chacun ses préférences ! Cette partie de la conversation est d’un grand intérêt : il faut la lire attentivement.
La deuxième partie, Pièces détachées, semble rapportée. Il s’agit de textes signés, poèmes ou proses, écrits indépendamment par Thierry Renard et Emmanuel Merle et publiés ici dans une parfaite alternance. Tous ces textes sont liés à un lieu, aux voyages des auteurs et révèlent leur façon d’écrire et leur façon d’aborder le monde. Ainsi, Thierry Renard a ces mots éclairants à propos de Ravenne : ” Ici, bien plus qu’en France, il y a des sourires et une douceur de vivre — malgré la situation de l’Europe, malade, sans nouvelle perspective historique. Malgré la crise imposée. ” On peut sentir une différence d’approche entre les deux auteurs : Thierry Renard tire du paysage ou du lieu des considérations générales, voire universelles sur le plan social, et même politiques alors qu’Emmanuel Merle en tire des considérations plus intimes… même si elles ont aussi une certaine forme d’universalité.
La troisième partie est sans doute la plus originale. Cet échange de poèmes se fait au jour le jour, chacun réagit à sa façon au poème qu’il a reçu de son interlocuteur. Mais s’ils ne sont pas signés, le lecteur familier de l’œuvre de l’un ou de l’autre poète reconnaîtra ce qui est dû à chacun. Même le néophyte repérera deux grandes tendances : une plutôt politique, panique, sensuelle et une autre plutôt introvertie, métaphysique et soucieuse d’accorder le corps et l’esprit au monde environnant. Pour dire vite. Ainsi ne faut-il pas s’étonner de ” retrouver ” dans le poème 92 le Thierry Renard de ” Citoyen Robespierre ” (paru en 2004) alors qu’on découvre (comme je l’ai fait) un Emmanuel Merle plus discret, plus tourné vers l’intériorité des poètes. De ce dialogue continu entre deux poètes différents naissent des questions que ne cesse de se poser le lecteur. Tout a‑t-il déjà été dit ? Ne resterait-il que l’indicible ? Et qu’est alors cet indicible ? Sans doute quelque chose aux prises avec le réel, avec la vie ? Et le monde ne change-t-il pas, obligeant le poète et le lecteur à poser de nouvelles questions ? .. ” Toute lumière / est imprononçable… ” dit l’un et l’autre lui répond : ” C’est l’âme du monde, mon ami, / rugueuse et libre. ” Poésie qui est cultivée car elle n’arrête pas d’être traversée par les poètes : Aragon, Ginsberg, Whitman, Apollinaire, Bousquet, Éluard…, mais aussi Goya, Léo Ferré, Héraclite… Directement nommés ou dont on reconnaît les échos des vers ou de la pensée…
Alors, Claude Burgelin a bien raison de terminer sa préface par ces lignes: ” C’est à l’intime que ces messages-poèmes s’adressent. C’est là qu’ils sont reçus. Et c’est ainsi un très beau texte sur l’amitié qui se compose sous nos yeux. ”