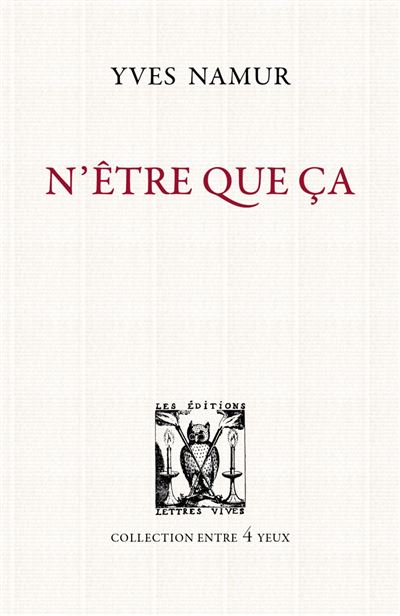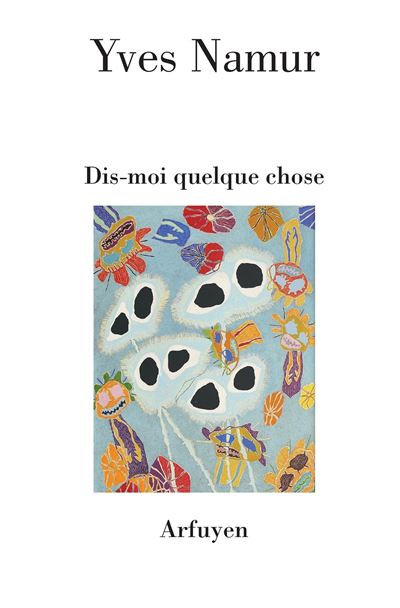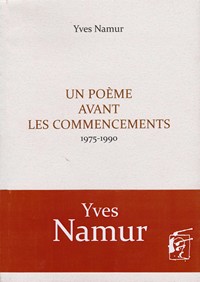Yves Namur, poète de l’interrogation vitale
« Aujourd’hui le figuier frappe à ma porte et m’invite :
dois-je saisir la hache ou entrer dans la danse ? »
Octavio Paz
Liberté sur parole, « le figuier »
Poète, éditeur, médecin, Yves Namur est l’auteur d’une œuvre substantielle se composant d’une quarantaine de titres et reconnue comme une œuvre poétique majeure, par des prix littéraires prestigieux ou par des distinctions officielles honorifiques.
Par-delà cette reconnaissance institutionnelle, ce qui touche le lecteur de poésie, c’est la vibration d’une voix lyrique qui se pose avec l’exigence intime et musicale de la justesse. L’emphase y est proscrite, tandis que s’y trouve privilégiée la recherche d’une éloquence paradoxale, à la fois retenue et percutante, laconique et intense, toujours empreinte de tension et de tendresse. En effet Yves Namur est le poète de l’interrogation vive, comme dans La tristesse du figuier, livre publié en mars 2012 : « Faut-il porter au ciel la poussière/ Parce qu’elle nous parle mieux que quiconque ? »
Plus que vive, la question se fait vitale dans Le livre des sept portes où s’affirme le motif emblématique de la source : « Où entendrais-je le chant de la Source ? / Où l’entendrais-je le plus distinctement, / Si ce n’était en la pesée du vide/ Qui m’entoure de toutes parts/ Si ce n’était/ Dans la traversée de la mort/ Qui me traverse depuis l’origine ?/ Où entendrais-je la Source ? »
La poésie d’Yves Namur se fonde sur un lyrisme du dépouillement qui interroge le sacré et le profane, en résonance avec la sagesse orientale, mais surtout l’obscur et le simple, où le simple est là pour dépasser et transcender l’obscur, pour faire vibrer l’essentiel. « Sous le fin tremblement des choses », une quête ontologique et métaphysique soumet la fragilité de l’être à l’épreuve de l’autre et du monde, cherchant à se rendre palpable, tangible, grâce à la gravité transparente des mots sur la page, dans Le livre des sept portes : « Qui pourrait vraiment entendre / La parole du simple/ Et entendre le simple ?/ Qui, /Si ce n’était toi, / Toi / Qui traverses le désert / Et la solitude du sable ?
Poète sensible de la fragilité et de la faille, Yves Namur désire réinventer le silence de façon primordiale, grâce à l’énergie du verbe poétique. Il cherche plus précisément à créer des « fragments de ce qui pourrait être du silence originel », comme il l’énonce dans La tristesse du figuier : « Tout est toujours à réinventer sur cette drôle de terre / Tout, même le silence. »
A l’ouverture de ce recueil, l’aspiration créatrice d’Yves Namur se place sous une ombre tutélaire double, celle de l’Apocalypse, dont il cite en exergue « et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d’un figuier secoué par un vent violent. », et celle de Rilke qui invoque dans sa Sixième Elégie « le figuier et sa manière de (se) hâter vers le fruit, jetant au cœur de sa précoce décision, loin de toute gloire, (son) pur mystère. » Là encore, l’ardeur vitale de l’interrogation l’emporte sur la formulation de réponses qui seraient trop péremptoires ou trop limitées face au « pur mystère » de notre existence humaine qui hante en profondeur Les ennuagements du cœur : « Que viennent à moi / Les oiseaux de l’obscur / Et la question / Qui n’a pas de réponse ».
Dans un poème de La tristesse du figuier où il se définit avec vigueur et modestie comme « le poète du peu et des riens », le poète s’adresse à lui-même par un jeu de dédoublement spéculaire propre à intensifier l’interrogation vitale :
« Poète,
Ne te trompe pas en regardant les hommes
Marcher avec les hommes :
Vivre, c’est tout autre chose
Que de porter sur soi un manteau de larmes
Ou même toute la colère noire des dieux.
Vivre,
C’est quelque chose de plus
Que de simplement parler de l’abeille, du miel de l’abeille,
Du bourdonnement de l’abeille, de la fleur
De l’abeille.
Vivre, c’est quelque chose de plus
Que tout ça.
Mais toi, le poète du peu et des riens,
Sauras-tu vraiment un jour ce que c’est que de vivre,
Que de vivre enfin hors du poème ? »
Dans ce recueil d’émouvante intensité, les poèmes inspirés par “La montée au Struthof” ne manquent pas de faire écho à la poésie de Paul Celan et notamment à sa “Fugue de mort”, mais aussi de façon plus subtile au livre même de Namur, Les ennuagements du cœur, inspiré par un voyage de jeunesse au camp de Dachau. On y retrouve la même question bouleversante sur cette part d’ inhumanité inscrite au coeur de l’homme, propre à mettre à l’épreuve la poésie « en ces temps de détresse ». En outre, les “regards tristes” et “la beauté terrible du Champ du feu” ne sont pas sans raviver “le fond de la misère ou la honte” quand “vivre était tout simplement un mot de trop”, ni sans rappeler le poème qui, dans Les ennuagements du cœur, rend hommage à « La rose de personne » de Celan et que je veux ici retenir :
Ce matin
Une rose s’est ouverte au grand vide,
S’est vidée
De son sang noir,
De tout son sang, de ses robes
Et de ses désirs d’abeilles.
Une rose
S’est dressée vers l’étoile et la douleur,
Une rose vide
S’est ainsi ouverte au lointain
Et
Aux regards de l’autre.
Ainsi, sous la transparence, la simplicité, le dépouillement, se décèle une fine érudition de poète grand lecteur de poésie, dialoguant par des motifs à la fois limpides et énigmatiques, personnels et universels, ‑comme la rose, l’abeille, l’étoile, l’oiseau, l’arbre‑, avec les grandes voix de la création poétique : Hölderlin, Rilke, Celan et Blanchot dont un fragment cité symbolise l’exigence intime de la poésie d’Yves Namur quand il s’agit d’ « écouter le silence avec des paroles ».
N’est-ce pas pour y puiser la vitalité de l’interrogation majeure, ontologique et métaphysique, qui fonde tout acte de poésie authentique, entre la tristesse immémoriale et l’invitation du figuier à « entrer dans la danse » ?
- La poésie d’Angèle Paoli : une esthétique de la trame - 17 juin 2016
- Dominique Sorrente, Lettres à un vieux poète - 8 février 2016
- Stratis Pascalis « poète grec » : la plénitude du pléonasme et de l’oubli dans Saison de Paradis - 8 janvier 2016
- Jacques Goorma : une po-éthique du dépouillement lumineux - 22 septembre 2013
- La tristesse du figuier, de Yves Namur - 18 juillet 2013