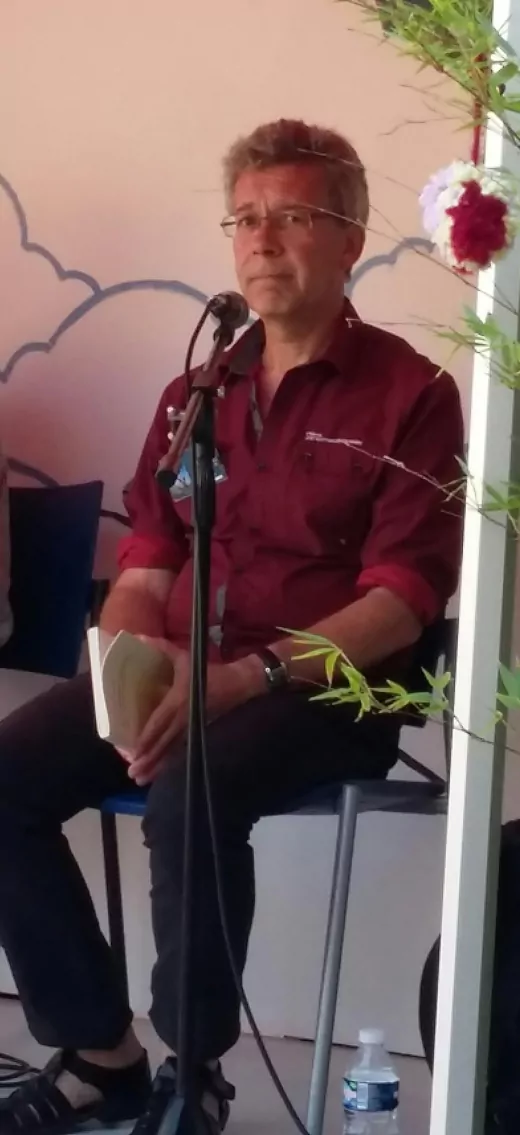Traductions : Sylvie Durbec
Ethique
Mon jeune ami,
si je me suis fait ouvrir les portes de cet endroit, c’est à cause justement d’un besoin moral irrépressible : je suis entré ici, presque sans m’en apercevoir. Oui, ma sœur était d’accord. Mais moi, plus encore.
Disparaître relève de l’éthique. Ne plus se trouver au milieu de gens qui se croient vivants. Et quel meilleur lieu que celui-là pour le dire de manière définitive, avec le consentement de votre science inutile ?
Maintenant je peux tresser des paniers et ficeler des paquets. Regarder défiler les saisons. Ecrire de la poésie et me réjouir de son inexistence. L’époque où je devais dire qui j’étais (et je me repens des monologues de Simon dans les Enfants Tanner, trop de mots, une suite de pages toutes pareilles) est passée depuis longtemps. J’ai eu trop de temps pour le dire, mais en ces temps les planètes tournaient en orbites gracieuses et je cédais à leurs caprices. Aujourd’hui je les sens immobiles et les regarde comme un seul point, je ne me vante pas d’elles ni elles de moi. Je regarde mes doigts, l’air qui les sépare, tellement d’air, trop, et qui vibre désagréablement dans les oreilles !
Rire
J’ai la nostalgie du temps où je recopiais des invitations à dîner et des ordonnances de docteurs, alors j’étais heureux comme un gosse, j’imaginais que mon écriture produisait des nourritures délicieuses ou soignait d’incurables maladies : choses que ma calligraphie rendait possibles à force d’arabesque précision. A présent je n’y crois plus. A présent j’ignore où va le monde, même si ici, à Herisau, il est facile de le prévoir. Observés par des visages atones, on se perd dans des yeux qui vont on ne sait où. Un halo, un bruit de voix, un écho et puis le sommeil.
Pourtant aucune larme.
Au contraire, il faudrait rire et ne jamais s’arrêter.
Ici, à l’asile, il y a tant de théâtres que je pourrais écrire des comédies en un acte si seulement j’avais encore l’envie de tracer des merveilles sur le papier.
Imminence
Tu es né en Italie, même si ton nom est suisse. Alors je te répondrai avec les mots de Dante « Je dirai une chose incroyable et vraie ». J’ai des raisons de contredire le grand metteur en scène des cosmogonies, l’homme hésitant qui disparaît dans les enfers froids et brûlants. L’écrivain doit s’approcher de l’incroyable et le montrer comme vrai. J’ai beaucoup aimé les romans d’aventures à cause de ça, leurs héros et leurs auteurs, de Dumas à London, d’Aramis à Martin Eden. Il arrivait quelque chose de neuf dans la vie absurde du lecteur : il lisait des aventures de mousquetaires et de dirigeables, d’étonnantes aventures au centre de la terre, l’histoire de vagabonds errants parmi les étoiles en vivant plusieurs vies. Je ne savais jamais ce qui allait arriver dans le chapitre suivant. Peut-être la révélation de quelque chose d’inconnu allait arriver et ce serait la vraie magie : l’esthétique dont parlent les érudits. Une chose imprévue a ce pouvoir : elle t’entraîne dans le sommeil, t’apaise, t’attend de l’autre côté du rêve. Celui qui renonce au monde est dans la bonne disposition pour le comprendre. Seulement ainsi tout ce qui existe redevient vrai.
Amour
J’aime les brigands, ceux qui viennent la nuit pour tout te voler et te laissent la vie pour que tu puisses te souvenir d’eux. Mort, ce ne serait pas possible. Les criminels sont rusés, ce sont des bandits de l’art, ils te bannissent du monde. Ils ressemblent à des dieux. La ressemblance entre un homme et un dieu est unique : l’homme ne comprend pas ce qu’il redoute ou qu’il aime, alors il l’appelle dieu. Et alors…O, dieu bandit !
Impénétrable
Difficile de te répondre. Je ne suis pas impénétrable. Je suis docile et réponds aux questions si ce sont de bonnes questions. Pour ma part, je ne peux poser aucune question, je connais déjà toutes les réponses. Ici, à Herisau, personne ne me demande rien. Personne ne sait que j’écrivais, personne ne dit le titre de mes livres. Si je devais conseiller une chose à quelqu’un, je lui dirai : écris pour toi et pour personne d’autre. Montre ton travail à quelqu’un, puis efface-le, oublie-le. Que signifie cette immortalité funèbre des livres, ces pauvres objets parfois laissés seuls durant des années dans les bibliothèques, recouverts de poussière tels des écrins sans trésor ? Les écrins sont ouverts et la poussière d’or dispersée sur les chemins !
Ce n’est pas vrai que je déteste les auteurs à succès, ils ne m’intéressent pas c’est tout. Je ne me sens ni le père ni le fils de ceux qui écrivent. Je vis un syndrome de la fugue ? Je ne sais pas. C’est une question musicale, plus qu’une question d’innocence. Les vainqueurs ne me parlent pas, ce sont des bronzes muets. A l’intérieur du paysage orageux de la ville en équilibre instable, les arcs de triomphe sont inutiles. Que veux-tu que je te dise ? Sous les arcs pissent les poètes et passent les gyrovagues. Comprends-tu à quel point je suis superbe ?
Schubert
Ta petite science, docteur Weiss…petite, trop petite, penser qu’elle pourrait devenir grande ! Vaste comme un panorama qu’aucune terre ne pourrait contenir. Mais vous ne savez que décrire vos propres peurs. Vous cherchez des solutions, vous n’êtes même pas surpris. Très mauvais, ça, et spirituellement pauvre. Le très doux Schubert, lui, était toujours dans l’étonnement. Sa musique, si pure, se dénoue prolixe et sublime dans les sentiers et les vallons, ses phrases ont toujours l’étonnement musical du wanderer qui s’arrête dans une clairière enchantée de clarté : ce que vous n’avez jamais eu et que je n’oublie pas. Je vais, heureux marcheur, malgré mon âge. Les ciels d’orage m’émeuvent. Je crois qu’écrire vient de la peur de les regarder pour de vrai.
Décrire
J’obéis. Servant mon rêve de servir. Je le fais parce que les serviteurs choisissent leurs maîtres, et les maîtres, non. Et ainsi je suis libre.
Mais trop de fois j’ai décrit en détail mon rêve et dans trop de livres. Ce n’est pas bien. Que mes mots trop clairs existent encore me déplaît, et qu’ils continuent toujours à tourner. J’ai été un bouffon. Le rêve a besoin d’enfants taciturnes. J’étais un taciturne vaniteux de mots, gonflé comme un paon de tellement, tellement de mots.
Je préfèrerais ne pas
Toute ma vie vient d’une phrase de Melville.
Je préfèrerais ne pas.
Ainsi j’ai perdu ma vie. Dans ce « je préfèrerais ».
Je n’ai jamais dit : je préfère.
Je suis resté entre le oui et le non.
Si on m’obligeait, je copiais des lettres obséquieuses dans ma chambre.
Si on ne me disait rien, je fixais le mur, comme tant de Merveilleux Écrivains qui n’écrivirent jamais rien.
Montgolfière
Je suis fou parce que vierge ? Vierge parce que fou ? Être vierge n’est pas le pire des péchés, c’est la meilleure des défenses. Je laisse le monde à sa tranquillité. Je marche à côté. Je me promène, je vais, c’est ma manière d’aimer le monde. Si on peut aimer avec violence ? Non, pas du tout, avec la violence on ne peut que blesser et déchirer. L’amour est douceur, lenteur. Comme traverser la terre colorée en la contemplant depuis une montgolfière. Ces derniers temps, les mots me semblent faibles et sourds. Mais les chants des oiseaux, ceux que j’entends quand je suis là haut, dans le ballon, oh oui, comme ils sont clairs là haut ! Et quelquefois (mais ne le dis à personne, c’est peut-être un symptôme), je crois entendre les voix des chevaux. Comme me le chuchotait une amie enragée, je me souviens de son nom, Greta, elle voulait révolutionner le monde avec le style logique et barbare de ses yeux clairs. Peut-être Gulliver avait-il raison quand il créa le royaume rationnel et parfait des Houyhnhnm. Je ne crée pas de royaume, je caresse le papier qui renvoie les reflets d’un miroir, comme il brille…
Lutter
Je n’ai aucune envie de lutter. J’ai contracté une maladie incurable et je ne suivrai aucun traitement médical. Je me déshabillerai pendant une promenade, pour me faire gifler par le vent froid. Je veux aider la mort. Pourquoi avoir avec elle, que personne ne vaincra jamais, un rapport d’opposition, un rejet artificiel ? Je suis d’accord pour lui faciliter le travail, sûr d’être sa cible. Suivre simplement les sept règles du Silence : prudence, secret, simulation, songe, fantaisie, métamorphose, mélancolie.
Presque
Je ne m’éloigne jamais longtemps. Je ne veux pas jouer le privilégié. Je dois rentrer aux heures imposées. Manger et dormir avec tous les autres. A la même heure. C’est le contrat avec Herisau. Tu dois avoir lu mon dossier médical. J’imagine qu’il est presque vide. Genre : Robert Walser. Promeneur. Entend des voix. Voudrait être moins visible.
Presque est le mot juste. Il appartient à deux royaumes distincts. Il est presque beau, presque laid, presque sain, presque fou. Mais il n’est jamais l’une ou l’autre chose. Tu vois, c’est sans fin. Je marche dans les bois mais c’est comme s’il n’y avait plus d’arbres. Même les oiseaux ne chantent plus. Les chemins sont vides. Je me sens libre. Non pas presque libre. Mais libre.
Autobiographie
Bien sûr, je ne suis pas un écrivain qui va écrire son autobiographie. Dans un livre à la première personne, le je est un personnage modeste, ce n’est pas l’auteur. Si je commençais à parler de moi, je m’arrêterais au bout de cinq minutes. N’importe quel moineau gazouilleur en dirait plus que moi. Le fait de ne rien raconter ne me cause aucune douleur. Absolument aucune. Que je vaille moins que le nettoyeur de latrines d’un hôpital psychiatrique ne me fait pas souffrir. Ici je suis protégé. Imagine : personne ne pourra plus m’enfermer ici parce que je me suis déjà enfermé moi-même par ma propre volonté. Le reste des hommes oubliera les noms des aliénés d’Herisau, effaçant nos vies sans hésitation. C’est bien. Qu’on se souvienne de moi me décevrait. J’ai toujours aimé les Lotophages qui mangent la douce plante de lotus et oublient toutes les inquiétudes du monde. Heureux enfants, sur les rives de quelque océan oublié. Ils n’iront jamais à ces enterrements tristes où de vieilles tantes, derrière de petits cercueils blancs, se demandent encore quelle existence auraient eue ces petits corps qui ne respirent plus. A quoi bon y penser ? Pourquoi ensevelir les morts ? Il suffit de demeurer enfants et la vie ne s’écoule plus, telle une belle écharpe chaude. Prenez exemple sur les Lotophages, comme ne l’a pas fait Ulysse, navigateur trop rusé, et demeurez dans des îles, mais sans mémoire.
Héros
Je ne lis plus parce que je me souviens de tout ce que j’ai lu. Je ne lis plus parce que sinon je me retrouverais dans la situation où j’étais quand je lisais La loge invisible de Jean-Paul, m’enthousiasmant pour certaines phrases et ensuite tombant sur des forêts d’étrangetés, j’interrompais ma lecture : il me semblait que l’auteur s’adressait à moi dans une langue secrète que je n’étais pas en mesure de déchiffrer. Chaque livre appartient au dessein de la nature. J’ai tant écrit de livres et me demande aujourd’hui pourquoi. N’aurait-ce pas été plus juste de n’en rien faire ? Tant d’essais sur le non-être, pourquoi ai-je voulu les faire exister ?
A ma décharge, je peux dire qu’en ce temps-là j’avais beaucoup de temps libre et la meilleure façon de le perdre était de consigner des histoires que personne ne lirait.
Combien j’enviais les grands prosateurs de Dickens à Balzac ! Tous ces personnages si vrais, si riches de vie qui faisaient rêver les adolescents. Moi, au mieux, je m’occupais de saltimbanques, de clowns. D’êtres de passage.
Le monde a perdu ses héros. Depuis trop longtemps. Il reste des gens comme moi qui sourient dans un coin de rue quand ils voient passer des personnes bizarres, des femmes délicieuses, des gens du cirque. A présent, il ne passe plus personne. Depuis toujours je désirais que cela arrive. Si tu m’as bien lu, quand je commence à gazouiller des phrases, entends aussi mes silences et mes vertiges. On ne le dirait pas, mais j’ai lu Rimbaud.
Les choses
Je ne sais pas si tu le sais, mais mes yeux se glissent entre les choses. Ce que je n’aime pas dans les sciences mentales, c’est qu’elles veulent dresser la nomenclature de l’invisible. Pourquoi ? Que vaut le monument au chant de l’oiseau ? Et, quand j’aurai déchiffré les traumatismes d’un assassin, sera-t-il moins assassin, sa victime moins morte, et moi, aurai-je davantage pitié de lui ?
La science devrait être comme une fleur qui s’épanouit au moment où elle est utile. Ensuite retourne fermer ses pétales. A quoi me sert la lecture des explications ? Je désire comprendre au moment où je respire.
Invisible
Naturellement. Comme personne, j’ai souvent changé d’adresse (quinze fois à Berne de 1921 à 1929). Je fuyais, tant que c’était possible, les mécanismes de la société : travail, identité, mariage. Maintenant je suis à l’intérieur de ces couvents modernes que sont les hôpitaux psychiatriques – Waldau de 1929 à 1933, Herisau dans le canton d’Appenzell depuis 1933. Et comme écrivain ? Oui, même dans mon œuvre je changeais de lieu ! Invisibilité ! Invisibilité ! J’étais tous les masques de mes personnages. J’étais nomades et vagabonds, hommes de la marge, comme Joseph Marti, qui acceptent de faire des travaux humbles et ne sont responsables de rien, dégoûtés par le pouvoir et le succès. Mais j’étais aussi le masque des grands écrivains du passé avec lesquels j’avais des affinités : Hölderlin, mais aussi Büchner, Bretano, Kleist, Lenau et d’autres encore. Mais sur un plan exclusivement littéraire, toujours le secret et l’invisibilité. D’ailleurs, nul n’a le droit de se comporter avec l’autre comme s’il le connaissait.
Et pour finir en beauté, je me cachais dans l’écriture et à l’intérieur de l’écriture. M’enfermer dans l’écriture avec un style gai et cérémonieux, me rappeler à un lecteur naturellement imaginaire, que je peux ainsi tenir à distance, est une chose belle et douce. Et pas seulement : me cacher quand je commence à développer un thème ou un argument et que régulièrement je ne développe pas, quand je me propose de rester fidèle à quelque thèse qui me semble décisive et que je change de discours et parle de quelque chose de complètement différent. Cette manière de procéder me rend invisible : elle me dispense de l’impératif d’avoir à dire quelque chose, de la mystication implicite qu’il y a à devoir dire quelque chose. « C’est le long des voies de traverse, et non sur la route principale, que se trouve la vie », ai-je écrit dans une de mes micro-écritures, non linéaires ! Comment pourraient-elles être linéaires, mon jeune ami ? Touche ton visage, tu ne vois pas qu’il t’échappe, ton nez est complexe, et tes oreilles et tes lèvres…
Oui, je me suis réfugié dans des feuillets très fins, écrits au crayon d’une écriture très petite, entre 1924 et 1936. Et puis, fin. La limite extrême du secret dépassée, seul le silence. (Mais qui peut t’empêcher de penser que je n’ai pas écrit des milliers de notes à Herisau, exerçant avec une maniaque précision le talent de les cacher ?)
Inaperçus
Non, non, ce n’est pas moi le patron. Les choses inaperçues, si on arrive à les apercevoir, échappent à l’attention.
Hier, j’ai lu un petit livre de Gotthelf, à mi voix entre moi et moi (quelqu’un l’aura oublié lors d’une visite, il avait quelques pages arrachées). L’écrivain se sert de mots que personne n’a trouvés avant lui : si particuliers, éclairés d’une lumière provenant d’on ne sait où, de sorte que, à certains moments, on s’étonne devant l’art de l’auteur qui parvient à être complètement lui-même dans sa pensée et sa formulation. Il faut lire ce qu’il dit. Personne n’est capable de l’exprimer avec autant de délicatesse. Dans ce récit, il y a un vieil homme qui ne se plaint pas de l’absence de larmes autour de lui. Autour de lui rient de nombreux enfants. Sa fille est sérieuse, impassible. Le vieillard veut qu’on l’emmène dehors et s’assoit au soleil, face à la maison. Il exhale son dernier soupir le regard tourné vers le paysage, au milieu des rires enfantins. Pendant que Gotthelf parle de manière si belle de cette mort, j’ai l’impression qu’il tient tout entre ses mains : le vieil homme, la maison, le monde, les enfants, comme s’il observait un jouet, avec une attention tendre. Beaucoup de vrais livres sont de parfaites mécaniques. Peu de gens liraient un livre si petit avec la même admiration que moi, fascinés qu’ils sont par des oeuvres plus vastes et morales, qui intimident et inhibent. Mais ici, il y a un écrivain qui sait voir les choses inaperçues et avec son récit, nous réveille et nous fait plaisir.
Nomenon
Ah, la cascade, la cascade de Nomenon ! La mienne, ma cascade ! J’étais petit, je jouais à mesurer ma taille sur les troncs des hêtres. Vingt-sept ans plus tard, je suis retourné dans ce lieu me mesurer à nouveau, appuyant ma tête sur le même arbre. La nuque correspondait à la même marque au même endroit. Je n’avais pas du tout grandi ! Comme je l’imaginais. Comme je le voulais. Ah, la magie de Nomenon ! Pourquoi serait-il si important de grandir ? Pour se souvenir du jour exact où Karl s’est marié et où a commencé la ruine de mon existence ? Pour me souvenir d’Ernest qui agonise après vingt ans d’asile ? Pour me souvenir d’Hermann qui se suicide à 49 ans ? A Lisa et Karl, disparus il y a quelques années ? On grandit pour compter le nombre des morts. Enfants nous sommes toujours protégés par les vivants. C’est beau de l’être, comme observer le coucher du soleil où la masse rouge et sombre ne descend jamais à l’horizon mais se transforme en un astre clair et rose et c’est ainsi que recommence le monde, en ignorant le royaume obscur de la nuit et des vivants.
Mythe
Docteur Weiss, je ne veux pas devenir un mythe.
Toi qui peux sortir d’ici, tu sais comment te comporter.
Je ne veux pas être un mythe. Pas même un mythe littéraire. Je me fous de la littérature si tu permets cette expression. Je ne veux pas que ton médecin chef mette à ma disposition une chambre, une table, du papier, une plume. Qu’en ferai-je ? Je suis un fou enfermé dans un asile.
Lis Tchekov, oui lis-le. Et tu t’apercevras que Tchekov n’existe pas. A la fin, il n’y a que les histoires. Ses histoires. Sans hystérie, commérages, idéologies. Des histoires, et ça suffit.
Si tu veux parler de moi, raconte que je n’oublie jamais de me promener. Seelig le sait. Tout Herisau le sait.
Je peux te faire un aveu ? J’ai horreur que la littérature continue sans avoir l’intensité des plus belles pages. Je veux la salle n°13 et que tout finisse.
Je préfère disparaître.
Les autres
Ma longue fréquentation de l’éloignement du monde m’a immunisé contre la douleur de sa fin. Je trouve insupportable, même si je suis schizophrène, d’imposer aux autres mes tragédies personnelles. Insupportable et stupide. Laisser des billets sous la neige est beaucoup plus magique. Les laisser vierges est certes un artifice, une plaisanterie, mais j’y ai pensé.
Pour écrire, j’ai toujours recherché le soutien des autres. Non, je ne les ai pas utilisés comme des miroirs. Me réfléchir, quel sens cela aurait-il eu ? Je me réfléchissais dans les autres en me changeant moi-même. Et enfin je regardais le soleil à travers la fenêtre de ma chambre, lisant les aventures des héros de roman, ou regardant les filles qui passaient dans les rues et chaque jardin était le jardin ombreux et touffu, les feuilles harmonieuses de la cime mouvante des platanes telles de très beaux masques verts, où, adolescent, j’avais rêvé de dormir dans un état d’extase, libéré de mon corps.
Confiance
Je suis vraiment libre. Vous, les psychiatres, l’avez compris. Vous avez compris que je ne veux pas m’enfuir. La porte de Herisau est toujours ouverte pour moi. Cette confiance me plaît et me console : c’est une vie parfaite. Avoir confiance en l’autre, en sachant qu’il ne t’agressera pas avec un couteau. Ne jamais fermer la maison puisque personne ne viendra te voler. Ici nous ne faisons aucun mal : l’ayant subi, nous restons proches les uns des autres, chacun comme il le peut, qui cuisine, qui nettoie, qui ficelle des paquets. Nous sommes réconciliés. Aucune douleur ne peut être plus grande que celle dont nous nous souvenons. Et nous ne redoutons pas la mort puisque, à notre manière, nous sommes déjà morts en vivant à la faible lumière de cette existence posthume de prisonniers.
Lecture
Je lis souvent à Herisau. N’importe quoi. Parfois certaines phrases dans un mauvais roman sont très belles, oh oui. Pendant la lecture la tête devient le lieu où tournent d’étranges pensées : les histoires vont et viennent. On n’est plus soi-même et c’est très beau. On pourrait presque dire qu’en lisant nous mourons et que quelque chose se met à germer en nous comme une vie nouvelle. D’autres fois, je ne lis pas mais me souviens de ce que j’ai lu. Thomas Mann, par exemple. Tonio Kroger et Désordres et douleur précoce (la première édition, celle avec les dessins de Karl). Norina, cinq ans, qui danse avec Max, son premier tourment, douleur absolue et sans remède. Tout un ruban de nuances, de tressaillements, de rougeurs comme des frissons sur la peau. Tonio qui regarde le monde vivre et danser, là, dehors, un monde heureux et beau ; dans la douleur, il le regarde depuis sa fenêtre. Je n’ai jamais compris sa douleur. Il aurait dû se sentir fier de se tenir là, à l’écart des autres. Que signifie être jeune et beau, se marier, avoir des enfants ? Etayer une illusion avec des poutres d’un millimètre d’épaisseur. Se condamner à des déceptions douloureuses et à des infidélités vaines. Utiliser un engrenage qui paraît avoir un sens. Voir celui qu’on aime tomber malade. Pleurer à l’idée de sa mort. S’émouvoir de sa joie. Que de peines !
Hans Castorp, au fond, était fier de vivre une existence en suspens de malade tout en écoutant les mots de Settembrini. Alors, si tu veux vraiment le connaître, dans La Montagne Magique, tu trouveras mon secret. Peut-être aussi le tien, docteur, quand il est question de santé et de maladie. La maladie est un état magique, qui anéantit la douleur du temps, et permet de se dissoudre sans avoir à le décrire en se servant de l’écriture. Herisau n’est-il pas ce genre d’endroit ? Certes, sans le style de Thomas Mann, sans ses réflexions pénétrantes. Penses‑y. Nous sommes tous à l’intérieur d’un livre. Puis nous en oublions le titre et ainsi nous croyons en la vie qui passe.
La langue des oiseaux
Hier j’ai fait un rêve. Tu ne me demandais rien, je ne te répondais rien. Nous étions si tranquilles, si sereins. En me taisant, je sentais que j’apprenais la langue des oiseaux. Mais, par chance, ne pouvant voler, je ne l’utiliserai jamais. Comme c’est beau ! Enfin, je me souviens d’un rêve. Depuis des mois, je fais des rêves très brefs, je m’éveille en pleine nuit et chaque fois je rêve d’histoires parfaites sans me rappeler aucun détail. Tous des mensonges, mes mensonges. Qui accompagneront (je l’espère) mon enterrement comme l’adagio de la Sonate pour piano de Franz Schubert.