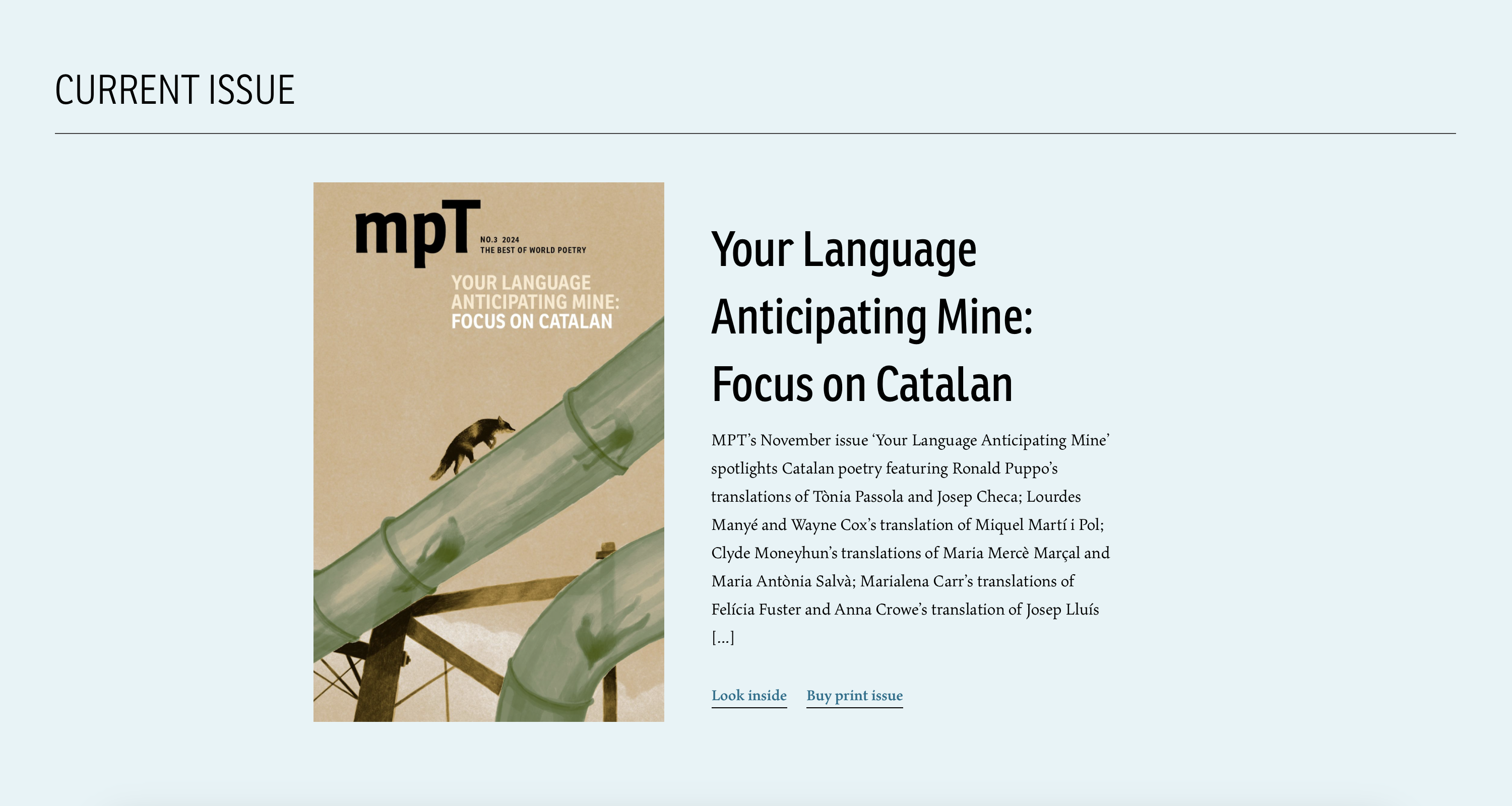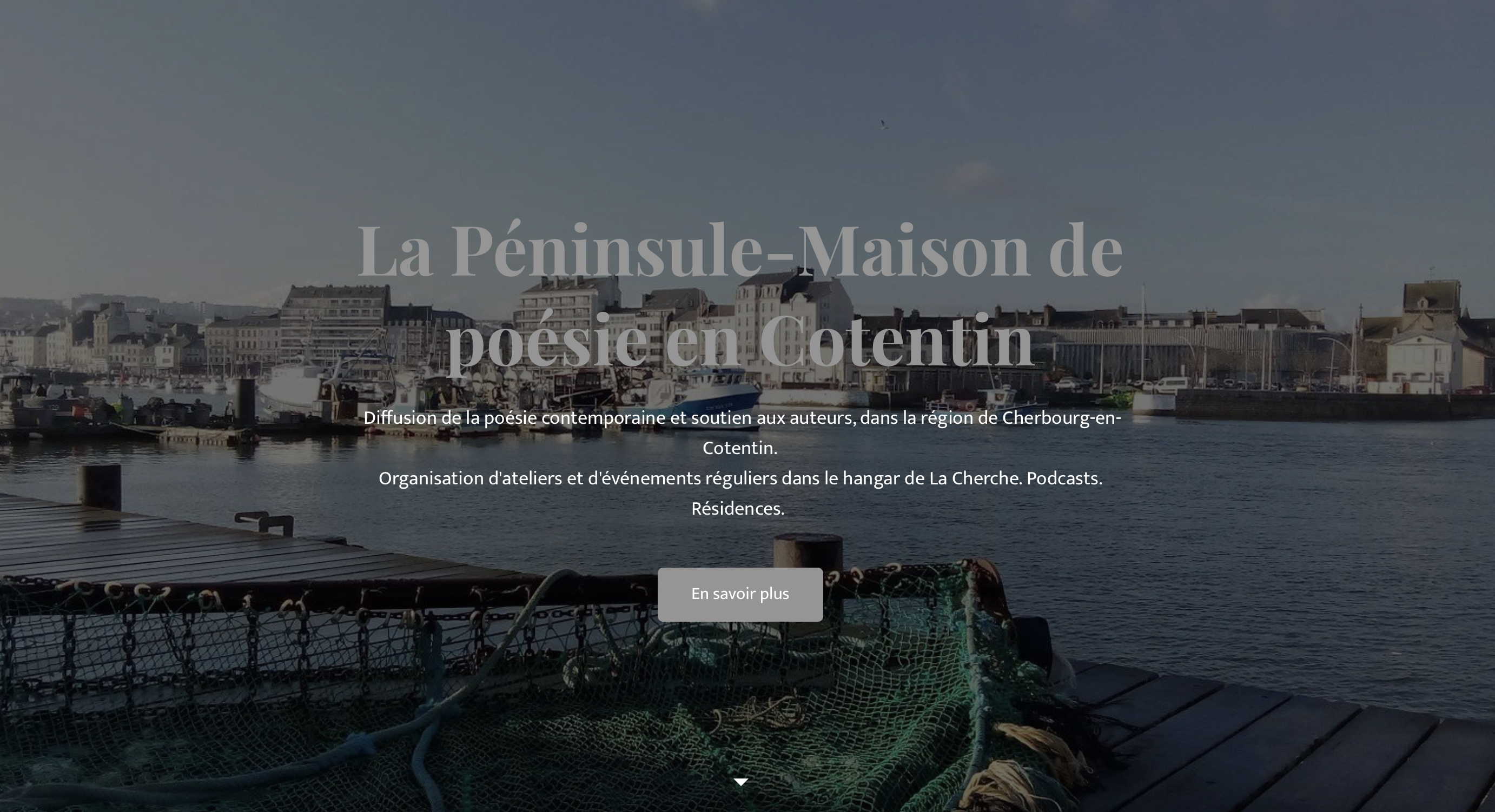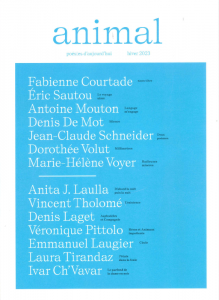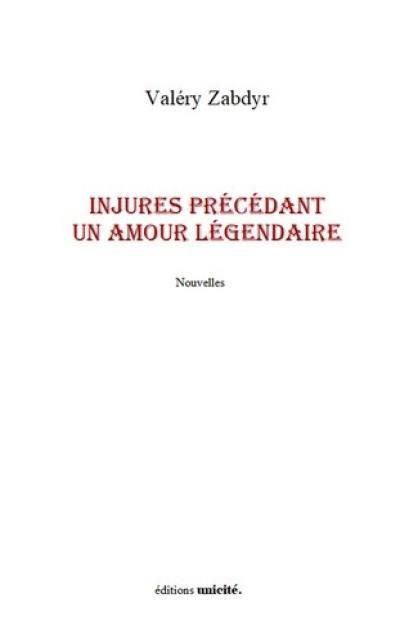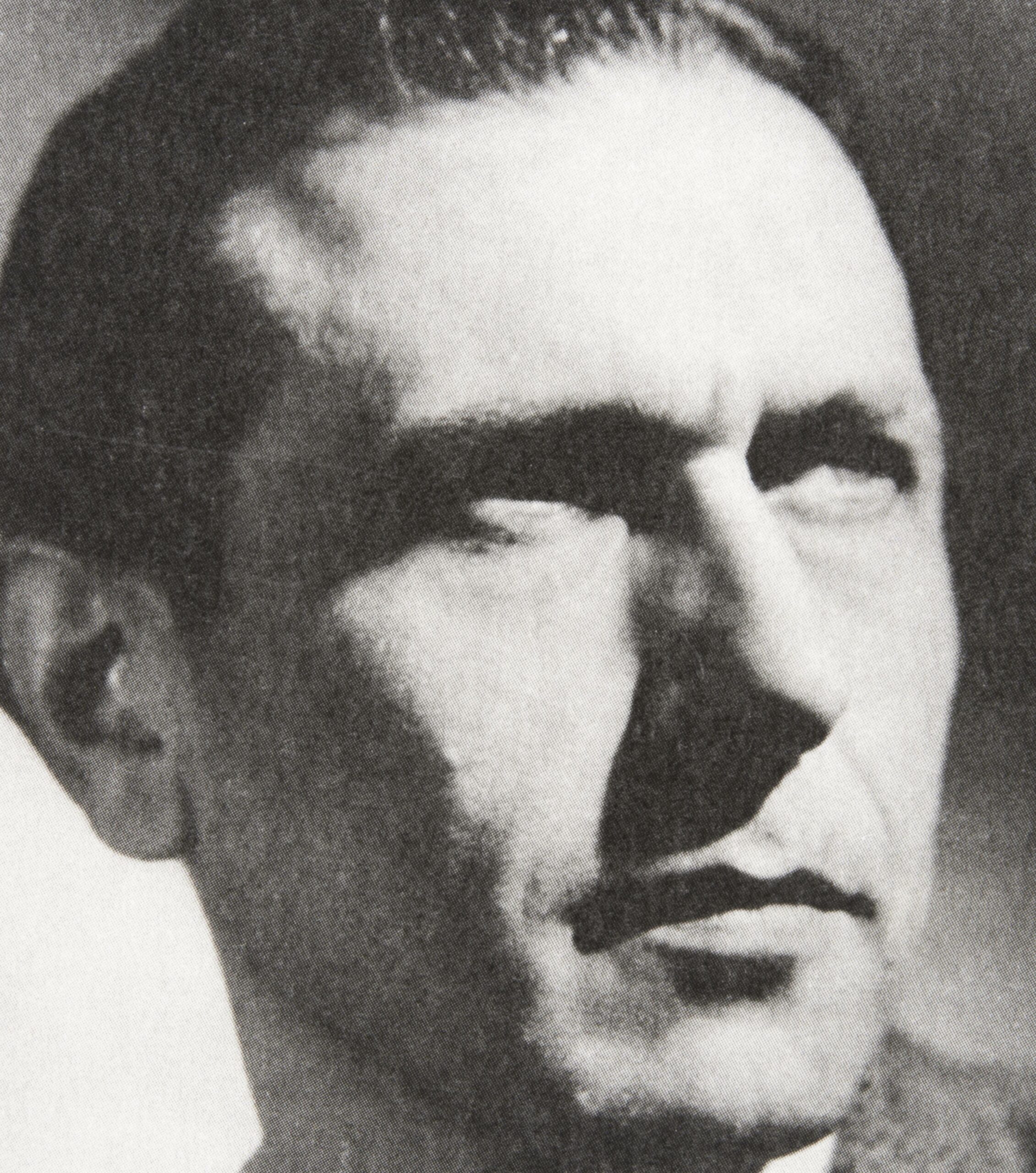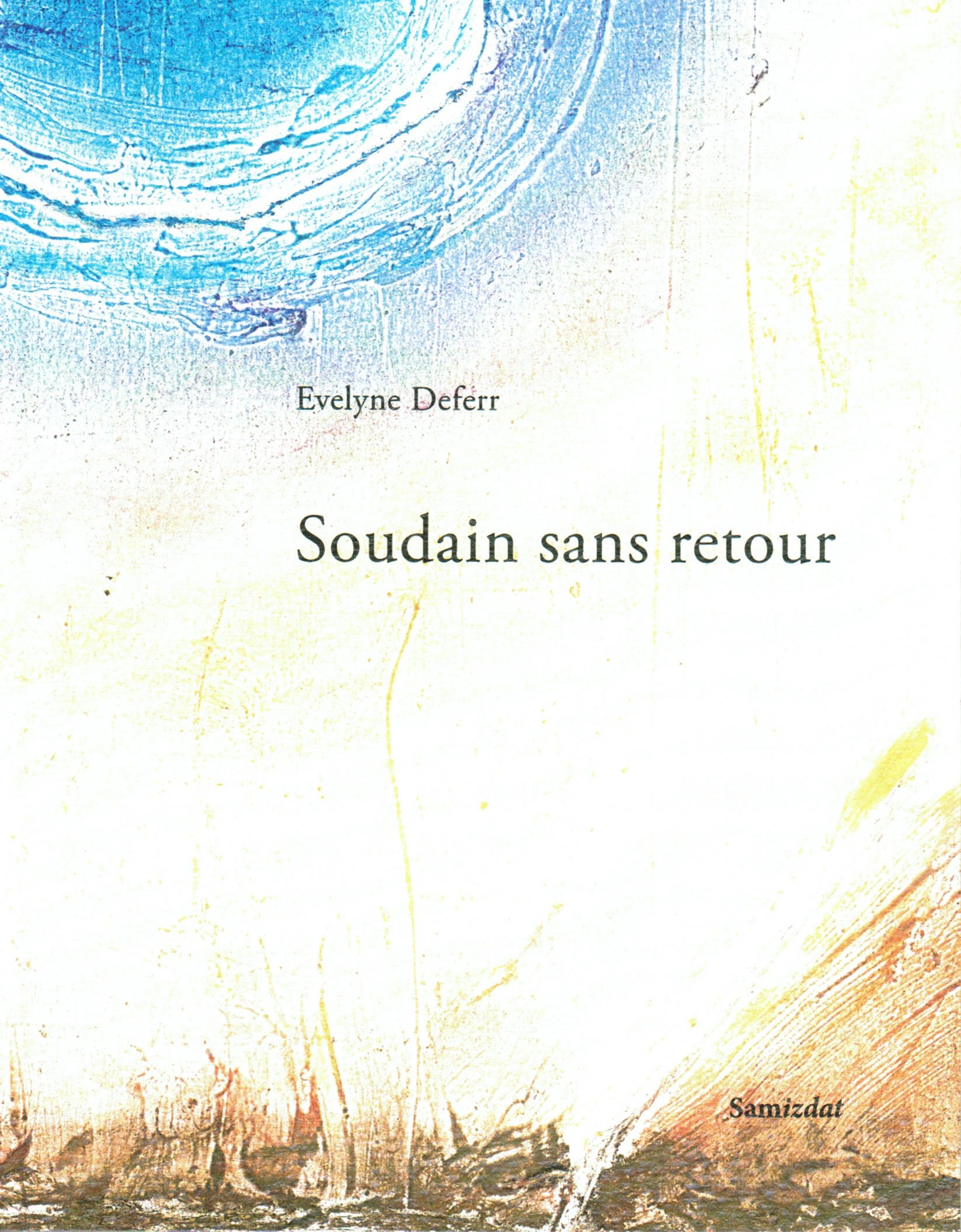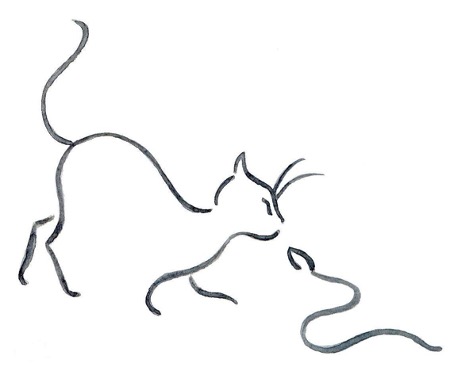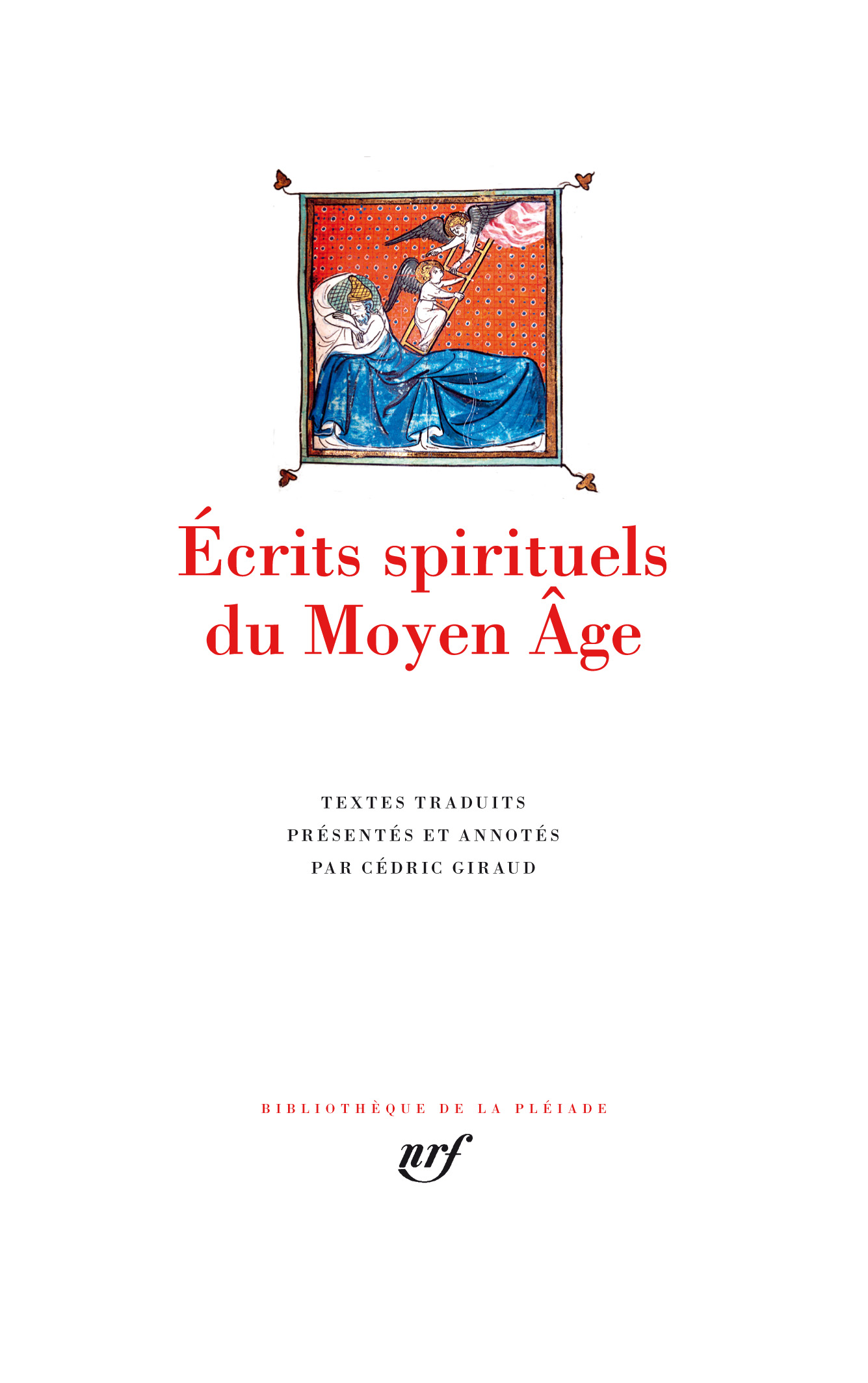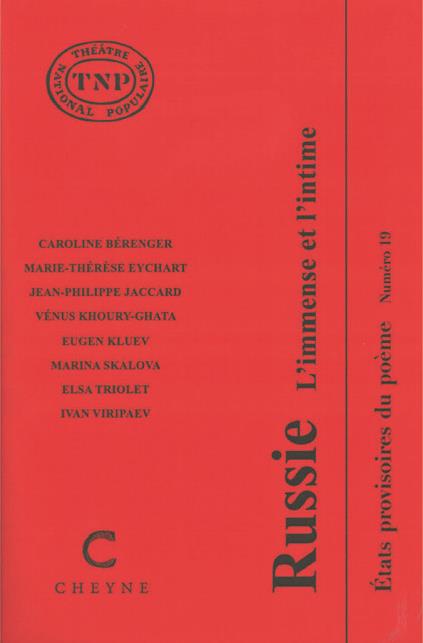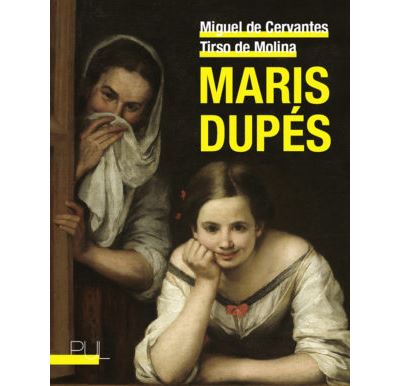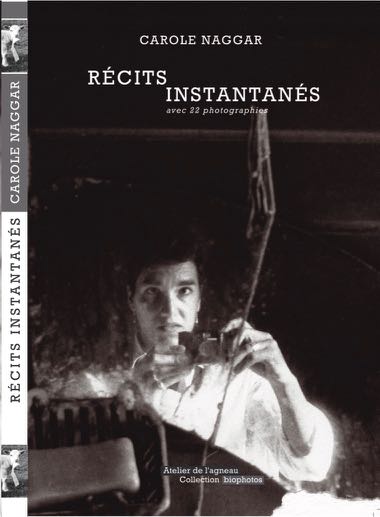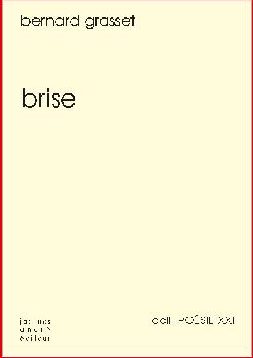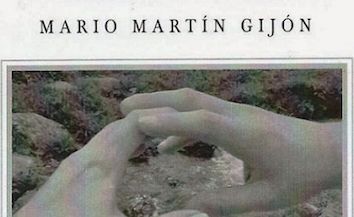Le mot de passe, rappelle la quatrième de couverture, est une clé qui permet d’ouvrir un domaine secret et d’y pénétrer. Ou, comme l’affirme le Littré, le mot qu’il faut prononcer pour entrer dans un endroit gardé. Quels rapports avec la poésie ou, plutôt, avec la démarche poétique de Marie-Claire Bancquart qui regroupe six ensembles de poèmes dans un recueil intitulé Mots de passe ?
La première suite a pour titre Ainsi ce paysage. De quel paysage s’agit-il ? Peut-être de paysages du Nord de la France : le poème liminaire, après des considérations qui peuvent s’appliquer à toutes les églises et cathédrales anciennes de France et de Navarre (les gargouilles…) se focalise sur un détail du portail (qui est une histoire taillée dans la pierre) et une région “aux confins de France et de Belgique”. Le poème se fait narratif et, peu à peu, on reconnaît la ville de Thérouanne à l’époque de Charles Quint où elle fut assiégée et prise en juin 1553 par les troupes de ce dernier, avant d’être rasée… Et sur les ruines : “il va, de sa main, répandre le sel qui dénie toute espérance”. De fait, cette ville que le signataire de ces lignes traverse souvent, ne se remit jamais de ce désastre. Elle perdit peu après son évêché et n’est plus aujourd’hui qu’une modeste bourgade d’un bon millier d’habitants. L’œuvre principale de la cathédrale détruite, le Grand Dieu de Thérouanne, est aujourd’hui conservée dans la cathédrale de la ville voisine de Saint-Omer. C’est une sculpture du XIIIème siècle, représentant le Christ entre la Vierge Marie et saint Jean… Le poème relate un voyage que fit Marie-Claire Bancquart dans cette région. Mais c’est une méditation sur l’histoire et les guerres, dans un va-et-vient entre la fin du XIIIème siècle et le présent. Mots de passe donc pour accéder, via l’Histoire, au tragique de la vie qui continue, malgré tout… Autre mot de passe : le patronyme de l’auteur. “Notre nom de charretier flamand, sur les routes cahoteuses du Nord” ; et c’est une fable qui se (re)constitue, une fable peut-être réelle… Et dès lors, la machine poétique est lancée et ça continue… D’autres lieux qui se prêtent à la méditation ou à l’interrogation, sont évoqués que le lecteur connaissant cette région identifiera (Berck ou Le Touquet pour leurs parkings et leurs alignements de voitures en stationnement) : ici, un souterrain, là un jardin, là encore une église avec ses chapiteaux. “Nous ne te louerons pas, / Seigneur. Mais la tristesse de ta maison nous pénètre”. Qu’est donc ce voyage sur lequel je m’attarde parce que je vis dans cette région ? La quatrième de couverture dit que ce recueil a été écrit durant une période difficile de maladie. Mais Marie-Claire Bancquart n’en dit pas plus, D’ailleurs, elle écrit rarement Je ; plus souvent Il ou Nous… Comme si la priorité était de capter les mouvements intérieurs du corps et la maladie est alors l’occasion privilégiée (?) de les percevoir, de les cerner et de les dire.
Dès lors, Marie-Claire Bancquart va s’attacher à décrire l’ambiguité de la vie qui ne va pas sans la mort. Ainsi, on découvre un poème qui met en scène le moment où la vie bascule : l’annonce que le patient est atteint d’un cancer, annonce qui, bien sûr, amène à prendre conscience de l’imminence de la fin. Mais surtout à s’interroger sur le sens de la vie, car c’est la mort qui, à la fin, donne son sens définitif à une vie qui s’achève : “Seul dans la rue, après le diagnostic, il se demande / s’il n’aurait pas mieux fait d’explorer, espérer, / prendre du temps pour de folles recherches / sur l’origine et sur la fin / que voici, prête”. Mais sont-elles si folles, ces recherches ?
Marie-Claire Bancquart évite, tant que faire se peut, toute référence autobiographique. Sans doute est-elle à l’écoute de son corps, et c’est pour cela qu’elle parle si bien du corps, du corps de l’autre, du nôtre. Le ton se fait alors dur, d’un réalisme cru, prosaïque : “Notre viande. // Nous rêvons à elle”, “… nous ne la sentons, pas la terre // pas plus que ces organes / cachés dans notre corps”, “chair / enfermée / dans son étui de peau” ou “je connaitrais / dans tripes et boyaux / le goût du monde”. C’est que Marie-Claire Bancquart interroge “la raison d’être de son corps”, qu’elle traduit par des mots toujours insuffisants à rendre compte du réel. Insuffisants mais terriblement efficaces malgré tout : “la vie nous quitte un peu chaque jour, on ne court même plus après elle”. Traversés par des contradictions que Marie-Claire Bancquart n’hésite pas à cerner : “ma recherche / constante, elle / désaccordée, / ressemble à une ascèse offerte à quelque dieu / dont on proclame fermement l’inexistence”. Parfois, on entend “presque inaudible / une confidence / sur le pourquoi de notre vie”. C’est alors, quand la liaison avec la vie ou le monde se fait, qu’éclate, lumineuse et évidente, la raison d’être des poèmes. Paradoxalement (mais pas tant que cela) ces moments de liaison avec l’univers apparaissent quand la conscience de la mort inéluctable se fait trop forte…
Marie-Claire Bancquart prête attention aux formes de vie les plus humbles, aux animaux les plus ordinaires pour demander, à la lumière de la mort des comptes à la vie… Le rythme respiratoire des poèmes fait alors se juxtaposer des mots isolés et des vers assez longs, voire des paragraphes de prose… C’est tout l’ensemble qui répond au poème liminaire du recueil : le titre du dernier ensemble, À fleur de sel, répond au sel répandu par Charles Quint sur les ruines de Thérouanne (mais la vie toujours est la plus forte). La boucle est bouclée : de l’interrogation sur la place de l’être dans le monde, Marie-Claire Bancquart passe au constat et à la racine du mal : “nous le [le flux de la vie] ressentirions / si nous n’avions pas divorcé du reste du monde”. Le recueil est soigneusement construit : poèmes se ressemblant qui se répondent d’un bout du recueil à l’autre (p 54 et p 137) ou poèmes quasiment similaires (p 131 et p 136) à l’intérieur de la dernière suite… De quoi “retenir l’existence”…