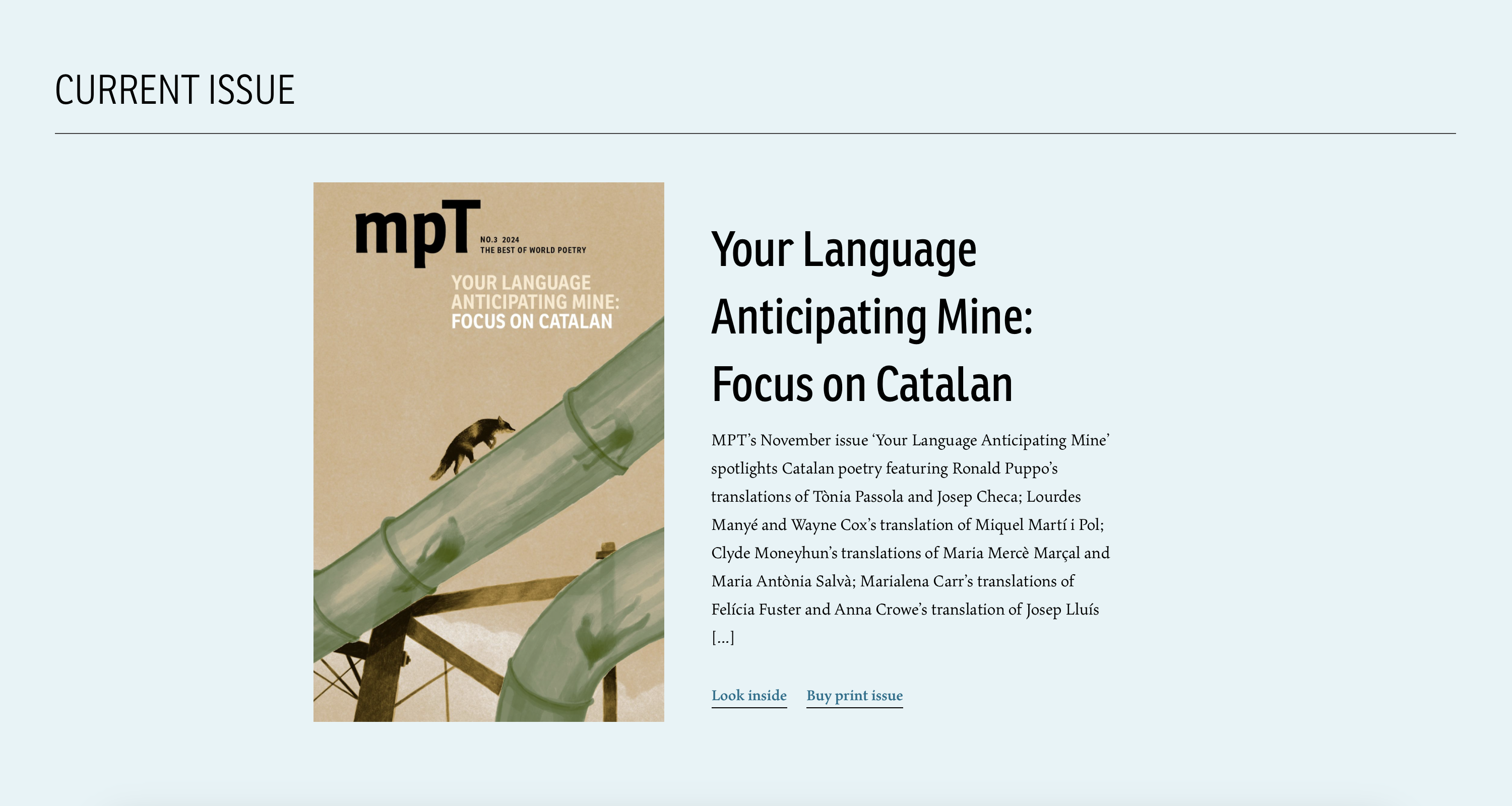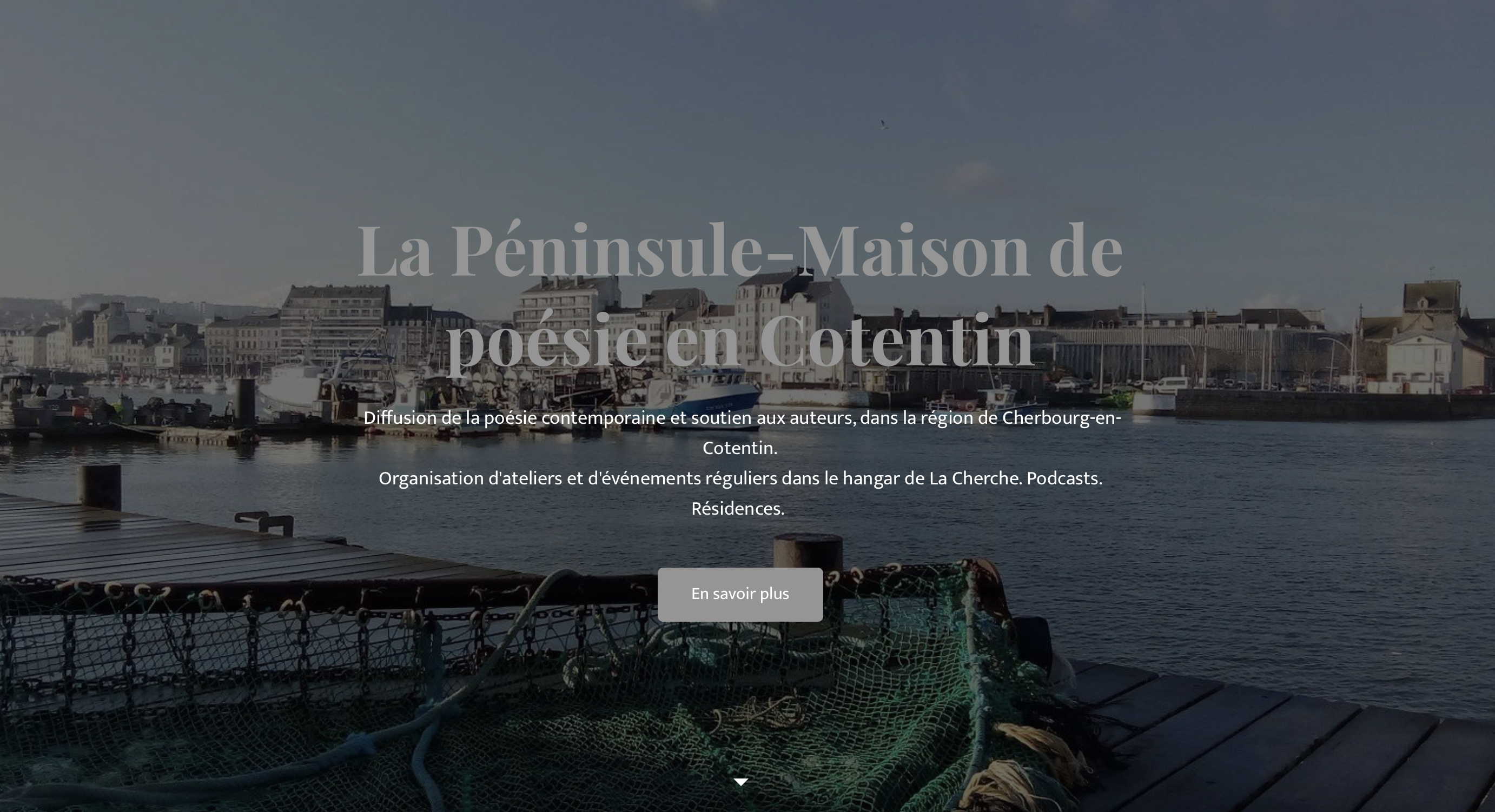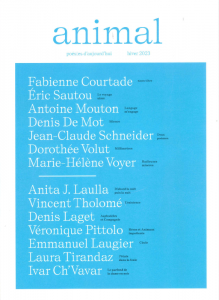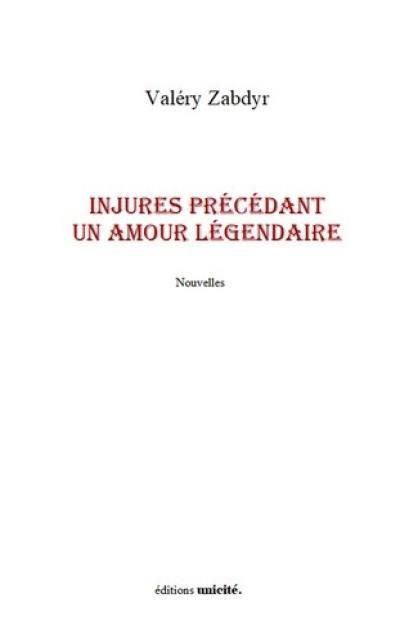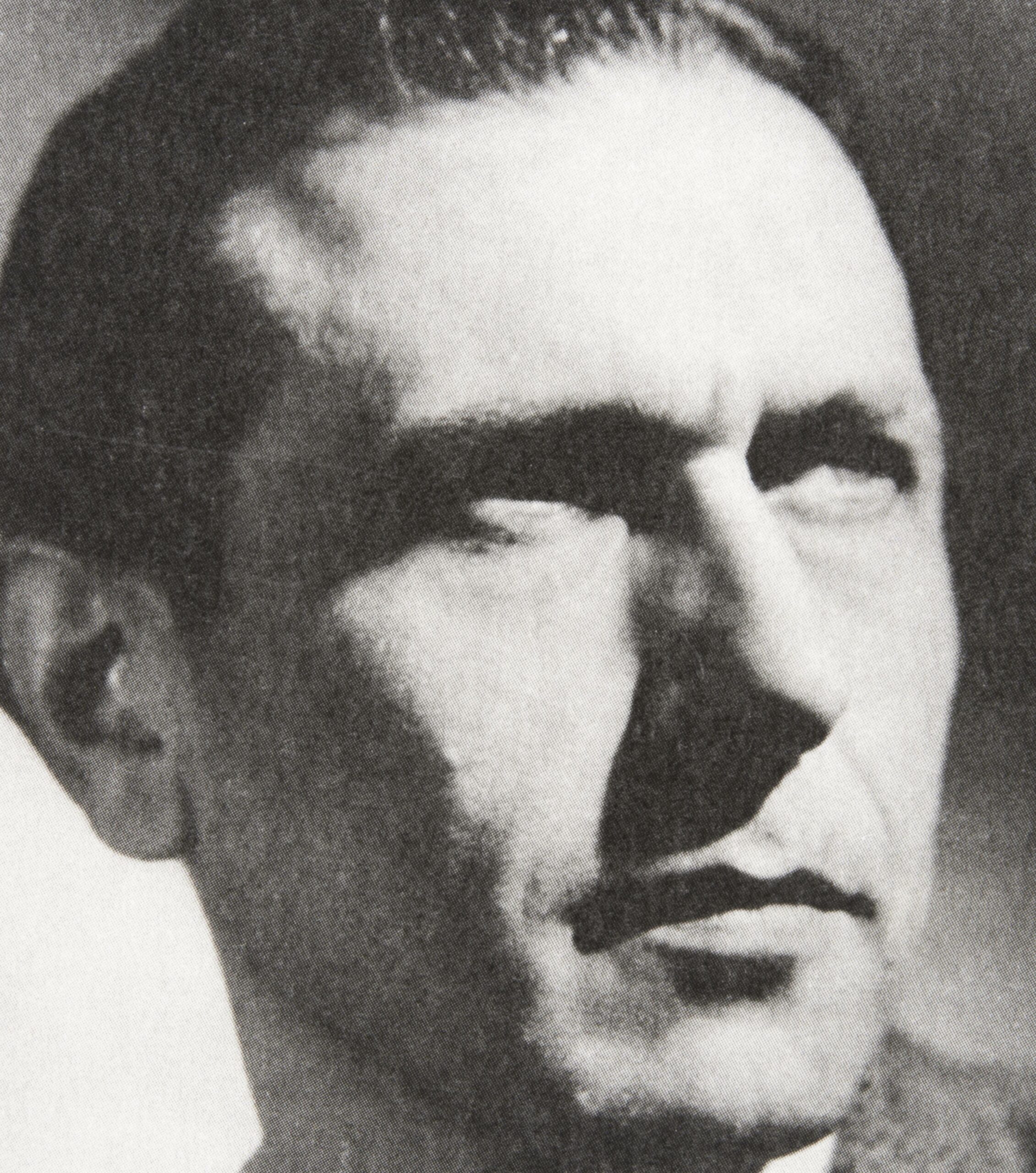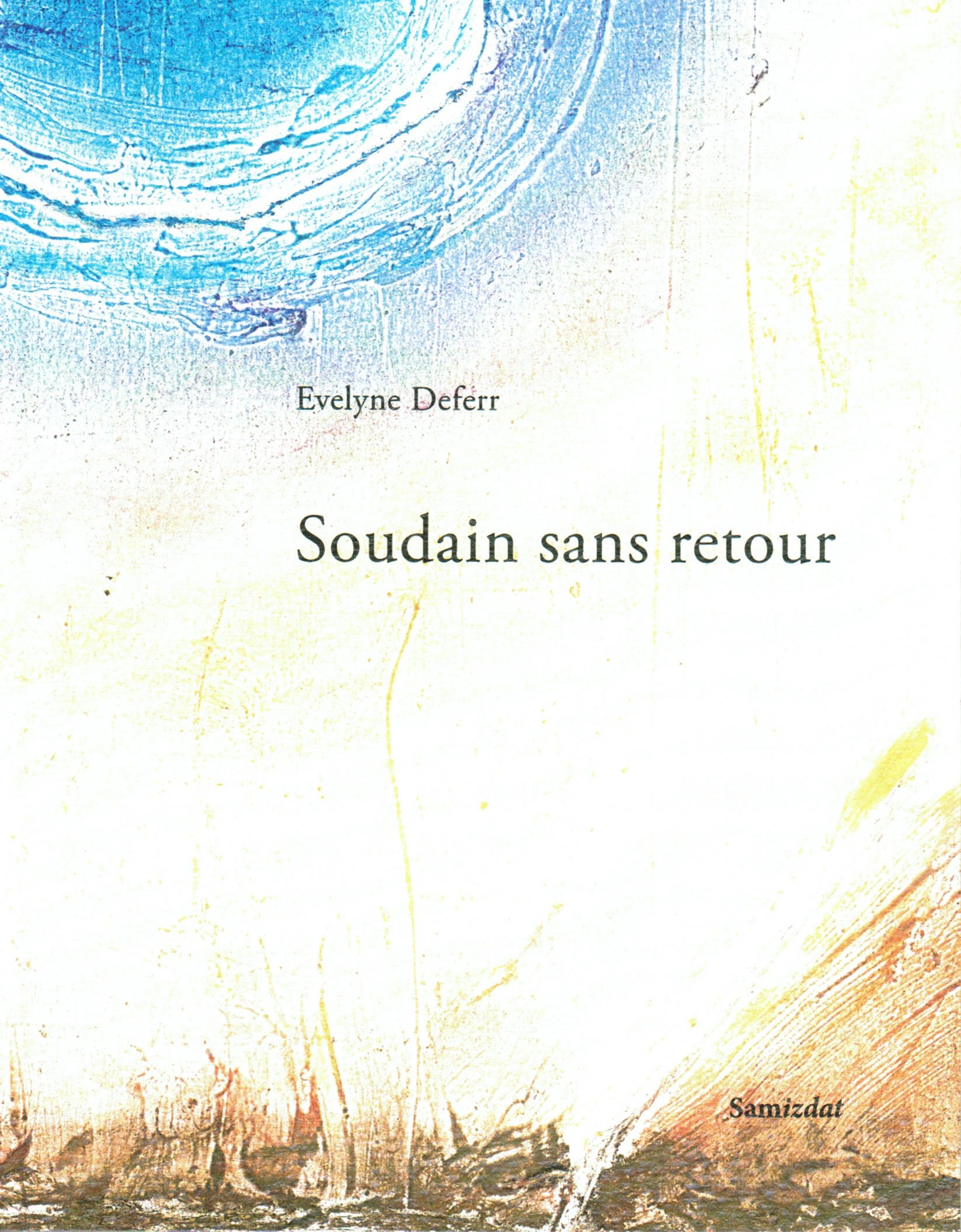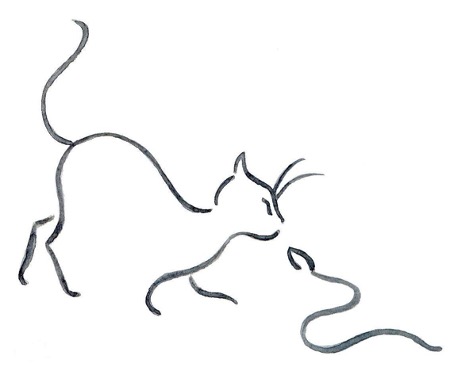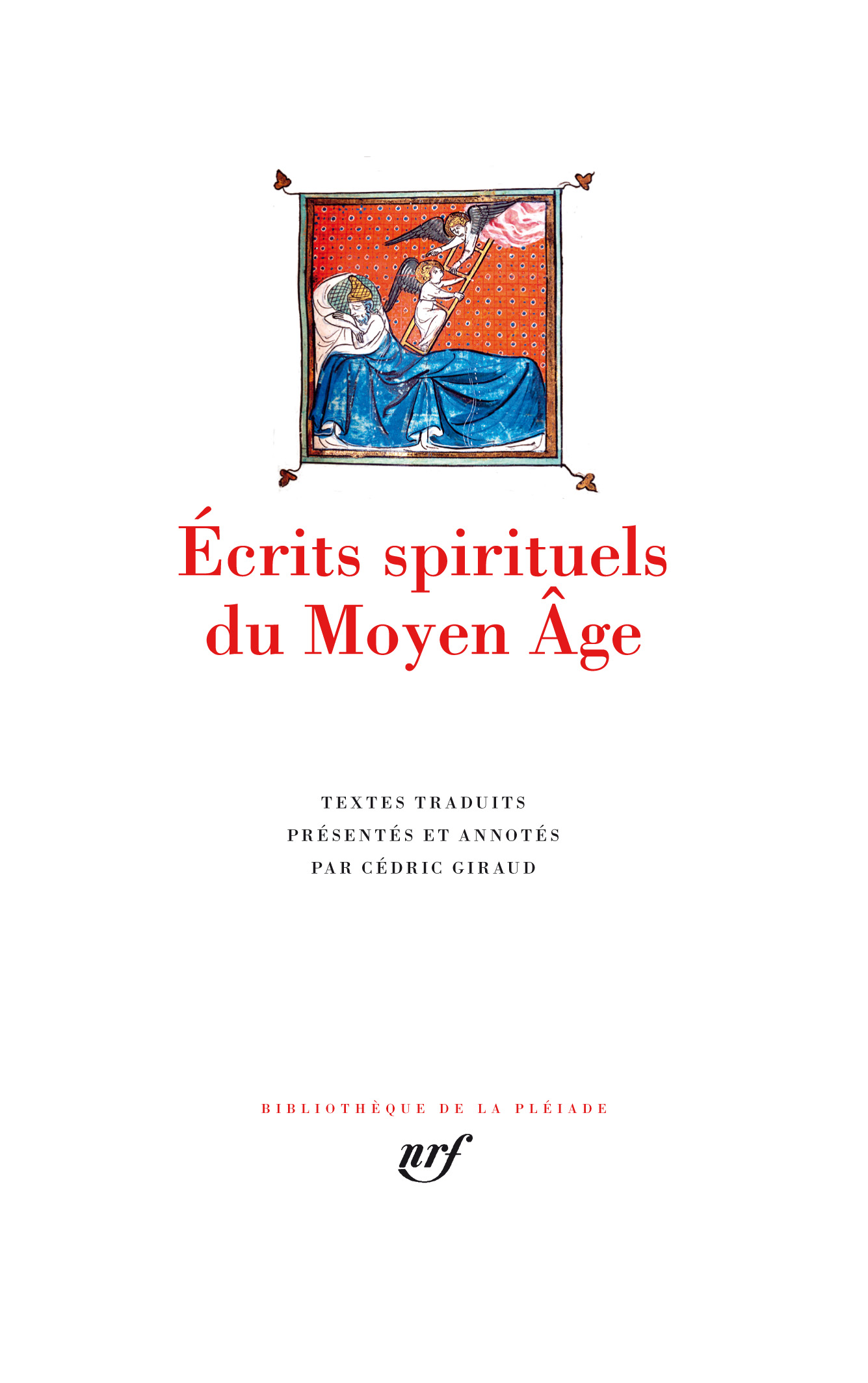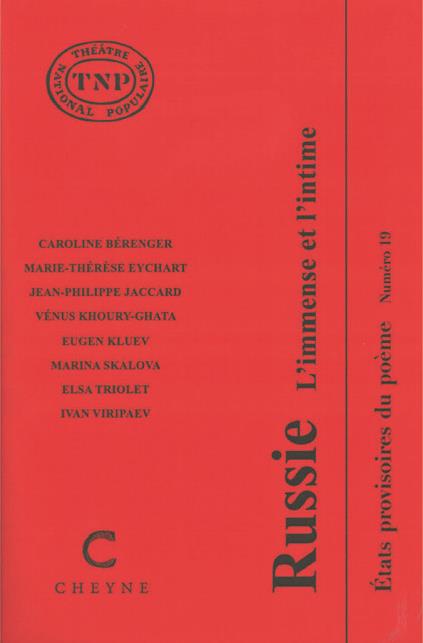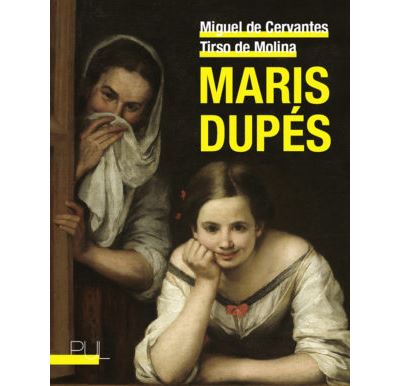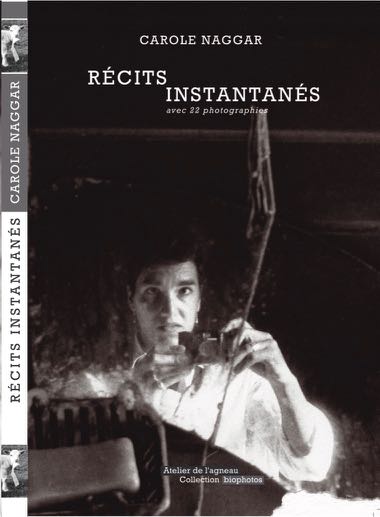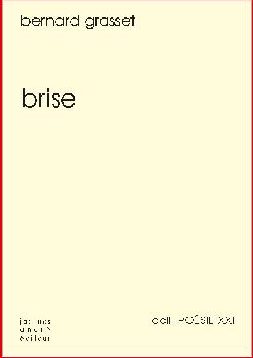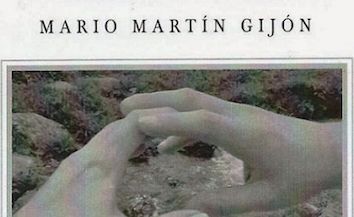Dix-neuf poètes de Bosnie sont présentés dans une traduction soignée et agréable à lire. Grâce à ce choix réduit, le nombre de poèmes varie entre 7 et 10 par auteur, ce qui permet de bien sentir la voix singulière de chacun. Toutes les générations sont présentes, ceux qui sont nés pendant la guerre et entrent juste dans la carrière, leurs parents jeunes adultes vers 1991, et ceux qui, nés vers les années 50, ont connu une vie « installée » avant les bouleversements et l’exil. Tomislav Dretar est l’un d’eux.
Même s’il définit le sublimisme balkanique par la faculté à « sublimer dans la poésie et par la poésie » la guerre qui a « traumatisé leur chair et leur imaginaire », on sent que l’oeuvre de tous ces poètes tourne autour de ce sujet… impossible… et que l’écriture nait de cette impossibilité même. Le ressentiment, les regrets, le nationalisme, le prosélytisme sont en effet absents de ces textes, mais ceux-ci n’en témoignent pas moins d’un engagement politique humaniste et, pour certains, d’une foi chaleureuse et ouverte.
Outre la maison et le chemin, un des motifs récurrents est celui du pont. Il a des résonances communes que l’on devine aisément et bien sûr des prolongements très divers selon les auteurs. Celui, très symbolique, de Mostar, Vesna Hlavacek le surplombe de nuages gris pigeon (qui) flottaient dans le ciel bleu. Mais dessous coulaient les profondeurs de la Neretva en silence / (qui) parlaient de beauté, de tristesse / chuchotaient inaudibles / sur les temps mauvais, les rires et les pleurs, / sur comment le matin resplendit en rosée de perles, … Le présent et la vie ont chez elle le dernier mot.
Mais chez Marjan Hajnal, le pont est chargé de nostalgie et donne sur un canton inintelligible :
Il est quelque part un pont étrange.
Sous la brume des souvenirs
On n’en voit pas le bout,
De l’autre et invisible rive
On ne perçoit que la résonance
De chants.
L’inintelligibilité, l’incapacité de la raison à saisir quelque chose du monde, traverse l’ensemble des oeuvres. Ainsi, dans une parenthèse de Mensur Catic, né en 1960 :
(moi je ne dis rien du tout
je ne suis pas philosophe
(…) absence de toute
pensée claire…)
Comme dans Impénétrabilité de la conscience de Tarik Jazic, né en 1991 :
Ils devenaient prisonniers des ténèbres
en quête d’une lampe.
(…) C’était tourner en rond
encore et encore…
Les figures de l’exil sont nombreuses. Pour Admiral Mahic, né en 1948, la vie a été tout entière errance. Ayant exercé des métiers manuels comme relationnels, seule la poésie est sa terre stable. « Le marteau » évoque un trajet en train vers Vienne :
Chers passagers, voilà ce que je suis : une pleine lune de Sarajevo / qui ne parle pas allemand et en bosnien je vous demande : / Pourquoi n’irions-nous pas tous boire un coup en Zambie !? / Et bien sûr, de Zambie nous pourrions chevauchant des girafes revenir à Sarajevo / déposer une couronne de fleurs des champs / sur le tombeau de la mère inconnue !
Une « prose du transsibérien » ? Mais en plus tragique, et rigolard aussi :
Dans le volcan d’où je viens nul / ne fait son travail. / Ô, marteau de la Terre, fais que je devienne citoyen / de l’Autriche. / Ô, marteau du ciel, fais que je trouve femme !
Certes, le désenchantement et l’errance n’appartiennent pas en propre à ceux qui ont connu la guerre, mais l’ensemble des auteurs donnent à ces motifs un tour très concret. Peu cérébrales, jusque dans les plus modernes, ces écritures cinglent à l’esprit du lecteur, ainsi Darko Cvijetic :
Dans les poupées sur l’étagère
Il n’y a pas d’utérus.
Comme un amas de muscles.
Cela n’est pas à toi comme
Brisé par le vertige du désert.
Quand les femmes pleurent
Toutes les césariennes fument
Sur les rafales de balles.
Tout se tait aux évocations réciproques.
Explorant ce silence, l’excavant avec ténacité, ces poètes n’en négligent pas les enjeux du temps présent. Ainsi Ferida Durakovic, dans une saisissante lamentation « à Olena, fillette sans personne », que « les mâles qui l’exploitaient » ont martyrisée jusqu’à la porte de l’hôpital où elle venait se réfugier, grave en lettres capitales un monument de révolte :
MÂLES MÂLES MÂLES
MÂLES OLENA POPIK MÂLES MÂLES
MÂLES POLITIQUE POLITIQUE OLENA
COMMERCE DES FEMMES COMMERCE
(…) MÂLES MÂLES OLENA EST OUEST NORD SUD
ISLAM CHRISTIANISME
ORTHODOXIE JUDAÏSME MÂLES MÂLES
POLITIQUE POLITIQUE POLITIQUE
COMMERCE…
Le poème et le sens de l’acte d’écrire sont remis en cause. Culpabilité, pour Ferida Durakovic : Je me sens coupable / pour ces lignes / qui involontairement me sont tombées des mains, /(…)un poème d’amour…
Marjan Hajnal, lui, se refuse à écrire des vers sur l’amour. Josip Osti, avec humour, cherche un poème : Le cherche depuis ma tendre enfance et ne trouve sous le lit qu’un billet de banque dissimulé / d’un État entre-temps effondré portant le sourire / d’un tout-puissant monarque mort depuis longtemps.
L’humour encore, mais très ambigu, dans ce « conte » de Sead Begovic où Dieu, pris de pité, fait couler l’eau dans le désert et offre au fidèle et pieux calligraphe une nouvelle contrée heureuse (qu’Il a) couverte du jardin luxuriant de la séductrice pensée de Satan.
Ce choix réunit des gloires littéraires et des jeunes gens peu connus que Tomislav Dretar « apprécie tout autant ». Sa subjectivité de bon aloi donne une vision diverse et cohérente de cet ancien peuple en construction.