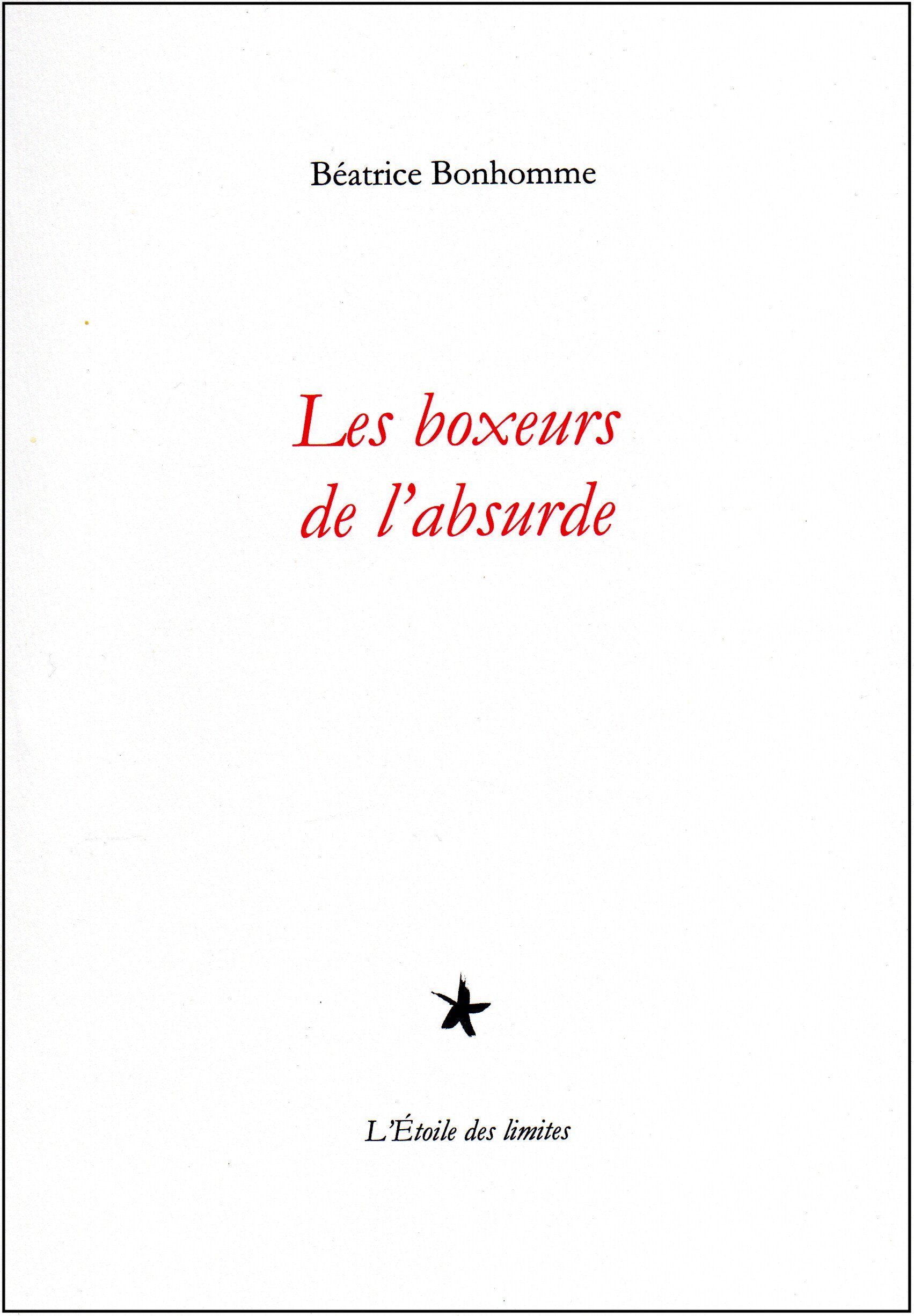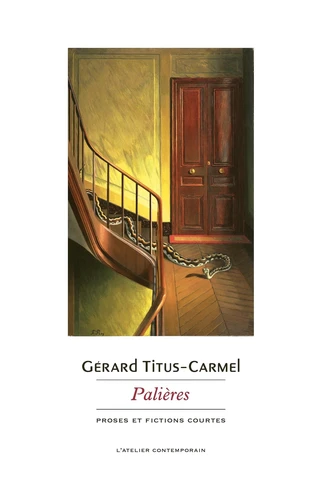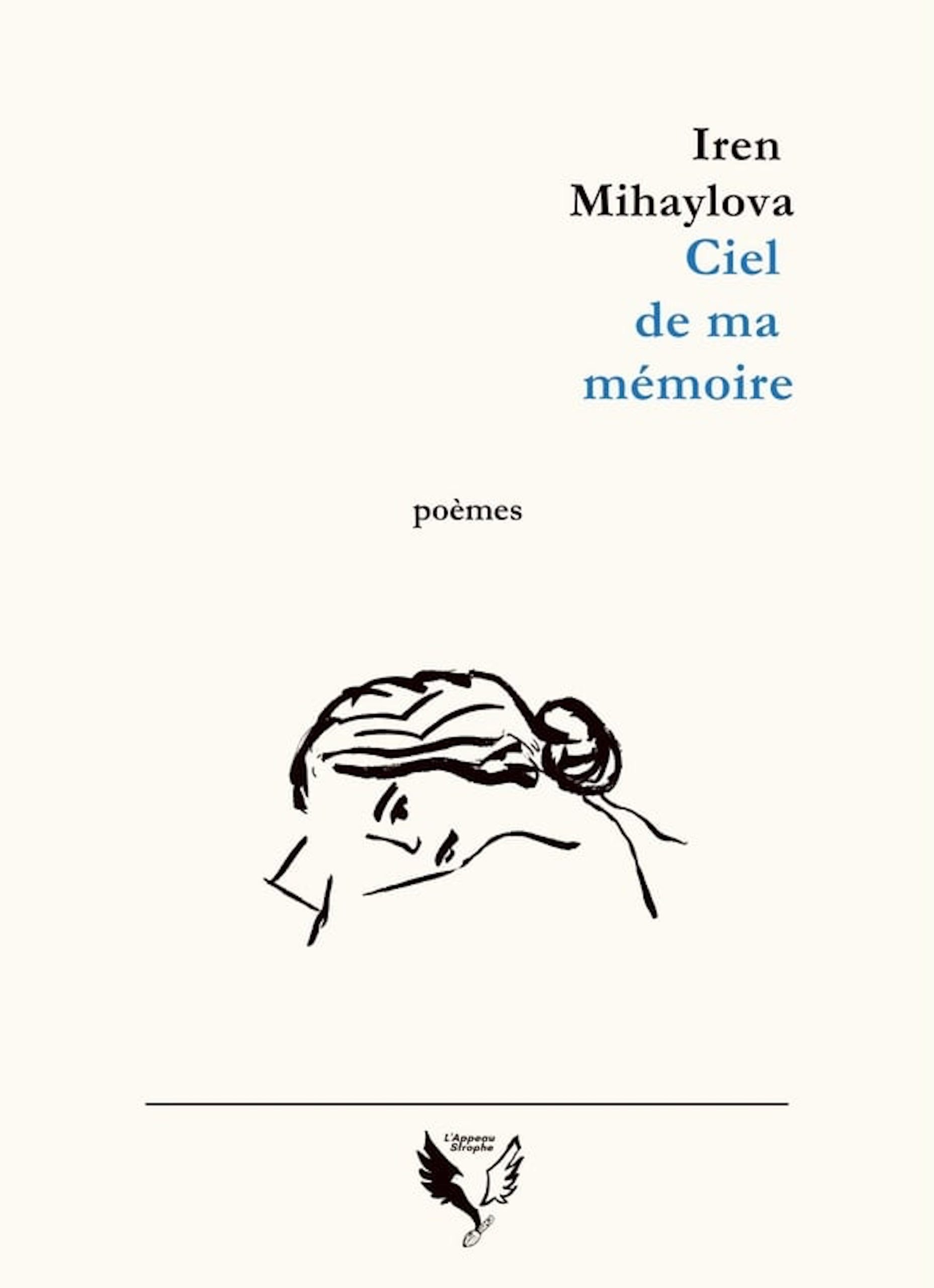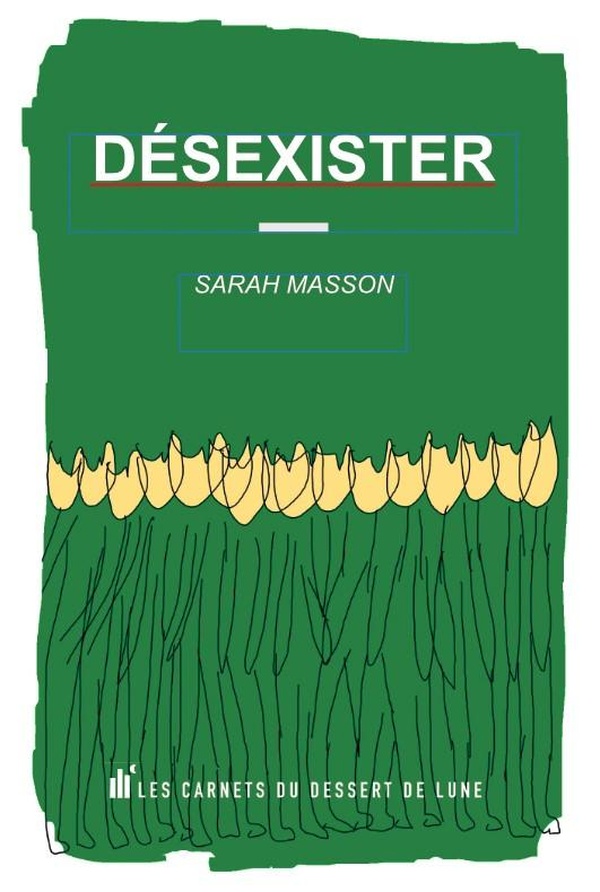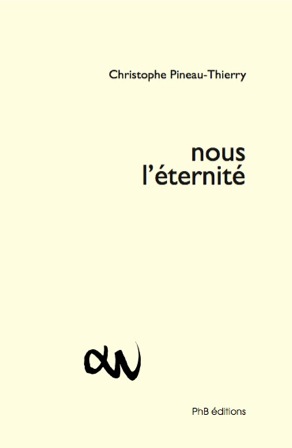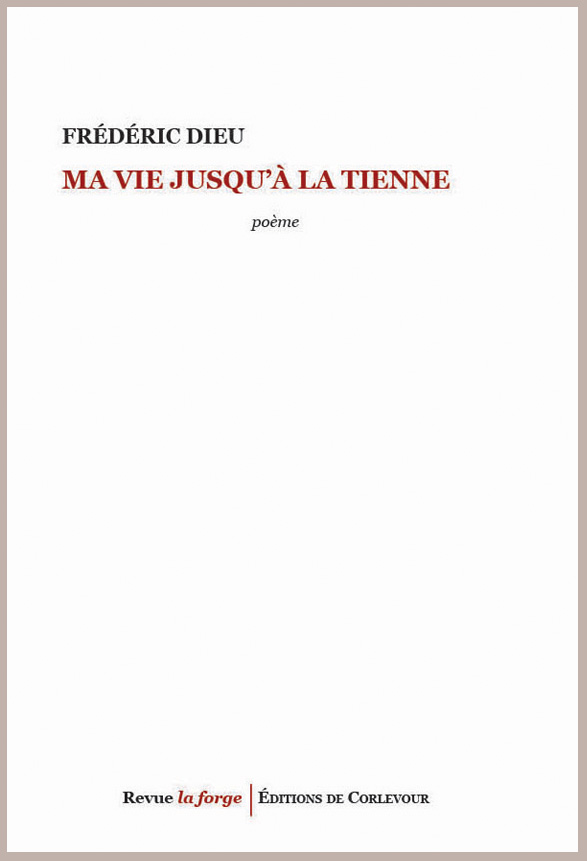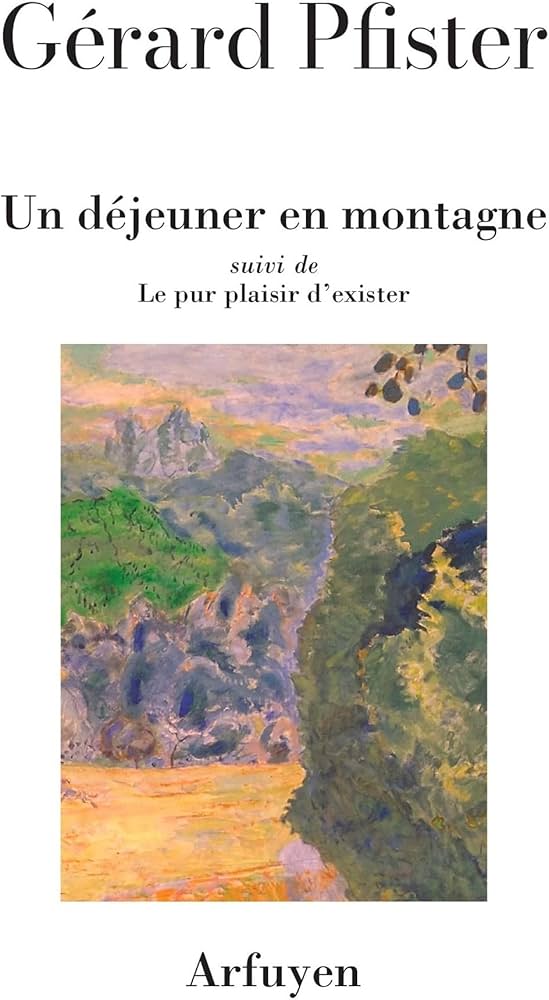La lecture d’un recueil de poésie est aussi un voyage dans sa vie intérieure par les sens, les formes, émotions, rêves, croyances, etc., mais un voyage à deux, avec un compagnon, rangé dans la catégorie des « fous » ou « des sorcières », que « la tradition yiddish dépeint sous les traits du shlemiel » (p. 9). C’est de cela dont je veux rendre compte à partir du dernier recueil de Cécile A. Holban.
Elle nous invite à six échappées en compagnie de vieux marins. Par ordre d’apparition, avec un certain Robert W[alser] qui stationne à Heriseau en 1956, avec Franz K[afka], à Prague en 1921, Mikhaïl B[oulgakov] à Moscou en 1938, Fernando P[essoa] à Lisbonne en 1916, Samuel B[eckett] à Paris en 1974, et Jorge Luis B[orges] à Buenos Aires en 1946. Chacun témoigne des « impossibles fiançailles de la réalité du monde et de la réalité » (p. 47).
Avant d’embarquer, quelques poèmes préliminaires nous familiarisent avec le mouvement de houle du recueil. Peu à peu, nous nous détachons du quai de notre existence. Le monde est désormais liquide. Les formes s’indistinctent : maisons ou navires affrontent la même vague. Écoutons un extrait : « Lorsque je marche / je suis loin déjà / Le sommeil aussi abandonne le monde » (p. 20). Premier effet de lecture : ne suis-je pas dans la vie comme dans mon sommeil (bien lire sommeil et non pas rêve), détaché du monde ? Deuxième effet : le verbe abandonner marque une séparation sans effort et sans perception claire de son début et de sa fin, une sorte de détachement par oubli. La suite du poème explique si ce n’est le pourquoi de la marche, du moins son effet constaté : « Lorsque je marche, mon visage s’ouvre » (p. 20). Cette marche se veut salutaire.
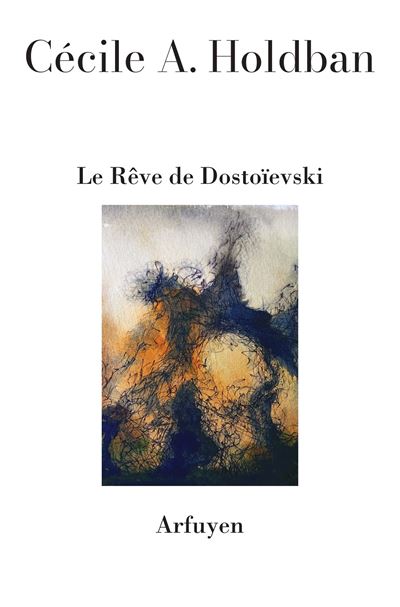
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski, Arfuyen, 2025, 176 pages, 16 €.
Nous venons d’embarquer dans l’esquif alpin de Walser. Lui aussi nous dit : « je dois marcher, je dois cartographier ce territoire du crayon. C’est le seul moyen que j’ai trouvé pour dénouer l’étreinte du monde, pour tenir à distance les voix des autres que je ne comprends pas. Ces montagnes m’offrent un repli. Ici je reprends confiance. Ici, je sais ce qui est beau. Ici, la vie est une promenade » (p. 29). Avec Walser, le monde se défait de ce qui est pesant et qu’on ne peut comprendre. Il ne garde que ce dont nous avons besoin : la légèreté de notre corps. Car c’est cela reprendre confiance : être léger. Dans cette nouvelle disposition, le monde vibre et se meut derrière le silence : « Parfois on se dit / qu’il y a derrière tout cela / l’énorme rire d’une nuit / surprise de sa béance » (p. 40). À la frontière entre monde et béance, se tiennent deux corneilles. « Elles paraissent sorties / du jardin des délices ». D’un côté, elles découvrent « les vagues de l’herbe nouvelle », de l’autre, « les racines à nu de l’univers » (p. 45).
Montons à présent dans l’esquif de Kafka, cet homme qui rédige « ces rapports d’assurance » (p. 49). Lui aussi, avec Cristina Campo, nous parle de deux mondes : celui-ci et « un autre tout proche » (p. 49). C’est pourquoi on guette « la matière des anges (celle qu’on attend) », celle qui fera se souvenir de « ce long chant étrange, façonné / dans la matière même de la pluie » (p. 52). On baignera nos yeux dans « l’eau de voir » (p. 55), celle à travers laquelle « tout à un sens » (p. 56). On entendra « les rires de voix inconnues » (p. 56), venus de « l’autre versant du sommeil » (p. 57). Il y a tant à partager depuis cette vision : « Comme ce matin est doux et vêtu simplement / du parfum du pain, de petites lueurs / et comme la table est lisse » (p. 75).
Avec Pessoa, l’aujourd’hui est une béance, « il n’est l’heure de rien » (p. 89). Il faut alors partir au loin, « faire voile, faire vent, / nous partons / l’arbre, sans nous, / s’endort / Sphinx clos / sur l’os de sa question » (p. 91). Un tu se profile dans les vers. Il se tient sur « la passerelle / sur la guerre du vide, / les yeux ouverts » (p. 93). Il est interpelé : « ta main fabrique / sa propre clarté » (p. 96) tandis que « la maison vogue » (p. 97), que « la neige tant attendue / ne vient pas alléger le monde » (p. 105). Pourtant, « écoute / par petites touches / le temps s’épaissit » (p. 109). Suivent quelques poèmes sur la nuit, « nous la prenons branche après branche / et la tressons en heures ». Un hors soi apparaît et je peux le rejoindre grâce à « une nuit de très profonde solitude / [où] mon cœur au bord des lèvres / chute hors de son lieu » (p. 119). Alors « je vis enfin / hors de moi » (p. 120), « nourrisson vagissant / mains crispées sur l’absence / je suis là, je suis né. » (p. 120–121).
Mais déjà nous quittons Pessoa et voyons apparaître le matelot Beckett penché sur un caillou, dans un poème dédié à Jean-François Mathé, « (Ô Molloy !) » (p. 122). On s’interroge alors sur la vie des pierres qui ont besoin de libellules pour que leur intérieur se fasse transparent. À bien les observer, on apprend que « toutes les pierres ont un visage », sachant que, lui-même, « le visage est un fleuve / plus ou moins tumultueux » (p. 126).
Une fois à bord de l’esquif de Beckett, les poèmes ressemblent à des « figures de la terre vues de l’intérieur » (p. 135), avec des mots fourchus et cornus. Par eux, la langue ne vise pas à converser. Elle doit d’abord être accouchée par la pluie puisqu’elle brille comme de l’eau. Ainsi, il nous est rappelé que la langue est d’abord un élément naturel, un parmi d’autres. Vient ensuite un poème sur Pâques. Il nous montre combien notre monde « est tout bas ». Il est suivi d’un court poème, Rameau (p.139–141), au singulier, suppliante prière à l’immanence telle qu’elle se devine au pied d’un candélabre.
Avec le dernier, marin du recueil, Borges, le voyage fait voile avec Ulysse, dont « l’œil est un périscope » (p. 145). Nous sommes en haute mer, au milieu « des vaisseaux et des traînes de pieuvres » (p. 147). De retour sur terre, on trouve toutes sortes d’ex-voto. Avec eux, la mémoire et la ruine antiques nous attirent, car d’elles « nous attendons un signe » (p. 157). Nous fascine aussi la force des fleurs, avec leurs pétales « charriant dans un même élan / des flots de pollen et d’ordures » (p. 161) ; celles aussi des ruisseaux et du mimosa aux « mille yeux clairs / qui clignent dans l’obscurité » (p. 163), ou celle des bourgeons qui sont « entre tes veines et le soleil » (p. 164).
Ces six voyages viennent de s’achever. Qu’avons-nous fait ? « Là / où nous pensions / nous déplacer / d’un lieu à un autre / nous n’avons fait / que traverser le temps » (p. 167). Puis, au cours de ces voyages, nous avons côtoyé de grandes puissances invitantes. Cécile nous les fait approcher en nous chantant un de leurs thèmes. Elle nous redonne goût au grand large, à faire voile avec ces grands anciens. Ils nous sont devenus nécessaires plus que jamais. Pourquoi ? J’en sais rien. Je le constate. Pareillement en musique, bien des compositeurs contemporains en appellent eux aussi à des grandes figures du passé, dont ils retravaillent les œuvres. Pourquoi ? Peut-être parce que, depuis leur ombre, ils y trouvent à neuf la lumière sonore que nous cherchons. Ou peut-être, pour reprendre une phrase de l’introduction, parce qu’ils découvrent dans la folie de leur œuvre cette « forme supérieure de liberté » qui tient « la ligne de crête entre la joie et l’inquiétude. » (p. 9). Le Rêve de Dostoïevski, parmi la soixantaine d’ouvrages lus cette année, est sans doute possible un des trois meilleurs. La beauté et la force du vers de Cécile A. Holban vous captivent, et cela ne s’oublie pas.
Présentation de l’auteur
- Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski - 6 janvier 2026
- Yves di Manno, Terre sienne - 6 novembre 2025
- Possibles, N°34, décembre 2024 - 6 mai 2025
- Les Hommes sans épaules, numéro 58 : Daniel Varoujan - 6 mars 2025
- La forge #4, octobre 2024 - 6 mars 2025
- Arpa, numéro 145–146, 2024 - 6 mars 2025
- Estelle Fenzi, Le goût des merveilles - 20 novembre 2024
- Les Hommes sans épaules, numéro 57 : Poètes breton pour une baie tellurique - 6 novembre 2024
- Arpa, numéro 144, juin 2024 - 6 novembre 2024
- Possibles, numéro 33, septembre 2024, Carnet II - 6 novembre 2024