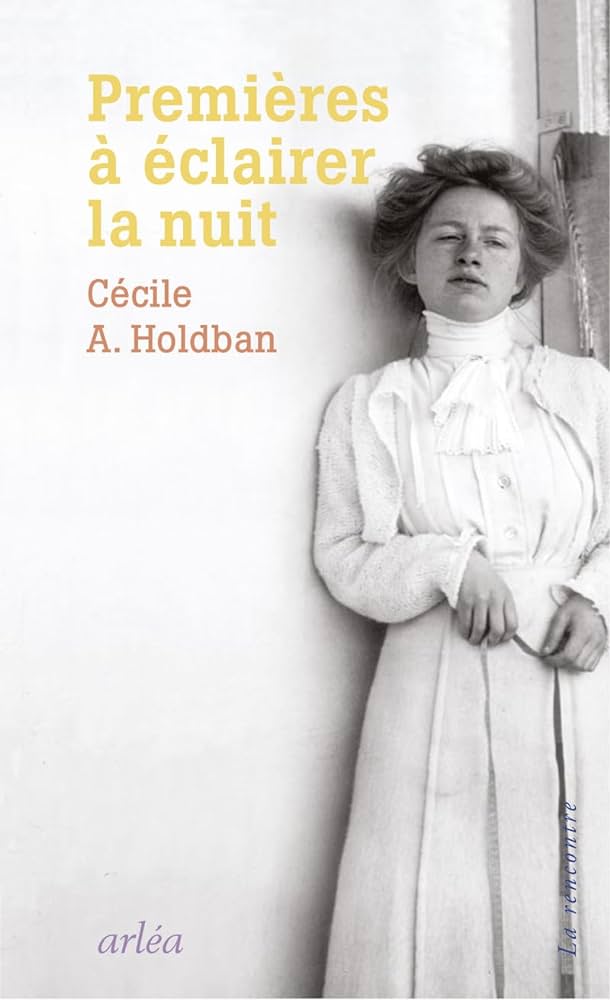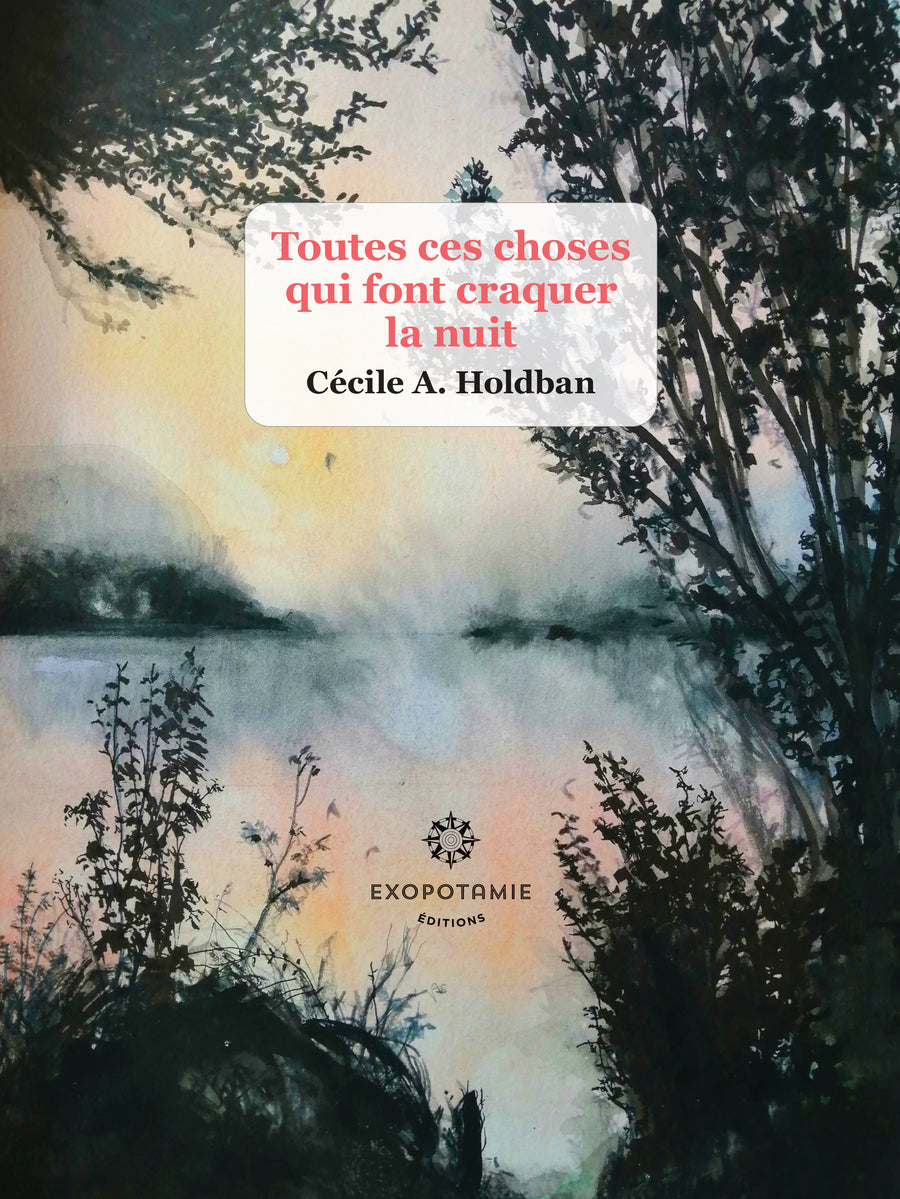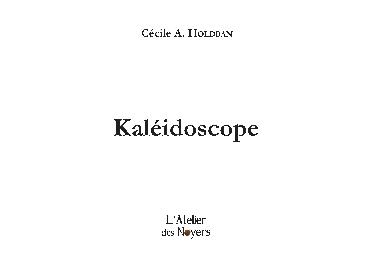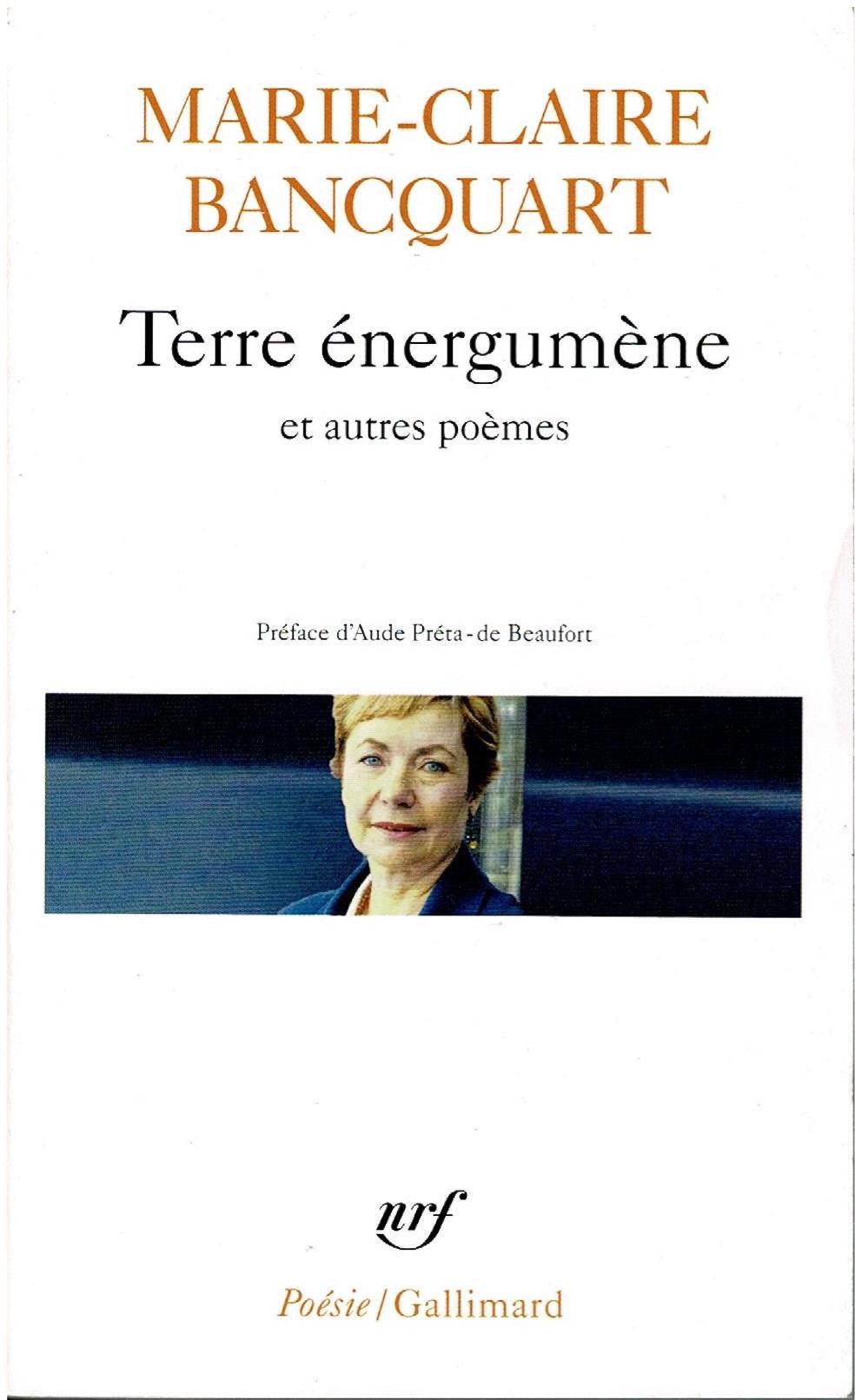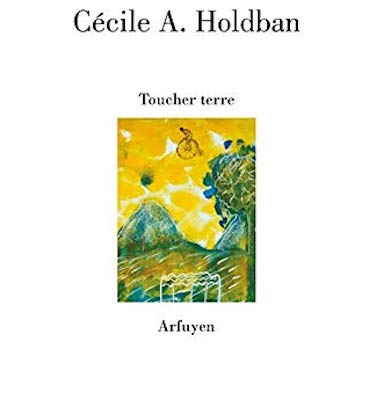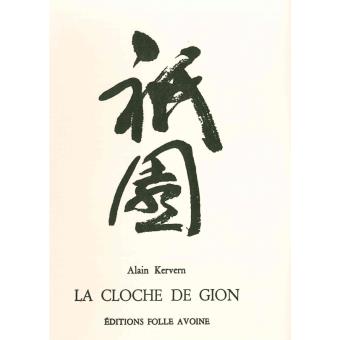Coup d’oeil sur deux collections des éditions Arfuyen : la collection Ainsi parlait et Les Cahiers d’Arfuyen. Dans la première vient de paraître un volume consacré à Novalis, dans la seconde, deux recueils de poèmes, l’un dû à Marie-Claire Bancquart, l’autre à Cécile A Holdban…
*
Ainsi parlait Novalis (choix de Jean et Marie Moncelon)
Novalis : sa vie est une légende, il est mort à 29 ans, en pleine jeunesse. Je ne l’ai jamais lu mais je l’ai découvert dans les œuvres de Pierre Garnier qui, fin connaisseur de la littérature allemande, ne manquait pas de se référer aux grains de pollen ou à la fleur bleue tant dans sa poésie spatiale que dans ses poèmes linéaires. La publication de “Ainsi parlait Novalis” (en édition bilingue) est une bonne occasion de (re)lire ce poète et philosophe pour le découvrir dans toute sa complexité. Il faut affirmer d’emblée que le concept de fleur bleue n’a rien à voir avec la bluette qu’il est devenu de nos jours mais serait plutôt l’articulation de la réalité et de la symbolique, pour dire les choses vite. Il faut donc remercier les auteurs d’avoir accordé la préférence aux fragments philosophiques (et non aux poèmes) qui expriment parfaitement la volonté de transformer pratiquement le monde. Il n’est donc pas étonnant que le philosophe marxiste Georg Lukacs lui ait consacré un essai, “Novalis et la philosophie romantique de la vie” dont j’extrais cette citation : “… il interrogeait la vie et c’est la mort qui lui a répondu”. Mais il ne faut pas simplifier la pensée de Novalis car, finalement, ce que dit ce dernier quand il affirme que “le monde doit être romantisé” (p 31), c’est la prééminence de la contradiction.
Mais si Novalis semble avoir retenu la leçon de Boileau, dans son Art Poétique (“Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. / Et les mots pour le dire arrivent aisément”), ici il dit “L’expression juste rend l’idée claire. Dès que l’on possède les noms exacts, on a les idées. Expression transparente, directrice” (p 37). Je relève aussi le volontarisme de Novalis : “La vie doit être non un roman qui nous est donné, mais un roman que nous faisons nous-mêmes” (p 41). Certes, c’est la présentation d’une pensée en fragments qui rend possible ma lecture : je ne retiens d’un fragment que ce qui me parle, en bien ou en mal ; mais Novalis semble avoir répondu d’avance à ma remarque (cf p 47/2)… Je ne suis pas un fanatique du rejet de ce que je lis mais force m’est de constater que ce choix de fragments ne me convient pas… Ou que j’ai été marqué plus que je ne le pense par Pierre Garnier et son usage des concepts de Novalis : me sont étrangers ces propos où Novalis parle de Dieu, de philosophie ou d’autre chose… Mais je suis sensible à ce qu’il écrit à propos de l’amour, j’y reconnais même son amour pour Sophie (p 71/1). Sensible aussi à ce qu’il dit des commerçants de son époque (je ne suis pas loin de penser que nos commerçants actuels, quelle que soit leur taille, ne sont que des boutiquiers !). Il y aurait encore à relever chez Novalis le goût du paradoxe, celui de la tautologie… ou encore cette propension qu’il possède à proférer des sentences brèves qui sont de purs joyaux de poésie comme : “L’eau est une flamme mouillée” (p 115/1).
Peut-être finalement faut-il picorer de-ci de-là dans cet ouvrage et aller voir de près ensuite dans les œuvres complètes de Novalis ? Mais en aurai-je le temps ?
*
Marie-Claire Bancquart, “Tracé du vivant”
Quatre suites de poèmes très libres constituent ce recueil. La première (“Toute minute est première”) commence par ce vers : “Je ne crois pas au ciel” ; voilà qui est dit. Comme Marie-Claire Bancquart ne croit pas non plus à une écriture de femmes. De fait, dans ces poèmes, elle dit l’adhésion au monde au moment où elle écrit (ce qui fait la simplicité de cette écriture poétique) et ce n’est pas un hasard si la première suite est traversée de chats et de chiens car il me semble qu’ils symbolisent bien la “chasse royale au bonheur” : “Petites fatigues prises en compte / mains sur le pelage du chat / tiède, tiède,”. C’est que malgré (ou grâce à) la maladie rencontrée dans son enfance, Marie-Claire Bancquart goûte au plaisir de vivre : “… je partage avec eux [la chatte, le bourdon] une place sur terre, un instant très bref dans les millénaires”. Rien de plus, rien de moins que cette place, que cet instant pour faire le bonheur : surtout pas l’horrible prétention de partager la vie de la chatte ou du bourdon… Dans la deuxième suite, “Le cri peut être tendre, aussi”, Marie-Claire Bancquart relève l’éphémère mais pour autant elle n’est pas insensible aux misères de l’univers. C’est qu’elle est attentive à “l’incertitude de la vie” tout en la célébrant : “- L’odeur / et l’idée que / le monde tout entier / restera peut-être ocre clair, été sucré, abeille”. Ce peut-être permet à Marie-Claire Bancquart d’éviter la naïveté… La troisième suite, “En célébration du vivant”, est paradoxalement la plus sombre car la conscience de la fugacité des choses étreint Marie-Claire Bancquart : “Dans l’extrême nous retrouvons / la soupe d’origine, où tressaillaient vaguement des cellules”. Signe que la poésie n’ignore pas les avancées de la science. Enfin, dans la dernière suite, “Au grand lit du monde”, éclate à nouveau la conscience de l’humaine finitude. Mais Marie-Claire Bancquart dit les choses sur le mode de l’euphémisme : “Alors je nous sens provisoires”. Le ton se fait plus grave mais avec une certaine légèreté : “La vieille femme dit à Phèdre : / Nous aimons l’existence / parce que d’une autre, nul / n’est jamais revenu pour donner nouvelle”. Mais, car il y a un mais, le goût de vivre (c’est ce que dit à sa manière le tercet suivant) se mesure aux petits plaisirs de l’existence comme la lumière ou la douceur d’une orange. Et le syncrétisme de l’avant-dernier poème peut se lire comme un chant d’amour ou une leçon de sagesse…
Je parlais plus haut de la simplicité de l’écriture de Marie-Claire Bancquart. Il m’en faut dire quelques mots. Celle-ci sait isoler un adjectif qualificatif (par exemple) pour le mettre en relief : il constitue alors un vers et ce n’est jamais gratuit. Le poème se fait parfois aphorisme, comme à la page 39. La ponctuation est précise et c’est rare en ces temps. La leçon du passé n’est pas oubliée : c’est ainsi qu’on peut lire (p 64) , “Plutôt que d’écrire sur toi / je te silence” : on pense alors à Henri Pichette et c’est bien… “Tracé du vivant” est à lire de toute urgence.
*
Cécile A. Holdban, “Poèmes d’après” suivi de “La Route de sel”
Osons une hypothèse : et si Dieu n’était qu’une invention de l’Homme ? Puisque “C’était une période où Dieu se taisait” et que “des langues de haillons captives / se taisent dans la nasse des bouches”… C’est du moins ainsi que je lis, au risque de me tromper, ces poèmes. Et ce ne sont pas les textes des poètes traduits par Cécile A Holdban qui viendront contredire cette première impression : je lis plutôt dans ce recueil un mysticisme sans dieu, une inquiétude “dans le sombre des rues” où “quelque chose bondit” qui n’est pas nommé (p 24). Peut-être la clé du livre se trouve-t-elle à la page 34 : Cécile A Holdban écrirait alors une poésie tantôt suave, tantôt sombre pour conjurer le fait d’avoir quitté son pays d’origine et d’être née à l’étranger ? Toute la deuxième suite met en scène “la petite fille”. Mais la patience d’exister pourra-t-elle mûrir ? La “Prière aux arbres” (p 51) semble indiquer que Cécile A Holdban est à la recherche de ses racines… Le troisième chapitre de “Poèmes d’après” est un chant d’amour et d’espoir. Cela ne va pas sans une certaine obscurité : “Tu révèles, silence, / l’univers fondé sur tes mains” (p 62). Ce qui n’empêche pas une attention extrême aux mots, à la langue : “Tu es langue en ce paysage, sa langue, son voyage” (p 75) ou “ces mots qui jamais ne te ressemblent” (p 69).
“La Route de sel” est un chant qui s’élève à la gloire d’un pays. On pense bien sûr à la mythique route de la soie mais ici il ne s’agit que (?) de la route de sel qui ouvre la porte à toutes les interprétations possibles. Cécile A Holdban a beaucoup voyagé : je ne sais pas si elle a parcouru la Nouvelle-Zélande mais ce dont je suis sûr, c’est qu’elle dédie “La Route de sel” à Emilia, un hétéronyme. Ce qui montre la complexité de la pensée de Cécile Holdban, une pensée qui bouge sans cesse. Mais, il faut l’avouer : je me heurte à un mur quand je lis Cécile A Holdban ; suis-je un piètre lecteur ? Ne suis-je pas suffisamment réceptif ? Je remarque bien la présence des oiseaux dans ses poèmes mais je ne sais qu’en penser. C’est là la limite de ma lecture et je l’assume. Mais je lirai avec intérêt et curiosité ses prochains recueils…
*
En librairie, Arfuyen est diffusé par SOFÉDIS et distribué par SODIS. D’autres collections existent qui font d’Arfuyen un éditeur spécialisé dans la spiritualité au sens large, mais pas exclusivement. Si une large place est faite à la création littéraire (et singulièrement à la poésie) cet éditeur, du fait de son implantation à Orbey (68), s’intéresse aussi à l’Alsace et à ce qui s’y écrit…
- Le rôle de la documentation dans Les Communistes de Louis Aragon - 20 février 2022
- Julien Blaine, Carnets de voyages - 5 juillet 2021
- Eve Lerner, Partout et même dans les livres - 21 février 2021
- Revue Cabaret n° 29 et 30 - 5 janvier 2021
- Frédéric Tison, La Table d’attente - 5 janvier 2021
- Eve Lerner, Partout et même dans les livres - 6 octobre 2020
- Louis BERTHOLOM, Au milieu de tout - 6 juin 2020
- Christian Monginot, Après les jours, Véronique Wautier, Continuo, Fabien Abrassart, Si je t’oublie - 6 avril 2020
- Autour de Christine Girard, Louis Dubost et Jean-François Mathé - 6 mars 2020
- Stéphane Sangral, Des dalles posées sur rien, Pierre Dhainaut, Après - 26 février 2020
- Patrick LAUPIN, Le Rien qui précède - 21 janvier 2020
- Pierre Dhainaut, Transferts de souffles - 20 décembre 2019
- Jean MAISON, A‑Eden - 21 novembre 2019
- Jean ESPONDE, A la recherche de Lucy - 6 novembre 2019
- Edith Azam & Bernard Noël : Retours de langue - 14 octobre 2019
- Béatrice Libert, Battre l’immense - 25 septembre 2019
- Les Hommes Sans Epaules n° 47 (1° semestre 2019). - 15 septembre 2019
- Béatrice Marchal et Richard Rognet, Richard Jeffries, Olivier Domerg - 4 juin 2019
- Autour de Jean-Claude Leroy, Olivier Deschizeaux, Alain Breton - 29 mars 2019
- Fil autour de Claudine Bohi, Yann Dupont, Françoise Le Bouar, Didier Jourdren - 3 mars 2019
- François Xavier, Jean Grenier, Gilles Mentré - 3 janvier 2019
- Claire Audhuy, J’aurais préféré que nous fassions obscurité ensemble - 5 octobre 2018
- Trois écritures de femmes - 3 juin 2018
- Brigitte Gyr,Le vide notre demeure - 5 mai 2018
- Eugène Ostashevsky, Le Pirate Qui Ne Connaît Pas La Valeur De Pi - 5 mai 2018
- Actualité de La Rumeur Libre - 5 mai 2018
- Michel Dvorak, Vers le cœur lointain - 5 mai 2018
- Ainsi parlait THOREAU… - 6 avril 2018
- Nicolas VARGAS, EMOVERE - 6 avril 2018
- Patrice BÉGHAIN, Poètes à Lyon au 20e siècle - 6 avril 2018
- DIÉRÈSE n° 70 : Saluer la Beauté - 1 mars 2018
- Du Cloître à la Place publique - 1 mars 2018
- Serge Núñez Tolin La vie où vivre - 26 janvier 2018
- Jean-François Bory, Terminal Language - 26 janvier 2018
- Gérard Pfister, Ce que dit le Centaure - 26 janvier 2018
- Éric Chassefière, Le peu qui reste d’ici - 26 janvier 2018
- Éric Chassefière, La présence simple des choses - 26 janvier 2018
- Claude Albarède, Le Dehors Intime - 29 novembre 2017
- Stéphane Sangral, Circonvolutions - 27 novembre 2017
- Horia Badescu, Le poème va pieds nus - 27 novembre 2017
- Jeanpyer Poëls, Aïeul - 26 novembre 2017
- Alain Dantinne, Précis d’incertitude - 26 novembre 2017
- Gérard Bocholier, Les Étreintes Invisibles - 22 novembre 2017
- Marc Dugardin, Lettre en abyme - 19 octobre 2017
- Christian Viguié, Limites - 19 octobre 2017
- Geneviève Raphanel, Temps d’ici et de là-bas - 19 octobre 2017
- Eric Brogniet, Sahariennes suivi de Célébration de la lumière - 19 octobre 2017
- Laurent Albarracin, Cela - 7 octobre 2017
- Place de la Sorbonne n° 7 - 2 octobre 2017
- Chiendents n° 118, consacré à Marie-Josée CHRISTIEN - 30 septembre 2017
- Fil de lecture : autour des Éditions L’Herbe qui Tremble - 30 septembre 2017
- CHIENDENTS n° 109, consacré à Alain MARC. - 2 septembre 2017
- Fil de lecture autour d’Henri MESCHONNIC, de Rocio DURAN-BARBA, de Marianne WALTER et de Joyce LUSSU - 2 septembre 2017
- Tombeau de Jointure (100) - 31 mai 2017
- POSSIBLES, et INFINIE GÉO-LOCALISATION DU DOUTE n° 2 & 3 - 31 mai 2017
- La nouvelle poésie mexicaine - 24 mai 2017
- Fil de lecture de Lucien WASSELIN - 19 mai 2017
- Actualité éditoriale de Sylvestre Clancier - 30 avril 2017
- Un éditeur et ses auteurs : les Éditions Arfuyen, avec NOVALIS, Marie-Claire BANCQUART, Cécile A. HOLDBAN. - 24 avril 2017
- Diérèse 68 et 69 - 24 mars 2017
- Un éditeur et ses auteurs : L’HERBE QUI TREMBLE avec Isabelle Levesque, André Doms, Pierre Dhainaut, Horia Badescu, Christian Monginot. - 21 février 2017
- Fil de lecture autour de Michel DEGUY, Patricia COTTRON-DAUBIGNE, Serge PEY, Mathias LAIR, et David DUMORTIER - 25 janvier 2017
- Fil de lecture de Lucien WASSELIN : une éditeur et ses auteurs, LA PASSE DU VENT - 21 décembre 2016
- Rectificatif de Lucien Wasselin à propos d’une critique parue dans le numéro 168 : - 29 novembre 2016
- Fil de lecture de Lucien WASSELIN : Un éditeur et ses auteurs, les éditions ROUGERIE - 16 novembre 2016
- Anne MOSER & Jean-Louis BERNARD, Michèle DADOLLE & Chantal DUPUY-DUNIER - 30 octobre 2016
- Fils de Lecture de Lucien Wasselin : éditions des Deux Rives, J.POELS, A. HOLLAN, W.RENFER - 20 septembre 2016
- Fil de lecture de Lucien WASSELIN : ARFUYEN — SPIRITUALITÉ et POÉSIE. - 25 juin 2016
- Fil de Lecture de Lucien WASSELIN : sur Jeanine BAUDE - 15 mai 2016
- Fil de Lecture de Lucien WASSELIN - 3 avril 2016
- Questionnements politiques et poétiques 2 “Les Orphées du Danube” - 4 mars 2016
- FIL DE LECTURE de Lucien Wasselin : Baldacchino, Garnier, Grisel - 8 février 2016
- Fil de Lecture de Lucien Wasselin : Nouveautés de L’Herbe qui tremble - 7 janvier 2016
- Jacques VACHÉ : “Lettres de guerre, 1915–1918”. - 5 décembre 2015
- Eugène Durif : un essai provisoire ? - 1 décembre 2015
- Fil de lecture de Lucien Wasselin : Actualité des Hommes Sans Epaules Editions - 23 novembre 2015
- Fil de lecture de Lucien Wasselin : autour de la Belgique - 11 novembre 2015
- Fil de lecture de Lucien Wasselin : Le Castor Astral a quarante ans - 3 novembre 2015
- Phoenix n°18 - 3 novembre 2015
- Fil de Lecture de Lucien Wasselin : Luca/Pasolini/Siméon - 26 octobre 2015
- Pierre GARNIER : “Le Sable doux” - 26 octobre 2015
- Fil de Lecture de Lucien Wasselin sur : A.Costa Monteiro, G. Hons, C. Langlois, J. Roman - 8 octobre 2015
- INUITS DANS LA JUNGLE n° 6 - 21 septembre 2015
- Fil de lecture de L.Wasselin : Abeille, Althen, Walter - 14 septembre 2015
- Deux lectures de : Christophe Dauphin , Comme un cri d’os, Jacques Simonomis - 24 août 2015
- Fil de lectures de Marie Stoltz : Hennart, Laranco, Corbusier, Maxence, Bazy, Wasselin, Kijno - 11 juillet 2015
- Fil de lectures de Lucien Wasselin : Louis-Combet, Moulin et Loubert, Dunand, Marc, Audiberti - 5 juillet 2015
- Christian Monginot, Le miroir des solitudes - 22 juin 2015
- Jean Chatard, Clameurs du jour - 22 juin 2015
- Contre le simulacre. Enquête sur l’état de l’esprit poétique contemporain en France (3). Réponses de Lucien Wasselin - 21 juin 2015
- EUROPE n° 1033, dossier Claude Simon - 14 juin 2015
- Yves di Manno, Champs - 14 juin 2015
- Jeanpyer Poëls, Le sort est en jeu - 14 juin 2015
- Jean Dubuffet et Marcel Moreau, De l’art brut aux Beaux-Arts convulsifs, - 23 mai 2015
- Mathieu Bénézet, Premier crayon - 10 mai 2015
- ROGER DEXTRE ou L’EXPÉRIENCE POÉTIQUE - 10 mai 2015
- Jacques Pautard, Grand chœur vide des miroirs - 17 avril 2015
- Patrick Beurard-Valdoye, Gadjo-Migrandt - 29 mars 2015
- François Xavier, L’irréparable - 15 mars 2015
- Fernando Pessoa, Poèmes français - 1 mars 2015
- Paola Pigani, Indovina - 1 février 2015
- Michel Baglin, Dieu se moque des lèche-bottes - 1 février 2015
- Didier Guth & Sylvestre Clancier, Dans le noir & à travers les âges - 18 janvier 2015
- Jean-Baptiste Cabaud, Fleurs - 6 décembre 2014
- Sylvie Brès, Cœur troglodyte - 30 novembre 2014
- Sombre comme le temps, Emmanuel Moses - 16 novembre 2014
- Zéno Bianu, Visions de Bob Dylan - 9 novembre 2014
- Marwan Hoss, La Lumière du soir - 19 octobre 2014
- Michel Baglin, Loupés russes - 13 octobre 2014
- Abdellatif Laâbi, La Saison manquante - 13 octobre 2014
- Deux lectures de Max Alhau, Le temps au crible, par P. Leuckx et L. Wasselin - 30 septembre 2014
- Porfirio Mamani Macedo, Amour dans la parole - 30 septembre 2014
- Chroniques du ça et là n° 5 - 2 septembre 2014
- A contre-muraille, de Carole Carcillo Mesrobian - 25 mai 2014
- Hommage à Pierre Garnier - 6 février 2014
- Sous la robe des saisons de Philippe Mathy - 29 janvier 2014
- Sub Rosa de Muriel Verstichel - 20 janvier 2014
- Comment lire la poésie ? - 19 janvier 2014
- Au ressac, au ressaut de Roger Lesgards - 6 janvier 2014
- Sous la robe des saisons de Philippe Mathy - 31 décembre 2013
- L’instant des fantômes de Florence Valéro - 23 décembre 2013
- La proie des yeux de Joël-Claude Meffre - 27 novembre 2013
- Bestiaire minuscule de Jean-Claude Tardif - 19 novembre 2013
- Après le tremblement, de Jean Portante - 18 novembre 2013
- Aragon parle de Paul Eluard - 10 novembre 2013
- Facéties de Pierre Puttemans - 4 novembre 2013
- La tête dans un coquillage de Patrick Pérez-Sécheret - 26 octobre 2013
- À vol d’oiseaux, de Jacques Moulin - 22 octobre 2013
- Vaguedivague de Pablo Néruda - 16 octobre 2013
- Mare Nostrum - 4 octobre 2013
- Rudiments de lumière, de Pierre Dhainaut - 15 septembre 2013
- Et pendant ce temps-là, de Jean-Luc Steinmetz - 15 septembre 2013
- Mémoire de Chavée - 30 août 2013
- Marc Porcu, Ils ont deux ciels entre leurs mains - 12 août 2013
- La chemise de Pétrarque de Mathieu Bénézet - 12 août 2013
- NGC 224 de Ito Naga - 6 août 2013
- LES ILES RITSOS - 7 juillet 2013
- Les Sonnets de Shakespeare traduits par Darras - 30 juin 2013
- Séjour, là, de JL Massot - 7 juin 2013
- Archiviste du vent de P. Vincensini - 27 avril 2013
- Mots et chemins - 8 mars 2013
- Passager de l’incompris de R. Reutenauer - 2 mars 2013
- Tri, ce long tri - 15 février 2013