Alfredo COSTA MONTEIRO : “Dépli”.
Pierre Garnier rêvait d’une poésie qui ignorait les frontières et les langues… Ses poèmes spatialistes ont été publiés en France, en Allemagne, en Irlande, en Grande-Bretagne, en Espagne… C’est que sa poésie visuelle et ses nano-poèmes pouvaient facilement être compris du lecteur indépendamment de sa langue maternelle. Mais il ne faut pas oublier que le spatialisme (qu’il crée dans les années 60 du siècle dernier avec Ilse, son épouse) n’est qu’une partie du mouvement qui s’élève alors et dont la poésie phonétique ou sonore est une activité de première importance : faut-il rappeler les recherches d’un Henri Chopin ou d’un Bernard Heidsieck ? C’est dans cette dernière lignée que se situe lointainement (et à sa façon originale) Dépli d’Alfredo Costa Monteiro que publient les éditions Érès…
Dépli se présente comme un livret regroupant quatre leporellos imprimés recto-verso et un mini-CD. Chaque livre accordéon fait penser à une partition musicale par la disposition des mots (en “escalier”) sur le blanc de la page ; trois langues se succèdent ou se mêlent dans cet espace : le portugais, le français et l’espagnol. L’éditeur précise sur la 2ème de couverture que l’auteur “recourt [à ces trois langues] tout naturellement, comme si elles n’en formaient qu’une seule, paternelle et adoptive à la fois. Le texte se compose de bribes qui, agencées selon une combinatoire construite sur la sonorité des mots libèrent une multitude de signifiés inattendus”. On ne peut mieux dire et il faut lire l’intégralité de ce texte de présentation qui éclaire parfaitement la démarche du poète. Comme il faut écouter l’enregistrement (l’auteur dit son texte) pour sa musique particulière : les mots chantent, se répondent d’une langue à l’autre. À l’origine de ce jeu d’échos, les homophonies et allitérations. Il faut encore une fois laisser la parole à l’éditeur : “Poussé dans ses retranchements phonétiques, le langage semble d’abord perdre son sens. Mais bientôt, derrière ce qui se dit, se profile une autre langue, étrangement sonore — une langue inhérente à tout discours mais qui habituellement ne se manifeste pas, bâillonnée qu’elle est au nom du primat du sens”. Il est vrai que la proximité phonétique de ces trois langues (d’origine latine) aide… Mais c’est envoûtant.
Gaspard HONS : “Le bel automne” suivi de “La merveille du rien”.
Gaspard Hons s’intéresse aux choses de peu qui débouchent sur une vision de l’universel dans ce recueil composé de deux suites de poèmes en prose. La première, intitulée Le Bel automne, revêt une forme significative. Chaque poème est une prose courte (pas plus de quatre lignes) qui, si elle est ponctuée, ne commence jamais par une majuscule et ne se termine jamais par un point. Comme si chacune de ces proses était un fragment arraché à un ensemble plus vaste, non écrit, mais qui traverse l’esprit de Gaspard Hons. La prose finale donne une clef pour mieux lire ces poèmes : des chardons, un glacier, des hirondelles, une peinture de Philippe Guston, du rouge sur la table et trois châtaignes. On passera sur le côté “Inventaire” à la Prévert… À quoi il faudrait ajouter une branche de forsythia. Son texte montre bien l’universel atteint par la rencontre avec ces choses banales ; c’est celui de la page 23 ; “il s’éloigne des folles graminées…” C’est le paysage ordinaire d’un jardinier au travail mais rendu d’une façon qui confine au fantastique : “la brouette [est] appuyée contre l’horizon, le portail déborde de l’image, Maître Hokusaï regarde la montagne”. Tout est dit, toute glose devient inutile… Sauf à ajouter que les références à l’art (Hokusaï, Philippe Guston) permettraient de supposer (c’est du moins mon hypothèse) que l’art rend le réel visible, donc intelligible.
Dans la seconde suite, “La merveille du rien”, Gaspard Hons écrit ces mots contraires à la société dans laquelle nous vivons : “Nous ne possédons rien”. Ces mots s’inscrivent dans un village qui n’est pas nommé mais ne valent-ils pas “une poignée d’éternité” c’est à dire d’absolu ? Dès lors, ce qui se décline, c’est la vie, une vie à rebours des habitudes sociales. Dès lors, c’est la vie que dit Gspard Hons, une vie qui prélève au livre sa lumière, une vie qui est placée sous le signe du partage. Une vie qui se définit par ces termes : “la merveille me construit / Le rien me comble”. Alors ? Un dénuement cistercien ? C’est que Gaspard Hons tente de cerner une sorte de réalité éphémère, faite de pauvreté, y compris dans l’écriture…
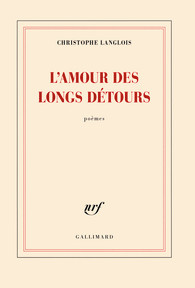
Christophe LANGLOIS : “L’amour des longs détours”.
Que les choses soient claires : je ne crois en aucun Dieu, ce dernier est une hypothèse dont je me passe, etc. Mais voilà, je n’ai pas oublié “La Rose et le Réséda” d’Aragon, “Celui qui croyait au ciel / Celui qui n’y croyait pas”… Aussi en lisant “L’amour des longs détours” de Christophe Langlois, ai-je été surpris par cette poésie à contre-courant de la vulgate ordinaire. C’est un livre de poèmes qui se tiennent à l’écart du temps syncopé et rapide que nous vivons et dont les thèmes sont divers : l’amour de Dieu (que le poète affirme avoir découvert à travers la figure du Christ ou de quelque chose qui lui ressemble : “innommé ce Nom, irrévélée sa Révélation”), l’enfance, la guerre de 14, la femme aimée, les hommes pour qui l’on éprouve de l’empathie, les choses simples, les questions que l’on se pose…
Christophe Langlois met en accord sa croyance et ses actes, ce n’est pas un menteur comme on rencontre trop souvent. Au prix, parfois, d’une langue contournée comme dans “Elle”. Il sait qu’il ne sait guère, d’où cette modestie : “Sur l’avenir des êtres / le bibliothécaire ne peut avoir / qu’un point de vue de poussière” (il sait de quoi il parle puisqu’il travaille dans le monde des livres). Et l’humaine condition (contre laquelle il faut lutter), c’est bien ce que dit ce distique : “après avoir désiré modifié l’univers / vous n’avez pas non plus changé les hommes”. Reste alors ce qui fait la dignité de l’homme, ici et maintenant, la révolution intérieure, certes pas plus facile que de changer le monde. À voir ses semblables (ses frères comme dit Langlois) qui refont continuellement les mêmes erreurs, on se dit que c’est difficile, voire impossible ; et pourtant ! Mais Langlois s’inscrit dans une tradition où la lutte est toujours à reprendre.
Si le vers est souvent ample, beaucoup plus long que l’alexandrin, si Christophe Langlois situe ses poèmes dans un monde où l’argent ne règne pas, un monde que nous pouvons partager, il y a, tant sur la forme que sur le fond, quelques remarques à faire. La ponctuation est souvent négligée, aléatoire : une virgule au milieu d’un vers (in “Le mouvement janvier”), deux points à fin d’un vers et une virgule au milieu d’un autre (in “Matière”) : c’est trop ou trop peu ! Ailleurs, elle est plus présente, mais pour autant le poème ne se termine pas par un point (in “If”)… Ailleurs encore, elle est totalement absente… Ce n’est pas sérieux. Quant au fond, deux choses… Christophe Langlois n’évite pas le culte de la personnalité, ainsi dans “Ma Rome” peut-on lire ces deux vers : “Dieu te fait demeure / il a les sourcils vieux et le regard jean-paul deux”… Et dans “Nos guerres”, le propos ne va pas sans obscurité ni naïveté pour le moins ; les ignorants (dont je suis) ne savent pas ce qu’est cette Nikolaï et l’idolâtrie à l’égard de l’Allemagne est insupportable car c’est ignorer les inégalités et les atteintes à la liberté dans l’Allemagne réunifiée.
Ces quelques reproches (parmi d’autres) sont suffisants pour m’empêcher d’adhérer totalement à ce livre malgré son ton élégiaque rare et bienvenu…
Jacques Roman : “J’irai cacher ma bouche dans ma gorge”.
C’est un livre énigmatique que celui de Jacques Roman. On hésite à l’ouvrir tant le titre sur la couverture fait rêver : “J’irai cacher ma bouche dans ma gorge”. On rêve, on pense, bien sûr, à “J’irai cracher sur vos tombes” de Vernon Sullivan/Boris Vian… On rêve, on rêve et l’on finit par l’ouvrir, ce livre, et l’on tombe sur une citation du grand Dylan Thomas. Si je me souviens de celle-ci : “J’avance dans un temps qui dure comme pour toujours”, je découvre cette autre qui donne son titre au recueil : “Reste immobile, dors dans l’accalmie, cache la bouche dans la gorge”. Le titre devient un vers qui est répété plusieurs fois (avec de légères variantes) dans ce qui n’est qu’un long poème entrecoupé de lettres adressées ‚par dessus le temps, à quelques poètes familiers, par Jacques Roman… ; ce qui retient l’attention du lecteur. D’où cette hypothèse en forme de question : à vouloir cacher sa bouche dans sa gorge, Jacques Roman se refuse-t-il à dire quelque chose qui le trahirait, ne veut-il pas renvoyer à l’impossibilité de dire ou à la volonté de ne pas dire ? Pourquoi alors le poème ?
Les occurrences relatives à la guerre sont nombreuses, ce qui pourrait expliquer ce refus de dire que semble signifier le titre : “Les mots alignés comme peloton / et combien de salves, combien de salves / l’auront réveillé” ou “Et je fouille dans une montagne de lunettes, / une montagne de souliers, / dans une collection d’abat-jour en peaux de garçonnets : / Jacob, Isaac, Samuel…” (on pense alors au génocide des Juifs organisé par les nazis) ou encore “la meute, la canaille tatouent la peau de ses enfants au bleu”. Comment comprendre ces indices ? Ce recueil est préfacé par Doris Jakubec qui ne donne pas de clef pour lire ce poème mais qui souligne dans un paragraphe, éclairant quelque peu le lecteur : “Deux mondes s’entremêlent sur un même fond de pudeur, de honte, de choses sans noms qui épouvantent, mais aussi de vouloir-vivre, de révolte, de besoin de voir, toucher, entendre et surtout de comprendre : celui du poète qui «empile ses mots pour construire son bûcher» et celui de l’enfant malmené, sensible et imaginatif, devenu poète, pour pouvoir dire, exprimer, détruire le silence qui mène à la mort. D’où la déclinaison du titre en je et tu, au présent et au futur, et dans tous les tons et registres, jusqu’à ce que soit conjuré le trop plein de la gorge”.
Conjurer le trop plein de la gorge serait alors dire, enfin. Et le poème le fait très bien sans rien dissimuler de la difficulté rencontrée… Qui explique peut-être la lecture incommode. Et l’on comprend mieux alors les vers de Bertolt Brecht “Dans les temps sombres / Est-ce qu’on chantera aussi / On y chantera aussi / La chanson des temps sombres” qu’on connaît aussi dans cette version, plus resserrée, plus percutante pourrait-on affirmer : “Au temps des ténèbres / Chantera-t-on encore ? / Oui, on chantera / Le chant des ténèbres”. Que ne revienne pas le temps des ténèbres, que persiste le temps des poètes malgré les menaces qui pèsent sur le monde ! Mais les poètes ne contribuent-ils pas, par leurs paroles, à tenir à distance les menaces, même si l’effort est toujours à reprendre.
- Le rôle de la documentation dans Les Communistes de Louis Aragon - 20 février 2022
- Julien Blaine, Carnets de voyages - 5 juillet 2021
- Eve Lerner, Partout et même dans les livres - 21 février 2021
- Revue Cabaret n° 29 et 30 - 5 janvier 2021
- Frédéric Tison, La Table d’attente - 5 janvier 2021
- Eve Lerner, Partout et même dans les livres - 6 octobre 2020
- Louis BERTHOLOM, Au milieu de tout - 6 juin 2020
- Christian Monginot, Après les jours, Véronique Wautier, Continuo, Fabien Abrassart, Si je t’oublie - 6 avril 2020
- Autour de Christine Girard, Louis Dubost et Jean-François Mathé - 6 mars 2020
- Stéphane Sangral, Des dalles posées sur rien, Pierre Dhainaut, Après - 26 février 2020
- Patrick LAUPIN, Le Rien qui précède - 21 janvier 2020
- Pierre Dhainaut, Transferts de souffles - 20 décembre 2019
- Jean MAISON, A‑Eden - 21 novembre 2019
- Jean ESPONDE, A la recherche de Lucy - 6 novembre 2019
- Edith Azam & Bernard Noël : Retours de langue - 14 octobre 2019
- Béatrice Libert, Battre l’immense - 25 septembre 2019
- Les Hommes Sans Epaules n° 47 (1° semestre 2019). - 15 septembre 2019
- Béatrice Marchal et Richard Rognet, Richard Jeffries, Olivier Domerg - 4 juin 2019
- Autour de Jean-Claude Leroy, Olivier Deschizeaux, Alain Breton - 29 mars 2019
- Fil autour de Claudine Bohi, Yann Dupont, Françoise Le Bouar, Didier Jourdren - 3 mars 2019
- François Xavier, Jean Grenier, Gilles Mentré - 3 janvier 2019
- Claire Audhuy, J’aurais préféré que nous fassions obscurité ensemble - 5 octobre 2018
- Trois écritures de femmes - 3 juin 2018
- Brigitte Gyr,Le vide notre demeure - 5 mai 2018
- Eugène Ostashevsky, Le Pirate Qui Ne Connaît Pas La Valeur De Pi - 5 mai 2018
- Actualité de La Rumeur Libre - 5 mai 2018
- Michel Dvorak, Vers le cœur lointain - 5 mai 2018
- Ainsi parlait THOREAU… - 6 avril 2018
- Nicolas VARGAS, EMOVERE - 6 avril 2018
- Patrice BÉGHAIN, Poètes à Lyon au 20e siècle - 6 avril 2018
- DIÉRÈSE n° 70 : Saluer la Beauté - 1 mars 2018
- Du Cloître à la Place publique - 1 mars 2018
- Serge Núñez Tolin La vie où vivre - 26 janvier 2018
- Jean-François Bory, Terminal Language - 26 janvier 2018
- Gérard Pfister, Ce que dit le Centaure - 26 janvier 2018
- Éric Chassefière, Le peu qui reste d’ici - 26 janvier 2018
- Éric Chassefière, La présence simple des choses - 26 janvier 2018
- Claude Albarède, Le Dehors Intime - 29 novembre 2017
- Stéphane Sangral, Circonvolutions - 27 novembre 2017
- Horia Badescu, Le poème va pieds nus - 27 novembre 2017
- Jeanpyer Poëls, Aïeul - 26 novembre 2017
- Alain Dantinne, Précis d’incertitude - 26 novembre 2017
- Gérard Bocholier, Les Étreintes Invisibles - 22 novembre 2017
- Marc Dugardin, Lettre en abyme - 19 octobre 2017
- Christian Viguié, Limites - 19 octobre 2017
- Geneviève Raphanel, Temps d’ici et de là-bas - 19 octobre 2017
- Eric Brogniet, Sahariennes suivi de Célébration de la lumière - 19 octobre 2017
- Laurent Albarracin, Cela - 7 octobre 2017
- Place de la Sorbonne n° 7 - 2 octobre 2017
- Chiendents n° 118, consacré à Marie-Josée CHRISTIEN - 30 septembre 2017
- Fil de lecture : autour des Éditions L’Herbe qui Tremble - 30 septembre 2017
- CHIENDENTS n° 109, consacré à Alain MARC. - 2 septembre 2017
- Fil de lecture autour d’Henri MESCHONNIC, de Rocio DURAN-BARBA, de Marianne WALTER et de Joyce LUSSU - 2 septembre 2017
- Tombeau de Jointure (100) - 31 mai 2017
- POSSIBLES, et INFINIE GÉO-LOCALISATION DU DOUTE n° 2 & 3 - 31 mai 2017
- La nouvelle poésie mexicaine - 24 mai 2017
- Fil de lecture de Lucien WASSELIN - 19 mai 2017
- Actualité éditoriale de Sylvestre Clancier - 30 avril 2017
- Un éditeur et ses auteurs : les Éditions Arfuyen, avec NOVALIS, Marie-Claire BANCQUART, Cécile A. HOLDBAN. - 24 avril 2017
- Diérèse 68 et 69 - 24 mars 2017
- Un éditeur et ses auteurs : L’HERBE QUI TREMBLE avec Isabelle Levesque, André Doms, Pierre Dhainaut, Horia Badescu, Christian Monginot. - 21 février 2017
- Fil de lecture autour de Michel DEGUY, Patricia COTTRON-DAUBIGNE, Serge PEY, Mathias LAIR, et David DUMORTIER - 25 janvier 2017
- Fil de lecture de Lucien WASSELIN : une éditeur et ses auteurs, LA PASSE DU VENT - 21 décembre 2016
- Rectificatif de Lucien Wasselin à propos d’une critique parue dans le numéro 168 : - 29 novembre 2016
- Fil de lecture de Lucien WASSELIN : Un éditeur et ses auteurs, les éditions ROUGERIE - 16 novembre 2016
- Anne MOSER & Jean-Louis BERNARD, Michèle DADOLLE & Chantal DUPUY-DUNIER - 30 octobre 2016
- Fils de Lecture de Lucien Wasselin : éditions des Deux Rives, J.POELS, A. HOLLAN, W.RENFER - 20 septembre 2016
- Fil de lecture de Lucien WASSELIN : ARFUYEN — SPIRITUALITÉ et POÉSIE. - 25 juin 2016
- Fil de Lecture de Lucien WASSELIN : sur Jeanine BAUDE - 15 mai 2016
- Fil de Lecture de Lucien WASSELIN - 3 avril 2016
- Questionnements politiques et poétiques 2 “Les Orphées du Danube” - 4 mars 2016
- FIL DE LECTURE de Lucien Wasselin : Baldacchino, Garnier, Grisel - 8 février 2016
- Fil de Lecture de Lucien Wasselin : Nouveautés de L’Herbe qui tremble - 7 janvier 2016
- Jacques VACHÉ : “Lettres de guerre, 1915–1918”. - 5 décembre 2015
- Eugène Durif : un essai provisoire ? - 1 décembre 2015
- Fil de lecture de Lucien Wasselin : Actualité des Hommes Sans Epaules Editions - 23 novembre 2015
- Fil de lecture de Lucien Wasselin : autour de la Belgique - 11 novembre 2015
- Fil de lecture de Lucien Wasselin : Le Castor Astral a quarante ans - 3 novembre 2015
- Phoenix n°18 - 3 novembre 2015
- Fil de Lecture de Lucien Wasselin : Luca/Pasolini/Siméon - 26 octobre 2015
- Pierre GARNIER : “Le Sable doux” - 26 octobre 2015
- Fil de Lecture de Lucien Wasselin sur : A.Costa Monteiro, G. Hons, C. Langlois, J. Roman - 8 octobre 2015
- INUITS DANS LA JUNGLE n° 6 - 21 septembre 2015
- Fil de lecture de L.Wasselin : Abeille, Althen, Walter - 14 septembre 2015
- Deux lectures de : Christophe Dauphin , Comme un cri d’os, Jacques Simonomis - 24 août 2015
- Fil de lectures de Marie Stoltz : Hennart, Laranco, Corbusier, Maxence, Bazy, Wasselin, Kijno - 11 juillet 2015
- Fil de lectures de Lucien Wasselin : Louis-Combet, Moulin et Loubert, Dunand, Marc, Audiberti - 5 juillet 2015
- Christian Monginot, Le miroir des solitudes - 22 juin 2015
- Jean Chatard, Clameurs du jour - 22 juin 2015
- Contre le simulacre. Enquête sur l’état de l’esprit poétique contemporain en France (3). Réponses de Lucien Wasselin - 21 juin 2015
- EUROPE n° 1033, dossier Claude Simon - 14 juin 2015
- Yves di Manno, Champs - 14 juin 2015
- Jeanpyer Poëls, Le sort est en jeu - 14 juin 2015
- Jean Dubuffet et Marcel Moreau, De l’art brut aux Beaux-Arts convulsifs, - 23 mai 2015
- Mathieu Bénézet, Premier crayon - 10 mai 2015
- ROGER DEXTRE ou L’EXPÉRIENCE POÉTIQUE - 10 mai 2015
- Jacques Pautard, Grand chœur vide des miroirs - 17 avril 2015
- Patrick Beurard-Valdoye, Gadjo-Migrandt - 29 mars 2015
- François Xavier, L’irréparable - 15 mars 2015
- Fernando Pessoa, Poèmes français - 1 mars 2015
- Paola Pigani, Indovina - 1 février 2015
- Michel Baglin, Dieu se moque des lèche-bottes - 1 février 2015
- Didier Guth & Sylvestre Clancier, Dans le noir & à travers les âges - 18 janvier 2015
- Jean-Baptiste Cabaud, Fleurs - 6 décembre 2014
- Sylvie Brès, Cœur troglodyte - 30 novembre 2014
- Sombre comme le temps, Emmanuel Moses - 16 novembre 2014
- Zéno Bianu, Visions de Bob Dylan - 9 novembre 2014
- Marwan Hoss, La Lumière du soir - 19 octobre 2014
- Michel Baglin, Loupés russes - 13 octobre 2014
- Abdellatif Laâbi, La Saison manquante - 13 octobre 2014
- Deux lectures de Max Alhau, Le temps au crible, par P. Leuckx et L. Wasselin - 30 septembre 2014
- Porfirio Mamani Macedo, Amour dans la parole - 30 septembre 2014
- Chroniques du ça et là n° 5 - 2 septembre 2014
- A contre-muraille, de Carole Carcillo Mesrobian - 25 mai 2014
- Hommage à Pierre Garnier - 6 février 2014
- Sous la robe des saisons de Philippe Mathy - 29 janvier 2014
- Sub Rosa de Muriel Verstichel - 20 janvier 2014
- Comment lire la poésie ? - 19 janvier 2014
- Au ressac, au ressaut de Roger Lesgards - 6 janvier 2014
- Sous la robe des saisons de Philippe Mathy - 31 décembre 2013
- L’instant des fantômes de Florence Valéro - 23 décembre 2013
- La proie des yeux de Joël-Claude Meffre - 27 novembre 2013
- Bestiaire minuscule de Jean-Claude Tardif - 19 novembre 2013
- Après le tremblement, de Jean Portante - 18 novembre 2013
- Aragon parle de Paul Eluard - 10 novembre 2013
- Facéties de Pierre Puttemans - 4 novembre 2013
- La tête dans un coquillage de Patrick Pérez-Sécheret - 26 octobre 2013
- À vol d’oiseaux, de Jacques Moulin - 22 octobre 2013
- Vaguedivague de Pablo Néruda - 16 octobre 2013
- Mare Nostrum - 4 octobre 2013
- Rudiments de lumière, de Pierre Dhainaut - 15 septembre 2013
- Et pendant ce temps-là, de Jean-Luc Steinmetz - 15 septembre 2013
- Mémoire de Chavée - 30 août 2013
- Marc Porcu, Ils ont deux ciels entre leurs mains - 12 août 2013
- La chemise de Pétrarque de Mathieu Bénézet - 12 août 2013
- NGC 224 de Ito Naga - 6 août 2013
- LES ILES RITSOS - 7 juillet 2013
- Les Sonnets de Shakespeare traduits par Darras - 30 juin 2013
- Séjour, là, de JL Massot - 7 juin 2013
- Archiviste du vent de P. Vincensini - 27 avril 2013
- Mots et chemins - 8 mars 2013
- Passager de l’incompris de R. Reutenauer - 2 mars 2013
- Tri, ce long tri - 15 février 2013
















