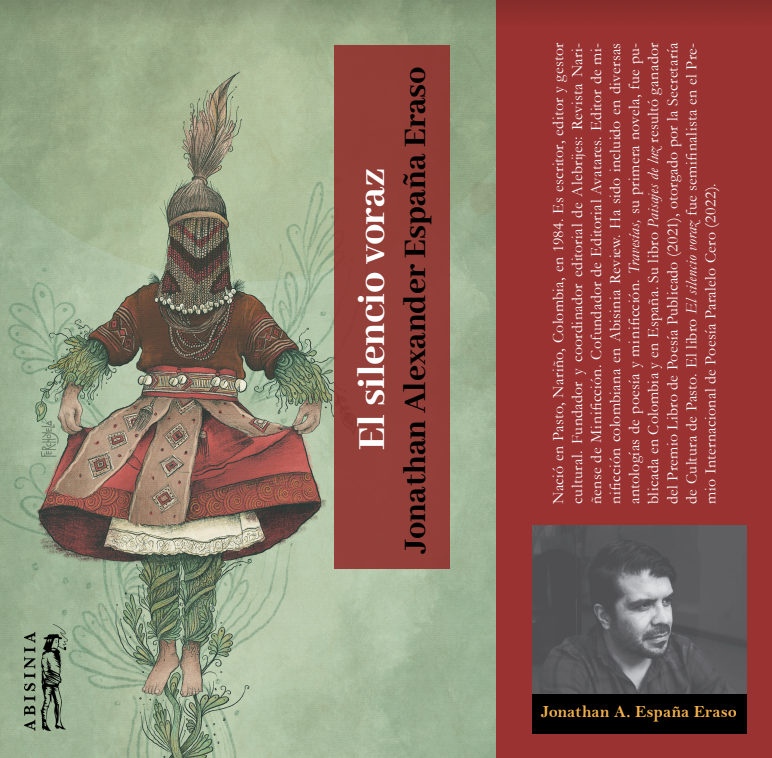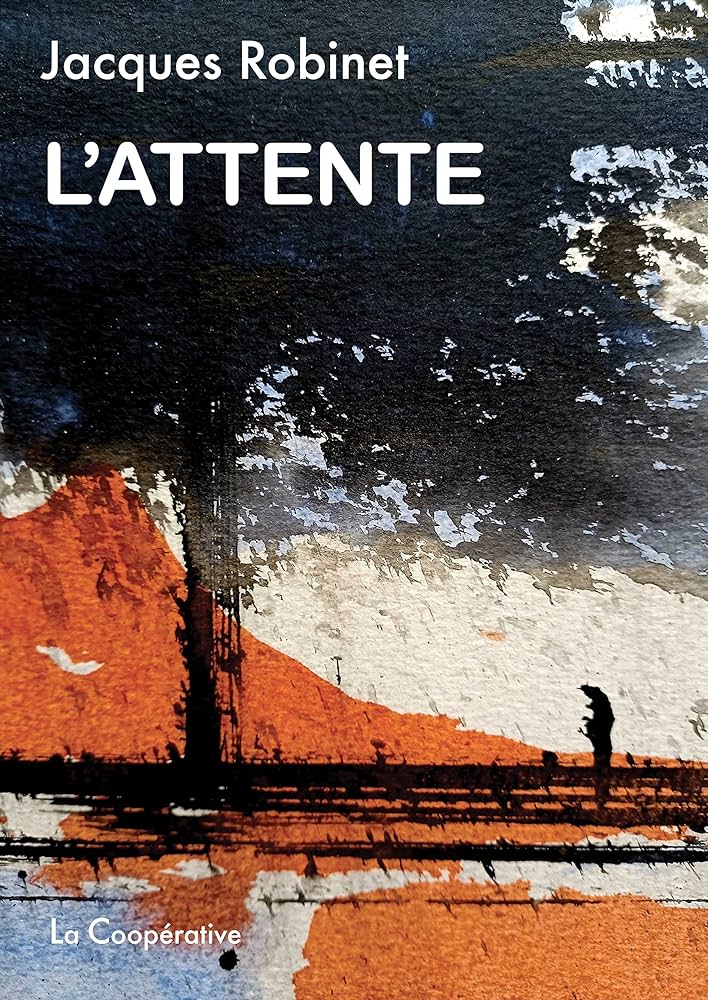Les critères permettant à un poète de franchir le cap de la reconnaissance publique, ou même simplement celle des experts, semblent plus aléatoires qu’irréfutables, et dépendent probablement davantage des phénomènes de mode que de la valeur « intrinsèque » des textes produits par les uns et les autres.
C’est ainsi que, si nous sommes quelques-uns à considérer Follain comme l’un des deux ou trois très « grands » du XXe siècle (avec Reverdy et Apollinaire), alors que la large majorité des « amateurs de poésie » le tiennent pour un poète de deuxième ordre, le cas de Georges-Louis Godeau est encore plus stupéfiant, je dirai même affligeant : presque personne ne le lit, son nom lui-même ne disant rien à la plupart des « connaisseurs » présumés.
Godeau est un cas. Il a publié, dans des conditions souvent peu valorisantes, peut-être à compte d’auteur (je n’ai jamais osé le lui demander), des poèmes d’une justesse, d’une fulgurance, d’une évidence poétique qui devrait en faire l’un des passages obligés de tout apprentissage de la poésie contemporaine.
C’est avec humour, singularité, finesse qu’il parle de ces « choses de la vie » que le public n’a aucun mal à discerner et apprécier au cinéma ou dans la fiction romanesque, mais qu’il semble ne pas percevoir, dès lors que ce sont de simples mots et des situations faussement « ordinaires » qui les délivrent en des textes courts, tableautins qu’on situerait volontiers entre les frères Le Nain et Daumier.
Quand on les donne à lire aux enfants normalement délurés et pas trop déformés par l’imbécillité ambiante, ils y adhèrent d’emblée. Mais la critique, pas plus que les directeurs de collections de l’édition nationale (à une ou deux exceptions près, dont le courageux Dé Bleu), n’a jamais daigné lui consacrer une étude digne de ce nom. Il fallut le bienveillant, perspicace et généreusement attentif Jacques Réda pour lui consacrer un fronton de la NRF.
Ainsi « les gens », si prompts à voir de la poésie partout (dans un parfum, un défilé de mode, une ânerie vociférée par des illettrés sans talent), semblent ne pas la voir quand elle crève les yeux, c’est-à-dire quand on sait lire.
Mais comment ne pas s’étonner de la cécité des « spécialistes » devant les écrits de ce leveur de lièvres capables de faire sortir de la poésie du chapeau de la vie ordinaire ?
Sans doute faut-il remarquer que Godeau ne fit aucun effort pour se faire « remarquer ». Bien qu’il ait publié sa première mince plaquette chez Gallimard, dans une collection dédiée à la « jeune poésie » d’alors (au début des années cinquante me semble-t-il), il ne trouva plus jamais preneur dans l’édition « prestigieuse » (Réda ni moi ne réussîmes à le faire apprécier par deux ou trois éditeurs de nos amis !). Et, sans doute du fait de cette insolente et stupéfiante négligence, il se replia sur sa solitude « littéraire », préférant les splendeurs amphibies du marais poitevin à l’angoissante atmosphère des bureaux d’édition.
Toujours est-il que, depuis sa maison de Magné, près de sa compagne, où il cultiva le retrait dans la dignité, il s’employa à glaner sans se presser ces poussières d’instants, qu’il transformait aussitôt en épiphanies, dont l’émotion était bien rarement absente.
Pour la santé de ses artères, peut-être aussi pour ne pas songer aux raisons qu’il aurait d’éprouver quelque rancœur à l’égard du si inattentif petit « monde des lettres », il sort de temps en temps avec son chien, prend sa voiture, salue au passage ces femmes à la poussette, ces hommes à la pelle ou au sac rempli de courrier à distribuer, qui tous trouveront place dans ses fulgurants tableaux de genre ; puis il va à pied s’enfoncer dans l’épaisseur odorante de son cher marais, pareil à une ombre furtive parmi toutes les ombres stagnantes que viennent trouer de ci de là le scintillement des feuilles de peupliers.
C’est dans ces moments, où il traverse le village, croise des fermes, rencontre des gens affairés ou vacants que, pour lui comme naguère pour Follain « tout fait événement », à moins que, comme pour Bachelard tout ne fasse émerveillement. Il relève les pièges à poésie qu’il a posés sur tout le territoire du vide charnu du monde, semblable à un de ces moines matérialistes et poètes du t’chan chinois, dont il partage la prédilection pour les brouillards d’automne et le goût salé de l’eau de pluie.
Là, cerné par l’eau de mer alliée à l’eau de terre, protégé de l’enlisement par ces îles mouvantes de terre toujours prête à se dérober, et qui met si fort l’attention à contribution, il se tient aux aguets, l’œil et l’oreille constamment prêts à saisir et reconnaître un signe ou un écho. Cette réalité végétale, minérale, climatique, élémentaire, il ne la connaît pas seulement pour avoir lu beaucoup de livres ; il la sait par cœur à cause de ce métier qu’il pratiqua près de quarante années durant : celui d’ingénieur des eaux et forêts et de spécialiste de la construction de châteaux d’eau.
Chez lui, la poésie a toujours coulé de source. A quoi bon des lacs artificiels dans un pays de rivières et de ruisseaux, d’étangs et de mares, de fondrières et de canaux tout pleins de nénuphars ?
Du fond de sa retraite, récemment interrompue par l’inéluctable rappel à l’ordre terrestre, il aura laissé les heures propices interrompre leur cours, savourant les rapides délices des plus beaux de ses jours. Il en vécut près de trente mille, de ces jours de jubilation lacustre.
(Godeau que personne n’attendit jamais. Octobre 2009)
© Eric Pistouley
choix de poèmes :
Jean Renaud
J’ai huit ans. Mon père est mort.
Le soir, à la maison, je suis seul, j’apprends mes leçons à voix haute en attendant ma mère.
Quand elle tarde, je prépare le feu, je dîne et je me couche.
Les yeux ouverts, j’écoute les bruits de la nuit.
Parfois, les voisins inquiets ouvrent la porte sur la pointe des pieds. Ils me prennent pour un enfant.
°°°°°
Dans cette maison
Dans cette maison pas plus mal qu’une autre, j’avais une femme, deux enfants, un chien et un tas d’ustensiles. La nuit, dans mon lit, je lisais Platon. Le jour, je travaillais, je courais et je buvais.Je n’étais pas heureux.
Pour changer la vie, un soir, je me suis sauvé avec ma valise. Le chien en est mort et les enfants sont devenus des hommes. Ils ont des tics qu’ils portent sans se plaindre. Je n’ei rien pour ma défense.
°°°°°
Dieu
Parfois quand j’ai pêché pour rien tout l’après-midi, je murmure sous ma visière : « Dieu, donne-moi un brochet ». En général, Dieu est ailleurs, ou il estime que les deux d’hier suffisent. Il sait que mon congélateur est plein, que je suis là avec deux bras, deux jambes en bon état et que dans ma musette j’ai des petits cigares qui fument bien. Et puis il est aussi le dieu des brochets. Alors il s’amuse à me voir lancer entre les arbres, les herbiers. Si je n’accroche pas, c’est peut-être encore lui. Car nous sommes complices, et les seuls à le savoir.
°°°°°
Le terrassier
Je travaille à la tâche. C’est mon droit de poser ma pioche, de dire aux camarades : « A demain, car je suis fatigué. »
Inquiets, ils se redresseront ; « C’est vrai, ça se voit que tu es fatigué. »
A mesure que le vent fouettera mon visage, sur la bicyclette, le souffle reviendra. Je casserai la croûte en arrivant. Assis à ma fenêtre, je fumerai la pipe en regardant tomber le jour, jusqu’au bout.
Ca doit être beau, un jour qui tombe.
(Premier et quatrième texte publiés chez Gallimard en 1962 ; les deux autres au Dé bleu, en 1988)