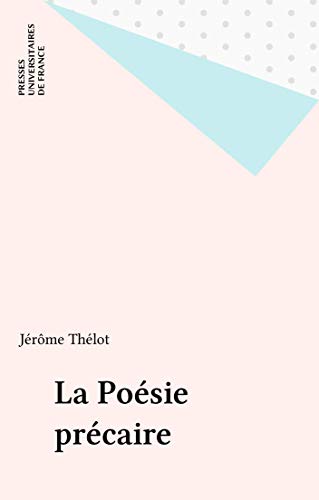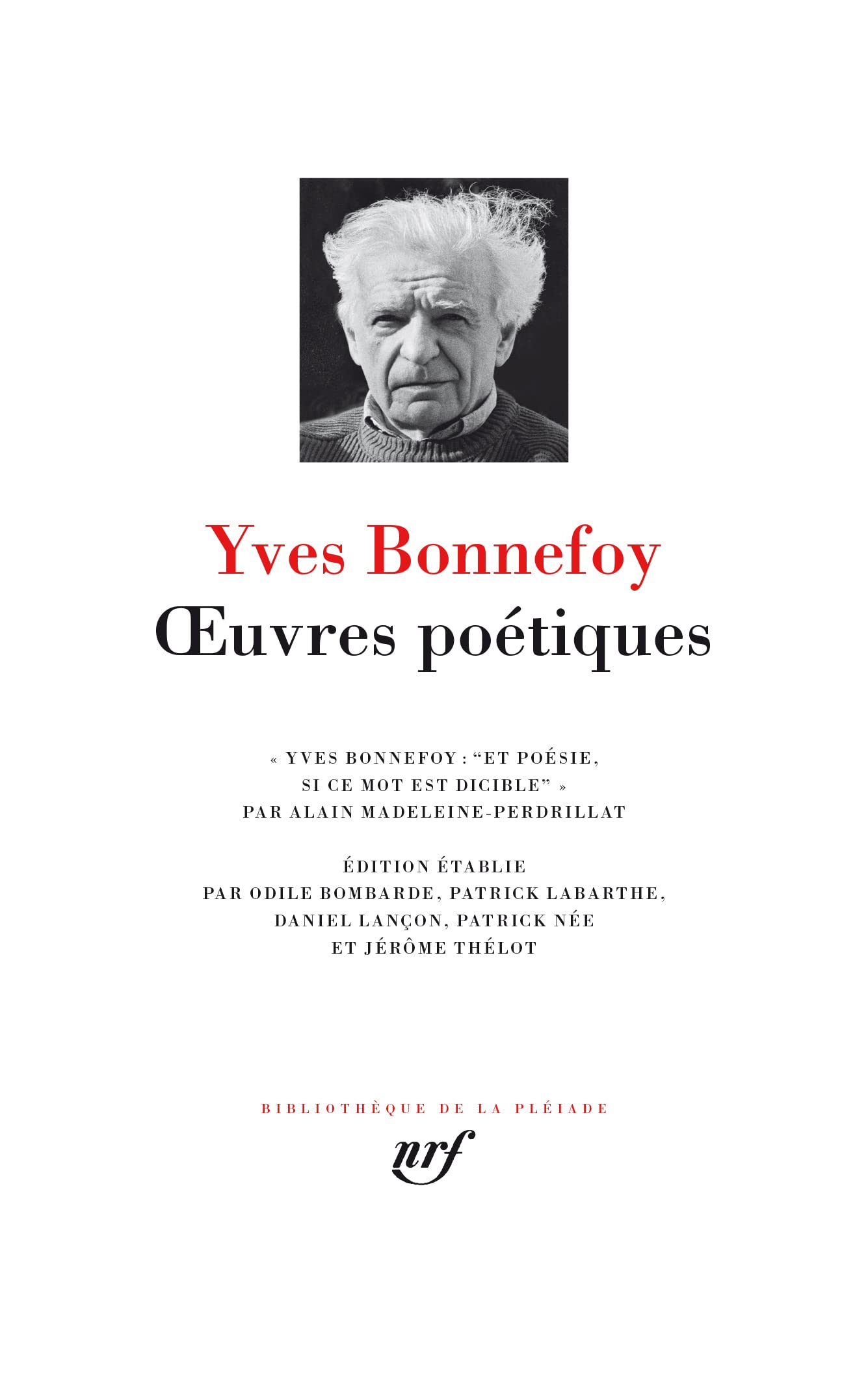Ce plan est un monde désert, certes, mais c’est tout de même un monde : et comme tel celui-ci est assez riche de ressources et d’abord de beauté pour encourager le poète à persévérer dans sa conviction fondamentale, qui est qu’à parler autrement, à laver les mots quotidiens de leur aliénation économique, l’amour pourra — comme disait Rimbaud — être réinventé, les énergies salvatrices pourront s’associer et le sens se reformer.
Et plus précisément chez Yves Bonnefoy, souvent qualifié de « gnostique ». Cette expression vous parait-elle juste le concernant ?
Non, elle est fausse et exprime un contre-sens. La « gnose », c’est d’une part la représentation selon laquelle le réel est une vallée de larmes, qu’ici-bas est un abîme de faute et de non-sens, et, d’autre part, l’idée qu’un Dieu caché, absent de ce monde, pourra répondre à la fine pointe de l’âme si celle-ci s’arrache enfin aux ténèbres du concret. La gnose est ce dualisme spéculatif auquel toute la pensée et l’expérience de Bonnefoy sont profondément contraires — lui qui aimait le réel, l’ici, qui adhérait de tout son être aux phénomènes sensibles et ne voyait aucun mal à la substance terrestre, à la nature telle qu’elle se donne, à la beauté de l’immanence. Seulement, c’est vrai qu’il a compris qu’à peine on prononce un mot, quoi qu’on dise, et c’est l’ordre tout entier du langage qui tend à se substituer aux choses pleines, à restreindre celles-ci à l’image qu’il en forme, et c’est du coup de l’irréel qui occupe la conscience, du factice, du chimérique qu’il a précisément appelé une « gnose ». Mais la poésie, c’est ce qui lutte contre cette chimère, contre cette abstraction préférée à ce qui est. La poésie ne veut pas l’irréalité, elle refuse que les présences concrètes soit dévaluées par les illusions du langage. Aussi est-elle selon Bonnefoy un combat incessant contre la dépréciation gnostique du monde, contre la fantasmagorie conceptuelle. Il s’agit donc, a‑t-il dit, d’« être parole malgré les mots » : d’être présent au monde, malgré les représentations. Un admirable essai sur cette dialectique est reproduit sous le titre « La poésie et la gnose » parmi ses Œuvres poétiques dans la collection de la Pléiade.
Vous dites aussi qu’Yves Bonnefoy « troue son œuvre par l’hypothèse d’un dieu à naître », et pourquoi pas un dieu mourant dont on pleure l’agonie, ou un dieu déjà mort ? N’y a‑t-il pas dans ce cas, une recherche impossible de la transcendance, comme principe « primordial », de l’élévation ?
Ces questions sont si grevées d’ambiguïtés qu’elles exigent des clarifications terminologiques. Au reste, c’est le rôle de la poésie de nous désencombrer des notions préconstruites et de l’usage convenu des mots. « Dieu », Bonnefoy n’a pas refusé d’en prononcer le nom. Par exemple, dans l’un de ses plus grands livres, Dans le leurre du seuil : « Tu peux nommer Dieu ce vase vide, / Dieu qui n’est pas, mais qui sauve le don, / Dieu sans regard mais dont les mains renouent. » Mais il s’agit là d’un nom désignant l’Unité de l’être quand celui-ci est rejoint en son absolu. Il ne s’agit donc pas d’une « élévation », mais, au contraire, d’une participation ici à l’être même du monde, d’une approbation réciproque du sujet et du réel tels qu’ils sont, dans leur finitude aimée. Ce « Dieu » n’est donc certes pas celui qui agonise ni celui qui est déjà mort : il n’a plus rien de sacrificiel, et il est toujours à recommencer par une pratique du langage qui dissipe les leurres de celui-ci, qui émancipe l’esprit des fictions idéologiques ou religieuses. Bonnefoy disait volontiers à la fin de sa vie : « La poésie, c’est ce qui reprend à la religion son bien ».
Le factice, le chimérique, que vous inventoriez si justement n’annoncent-ils pas finalement une société du désastre, qui n’aurait plus rien de spirituel ?
Que notre temps soit souvent ou même structurellement désastreux, Bonnefoy le dirait ou l’a dit en effet, comme l’avait dit Hölderlin prenant conscience du retrait des formes traditionnelles du sacré. Mais ce désastre est selon Bonnefoy l’une seulement des conséquences du langage, qu’il a mise en balance avec une autre, dont il convient aussi de tenir compte. La première conséquence du langage, c’est, nous venons de le dire, le déploiement du chimérique dans la conscience aliénée, c’est l’assujettissement de celle-ci à l’empire des concepts qui substituent aux réalités évidentes leurs exériorités partielles et fragmentées, et c’est donc la séparation de l’homme d’avec le monde réduit au rang d’objet exploitable — et tel est, de toujours, le « désastre ». Mais l’autre conséquence du langage est qu’il autorise un emploi des mots non pas pour leur seule valeur conceptuelle, mais aussi pour leur musique, et qu’il encourage que soit ranimée dans les vocables leur matérialité sonore : or celle-ci permettant aux mots de se réassocier à la matière du monde leur donne de se faire non pas des concepts mais des symboles, non pas seulement des représentations mais des participations unitives à la plénitude du sensible. Disons que le langage ne condamne pas la conscience à l’aliénation, il lui permet aussi d’inventer dans la langue une utopie qui la désencombre de ses illusions la rouvre à l’unité. En face du « désastre », se tient toujours le possible. Et le possible, c’est la réserve de sens inédit dont les mots sont porteurs quand ils sont rendus à leur musique native — à leur puissance poétique. Les sociétés contemporaines ne sont pas privées de ce que vous appelez le « spirituel », peut-être même ne sont-elles pas beaucoup plus abandonnées au désastre que les sociétés de jadis et de naguère : car elles disposent — par-delà toute croyance héritée et tout rêve d’arrière-monde — de l’esprit d’utopie dont le poète prend la responsabilité en ceci qu’il décide de parler autrement. Autrement que selon le savoir ; autrement que selon la nostalgie des métaphysiques épuisées ; autrement que selon le concept. C’est l’utopie en acte telle qu’elle se lève dans la musique verbale, dans la prosodie, dans les rythmes de la parole poétique, que d’inventer par ses symboles un nouvel être-au-monde qui émancipe l’humanité et lui donne un vrai lieu. Bonnefoy, en tout cas, n’a jamais cessé de revendiquer cette sorte de « foi » : non pas un catalogue de croyances adossées à des représentations douteuses et souvent désastreuses, mais, par le son des mots, la réinvention de l’homme nu, et la retrouvaille de chaque chose non comme objet mais comme visage.